Calvin et Loyola
DEUX RÉFORMES
par
André FAVRE-DORSAZ
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES
1951
ABRÉVIATIONS
A.
I DOCUMENTS
H. A. L. HERMINJARD, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, 9 volumes, Genève, 1866-1897.
OC. Les Œuvres complètes de Calvin, 59 tomes. – Joannis Calvini opera quae supersunt omnia, du Corpus Reformatorum, Brunswick-Berlin, 1863-1900.
II ÉTUDES SPÉCIALES
BORGEAUD Charles, Histoire de l’Université de Genève ; l’Académie de Calvin, Genève, 1900.
BUISSON Fernand, Sébastien Castellion, sa vie et son œuvre, 2 vol. Paris, 1892.
BULL. Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français.
CHOISY Eugène, La Théocratie à Genève au temps de Calvin, Genève, 1897. Calvin, Éducateur des Consciences, Neuilly, 1925.
Do. Émile Doumergue, Jean Calvin, les Hommes et les Choses de son temps, 7 vol. Lausanne-Paris, 1899-1927.
Le caractère de Calvin, 1931.
FAREL Guillaume Farel, par un groupe d’historiens, professeurs et pasteurs, Neuchâtel, 1930.
FEBVRE Lucien, Le problème de l’Incroyance au XVIe siècle, Paris, 1947.
Un destin, Martin Luther, Paris, 1945.
I. IMBART de la TOUR, Calvin et l’Institution chrétienne, t. IV, des Origines de la Réforme, Paris, 1935.
K. F.W. KAMPSCHULTE, Johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf, 2 vol., Leipzig, 1869-1899.
Lef. Abel LEFRANC, La jeunesse de Calvin, Paris, 1888.
Calvin à Noyon, dans « Foi et Vie », 1909.
NAEF Henri, Les Origines de la Réforme à Genève. Genève-Paris, 1936.
Pa. J. PANNIER, L’enfance et la jeunesse de Calvin, Toulouse, 1909.
Recherches sur la formation intellectuelle de Calvin, 1931.
Recherches sur l’évolution religieuse, 1924-1925.
(Dans la Revue d’hist. et de philosophie relig. de la fac. th. prot. de Strasbourg.)
Ro. Amédée ROGET, Histoire du peuple de Genève, 3 vol. Genève, 1870-1883.
VIENOT John, Histoire de la Réforme française, Paris, 1926.
VUILLEUMIER, H., Histoire de l’Église réformée au pays de Vaud, Lausanne, 1928, t. I.
We. François WENDEL, Calvin, Sources et évolution de sa pensée religieuse, Presses Universitaires, Paris, 1950.
WW. Williston WALKER, Jean Calvin, l’Homme et l’œuvre, Genève, 1909.
B.
I DOCUMENTS
MH. La collection des Monumenta Historica Societatis Jesu comprenant 70 volumes, publiée en partie à Madrid, en partie à Rome. Instrument de travail indispensable pour une étude sérieuse de la Compagnie et de son Fondateur. Nous ne désignons de ce sigle que les chroniques, p.e. MH. Chronicon, désignant le Chronicon de Polanco, 6 vol.
MI. Monumenta Ignatiana, contenant la correspondance et les écrits de Loyola, ainsi que les témoignages et documents de procès le concernant directement ; 20 volumes répartis en 4 séries. P.c. MI, I, II, 123 = première série des Monumenta Ignatiana, vol. II, p. 123.
Mon. Bobadilla : Désigne la correspondance et les écrits de Bobadilla, dans la même collection MH.
Mon. Broet-Rodriguez : désigne leurs écrits, ainsi que ceux de Codure, Lejay.
Mon. Fabri : désigne les documents de Pierre Le Fèvre.
Et ainsi de suite les
Mon. Lainii, Salmeron, Xaverii, Nadal, Borgia.
CANISIUS. Epistolae, Edit. Braunsberger, vol. I.
Ri. RIBADENEIRA Pierre, Vita Ignatii Loyolæ, citée suivant les divisions en chapitres de l’original, Naples, 1572.
Ex. Les Exercices, suivant la numérotation des « Monumenta » de 1919.
Pel. Récit du pèlerin, Confidences recueillies par Gonzalez de Camara (Memoriale) – cité d’après la numérotation de MI. 4, I. Traduit sous ce titre par E. Thibaut.
Constitutions désigne les « Contitutiones cum declarationibus » de saint Ignace, citées d’après les divisions de l’original.
II ÉTUDES SPÉCIALES
A. Antoine ASTRAIN, Historia de la Compania de Jesus, en la Asistencia de España, Madrid, 1902, I. vol.
Bro. James BRODRICK, Origines et Expansion des Jésuites, Paris, 1950, 2 vol.
Du. Paul DUDON, Saint Ignace de Loyola, Paris, 1934.
DUHR. Bernhard, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Freiburg-Regensburg, 1907, I vol.
Jesuiten-Fabeln, Freiburg-im Breisgau, 1904.
Hu. Antoine HUONDER, Ignatius von Loyola, Cologne, 1932.
Jesuitenlexikon, Ludwig KOCH, Paderborn, 1934.
Let. Pierre LETURIA, El Gentilhombre Inigo Lopez de Loyola es su patria y en su siglo, Barcelona, 1941.
La conversion de San Ignatio... dans « Archivum historicum Societatis Jesu », 1936.
Genesis de los Ejercicios, Ibid. 1941.
Przy. Erich PRZYWARA, Deus semper major, Eine Theologie der Exerzitien, Fribourg en B., 1940, 3 vol.
TACCHI. Pietro TACCHI VENTURI, Storia della Compagnia di Gesu. 2 vol., Roma, 1922, 1931.
INTRODUCTION
___________
1. Une réforme indispensable
À la lumière de ses lointaines conséquences, la Réforme peut nous apparaître, après coup, comme un crépuscule. Elle consacre, en effet, la ruine presque irréparable de l’unité chrétienne.
Mais pour ceux qui l’attendaient encore, ce changement promettait une aurore libératrice. On ne saurait surestimer la puissance de cet élan. Ce fut la dernière mystique collective de la chrétienté. Vit-on jamais l’idéalisme et la foi des hommes tendre avec un pareil ensemble vers un monde meilleur ? Sans doute les institutions donnaient l’impression d’une décadence générale. Mais si l’on a pu réussir la gageure de nous montrer « la religiosité et la foi profonde » des créateurs du monde moderne, de Rabelais à Descartes [1], combien plus sûrement pourra-t-on affirmer que le XVe siècle et le XVIe commençant ont été des époques intensément chrétiennes.
À la longue cette mystique de la réforme fut abreuvée de tant de déceptions que, pareille à un grand amour blessé, elle tourne à la maladie, à la passion haineuse. Mais ce ne sera qu’après avoir réclamé, trop longtemps en vain, le rétablissement d’une chrétienté qui fût vraiment chrétienne, d’une hiérarchie vraiment ordonnée et sainte, d’une Église guérie dans sa tête et dans ses membres. Plus les peuples se montrent exigeants, plus les responsables se dérobent. Grande est la pitié des âmes souvent abandonnées à leur seule bonne volonté depuis l’exil d’Avignon et le Grand Schisme. Quels hommes providentiels mettront enfin un terme au désarroi des institutions ecclésiastiques, à l’impuissance de la hiérarchie entraînée dans le glissement général de la société ?
Les relations sociales, économiques et politiques se modifient profondément. Peu à peu le monde laïque accède à la majorité. Comment va réagir le sentiment religieux alors mêlé à toutes les manifestations de la vie, aux travaux des métiers et des champs, aux arts et aux sciences, au jeu de la diplomatie et des affaires ? Le souci spirituel marque les discussions les plus profanes, les activités des corporations, les doléances de quiconque réalisait la crise de la société chrétienne. Le mythe de cette époque, ce fut justement cette attente inouïe d’une guérison rapide et quasi instantanée de la lente maladie des siècles.
On avait cependant eu le loisir de se familiariser avec l’anarchie. Et si les scandales fleurissaient au grand jour, les saints et les mystiques ne les dénonçaient-ils pas depuis le fond du moyen âge [2] ? La critique des abus dont la cour romaine, le clergé et les moines donnent le spectacle est un art qui remonte « dans la nuit des temps ». Depuis que Joachim de Flore, au XIIe siècle alarmait la conscience chrétienne, bien d’autres visionnaires, fraticelles, béguines, mendiants, se recommandent du même esprit pour accuser l’antithèse croissante entre la pauvreté évangélique et l’inextricable système des bénéfices et du pouvoir temporel. Le moine poète qui écrit la Bible de Guiot de Provins ne s’en prend pas moins à l’autorité pontificale que le premier des lyriques allemands, Walter von der Vogelweide. Au tournant du XIIe siècle, ce dernier inaugure une argumentation mystique dont se serviront volontiers les réformateurs du XVIe, traitant le pape d’Antéchrist et les clercs de suppôts de l’Antéchrist. Avec un regard plus indigné peut-être que les hommes de la Renaissance, le réformateur de Clairvaux considérait « le successeur de Pierre orné de soieries et de pierres précieuses, couvert d’or, porté par une blanche haquenée, escorté de gendarmes, entouré de ministres bruyants, comme un successeur de Constantin [3] ». L’écho de la protestation véhémente des foules exaltées des Cathares, des Albigeois, des Vaudois, se répercute indéfiniment dans l’âme populaire, par l’art des imagiers, par les chansons, par le théâtre religieux et comique, par les romans. Les différents pays ont entendu répéter le procès de la puissance temporelle de l’Église, par des voix sinon autorisées, du moins retentissantes. Arnauld de Brescia, Marsile de Padoue, Occam et Dante lui-même, avec sa lourde plainte de la Divine Comédie et de la Monarchia, jettent le discrédit sur les ambitions romaines. Que sera-ce lorsque les attaques puissantes du prophète et martyr florentin, les audaces de Wiclef et de Jean Hus prendront corps, au centre de l’Europe, dans de véritables mouvements de masses ; quand l’imprimerie et la gravure permettront de diffuser indéfiniment et de répéter sous toutes ses formes le parallèle accablant entre la vie du Christ pauvre, humble, sacrifié, et la conduite mondaine des chefs de l’Église.
Immense fut le retentissement des charges bien calculées, telles que l’Onus Ecclesiae ou le « Miroir de toute la chrétienté », dont semblent s’inspirer non seulement Luther, Castellion et leur entourage, mais encore les écrits de la Contre-Réforme. Les grandes houles populaires déjà remuées aux quatre coins de l’Europe par d’innombrables idéalistes, plus ou moins orthodoxes, joachimites, frères de la croix, frères apostoliques, frères et sœurs du libre esprit, flagellants, lollards, franciscains, vont obéir à une opinion publique dirigée par les plus adroits des pamphlétaires et des caricaturistes. Lorsque les humanistes s’en mêlent enfin avec l’Éloge de la Folie d’Érasme, ou bien, à l’occasion de l’affaire Reuchlin, avec les Épîtres des hommes obscurs, lorsque le chevalier Hutten déverse contre la curie romaine toute l’animosité qu’il nourrit contre les Welches en général, on peut dire que la crise, de latente et d’universelle qu’elle était, est en passe de devenir nationale et agressive [4]. D’un mot, Michel Bureau, caractérisait bien l’état des esprits, en 1496 : « De notre temps, le mot de réforme a si bien sonné aux oreilles populaires que, quand vous parlez avec quelque homme que ce soit, ce sujet revient plus fréquemment dans les discours. »
Les politiciens ne demandent pas mieux que d’intervenir. Combien de princes seraient disposés à s’affranchir, comme le roi de France, par une Pragmatique Sanction ou un Concordat, qui leur permette de partager avec Rome l’exploitation des biens d’Église. Le souci de l’ordre et du bien commun, le zèle des âmes et les intérêts de la religion, tous les prétextes les plus louables poussent les autorités laïques à prendre des responsabilités sur le plan spirituel, pour parer à la carence de la hiérarchie embourbée dans les affaires de ce monde. La symptomatique « Réforme de l’empereur Sigismond » témoigne de ces tendances à la séparation radicale du temporel et du spirituel, difficiles à refouler depuis les conciles de Bâle et de Constance.
À l’enseigne de la réforme les novateurs du XVIe siècle furent naturellement accueillis comme des prophètes. « Il ne faut pas croire, observait Bossuet, que les hérésies aient toujours pour auteurs des impies ou des libertins qui, de propos délibéré, fassent servir la religion à leurs passions. Saint Grégoire de Nazianze ne nous représente pas les hérésiarques comme des hommes sans religion, mais comme des hommes qui prennent la religion de travers : « Ce sont, dit-il, de grands esprits, car les âmes faibles sont également inutiles pour le bien et pour le mal. Mais ces grands esprits, poursuit-il, sont en même temps des esprits ardents et impétueux, qui prennent la religion avec une ardeur démesurée. »
Trop d’hommes d’Église, en revanche, manquaient à cette époque du minimum d’ardeur qu’on était en droit d’attendre d’eux. Une réforme s’imposait « dans la tête et dans les membres ». Et encore par cet euphémisme entendait-on suggérer que la chrétienté avait surtout mal à la tête. Un diagnostic plus clairvoyant décelait bien parfois qu’elle souffrait encore davantage du cœur et que son âme en détresse devait être traitée avec les attentions les plus délicates. Mais la bonne volonté du grand nombre ne sait plus s’exprimer que par la violence. La modération des hommes de Dieu qui empêchèrent que l’amour ne se refroidît encore dans le monde, ne fut guère imitée. On avait hâte d’obtenir une transformation de la structure administrative de l’Église et une épuration précipitée des habitudes extérieures du culte. Bien plus, la révolte qui supprime indistinctement les abus et les trésors du passé, loin d’être ressentie comme une faute, prend souvent les allures du courage, qui, vite contagieux, dicte à d’autres pour se justifier, le même devoir d’émancipation. Les agitateurs les plus révolutionnaires ne quittent l’Église qu’après en avoir été chassés. Calvin lui-même est tellement sûr d’être resté dans la véritable Église que toute sa dialectique s’évertue à démontrer l’hérésie et le schisme de ses adversaires. Avant comme après sa venue, le peuple de Genève ne s’achemine que graduellement et sans intention d’apostasie, vers l’idéale « Institution chrétienne ».
L’attachement aux chefs ecclésiastiques s’était bien relâché depuis qu’on avait vu se dresser les uns contre les autres les papes et les antipapes, le concile et la hiérarchie, les rois et les souverains des États pontificaux ; depuis qu’à Rome le népotisme s’était peu à peu érigé en système de gouvernement. La grande crise de confiance qui avait déjà permis l’abandon de la chrétienté orientale à l’Islam, empirait encore au spectacle du train de vie que menait la cour romaine, étalant parfois un luxe païen et une luxure « babylonienne ». Les spéculations du Saint-Siège avec les grandes banques, avec les Doria, les Médicis et les Fugger, le marchandage des indulgences, se soldent par un grave déficit pour la conscience chrétienne, choquée sans cesse par la rapacité financière d’une bureaucratie avide de taxes, de décimes, de procurations, de subsides curatifs, d’annates, d’expectatives, de droit de dépouilles, de commende...
D’un côté, le peuple chrétien abandonné à lui-même, a pris l’habitude, malgré l’Inquisition, de se passer de directives ou de les ignorer. D’autre part, l’autorité religieuse tourne à vide, prisonnière de sa routine, s’illusionnant de faire face, avec des expédients, avec des négociations diplomatiques, avec des concordats et des diètes, bref avec des compromis, à la perte de l’estime et du respect, à la sourde colère qui gronde çà et là dans l’élite même de la chrétienté. Avec les familles des Borgia, des Rovere, des Médicis, des ébauches de dynasties pontificales se dessinent en vue d’accaparer le pouvoir et la fiscalité du Saint-Siège. Dilettantes, ambitieux ou même licencieux, des pontifes sans âme devaient faire douter de la sincérité de leurs convictions religieuses. L’Église allait-elle se transformer en une immense société commerciale où tout serait l’objet de trafic et de troc : l’élection papale, les nominations des évêques et des supérieurs religieux sans vocation, les honneurs, les dispenses, les privilèges, les « pardons », les messes, les reliques, les biens spirituels de tout ordre ?
Déjà menacée par le retour en force de la culture païenne renaissante, la foi est soumise à une rude épreuve. Quand surgissent les conflits les plus graves de la conscience chrétienne, les questions du salut, de la grâce, de la révélation, ces problèmes sont traités à la légère, confiés à des théologiens de métier qui débitent des formules et des abstractions. En face de l’humanisme contemporain, l’insuffisante formation du clergé tant séculier que régulier est désastreuse. Il nous est difficile de nous représenter le choc produit dans les esprits du XVe siècle par la diffusion, grâce à l’imprimerie, des premières sources chrétiennes. La Bible manuscrite avait été extrêmement rare. De l’Écriture, le simple fidèle connaissait les passages classiques tissés dans le magnifique jeu de la liturgie et des arts religieux. Mais quelle sensation, le jour où quelqu’un prend directement contact avec la parole de Dieu, avec la réalité concrète de la Bible ! Quel contraste frappe le lecteur des Actes des Apôtres entre la chrétienté primitive et celle de Sixte IV, d’Alexandre VI, de Jules II et de Léon X... Les fautes les plus graves de la hiérarchie doivent peut-être se situer dans ce domaine : la négligence du message authentique, l’insouciance à l’égard d’études bibliques qui se poursuivent malgré elle, à Oxford, à Paris, à Bâle, à Alcala. L’intérêt superficiel témoigné aux initiatives particulières de Reuchlin, d’Érasme, de Lefèvre, de Jimenès ressemblait trop à une attitude conventionnelle. Publiée d’abord par des catholiques, la Bible ne fut pas utilisée par le grand public catholique, mais bien par celui de la Réforme. Le sentiment religieux que la pauvreté doctrinale du clergé laisse sur sa faim, se rabat sur des aliments de fortune : dévotions bigarrées, course aux pratiques et aux croyances parfois superstitieuses. Si Farel peut dire, en exagérant sans doute un peu, que de tous les curés qu’il avait rencontrés dans le pays de Vaud, il n’y en avait pas un qui sût lui réciter les dix commandements de Dieu, il est probable que les idées religieuses des fidèles étaient à l’avenant [5].
À défaut de substance spirituelle, prélats, moines et clercs recherchent avec d’autant plus d’avidité les nourritures terrestres. Provoqué ou suivi par la diminution de la foi, le dérèglement des mœurs ne vient pas d’en bas, comme on pourrait s’y attendre. En corrompant les gardiens attitrés de la morale, et cela dans une progression qui monte avec le degré de dignités, c’est-à-dire en fonction du cumul des bénéfices, la cupidité ecclésiastique appelait de grands remèdes et de dures réactions. Elle explique la sévérité de tous les saints de cette époque sur le chapitre de la pauvreté évangélique, et de l’autre, le laïcisme réformé. Parmi les plaisanteries les plus usées et les plus caractéristiques de cette situation anormale, notons le reproche des Bernois à leur évêque de Lausanne, « pasteur plus préoccupé de tondre que de paître les brebis du Christ ». Il est courant de dire que les pasteurs ecclésiastiques rongent, pillent les pauvres brebis qu’ils écorchent et dont ils sucent la moelle. Fréquemment, en effet, les hommes d’Église, tels l’évêque et les chanoines de Lausanne, abusent de leur autorité spirituelle pour dépouiller leurs sujets, en frappant de la mauvaise monnaie, en altérant à leur profit les testaments qu’ils se chargent d’instrumenter, en s’appropriant des donations pies destinées à des œuvres charitables, allant même « jusqu’à convertir leurs maisons en lieux de débauche [6] ». Sur ces clercs et leurs « ribaudes », sur les moines et leurs désordres, tout a été dit et avec mille hyperboles par les polémistes de l’époque. Mais on ne saurait guère dépasser en sévérité le cardinal Contarini écrivant que « dans les principales cités italiennes, le relâchement des mœurs a atteint un tel point que la plupart des couvents sont convertis en mauvais lieux [7] ».
La chrétienté était lasse de tant de déchéance chez ceux-là même qui auraient dû la conduire vers les hauteurs. Les luttes incessantes entre les princes et la papauté, entre les seigneurs ecclésiastiques et les villes, entre les séculiers et les réguliers, détournaient de la hiérarchie les esprits les plus sérieux. Les malheurs publics, comme la peste, ou le sac de Rome en 1527, sont ressentis avec une sorte de satisfaction par bien des gens, comme un châtiment du ciel pour les « grans péchez contre nature, énormes, régnant à Rome [8] ». Le clergé a définitivement perdu son prestige et le monopole du savoir. Ce sont surtout des théologiens laïques qui orientent la pensée religieuse de cette révolution spirituelle. Lefèvre, Érasme, Farel, Melanchthon, Calvin créent une nouvelle forme de christianisme « purement évangélique », tandis que, indifférents, dirait-on, au mouvement de l’Église, les « vicaires du Christ », avec l’art gigantesque de Bramante, de Michel-Ange et de Raphaël, s’appliquent à ressusciter le paganisme. L’humanisme chrétien tourne ses regards inquiets vers le « Cénacle de Meaux » à l’heure où la cour de Jules II et de Léon X ne semble plus se souvenir que de l’Olympe.
Mais soudain la terre trembla. Luther lui-même fut sans doute étonné de l’ampleur de la révolution qu’il avait mise en marche. Mais une fois le cataclysme déchaîné, il ne sut plus très bien où il allait, porté qu’il était par un mouvement qu’aucun homme n’était plus capable de maîtriser. La première phase de la Réforme aboutit au chaos.
Alors un surhomme, une sorte de génie prophétique apparut, capable non seulement de tenir tête à cet effondrement d’un monde, mais encore de reconstruire, de toutes pièces, une chrétienté nouvelle : Calvin. Il surgit à la seconde génération de la Réforme, avec un recul suffisant pour tout embrasser du regard et mesurer exactement les possibilités uniques d’une refonte complète des institutions. Il a l’ambition de donner à sa réforme toute l’universalité et toute la perfection intransigeante de la foi. La réussite de Calvin est un phénomène sans équivalent dans l’histoire. Les autres efforts de réforme, les plus nobles et les plus saints, ceux de Benoît et de Grégoire le Grand, ceux de Grégoire VII, de François et d’Innocent III, travaillent un monde passif et docile, et ne s’attaquent pas à une rénovation de structure de l’Église. Depuis le XVIe siècle, toutes les transformations tentées demeurent sporadiques. Mais alors tout le monde, et surtout Calvin, vise le bien général de la chrétienté. On pense encore en catholique en détruisant l’unité catholique.
Établie sur une base monacale, l’entreprise de Loyola reste attachée, malgré elle, à des cadres moyenâgeux. Elle n’a pu alléger la tradition de tout son feuillage mort. L’ombre du curialisme romain recouvre cette réforme limitée au dehors par le bon plaisir du pape, et au dedans, par les méthodes recherchées et les procédés minutieux de l’ascèse. Loyola mobilise tous les esprits et spécialement les élites : sa systématisation de la vie intérieure et son attachement à l’autorité épaulent puissamment la hiérarchie chancelante. Mais au lieu d’étayer une construction vieillie, ne valait-il pas mieux rebâtir solidement et tout à neuf ?
Calvin du moins s’y est appliqué énergiquement. Il a voulu obtenir une décision rapide. L’ère des palliatifs et des demi-mesures est révolue à ses yeux. Il est résolu à aller au fond des choses et à soumettre à la règle évangélique toutes les formes de la vie individuelle et sociale. Plus de considérations humaines, plus de timidité respectueuse des préséances, plus de ménagement, ni de casuistique : un même christianisme pour tous et pour chacun, une même perfection de la foi et des mœurs exigée sérieusement de toutes les classes, et obtenue par les moyens les plus simples, les plus obvies. Réforme personnelle et collective tout à la fois, qui se veut austère et pure aussi bien des illusions mystiques que des artifices humanisants. En ramenant tout à la parole de Dieu, à la vocation, à la foi, Calvin refait l’éducation d’une conscience moderne, responsable et croyante. Souverainement indépendant de toutes les formalités et de toutes les concessions, le puritanisme qu’il inspira se dresse devant nous avec une netteté et un relief extraordinaires.
Peut-on décemment lui opposer le psychologisme et le conformisme de Loyola, son dévouement absolu à la cause d’une autorité sérieusement compromise, son indulgente soumission à une curie tombée dans le discrédit ? Où est le progrès et où est la réaction ? Y a-t-il quelque rapprochement possible entre ces deux mentalités ? À l’extrême droite, le défenseur du passé, d’un état de choses périmé, dont toute la légitimité semble reposer sur le fait qu’il est l’ordre établi. À l’extrême gauche le rénovateur de la religion et de la morale, soucieux de réformer tous les domaines de l’enseignement, de la culture, de la vie publique et privée et jusqu’au monde des affaires et de la finance.
La réforme de Calvin ne peut-elle prétendre, à bon droit, incarner le christianisme le plus neuf et le plus efficace ? Le titre d’ancienneté d’ailleurs ne lui revient pas moins, semble-t-il, puisqu’elle s’alimente exclusivement aux sources les plus sûres, les plus authentiques de la révélation ? Voilà bien des objectifs dignes de notre admiration. Furent-ils atteints et comment ? Toutes les étapes et l’aboutissement de cette destinée surhumaine méritent-ils une estime inconditionnée ?
« Au moment où l’on enseigne à de futurs théologiens le calvinisme, comme le pur Évangile du Christ, irons-nous protester avec M. le pasteur Jean Schorer de Genève : le calvinisme ne peut pas être et n’est pas le christianisme [9] ! » Il est d’ores et déjà probable que Calvin n’est pas un personnage « tellement sacré qu’il ne puisse être permis de le juger librement ». Loyola non plus d’ailleurs. Mais plutôt que de juger, ce livre voudrait surtout comprendre.
2. La Méthode et les Sources
________
Le parallèle Calvin-Loyola est fréquemment évoqué, non seulement par les journalistes et les amateurs de synthèse rapide, mais tout autant par les théologiens et les historiens de métier. Ces comparaisons sont généralement hâtives et superficielles. On se contente, de part et d’autre, de se relancer par-dessus la barrière confessionnelle les mêmes préventions et les jugements sommaires fidèlement transmis et répétés par la propagande religieuse [10]. Sur chacun de ces deux hommes, les études les plus soigneuses ont été entreprises avec une abondance et un luxe d’érudition qui semblerait devoir simplifier un travail de psychologie et de théologie comparées. Mais, pour que le rapprochement de physionomies aussi opposées soit éclairant, il faut avoir le courage de les examiner avec attention, longuement, et si possible même avec sympathie. Que cela ne soit pas facile, Renan nous le dit brutalement : « Je ne sais si l’on trouverait un type plus complet de l’ambitieux, jaloux de faire dominer sa pensée parce qu’il la croit vraie. Tout est sacrifié à l’envie de former les autres à son image. Je ne vois guère qu’Ignace de Loyola qui puisse lui disputer la palme de ces terribles emportements... » Mille autres témoignages prouveraient aisément que Calvin et Loyola ne laissent indifférents que ceux qui les ignorent. Personnages de légende cruelle, dressés en fantômes par le sabbat de la polémique, ils ne cessent d’inspirer des passions partisanes, dans lesquelles l’élément agressif et rancunier joue souvent un plus grand rôle que l’enthousiasme pour les héros eux-mêmes.
Dans son Épître au Roi de France, Calvin proclamait un principe admirable : « Dieu n’est point Dieu de division, mais Dieu de paix [11]. » L’idéal, hélas, est d’ordinaire bien loin de la réalité... Le chancelier de l’Hospital aux États de Fontainebleau le comprenait d’une manière plus pratique : « Notre Dieu est Dieu de paix, non de division... À tous ces mots diaboliques, factions, séditions, luthériens, huguenots, papistes, substituons le beau nom de chrétiens [12]. » Tel est aussi le point de vue que nous voudrions observer au cours de ces études, afin de sauvegarder autant que possible notre indépendance et le sens de la vérité objective. Loyola nous semble avoir tracé en tête des « Exercices » une méthode de recherche qui garantit une compréhension bienveillante, sans pour autant sacrifier aux compromis ou à la confusion des tendances. « Il faut présupposer que tout chrétien doit être plus prompt à sauver l’opinion du prochain qu’à la condamner. Et s’il ne peut la défendre qu’il cherche à savoir comment le prochain la comprend. Et s’il pense qu’il l’entend mal, qu’il le rectifie avec bienveillance. Et si cela ne suffit pas, qu’il cherche tous les moyens convenables pour la bien comprendre et la justifier [13]. »
Ainsi nous nous bornerons à étudier Calvin à travers sa correspondance et ses œuvres, en nous aidant presque exclusivement de travaux d’historiens « réformés » ou indépendants, en négligeant délibérément la littérature adverse. Et de même pour Loyola, nous ne nous préoccuperons pas de soulever la montagne de pamphlets qui fait face à la Compagnie de Jésus. Les documents concernant le fondateur des Jésuites et son Ordre sont intégralement publiés depuis longtemps, et des autorités scientifiques ont examiné tous les secrets de ce phénomène historique relativement simple.
Le volume de psychologie et de théologie comparées que nous consacrons aux deux principaux porte-parole de la Réforme et de la Contre-Réforme ne prétend pas offrir des découvertes sensationnelles, mais aider à une mise au point, et amorcer des échanges de vues concrets, positifs, qui ne s’évaporent pas tout de suite en lieux communs et en phraséologie partisane. Cette confrontation prolongée des deux réformateurs nous semble imposée par les faits. L’histoire présente peu d’exemples de parallélisme plus providentiel. « Ignace a surgi, déclare Gabriel Monod, pour rendre à l’Église romaine, partout ébranlée et menacée de ruine, la force de résister au luthéranisme... Calvin, au moment même où Ignace de Loyola accomplissait son œuvre, fait de Genève le plus puissant foyer de propagande protestante, crée la doctrine et l’organisation ecclésiastiques les plus propres à donner au protestantisme une force nouvelle d’expansion, et peut être considéré comme l’anti-Loyola... Si la crise de la foi n’a rien de commun chez le mystique imaginatif que fut Loyola et chez l’intellectuel raisonneur et moralisateur que fut Calvin, il y a de frappantes ressemblances dans le développement de leur génie et l’évolution de leur activité. Ni l’un ni l’autre, au moment où ils ont voué leur vie à la recherche et à la défense de la vérité religieuse, ne se doutait de la nature de la tâche qui allait s’imposer à eux... À mesure que se transformait la vocation de Loyola, un véritable génie d’homme d’action et de gouvernement, de créateur et d’organisateur se manifestait en lui... Calvin, lui aussi, allait être un créateur... Calvin, comme Loyola, verra dans l’enseignement la base même de son édifice religieux. Ces ressemblances entre le génie et le développement des deux grands hommes d’action, des deux grands organisateurs que furent Calvin et Loyola, laissent subsister, elles manifestent même avec plus d’éclat, les divergences de leur esprit et de leur œuvre [14]. » Et A. Vinet ne va-t-il pas jusqu’à dire : « Les compagnons d’Ignace ont prolongé jusqu’à l’extrémité les lignes commencées ; en théologie, en morale, ils ont dit le dernier mot de leur Église ; ou plutôt ils lui ont révélé sa pensée, ou plutôt encore, ils lui ont révélé les inévitables conséquences de ses principes [15] ». Et de Calvin, il faut bien accorder avec Walker, « qu’il fut sans rival à son époque pour la systématisation de la vérité chrétienne (protestante) [16] ».
Il est universellement admis que Calvin fut un Réformateur. On connaît moins Loyola sous cet angle, bien que tous ses efforts, toute son œuvre ne visent à rien d’autre qu’à « réformer les consciences, réformer l’orientation de la vie des élites, réformer le clergé et l’Église [17] ». Les deux réformateurs semblent soulevés par les mêmes grandes idées dominantes : la gloire et l’honneur de Dieu, le service de la Divine Majesté, de la Volonté de Dieu, la pureté de l’Évangile, la vocation et le zèle pour le Règne de Dieu. La correspondance entre les deux destinées s’affirme providentiellement jusque dans le détail des œuvres, des mots d’ordre parallèles, et des dates décisives. À force d’être employées par les compagnons et les disciples d’Ignace, les vieilles initiales « J.H.S. » (Jesus hominum Salvator) signeront les œuvres de Loyola, comme l’abréviation du mot grec Jésous, « ΙΗΣ », décorera désormais les actes de la Genève calviniste. À la devise « Ad majorera Dei gloriam », s’opposera le « Soli Deo gloria » ; de même que la « Compagnie de Jésus » fait pendant à la « Vénérable Compagnie » des ministres ; le « Collège romain », l’« Université grégorienne » jouent un rôle pareil à celui du « Collège et de l’Académie » de Genève. Les « Constitutions » dominent l’édifice ignacien, comme les « Ordonnances » régissent la Cité-Église de Calvin. Un synchronisme étrange commande le rythme de ces deux vies. En 1534, l’année des Placards, les deux réformateurs débutent dans l’action apostolique. Calvin élabore l’« Institution chrétienne », Loyola, avec les compagnons liés par le vœu de Montmartre, tire les conclusions de ses expériences et généralise l’usage des « Exercices ». En 1536-1537, Calvin, retenu malgré lui à Genève, entrevoit la possibilité de réaliser sa théocratie, son Église idéale ; Loyola, retenu malgré lui en Italie, prend contact avec les réalisations de l’Église traditionnelle. Entre 1538 et 1540, Calvin chassé à Strasbourg, observe les perspectives européennes de la Réforme ; Loyola, de Rome, du centre de la chrétienté, mesure les besoins les plus urgents de l’Église universelle. En 1541, Calvin rappelé à Genève, devient vraiment le maître de la Cité et le chef de l’avant-garde du parti réformé ; Ignace de Loyola est élu Général de l’Ordre qui commence tout de suite à se répandre dans les différentes parties du monde. Ensuite, les deux chefs poursuivent, parallèlement et simultanément, un travail analogue de législation, d’organisation, de propagande : ils sont aux prises avec des attaques similaires, ils conjurent, chacun à sa manière, la crise de croissance de leur œuvre ; ils mobilisent pour le soutien de leur Église respective, toutes les influences, sociales, intellectuelles, culturelles dont ils disposent au mieux de leurs idées ; et ils laissent, en mourant, une chrétienté « réorganisée », bien différente de celle qui les avait vus naître.
Et cependant ils semblent s’être comme délibérément ignorés. Loyola ne songeait pas plus à combattre les protestants en mettant au point les Exercices et en réunissant ses compagnons, que Calvin ne visait les Jésuites en composant son Institution chrétienne. Bien que partis de deux pôles opposés du monde chrétien de la Renaissance, ils ont souvent poursuivi des buts semblables, ils se sont occupés des mêmes questions brûlantes, ils ont essayé d’atteindre des objectifs analogues avec des méthodes presque symétriques. La puissante volonté de ces deux adversaires religieux finit par canaliser les courants spirituels et les tendances les plus caractéristiques au seuil des temps modernes. Si ces deux réformateurs ont exercé sur leur temps et jusqu’à nous une influence extraordinaire, ils le doivent moins au contenu de leur doctrine qu’à la vibration toute nouvelle qu’ils ont communiquée aux idées. Les éléments particuliers de l’enseignement de ces deux maîtres peuvent presque tous se retrouver chez leurs devanciers ou leurs voisins immédiats. Ce qui est absolument original, c’est le type religieux qu’ils ont créé, et qu’ils ont réussi à incarner profondément non seulement dans leur propre vie, mais dans la mentalité de leurs fidèles, dans tout le comportement humain [18]. Par là s’explique la difficulté d’interpréter certaines de leurs formules isolées, si l’on oublie qu’ils sont avant tout les hommes d’une pensée vivante, d’un mode de pensée qui ne fait qu’un avec leur personnalité. Après Thomas a Kempis et Luther, Loyola et Calvin achèvent une révolution de la pensée religieuse. Jusque-là, pour l’intellectuel du moyen âge surtout, connaître était une activité qui se suffisait à elle-même. Désormais on pourra dire : « Malheur au savoir qui ne sert pas... » La spéculation théologique, coupée du réel, est discréditée. Toute la doctrine de Loyola et de Calvin est dynamique. « La principale fin de la vie humaine, c’est de connaître Dieu. Mais quelle est la vraie et droite connaissance de Dieu ? – Quand on le connaît afin de l’honorer. » Cette déclaration du catéchisme de Calvin, Ignace de Loyola aurait pu la signer. Ni l’un, ni l’autre n’est tenté de se complaire dans un intellectualisme théorique.
Aussi, pour les expliquer adéquatement, est-il nécessaire de ne pas dissocier leur pensée de leur psychologie. En conséquence, avant d’analyser logiquement le contenu de leurs œuvres, nous nous efforcerons de comprendre les hommes.
*
* *
Les sources de la biographie de Calvin ne sont pas limpides. Sa personnalité a toujours été violemment discutée. Les aspects négatifs, chez lui, sont si essentiels que tous les biographes sont obligés de les relever, soit pour les accuser et mettre davantage en relief ce profil anguleux, soit pour les excuser et les voiler quand on veut à toute force l’amener à sourire. Les discordances ne viennent pas seulement de témoignages hostiles éloignés, catholiques, luthériens, bernois, mais précisément de l’entourage immédiat. Les premières protestations qui s’élèvent contre le Réformateur sont dues à des hommes qui, avant ou avec Calvin, ont établi le protestantisme à Genève. Aussi est-il impossible de négliger cet autre son de cloche. Et quand les Bolsec, les Florimond de Raemond donnent une verte réplique aux panégyriques des Bèze et Colladon, ils évoquent une opposition réelle, qui ne s’est tue, à Genève, qu’après avoir été étouffée. Le point de vue qu’ils représentent est attesté par la correspondance des contemporains, par les actes des procès, par les Registres du Conseil et du Consistoire : il corrige le parti pris laudatif des porte-parole du nouveau régime intéressés à idéaliser le portrait de celui auquel ils devaient tout : leur religion, leur nouvelle Église, leur bourgeoisie. Bolsec, par exemple, c’est entendu, n’a pas la moindre préoccupation d’objectivité. Mais Calvin lui-même et son successeur s’en soucieront-ils beaucoup plus à l’égard des adversaires ? La confiance que Doumergue revendique pour Théodore de Bèze tient au mystère d’un acte de foi : « Nous savons que les chroniqueurs de cette époque ne se piquaient pas d’exactitude minutieuse, et que Bèze en particulier a commis plus d’une erreur de détail... Il n’en reste pas moins que Bèze parle de choses qu’il a vues... Si donc l’on peut contester certains renseignements généraux, il ne paraît guère possible de rejeter les détails particuliers [19]. » Cette histoire qui veut tout blanchir défie autant la logique que celle qui noircit de propos délibéré.
Au milieu du siècle dernier, les archives genevoises découvrent une bonne partie de leurs secrets et J.A. Galiffe, entre autres, au nom de tous ceux qu’exaspérait l’image conventionnelle d’un « saint » Réformateur, se mit en devoir d’en souligner les rides jusqu’à la grimace et à la caricature. Un grand savant, vieux-catholique, F.W. Kampschulte, brosse là-dessus un portrait d’un réalisme assez rébarbatif. Celui-ci demeure encore, même après le « colossal » panégyrique de Doumergue, une des rares biographies critiques de Calvin. Les Abel Lefranc, les Herminjard, les savants éditeurs strasbourgeois des œuvres complètes eurent fort à faire pour restaurer une beauté bien atteinte. Alors Doumergue vint... Au tournant du XXe siècle, Émile Doumergue s’impose à l’attention du monde protestant comme le grand « défenseur de la Cause », ainsi qu’il aime à s’appeler lui-même [20]. C’est un infatigable bâtisseur de monuments qui se présentent sous la forme de murs de défense. Contre la désaffection des foules et l’oubli qui menace sans cesse la mémoire du Réformateur, il éleva une muraille propre à arrêter tous les regards : le monument de la Réformation. Contre les reproches d’intolérance et de fanatisme, il dressa une sorte de borne à Champel : un monument à Servet pour honorer Calvin. Enfin contre le flot des monographies et des recherches analytiques qui envahissaient les dernières retraites de la gloire de Calvin, Doumergue construisit une immense digue où tous les matériaux sont jetés pêle-mêle, pour faire masse. Les sept gros volumes de « Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps », accumulent bien tout ce qu’il a été possible de rassembler sur le sujet, mais ce « perpétuel panégyrique », en voulant transfigurer son saint patron, ne déforme pas moins son vrai visage que ceux qui, par dépit, le défigurent. On croirait que Doumergue a décrit sa méthode dans une de ses protestations véhémentes : « L’inexactitude du fond s’allie à l’énorme érudition de la forme. Des textes, des textes, encore des textes. Seulement, ces textes sont souvent forcés [21]. » Il faut bien noter que ce vaste fichier mal trié, mal digéré, n’est pas une histoire [22]. C’est un interminable discours de propagande, un plaidoyer sans fin, souvent déclamatoire. Les biographies édifiantes qui en dépendent, celles de Stickelberger, de Choisy, de Benoît, n’évitent qu’avec peine l’entraînement de cette admiration de commande, qui voudrait tout justifier. Aussi, malgré ses dimensions modestes, la biographie de Williston Walker est-elle encore regardée comme le meilleur aperçu de la destinée de Calvin, vue sous l’angle d’un protestantisme clairvoyant et moderne. Du côté catholique, l’œuvre inachevée d’Imbart de la Tour, donne une vision panoramique, que le professeur protestant E.-G. Léonard trouve « trop irénique et trop conciliatrice, pour rendre compte du grand hérésiarque [23] ».
Il en va de même de récentes études pourtant si consciencieuses de Jean-Daniel Benoît, de François Wendel et de Pierre Jourda qui nous offrent les côtés lumineux et positifs de la vie et de la pensée de Calvin. C’est évidemment à ce point de vue idéalisé qu’il faut se rapporter pour juger du rayonnement merveilleux du puritanisme. Cependant la haute spiritualité et les nobles intentions du réformateur sont loin de suffire à expliquer le climat véritable de la Genève calviniste et l’évolution réelle de son Église au sein des autres confessions protestantes et en face du catholicisme. Presque chaque page des Opera et chaque étape de cette destinée se dessine en noir et blanc nettement tranchés. La grisaille de l’édification, ou de la pure érudition, reflète mal ces violents clairs-obscurs. Au risque de paraître subjectif, cet essai de psychologie s’efforce de soulever le voile des apparences, des images et des belles formules. Notre interprétation se gardera cependant de suivre n’importe quel filon intuitif : chemin semé d’écueils sur lequel les biographes-romanciers tels que Stefan Zweig, J. Moura et P. Louvet, D. Merejkovski ont trop souvent commis le « péché entre tous irrémissible », l’anachronisme.
Concernant la jeunesse et l’évolution du Réformateur, les travaux d’Abel Lefranc, de J. Pannier et de John Viénot, restent classiques. Quant à sa vie publique, ce sont des profanes, comme Amédée Roget, qui en décrivent peut-être le mieux l’atmosphère. « La base de l’histoire de la vie et de l’œuvre genevoises de Calvin est encore le livre de Kampschulte qui, s’il n’est pas toujours juste pour Calvin, a l’avantage de bien caractériser le milieu et l’état d’esprit des opposants [24]. » Le professeur E.-G. Léonard insère cette remarque dans sa « Bibliographie calvinienne abrégée », à laquelle nous renvoyons, comme au guide le plus pratique, à travers la forêt des neuf cents ouvrages que citait déjà en 1900, le dernier tome des Opera Calvini, et le maquis des études de toutes sortes dont la nomenclature occupe soixante pages du t. IV d’E. Doumergue. François Wendel rassemble également une bonne bibliographie : Calvin, p. 277.
La biographie de Loyola n’emprunte pour ainsi dire rien aux mémoires tics adversaires trop éloignés pour être à même de se renseigner utilement. Il faut s’en tenir aux dépositions de témoins immédiats, incomparablement moins contradictoires que ceux qui se prononcèrent sur le compte de Calvin. Les attaques plutôt tardives qui intéressent le Général de la Compagnie se sont beaucoup plus acharnées contre son œuvre que contre sa personne. Lui-même, passé au crible d’une douzaine d’enquêtes inquisitoriales, finit par ne plus être inquiété. Il apaisa doucement les oppositions les plus tenaces, et mérita finalement une confiance unanime qui ne devait rien à l’intimidation. Dans le dialogue de haine et d’admiration qui va se poursuivre pendant des siècles autour de la Compagnie, la personne du fondateur ne se trouvera pas au centre de toutes les discussions, comme le sera celle de Calvin qui, lui, incarne vraiment tout le nouveau système religieux.
Cependant les confidences que Loyola a faites sur son évolution sont bien plus explicites et plus précises que celles que nous a laissées l’avocat de Noyon, trop habile à manier les circonlocutions. On peut tirer toute une biographie des entretiens d’Ignace avec Gonzalez de Camara, notes connues en français sous le nom de Récit du pèlerin. Les disciples et amis, Ribadeneira, Polanco, Laynez, Nadal, Manaere et Lancicius, malgré une tendance au panégyrique, ne cachent aucun des détails qu’ils ont pu observer avec leurs yeux aussi attentifs que dévots. Ce sont ces témoins naïfs qu’il faut faire parler pour connaître Loyola. La polémique allumée par les pamphlets de Chemnitz et d’Osiandre, attisée par de faux documents, par les Monita Secreta et les révélations burlesques attribuées aux apostats Hasenmüller, Zahorovski et autres, ne laisse heureusement que des cendres inutiles à remuer.
Les panégyriques de la période héroïque de l’Ordre, les monuments de style baroque signés des noms de Maffei, Bartoli, Bouhours pouvaient justifier une certaine indignation de la part des ennemis de la Compagnie. Mais le genre hagiographique, idéaliste à tout prix, a la vie dure, aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, ombrageusement fidèles à leurs héros respectifs.
Le XXe siècle enfin vit naître des ouvrages critiques de réelle valeur historique. Les Espagnols A. Astrain et P. Leturia, les Français L. Cros, P. Dudon, Gaétan Bernoville, l’Italien Tacchi-Venturi, l’Allemand A. Huonder, les Anglais Thomson, Martindale et Brodrick surtout, ont dégagé les traits essentiels de la physionomie d’Ignace de Loyola. Le volumineux essai de Fülöp-Miller sur « le secret et la puissance » des jésuites, fruit d’une érudition composite, témoigne d’une bonne volonté méritoire pour un profane. Les études du protestant H. Böhmer sont à peu près les seules dignes d’attention dans le camp opposé. Signalons pour mémoire le prétentieux ouvrage de L. Marcuse, Ignace de Loyola, le dictateur des âmes, traduit de l’allemand, roman sans valeur, égaré dans la bibliothèque « historique » de Payot.
Nous avons jugé superflu de refaire les bibliographies maintes fois mises au point. Nous signalons le répertoire pratique, bien que sommaire, par lequel commence le Saint Ignace de Loyola du R.P. Paul Dudon, 1934, pp. XIII-XX, et pour plus de détails la Bibliographie ignacienne de Pinard de la Boullaye, Aubier, 1947, ou les Tables des Monumenta Historica.
Societatis Jesu, par ex. MI. 4, Fontes I. pp. 91*-109*, en attendant que E. Lamalle ait rassemblé et complété les Bibliographies dispersées dans différents numéros de l’Archivum Historicum Soc. Jesu.
*
* *
La biographie de Loyola puise principalement à trois sources dont les autres dépendent : la Lettre de Laynez, le Sommaire de Polanco, les Actes et le Memorial de González de Camara. Le Chronicon, les précisions de Nadal et de Ribadeneira, n’ajoutent que des détails.
Puisqu’il s’agit d’amener une confrontation directe entre Calvin et Loyola, nous les laisserons autant que possible se répondre sans intermédiaires « anachroniques ». Nous préférerons leurs témoignages, leurs textes, à toutes les explications partisanes, aux intarissables commentaires de la propagande offensive et défensive.
N’écrivant pas une étude philologique, mais un essai de psychologie, nous nous sommes permis de moderniser l’orthographe de Calvin, croyant rendre ainsi à son style ce caractère actuel qu’il a gardé. Sa langue est une de celles qui ont le moins vieilli. De même pour Loyola nous avons cru bon parfois de remettre à la première personne les confidences du Memorial.
A. F.
_______
PREMIÈRE PARTIE
ÉVOLUTION
___________
CHAPITRE PREMIER
Le Basque et le Picard
________
I
LE BASQUE
Ignace de Loyola est de quelque vingt ans l’aîné de Calvin [25]. Il appartient encore au XVe siècle, au siècle de Jeanne d’Arc, de Bayard et de Colomb, de Ferdinand et d’Isabelle. Calvin apparaît en pleine Renaissance française, quand le siècle de Charles-Quint et de François Ier est déjà bien engagé.
Dans une nation éblouie par le récent triomphe sur les Infidèles, Maures et Juifs, par la découverte et la conquête du globe, le cadet d’une grande famille féodale incarne une époque et un monde absolument différents de ceux où Calvin doit prendre place. Dès leur enfance ces deux hommes s’opposent aussi bien par la race et le milieu social et culturel que par l’air qu’ils respirent et l’horizon qui impressionne leurs yeux.
Loyola est originaire de la province basque de Guipuzcoa. Il appartient à un petit peuple, un des plus vieux du monde, obligé régulièrement de se sauver en regardant vers les montagnes ou vers la mer. Une des barrières de l’Occident, où l’ancienne civilisation tourne à angle droit, avant de revenir sur elle-même. Peuple de frontière d’autant plus tenace qu’il est plus menacé. Depuis tant de siècles, il défend son sol âpre et rude contre les envahisseurs du Nord, et sa foi ardente contre les Maures refoulés péniblement toujours plus loin vers le Sud. Partout du fer et des forges. Les habitants ont la tête chaude, le geste énergique, le cœur tendre et fier. C’est la race qui se souvient encore de la victoire de Béotibar [26] où les Guipuzcoans triomphèrent des Français (1324), grâce en particulier à la bravoure de Jean Pérez de Loyola et de ses sept fils.
La famille de Loyola appartient aux parientes mayores [27] qui se disputent les privilèges et les premières places parmi les ricos hombres. Les chefs de lignage sont divisés en deux partis, les Oñacinos et les Camboinos. À la tête des Oñacinos combattent les Loyola. Leurs querelles ensanglantent le pays depuis longtemps déjà. On s’occupe d’eux dans les documents dès 1180. La famille des Loyola, qui est une des dix grandes familles basques, sert avec fidélité le Roi Catholique, le roi de Castille, quand le bien commun est en jeu. Un document leur confère le droit d’être, à certaines dates, invités à la cour par le roi. Mais ils ont aussi conscience d’être de même noblesse et de pouvoir se permettre de téméraires révoltes. C’est à une de ces désobéissances entêtées que le grand-père d’Ignace dut de voir démolir le donjon du château. La demeure fut relevée avec des airs moins provocants : quatre petites tourelles rappelaient seulement que les Loyola ne renonçaient pas tout à fait à leur passé. Les coups de tête ne modifient d’ailleurs pas les relations de fidélité avec le souverain. Le père d’Inigo est aux côtés du roi devant Grenade et les documents parlent de lui comme d’un generoso caballero y gran soldado [28]. Ce chevalier magnifique s’appelle Bertrand Yanez de Loyola. La mère d’Ignace est biscaïenne : Marina Sanchez de Licona. Pour compléter l’hérédité d’Inigo, elle ajoute à la fougue du chevalier guipuzcoan, tout le romantisme, les rêves idéalistes et la tendresse émouvante des rivages cantabriques.
Comme pour mieux le rattacher au particularisme national, on lui donne le nom d’Inigo très répandu dans le pays basque. Mais plus tard, par sympathie pour le prestigieux martyr d’Antioche, il adoptera la forme d’Ignace. C’est le dernier d’une nombreuse famille. « Beaucoup d’enfants légitimes, sans compter les autres [29]. » Douze frères et sœurs l’ont précédé au foyer où l’on ne parle que d’aventures et de prouesses. La ville de Grenade est conquise, l’année même où Colomb aborde en Amérique (1492). Les Basques s’enthousiasment pour les expéditions lointaines. Le frère aîné d’Inigo tombe en 1496, pendant la campagne de Naples. Un second frère prend part à l’expédition du Mexique et meurt pour la conquête de Mexico. Un troisième donnera sa vie plus tard, en terre hongroise, contre les Turcs. Faut-il s’étonner, si en écoutant les romances du Cid et les récits du Nouveau Monde, l’enfant pense à devenir un conquérant, et si demain une croisade spirituelle au pays des Infidèles le passionnera encore, quand il aura tout sacrifié ; si l’horizon de ses projets missionnaires englobera tout de suite « la terre entière » ?
Mais pour mettre une part suffisante de réalisme dans ses rêves, on le fera élever à la campagne. Le domaine de Loyola comprend, outre la demeure seigneuriale, à l’aspect patriarcal paysan, des forges, des métairies, des ermitages, des chapelles, des pépinières, des troupeaux. On n’a pas le temps de dorloter le cadet. La noblesse à laquelle il appartient, est très proche de la terre et du peuple. On le confie à une nourrice paysanne, Marie Garin, de la ferme domaniale d’Eguibar [30]. Le décor de la première enfance d’Inigo est une petite vallée avec des roches et des bois, des moulins et des granges. Les châtaigneraies et les jardins sont les témoins de ses folles escapades. Il s’accusera plus tard devant son peuple, du haut de la chaire, d’avoir volé des pommes. C’est un garçon remuant, rusé, entreprenant. Une âme hautaine et claire comme le paysage.
L’espagnol qu’il parlera un jour et dont il se servira maladroitement pour écrire rappelle-t-il le langage qu’il entend sur les genoux de la fermière Marie Garin, et dans ses contacts avec les gens du hameau [31] ? Le parler paysan se retrouve dans le style concis et pittoresque de ses maximes, dans le choix de ses images. Pareil aux simples, habitué à la réflexion lente et solitaire, il sait condenser fortement les conclusions de sa pensée. Il saura « fixer le clou », comme l’observera plus tard à Rome le cardinal Carpi [32].
Les impressions de cette vie au grand air avec les paysans ne perdront jamais pour lui leur fraîcheur savoureuse. Plus tard, le vieil étudiant mystique ne trouvera rien de mieux pour distraire la mélancolie d’un retraitant déprimé que de danser et de chanter quelque ronde paysanne [33]. Une de ses joies préférées, aux jours de fête, les dernières années, c’est encore de savourer quatre châtaignes au goût de son enfance.
Que faire d’un cadet, d’un treizième légitime, sinon l’engager dans la cléricature ? Moyennant quelques études, on projette de lui confier une église dont la famille a le patronage. L’enfant est donc tonsuré. Il se soumet à des premiers essais au service des autels et au chœur. Un clerc pédagogue s’efforce, à coups de bâton, de l’instruire. Mais quand il lui eut appris à lire et à écrire, il fut à peu près au bout de sa science. Inigo n’a aucun goût pour le latin. C’est un vrai Loyola. Il rêve d’inscrire son nom dans l’histoire avec une épée et non avec la plume d’un lettré. Dans le château, d’ailleurs, il n’y a, en fait de livres, que quelques ouvrages de piété, amenés par la dot des femmes et qui manquent de charme pour un garçon aussi passionné du réel.
L’influence pieuse de sa mère devait malheureusement disparaître trop tôt. Au milieu de ses frères, soldats et aventuriers, l’orphelin oubliera bien vite les obligations de sa tonsure. Si la foi de ces hommes, sauvée de haute et longue lutte, était restée inébranlable, les mœurs laissaient bien à désirer, même chez les clercs. Autour de Loyola et à Loyola même régnait « une tradition de péché » [34]. Les frères et les proches d’Inigo ont des convictions religieuses, une bravoure et un sens de l’honneur auxquels il vaut mieux de ne pas demander des explications. Le côté intellectuel reste en friche. La seule culture dont fassent cas ces nobles désœuvrés sera celle du sentiment, des manières, de la dignité. Inigo apprend sans doute à mimer la courtoisie de son élégant cousin l’archiprêtre d’Azpeitia. Il ne manquera pas de se faire valoir quand il occupe le banc réservé à la famille seigneuriale à l’église de la paroisse, se délectant aux chants populaires, ou aux mélodies modernes de Juan Anchieta, quitte à prendre sa revanche dans des équipées avec des garçons de son âge qu’il mène à la maraude dans les vergers. Expéditions qui en présagent d’autres et marquent bien à quels efforts concrets il s’habitue, quelles attitudes viriles, quels gestes de conquête et de commandement il s’assimile de préférence.
La mort de son père, en 1507, vient encore livrer davantage l’adolescent à son propre destin. Rien n’est indélébile comme les empreintes de la première enfance. Le cadet, peut-être parce qu’il se sent de trop, ne sera-t-il pas plus que les autres travaillé par le besoin de s’élever au-dessus de l’ordinaire ? Inigo aura-t-il le caractère difficile et tourmenté de ceux qui ont subi de profondes amputations affectives ? Il ne semble cependant pas que sa condition d’orphelin, de cadet, de clerc forcé ait laissé de traumatisme, ni de trouble psychique. Le milieu aristocratique est assez large, la famille assez nombreuse et unie, la mentalité assez libre et saine pour empêcher ce jeune passionné de se replier sur lui-même. On ne voit ni refoulements, ni complexes ultérieurs. Son amour même de la gloire n’obéira pas à un instinct de compensation mais à une tendance cordiale et positive.
Cependant, sans une certaine mégalomanie, nul ne fait son chemin dans ce pays hallucinant, aux contrastes tranchés, où les ombres sont d’autant plus noires que la lumière est plus crue. Les sentiments et les gestes, le regard et la voix ont quelque chose de contenu et d’excessif tout ensemble, dans la douceur comme dans la dureté. Il faut dompter les forces d’une nature ou trop sauvage ou trop belle, comme le toréador triomphe de sa bête, avec une grâce et une patience qui ne connaissent pas de merci. Un peuple de visionnaires et d’ascètes. Une austérité qui s’excite « aux fontaines du désir », qui se sauve de la sensualité en courant aux exploits réels ou imaginaires. Les héros de Claudel et de Montherlant ne sont pas que des mythes.
Dans son hérédité et son éducation, Inigo de Loyola collectionne bien des nœuds et des travers difficiles à défaire. Même après sa conversion et la fondation de la Compagnie, le réformateur catholique obéira parfois, sans s’en douter, à des préjugés aristocratiques, à un esprit de caste typiquement espagnol [35].
II
LE PICARD
À côté de l’enfance noble et bucolique de Loyola, celle du jeune « Cauvin » semble un peu grise.
Il naquit à Noyon, le 10 juillet 1509. La Picardie est également une contrée frontière, souvent visitée par les armées en guerre. Un pays de plaines et de vagues collines parcouru sans cesse par de nouveaux courants d’idées. Pierre l’Ermite put bien y déclencher la croisade, mais ce souvenir ne compte plus. La Jacquerie s’y déchaîna. Mais le vent a tourné, il ne souffle plus contre les nobles. C’est l’Église qui excite les esprits. « Entre tous les démolisseurs, les Picards figurent parmi les plus fougueux et les plus convaincus », nous assure Abel Lefranc, qui rappelle les noms du Grand Ferret, de Camille Desmoulins, de Babeuf et de Michelet [36]. C’est « la violente et colérique Picardie qui a, paraît-il, donné le branle au mouvement communal. Le Picard a toujours été en dispute contre quelqu’un ou quelque chose. Quand il ne se battait pas contre les Anglais, c’était contre les nobles, quand ce n’était pas contre les Espagnols, c’était contre le clergé, quand ce n’était pas contre les institutions établies, c’était contre les idées et les doctrines reçues ». Roscelin, Ramus, Lefèvre d’Étaples sont Picards. « C’est une remarque curieuse que les deux mouvements contraires, la Réforme française, et ce qui la combattit avec le plus d’acharnement, la Ligue, sont nés dans le même pays. » On dirait que le Picard, avide de controverse, éprouve le besoin de battre en brèche, dès qu’elles sont admises, les idées qu’il a lui-même avancées. C’est avant tout un opposant. Sa rage de discussion l’emporte malgré lui... ils en arrivent vite aux allures de sectaires... » (Ibid.) Il est vrai que ces combats de coqs ont toujours fait le plaisir, non seulement des Picards, mais encore de la plupart des Gaulois et même des Celtes. Laissons cependant la palme aux Picards, puisqu’ils y tiennent.
Pour devenir le roi de la controverse, Jean Calvin ne pouvait être à meilleure école. Pendant son enfance, sa ville natale est pleine de chicanes qui s’exaspèrent jusque dans des bagarres à main armée. Depuis soixante ans, l’abbaye d’Ourscamp et le chapitre de Noyon se disputent les reliques de saint Éloi. Les chanoines sont, de plus, en guerre contre leur évêque, dont ils ne parviennent pas à faire couper la barbe anticanonique. Hommes de lois et hommes d’affaires, bourgeois, ecclésiastiques, moines et chanoines se disputent prébendes, privilèges, pots-de-vin. L’écho de toutes ces criailleries s’entend spécialement bien dans la demeure de Gérard Cauvin, père de Jean, sur la place du marché au blé. C’est un bourgeois de fraîche date, un notaire issu d’une famille de mariniers de l’Oise.
Bèze nous décrit le père de Calvin comme un « homme de bon entendement et conseil et pour cela fort requis ès maisons des seigneurs circonvoisins [37] ». Le fils du batelier-tonnelier de Pont-l’Evêque est devenu un personnage. Il n’a pas quitté le métier familial pour courir la petite aventure d’ouvriers forgerons, ainsi que ses deux frères à Paris. Il a étudié assez pour devenir, par son seul mérite, notaire du chapitre, greffier du tribunal ecclésiastique, procureur fiscal du comté. Dans la salle basse, aux petits carreaux, l’homme d’affaires discute à longueur de journée avec les gens d’Église et les bourgeois impliqués dans mille intrigues.
Gérard Cauvin doit aussi une bonne part de sa considération au beau mariage qui l’unit avec la fille d’un hôtelier enrichi de Cambrai, Jean le Franc. Nous savons que la mère de Calvin était belle et pieuse, et qu’elle fit de son mieux pour que son petit jean fût « adonné à toutes les superstitions de la papauté ». S’il hérita de sa mère la délicatesse et la civilité en usage dans l’hôtellerie, il apprit dans le cabinet de son père toutes les habiletés requises sur l’échiquier des bénéfices. Ici, Cauvin est un maître. Il a trois fils qu’il pourvoit de revenus ecclésiastiques. À peine trouve-t-il un bénéfice meilleur pour l’un, qu’il réussit à faire succéder l’autre dans son titre.
Parmi les visiteurs de la maison, le jeune Calvin ne dut rien voir de plus fréquent que le costume ecclésiastique. Son parrain est un des cinquante-sept chanoines [38] ; les clients de la famille sont des prêtres ou des religieux. L’enfant enregistre l’écho des histoires, des scandales, des plaintes au sujet du chapitre, ou de l’abbaye voisine, ou de l’évêque, le tout commenté et analysé dans la suite par l’esprit critique du père ou du grand frère, au courant de toutes les rumeurs d’une ville trop cléricale pour être paisible. La mère réagit du mieux qu’elle peut. Elle entraîne son enfant de chœur dans les chapelles et les sacristies vénérables dont regorge Noyon-la-Sainte. Jean fut peut-être même saturé de piété plus ou moins bien éclairée. Si le père et le frère aîné, qui finiront excommuniés et sans doute hérétiques, n’abusaient pas en fait de pratiques religieuses, la mère en revanche devait multiplier ses dévotions [39]. Un des rarissimes souvenirs de son enfance évoque peut-être les plaisanteries auxquelles la belle et naïve dévote était en butte chez elle. Le pamphlet que Calvin composera un jour contre les reliques sera-t-il autre chose que l’amplification magistrale de ces critiques anciennes, que les esprits forts de Noyon répétaient sans doute à la suite du Picard Guibert de Nogent ? Les railleries qu’un « petit enfant » aussi précoce aura subies lui enlèveront le sens du symbolisme et de la piété populaire, le goût du mystère et du merveilleux.
À douze ans l’enfant est tonsuré afin d’entrer dans la cléricature, ou plutôt afin d’accéder au bénéfice de la Gésine, que son frère Charles vient d’échanger contre celui de la Madeleine, plus intéressant. Le notaire pense qu’on peut fort bien profiter d’une institution que l’on blâme, et que l’essentiel est de faire arriver ses fils. Comment le petit Jean acquerrait-il tout le savoir dont il est capable si cette Église corrompue ne lui venait en aide ? Un ami et bienfaiteur de Calvin, Louis du Tillet, le fâchera un jour d’une manière irréparable, en lui conseillant de crier moins fort contre des « abus » auxquels il doit précisément le meilleur de sa formation et de sa culture. Est-ce bien logique de ne pas « estimer églises de Dieu celles où vous avez reçu le commencement de votre chrétienté et l’avancement qu’avez eu en icelle, par l’espace de plus de quinze ans, et condamniez en icelles églises des choses par soi non condamnables et desquelles infinies personnes usent en bien et au gré de Dieu, avec zèle et science de Dieu, en ayant bon témoignage de l’esprit en leurs consciences [40] ».
Jean Calvin, comme son frère aîné, fut mis au collège ecclésiastique des « Capettes ». Il étudie fiévreusement sous l’uniforme à capuchon, et montre une vivacité d’esprit étonnante. À la même école se forment les fils de la noble famille des Hangest-Montmor. Le fils du notaire sera même invité au château. Avec le savoir-faire de l’habile homme de loi, avec la finesse de la belle bourgeoise de Cambrai, l’influence des Montmor achève son initiation sociale. C’est à un de ces fils de grande famille, Claude de Hangest, son contemporain, devenu abbé de St-Éloi, que le jeune Calvin dédiera son premier essai littéraire : le commentaire sur le De Clementia de Sénèque. « Non seulement parce que je vous dois l’hommage de tout ce que je suis et de tout ce que j’ai, mais surtout davantage, parce qu’enfant j’ai été élevé dans votre maison, et initié avec vous aux mêmes études ; et je reconnais que la première formation à la vie et aux lettres me vient de votre très noble famille [41]. » Cela est vrai, dans ce sens qu’à Noyon, au XVIe siècle, tout dépend de l’évêque, seigneur temporel et spirituel, le plus grand propriétaire du pays. Et la dignité épiscopale est le monopole des Hangest [42]. De 1501 à 3525, pendant toute l’enfance de Calvin, l’évêque est Charles de Hangest auquel succède son neveu Jean « dont l’épiscopat de cinquante-deux années se prolongea jusqu’après la mort de Calvin [43] ».
Lorsque Gérard Cauvin se décida à laisser partir son fils Jean à Paris, dans la compagnie des enfants de Montmor, il ne pensait encore qu’à lui faciliter l’accès aux dignités ecclésiastiques. Le jeune Calvin s’éloigne sans trop de peine du foyer où sa mère n’est plus même un souvenir. Car son père s’est remarié très vite et l’agitation du procureur de tant d’affaires ne favorise guère l’intimité studieuse. Si Jean semble attaché à ses frères et sœurs par des liens de solidarité, il n’est pas sûr qu’il ait eu pour ses parents la tendresse qu’on pourrait attendre d’un enfant. La manière impersonnelle dont il annoncera la mort prochaine de son père, impressionne péniblement le lecteur [44]. Le contraste est frappant entre la brève mention de la fin imminente de son père et les termes dans lesquels il s’adresse à Duchemin, « mon ami, plus cher que ma vie [45] ». La publication de son ami, avec lequel il collabore, des explications sur des détails futiles, semblent le préoccuper beaucoup plus que la perte de son père : une affaire pénible à régler en attendant la joie de revoir ses amis...
Les agissements peu scrupuleux, dans deux cas de succession ecclésiastique, pour lesquels Gérard Cauvin mourra excommunié, ne furent certainement pas les seules difficultés qu’il eut avec l’Église. À Noyon, les idées nouvelles n’ont peut-être pas attendu l’arrivée des thèses luthériennes pour fermenter (1526). Dans le milieu professionnel de son père, Jean Calvin va bientôt compter un ami très cher, un peu plus âgé que lui, un proche parent, mêlé aux mêmes disputes politico-religieuses, Pierre-Robert Olivétan, qui s’efforcera de le « distraire des superstitions papales et de lui faire goûter quelque chose de la pure religion [46] ». Si les Cauvin servent encore l’Église traditionnelle, au moment où Jean va quitter Noyon, c’est plus pour des motifs d’intérêt que par fidélité mystique. Il le dira lui-même un jour dans la préface à son commentaire du livre des psaumes : « Dès que j’étais jeune enfant, mon père m’avait destiné à la théologie ; mais puis après, d’autant qu’il considérait que la science des lois enrichit communément ceux qui la suivent, cette espérance lui fit incontinent changer d’avis [47]. » La sagesse de la famille était moins sublime que pratique. Calvin prétend, dans une lettre à Farel, avoir appris tout enfant le vers d’Ovide : « Non minor est virtus quam quaerere parta tueri [48] » qu’il n’a vraisemblablement pas lu dans l’Art d’aimer, mais dans quelque grammaire ou recueil de maximes. Il ne faut pas moins de « vertu » pour maintenir son bien que pour le conquérir ! Que ne l’a-t-il pris dans un sens religieux et médiéval, au lieu de n’y voir qu’une leçon de ténacité. Il ne sera que trop porté à avoir toujours gain de cause.
À quinze ans, Calvin est déjà un adolescent prématurément développé, qui toise de haut l’incapacité du précepteur des Montmor. C’est sans doute un garçon réfléchi et pénétrant, conscient de ses dons exceptionnels qu’il entend vanter par tout le monde autour de lui. Il a déjà trop observé l’envers de la religion de son temps. D’un naturel très sensible et affectif, il n’a pas eu le bonheur de s’attacher profondément à sa famille, à des traditions spirituelles, en même temps qu’humaines. Dans l’éducation qu’il subit, son cœur ne saurait prendre racine. Sa famille, d’ailleurs, n’a pas de traditions. Les Cauvin sont des Noyonnais d’hier que rien ne retient dans leur ville. Calvin, un jour, s’étonnera de survivre deux fois à sa patrie ravagée par la guerre, mais il s’émerveillera davantage que sa maison natale soit restée seule debout, et y verra avant tout un signe providentiel en faveur de son système religieux [49]. Il approuvera sans réticence le correspondant qui lui écrit : « Je ne doute pas que Dieu n’ait voulu laisser ce témoignage contre tous ceux de votre ville [50]... », transposant, comme l’observe Abel Lefranc, sur le terrain des idées théologiques, les principes de discussion et d’examen qui guidaient les bourgeois de Noyon dans leur politique locale [51]. Il est picard par le tempérament, par la langue et le cerveau, mais non par le cœur. Il est plus attaché à un parti qu’à sa patrie. Le crédit des gens d’Église, le contact avec les enfants de la noblesse, qu’il juge de son regard critique et sans appel, lui donnent une haute idée de lui-même. La timidité et la gêne qui lui font sentir son obscurité de petit plébéien en face des Hangest [52] ne l’empêcheront pas de vouloir dépasser tout le monde, le clergé et la Robe, la noblesse et la hiérarchie de son temps. Toujours un peu plus déraciné, en même temps que plus cultivé et plus abstrait, il est prédisposé à devenir un homme nouveau, dans le sens classique de révolutionnaire, un homme de ressentiment, comme peu d’hommes le seront jamais.
Plus encore qu’à Loyola, il fut donné à Calvin de regarder dans les coulisses de la cléricature. L’un et l’autre n’auront qu’à se pencher sur les souvenirs de leur milieu familial pour éprouver le désir de « réformer » le clergé en fonction de leurs expériences. L’un et l’autre projetteront, mais dans deux directions opposées, de restaurer « la belle discipline ecclésiastique ».
En attendant, ce sont deux clercs malgré eux, deux garçons qui bientôt ne se souviendront plus de leur tonsure que comme d’un gage de protection. Elle permettra à Calvin d’échapper à l’obscurité et à la gêne, et à Loyola aux poursuites de la justice civile. Sur le point d’embrasser la carrière, l’un et l’autre se dérobent, avec le sentiment d’être faits pour quelque chose de mieux. L’esprit acide de Calvin mettra bien du temps pour dissoudre les fibres légères qui le relient à l’Église. Avec l’amertume de ses souvenirs d’enfance, il écrira de prodigieux réquisitoires contre les reliques, contre les images, contre le culte et la foi catholique. Mais dans le dessein négatif qu’il conçoit pour son Église, on pourra reconnaître tous les traits d’un amour refoulé.
Tandis que Calvin est préservé des écarts de conduite par son caractère studieux et son besoin de soutenir sa réputation d’élève prodige, son esprit est d’autant plus exposé à l’inquiétude, à la défiance et au mépris. À l’opposé, Loyola ne se gênera pas pour faire de violentes entorses à la discipline ecclésiastique. Mais dans sa dissipation, il n’engagera que la surface de sa conscience. Sa foi ne vacille jamais. Il est entendu qu’il commet des fautes ; mais jamais il ne sera tenté d’expliquer ses défaillances par des nécessités métaphysiques. Calvin emploie, plus tard, beaucoup plus tard, des formules hyperboliques pour déplorer ses péchés de jeune homme irréprochable, angoissé et peut-être scrupuleux : « Car toutes fois et quantes que je descendais en moi, ou que j’élevais le cœur à toi, une si extrême horreur me surprenait qu’il n’était ni purifications, ni satisfactions, qui m’en pussent aucunement guérir [53]. » Quand Inigo de Loyola cessera de faire des folies, il retrouvera intacte sa confiance dans la bonne volonté de l’homme et la bonté de Dieu. Dès son enfance, le Picard est négatif, rétracté : il tourne surtout ses yeux vers les données grises et sévères de la vie. L’insouciance de la jeunesse durera pour le Basque beaucoup plus longtemps et laissera dans son âme un optimisme foncier.
Le Basque croit au mystère. Il imagine qu’il y a beaucoup plus de choses sous le soleil que dans les grimoires et les livres. À tort ou à raison il pense que sa destinée est exaltante, et il en relève encore les détails quotidiens de rêves et de projets chimériques, dont les héros pourraient aussi bien être don Quichotte que le Cid Campéador. Le Picard se livre à l’étude avec un sérieux que ne soutient pas seulement la volonté de briller d’un bon élève, mais surtout l’intuition de tout ce que représente la supériorité intellectuelle. Le Basque grandit dans un climat d’épopée vraiment chrétienne, stimulé par l’appétit du plaisir et de la gloire [54].
CHAPITRE II
Le chevalier errant et l’enfant prodige
_______
I
LE CHEVALIER ERRANT
Le grand trésorier de Castille, Jean Vélasquez de Cuellar, un ami paternel, et son épouse Marie de Velazco de Guevara, une parente de la famille maternelle des Licona, recueillent l’orphelin Inigo de Loyola dans leur maison et le traitent sans doute comme un de leurs enfants. Jean Vélasquez, officier civil de la couronne, était un homme sage, vertueux, très chrétien, de grand air et de conscience délicate [55]. Sa femme était la confidente préférée de la reine Germaine de Foix, « qui, paraît-il, ne pouvait passer un jour sans la voir [56] ». Entre 1507 et 1521 Ignace fait l’apprentissage de tous les rôles de page, d’écuyer, de chevalier galant, de troubadour et de soldat.
Sans être directement page des rois catholiques, Inigo, dans la maison du majordome, mène la même existence que ses jeunes fils, soit sur ses terres à Arévalo, soit dans l’une des villas royales, suivant les déplacements du souverain, qui était à la foi roi d’Aragon et de Castille, roi de Grenade, maître du Roussillon et de la Navarre, et qui devait se montrer avec sa cour dans ses multiples capitales. Sans doute Inigo visita-t-il ainsi Valladolid, Medina del Campo, Ségovie, Séville et Madrid.
Inigo n’a absolument plus rien d’un clerc. Par une affaire peu reluisante pour lui, nous savons qu’il violait sans scrupule les statuts ecclésiastiques prescrivant de porter la tonsure visible et les cheveux courts [57]. Sa chevelure flotte sur les épaules ; des vêtements aux couleurs voyantes remplacent la soutane sombre ; les étoffes sont tailladées pour faire apparaître les doublures bigarrées et mettre en valeur la ligne élégante du danseur. On reconnaît un Oñacino à sa toque écarlate, à son panache ondoyant qui attire les regards. Le type de ce raffinement mondain contre lequel un jour Calvin mobilisera les foudres de l’Ancien Testament et l’appareil de la police genevoise [58]. Les principales obligations d’Inigo comportent des représentations et des parades : figurant dans des cortèges ou des visites solennelles du trésorier royal. Tout le monde, dit le procès, a vu Loyola aller, venir, avec cuirasse, cotte de mailles et toutes sortes d’armes. Bien botté, l’épée au côté, il tient à avoir grande allure. Il aspire à être le plus élégant, le meilleur lutteur, un maître dans toutes les armes à pied, à cheval, avec la lance, la dague ou l’épée [59].
Le maître d’Inigo, Jean Velasquez, grand seigneur, gouverneur de plusieurs forteresses, était une sorte de Mécène, un ami des lettrés et des clercs érudits. Une certaine atmosphère de culture spirituelle régnait chez lui. Sa belle-mère, Marie de Guevara, s’intéressait surtout à la poésie religieuse. Inigo ne resta pas insensible à cette ambiance distinguée. Ce que la férule du pédagogue de Loyola ne put obtenir, se fait spontanément à Arévalo. Inigo s’exerce à écrire « muy buen », c’est-à-dire à la perfection : les caractères fermes et harmonieux de cette calligraphie renaissante appellent la comparaison avec celle que l’Infante Catalina (qui fut probablement la « dame de ses pensées ») apprend au même moment à Tordesillas [60]. Comme tout chevalier courtois, Inigo lime des couplets galants en l’honneur des dames. Cela faisait partie de son entraînement à la chevalerie, comme la musique et les cantiques spirituels chers à la feue reine Isabelle, comme les madrigaux et les danses importées par la nouvelle reine Germaine de Foix. Et non seulement il s’est aventuré à chanter ses amours profanes, mais il s’est risqué encore à composer des cantiques religieux en l’honneur de saint Pierre qu’il a toujours beaucoup vénéré, et surtout en l’honneur de Notre-Dame [61]. Il n’est pas possible de dire avec quelle peine et quel succès il cultive la muse. Astrain pense qu’il serait curieux de savoir comment s’exprimait en vers cet homme qui eut toujours des difficultés à se servir de la prose [62]. Peut-être ressent-il avec une intensité d’autant plus forte qu’il est plus embarrassé pour traduire son émotion. Ribadeneira, son disciple et « enfant gâté », dit ingénument que le « Père ne fut éloquent ni hier, ni avant-hier, mais inhabile à la parole [63] ». Certes, l’éloquence oratoire ne sera jamais son fait, mais une passion plus profonde et plus sincère lui communique le contact direct avec les réalités qu’il aime.
Les livres ne sont pas absents de son programme de formation. Les romans épiques permettent au « soldat déréglé et vain » de se comparer avec des modèles prestigieux. Ces mythes ne lui offrent pas seulement une pâture pour l’imagination, un prétexte à tuer le temps, mais aussi un code d’honneur où l’héroïsme est la plus grande vertu, et où la religiosité fusionne étrangement avec les aventures sentimentales. Romanesque, sans contredit, mais non songe-creux, Inigo traduit en expériences concrètes les divagations vaporeuses de l’Amadis de Gaule. À côté des jeux violents, des fêtes et des tournois, les expéditions galantes eurent aussi leur place. « Très attaché à sa foi, nous dit de lui son secrétaire Polanco, il ne vivait pas selon sa croyance et ne se gardait pas du péché. Il était particulièrement déréglé dans le jeu, dans les affaires de femmes et de duel [64]. » Un autre des amis de Loyola, son successeur Laynez, note discrètement qu’il succombait à la luxure et Gonzalès de Camara assure avoir reçu des confidences circonstanciées sur ses folies de jeunesse [65].
Loyola fut alors ce qu’on aurait, à d’autres époques, appelé un pécheur public, que les pièces du procès d’Azpeitia de 1515 nous font connaître en mauvaise posture. C’est au temps de Carnaval. Il est sans doute de passage en famille, à Loyola. Avec un de ses frères, chapelain et prêtre, il se compromet dans une aventure assez scabreuse pour justifier les termes de l’accusation : délits énormes (gravia, diversa, enormia) [66]. Le corrégidor, qui veut le contraindre, voit Inigo lui échapper ; tout à coup, le « clerc » se rappelle qu’il est tonsuré et qu’il relève d’un tribunal ecclésiastique. L’immunité le sauva-t-elle, ou bien étouffa-t-on l’affaire sur une intervention de Velasquez ou de Germaine de Foix [67] ? Le type du péché mortel reste, dans son souvenir, le scandale que deux complices se donnent l’un à l’autre. Les Exercices laissent entrevoir que leur auteur a une connaissance personnelle de bien des détours par lesquels la tentation arrive au cœur de l’homme, dont la lâcheté se compose de faiblesse et d’orgueil. Il semble connaître également bien la psychologie du démon et celle de la femme [68].
Ce qui lui fera particulièrement honte plus tard en expiant ses péchés, c’est leur aspect de félonie cachée. L’hidalgo se contentait alors d’un décalogue simplifié à l’usage des hommes de guerre, pointilleux sur des questions formalistes de préséances et large sur des devoirs élémentaires. Il était indigne d’un chevalier de mentir, de voler, de manquer à sa parole, de prononcer des jurons, mais tuer quelqu’un en duel ou séduire une femme ne touchait pas nécessairement le point d’honneur. Les aventures d’Inigo ne devaient guère scandaliser dans une famille où un autre frère, prêtre, enrichit l’arbre généalogique de quatre fils illégitimes.
Tel nous apparaît Inigo de Loyola à Arévalo, à la cour du majordome, dans le voisinage des reines Germaine et Jeanne et tel encore il demeure au service du vice-roi de Navarre, chez lequel il s’engage, sans doute bien à contrecœur, lors de l’avènement de Charles-Quint. Son maître Vélasquez, pour revendiquer des droits légitimes, s’était révolté. Ruiné, disgrâcié, il était mort de chagrin en 1517. Inigo se réfugie chez un parent, le duc Antoine Manrique de Lara, récemment nommé vice-roi de Navarre. Après la vie de la cour, la vie des camps. On change souvent de séjour et d’occupation. On se déplace de Pampelune à Navarette, de Najéra à Logrono. Inigo est un officier. Les jeux, les parties de chasse, les aventures galantes, partagent son temps avec les « Exercices militaires » qui lui donneront l’idée des Exercices spirituels : les marches, les courses à pied et à cheval, entraînent le corps de ses hommes comme les examens de conscience, les méditations et l’oraison vocale ou mentale entraîneront l’âme à discipliner ses « affections », à chercher et à trouver le vouloir divin [69].
La tradition a retenu quelques gestes caractéristiques de Loyola pendant qu’il servait le vice-roi de Navarre. Quelle transformation devra s’opérer en cet homme si épris de son honneur, pour qu’un jour il recherche uniquement la plus grande gloire de Dieu ! « Je l’ai vu de mes propres yeux, dira plus tard un Manrique, de la famille de son maître ; un jour à Pampelune, Inigo croisa dans la rue une file d’hommes : quelques-uns de ceux-ci curent le malheur de le pousser contre la muraille. Lui alors de tirer l’épée et de les poursuivre jusqu’au bas de la rue. Si on ne l’avait pas contenu, cela aurait fini par un meurtre [70]. » Il faut souligner cette réaction typique pour apprécier adéquatement la maîtrise et la patience avec laquelle un jour le pèlerin subira les insultes et les mauvais traitements.
Les forts de Najéra avaient été occupés par des émeutiers. Inigo participe à l’assaut, mais la victoire fut suivie de pillage. Loyola dédaigne le butin dont les soldats lui offrent une part : « Piller n’est digne ni d’un chrétien, ni d’un gentilhomme », réplique-t-il avec hauteur. Il tient passionnément, presque naïvement à son honneur d’hidalgo. Il pratique avec ferveur le culte du Moi, qui occupe une grande place dans sa religion même. Il est fort tenté de se croire plus que le reste des hommes, parce qu’il appartient à la classe des maîtres et a conscience d’être destiné à de grandes choses. C’est ce complexe de supériorité qu’il s’efforcera de sublimer dans une lutte sans merci, et qui, en attendant, le préserve de la vulgarité.
« Respectueuse de la vérité jusqu’au scrupule, détachée de l’argent, courageuse pour s’attaquer aux choses difficiles et prudente pour les mener à bonne fin », l’âme encore mal labourée d’Inigo offre déjà un certain terrain favorable à la grâce [71].
Loyola jusqu’ici ne fait que rassembler des symboles, des images et des gestes extérieurs qui lui serviront un jour à exprimer l’idéal chrétien du moyen âge et de son temps. Mais le féodal n’a pas encore réfléchi sur le contenu des valeurs qu’il porte en lui, que lui a léguées le passé héroïque de l’Espagne chrétienne. Un jour il recomposera, avec l’Évangile, toute sa vision du monde : mais il ne pourra s’empêcher d’en décorer tous les plans avec l’imagerie médiévale. Les thèmes de service royal, de fidélité, de compagnonnage, de reconquista, d’hommage et de gloire interviennent sans cesse dans sa spiritualité. Quand il songe à fonder un institut religieux, c’est pour une bonne part des habitudes de chevalerie qu’il transpose dans son Ordre.
Sa « petite compagnie » sera d’abord un groupe d’hommes librement ralliés pour une expédition évangélique en Terre Sainte. Le Roi et son règne, malgré l’esprit évangélique très pur, gardent des couleurs de croisade. Le service, en devenant intérieur et spirituel, gardera l’armure de l’obéissance et l’élan militaire : tout ce qui gêne une troupe en marche est sacrifié (chœur, clôture, habit monastique, pénitences spéciales). Modo militari, tout porte une certaine marque vigoureuse qu’il serait cependant absolument abusif d’assimiler à un esprit militariste [72]. L’ascèse offensive de l’agere contra et du vince teipsum [73] relève du même esprit féodal que l’abandon filial du compagnon, qui, au sommet des Exercices, en une sorte de cérémonie d’hommage, se remet entre les mains de son Seigneur : « Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté. » Les mots même de Seigneur, de Divine Majesté, de cour céleste, la devise incantatoire Ad majorem Dei gloriam, répétée jusqu’à cent et quatre fois dans les seules Constitutions, prennent dans l’original espagnol une tonalité éclatante qu’on ne saurait traduire.
Demain, après sa conversion, quand il aura déposé un certain donquichottisme spirituel [74] commencera pour Inigo de Loyola la « chevalerie divine ». Il a connu tout l’orgueil et tout le désordre de cette élite sociale d’où sortirent les conquistadors, les maîtres politiques et militaires de son temps. À cette société éprise de grandeur et de sensations violentes, le message chrétien repensé par le chevalier de Loyola apportera un renouveau de foi virile. Sa conversion et sa réforme s’insèrent dans le courant des âges chrétiens antérieurs. Il prolonge une évolution continue et homogène. Au lieu de bouleverser la chrétienté de son temps, il trouvera plus urgent de l’approfondir et de réveiller ses anciennes énergies.
Mais quel esprit introduira dans l’Église ce soldat raboté par tous les heurts de la grande aventure espagnole ? Le « Père Maître » des temps modernes ne portera-t-il pas trop visible la marque de ce rude climat, de cette terre à mirages, de cette mentalité inflexible ? Non, l’officier est déjà un diplomate, un pacificateur habile à réconcilier les partis [75]. Il ne se borne pas à se battre contre des moulins à vent.
II
L’ENFANT PRODIGE
À Paris, le tout jeune chapelain de Noyon étudie quelque temps avec le précepteur des Montmor. Mais il le qualifie bientôt d’inepte, et pour ne plus perdre son temps, il se dirige, avec les enfants de Montmor, vers le collège de la Marche, dont il suit les cours en qualité de martinet, ou d’externe, logé chez son oncle, le serrurier Richard.
Le jeune phénomène tombe sur un éducateur clairvoyant et désintéressé : Mathurin Cordier. Loin de flatter Calvin, celui-ci lui fait toucher du doigt combien son premier latin était rudimentaire et combien la formation reçue précédemment était déficiente, « un vain étalage, un appareil gonflé de vent, sans rien de solide au fond ». Suivant un usage qui semble avoir été assez répandu, Cordier, qui était en Rhétorique, reprend ses élèves dans les degrés inférieurs de la quatrième pour les accompagner jusqu’aux classes supérieures. On devine si ce nettoyage fut salutaire au jeune coq de Noyon. L’influence de ce pédagogue éclairé, compréhensif, pieux, stimula à tel point l’ardeur de Calvin, que, trente ans plus tard, celui-ci y verra une intention providentielle. Il se félicitera qu’un tel précepteur lui ait été accordé de la part de Dieu pour un petit temps [76].
La place de Cordier dans la vie de Calvin a tendance à être exagérée. Il dut se hâter pour « adresser son élève modèle au vrai chemin et droite façon d’apprendre ». Les compliments du réformateur devenu dispensateur de renommée et proclamant « pour les générations futures » qu’il doit à Cordier tous les progrès réalisés dans la suite, ne suppriment pas le fait que, à la Marche, Calvin ne fit que passer. Par un réflexe de rancœur, le souvenir idéalisé du professeur réformé servira à effacer les mérites des autres. Cordier eut à peine le temps de polir le latin de l’adolescent. Put-il épurer d’un coup son instinct de la forme et du beau langage ? Éveilla-t-il brusquement son talent littéraire, délivra-t-il ce don « prodigieux qui fera plus pour le succès du calvinisme, au dire de Walker, que la pensée et la richesse du fond ». Il faut aussi laisser quelque chose à Érasme, à Sénèque... et à Jean Cauvin [77].
Il faut aussi admettre que le « sinistre » collège de Montaigu, où les chanoines de Noyon le placent pour de longues années, ne fut pas inutile à la formation du grand Picard. Nous pensons même qu’il eut une influence décisive sur sa mentalité et sa piété. En sautant l’obstacle de cette longue et importante période, J. Pannier ne manque pas d’habileté, mais il se prive d’un bon moyen de pénétrer l’« évolution religieuse de Calvin ». Walker observe plus ingénument que « l’école qui enseigna la dialectique à Calvin ne pouvait pas être sans valeur... et même cet enseignement dut lui être fort utile ». Et non seulement pour la forme de son esprit, mais encore pour le fond. La formation catholique n’a pas fourni que des influences exclusivement négatives ainsi qu’un révolté le pensera automatiquement. Pour déceler les premières tendances protestantes, il est trop simple de dater, dans la correspondance du jeune clerc, le moment où il commence à citer la Bible, et de déclarer protestants les écrits où apparaissent des citations empruntées probablement à la Vulgate catholique. Quinze ans avant la naissance de Calvin, un des plus grands initiateurs de la recherche des sources chrétiennes, Érasme, pénétrait à Montaigu et, malgré l’étroitesse d’esprit de Standonck, était chargé d’enseigner l’Écriture [78].
Avec Jean Cauvin, le chapelain enfant de la Gésine, entrons donc au « collège de pouillerie » et d’orthodoxie, à Montaigu. Évidemment, pour ce qui est du confort, de l’hygiène, de la cuisine, la maison laisse beaucoup à désirer. On n’était pas aussi exigeant sur ce chapitre à cette époque, pas même plus tard, à Genève, au Collège de Calvin, qui n’avait rien de rousseauiste, ni de tendre. Cependant, avec le Principal Tempête, épouvantail des élèves, qu’on surnommait horrida tempestas, Montaigu poussait la barbarie un peu loin. Rabelais et Érasme s’en gaussent à bon droit. Les privations de toutes sortes, les veilles, les travaux poursuivis avec acharnement dans des conditions impossibles, provoquaient parfois la maladie, la folie ou la mort des meilleurs sujets. Néanmoins la gymnastique de l’esprit y était intense, l’arc tendu jusqu’au point où il se brise avec un choc en retour. Et pour des jeunes bien doués d’esprit de contradiction, ne suffisait-il pas de directeurs bornés comme Noël Bédier ou Béda, pour susciter, par réaction, les plus vives controverses, et pour stimuler, à force d’interdictions, une soif intense de la nouveauté ?
Calvin est nerveux et impressionnable. Montaigu l’a marqué bien plus profondément que d’autres hôtes illustres : Érasme, Rabelais, Loyola. Le clerc de Noyon se trouve dans une ambiance qui lui convient. Béda domine la maison : c’est « un Picard d’origine, qui a tout le sérieux et toute la ténacité de Calvin ». Même quand il déclare la guerre aux théologiens « sophistes » formés à l’école de Béda, Jean Calvin s’inspire souvent des mêmes vues, des mêmes principes et des mêmes méthodes [79].
Le but de Montaigu était de former des clercs d’élite. Le réformateur de l’institut, Jean Standonck, prêtre malinois, dépend des Frères de la vie commune, chez lesquels il a étudié à Gouda. Leur pédagogie a influencé pour une bonne part les écoles de Sturm et des jésuites, ainsi que l’orientation du Collège et de l’Académie de Genève. Partout il s’agit de renouveler l’Église, en lui donnant des ministres de choix et une élite laïque influente sur l’ensemble de la société. Une austérité rigide, une utilisation parcimonieuse des moindres moments de la journée, une concentration inhumaine des énergies, tout devait favoriser « le service de Dieu ».
On peut croire que Calvin s’en trouva bien, car « il était fort adonné au service de Dieu » et « très religieux » [80]. L’esprit de la maison ne le corrompit pas, bien au contraire. « Quant à ses mœurs, il était surtout fort consciencieux et ennemi des vices », nous dit Bèze. Cela n’allait probablement pas sans contention, ni aigreur, mais c’était normal. On insistait beaucoup dans l’entourage du martinet pour conseiller et protéger la vertu des écoliers, pour inculquer aux clercs et aux prêtres la nécessité d’une vie irréprochable et édifiante. La peur du dérèglement et des désordres était plus obsédante que l’amour du bien. Plutôt que d’élever la jeunesse, on moralisait, et on formait des... réformateurs, des censeurs du genre humain. Cependant, dans toutes les écoles catholiques fréquentées par Calvin, on prend soin de lui, on découvre ses talents remarquables, on encourage et on soutient d’une façon très compréhensive chacun de ses pas sur le chemin du savoir. Discernant même son étonnante capacité de travail, on ne le freine pas, mais on force plutôt les progrès qu’il réalise.
C’est le cas de cet excellent maître espagnol Antonio Coronel, dont la miraculeuse mémoire de Calvin et de Bèze a réussi à oublier le nom : pressentant la facilité de ce prodige, il achève ce que Cordier n’avait eu que le temps d’ébaucher, il permet à Calvin de dépasser rapidement ses camarades et de se lancer dans la dialectique avec toute la rigueur d’un Picard affûté à l’espagnole [81] : Ingenium acerrimum, tout est à l’extrême pointe de la volonté et du raisonnement. Peu ou pas de concession au cœur et à la santé. « Il profita si bien, nous assure Bèze, qu’en peu d’années il fut avancé à l’étude de la philosophie, tellement son cœur tendait entièrement à la théologie. »
Comme les autres réformateurs instruits dans les écoles catholiques, Calvin pouvait-il rêver de conditions plus « profitables » ? À Montaigu, comme hier à Noyon, et comme demain à Orléans, les maîtres de l’enseignement catholique firent preuve à son égard d’une bienveillance généreuse, sinon bien éclairée. Mais cette éducation en serre chaude, où triomphaient la routine et le rabâchage, ne put qu’endormir superficiellement les inquiétudes de cet « esprit suraigu ». Au lieu de reconnaissance, la mémoire fort sélective de ce disciple à rebours n’a gardé de ces écoles qu’un amer ressentiment. Cependant la condamnation tardive que le maître de Genève prononce contre sa première formation ne retombe-t-elle pas en partie sur lui-même ? « J’ai encore ceci qui m’est demeuré de la méchante instruction que j’ai eue dans mon enfance. Au bout de dix et vingt ans, un homme qui aura dûment été touché de la révérence de Dieu, et qui aura désiré profiter en sa parole, encore connaîtra-t-il qu’il en tient toujours quelque racine, et faudra qu’il combatte aussi : et chacun le voit en son endroit. Car selon que les uns ont été plus plongés que les autres en ces maudites assemblées, ils retiennent toujours la nourriture : tellement que ceux qui ont le mieux profité à l’école de Dieu, s’ils ont été plongés en ces momeries, ou en ces cavernes infernales de la papauté, ils sentiront en eux-mêmes qu’il y a toujours je ne sais quoi qui leur demeure [82]. »
Le réformateur ne traduit-il pas ici un complexe émotionnel ? Au moment même où il s’insurge contre des fantasmes plus ou moins imaginaires créés par son éducation religieuse, il reste collé avec, une viscosité regrettable à des sentiments de méfiance, d’angoisse et de suffisance, par lesquels Montaigu le garde prisonnier de sa pauvre mystique. Il ne se libérera effectivement jamais de certaines fixations qui lui jouent bien des tours. Il croit les rejeter en reniant quelques attitudes extérieures, alors qu’elles commandent toujours les poussées profondes de sa vie affective et mentale.
Le jugement de Loyola sur les mêmes écoles parisiennes ne porte pas de trace de pareils conflits intérieurs. Il vante les chances uniques de formation intellectuelle et spirituelle rencontrées à Paris. Il exhorte son frère à y envoyer son neveu Émilien pour y achever ses études, parce qu’« on y fait en peu de temps plus de progrès qu’ailleurs pendant de longues années. Et puis c’est un pays où les étudiants gardent plus d’honnêteté et de vertu [83] ».
Quel est donc ce poids qui pèse sur la conscience ou plutôt sur le subconscient de Calvin ? A-t-il vraiment connu « une mauvaise instruction et une maison débauchée » au point qu’après vingt ans d’activité réformatrice il ne parvient pas à oublier « les corruptions qu’il a vues et desquelles il a été abreuvé, dont il garde toujours quelque tache ou macule » ? Mystérieuse élaboration de ses préférences religieuses, toutes d’opposition voulue et d’imitation instinctive, involontaire. Narcisse qui voudrait fuir et qui retrouve sans cesse l’image de son premier faux idéal. Il se défait du meilleur et garde le pire : l’empreinte.
Les « macules » que Calvin devait regretter le plus sont celles qui ont pu ternir la pureté de la doctrine. Montaigu réserve au nominalisme toutes les faveurs qu’il refuse à l’humanisme. Le souvenir du fougueux nominaliste Jean Major y était davantage en odeur de sainteté que celui d’Érasme, contre lequel s’acharne la ténacité de Béda. Montaigu dessine en traits indélébiles les contours principaux de ce système de la prédestination et de l’agnosticisme par lequel Occam tend la main au Réformateur [84]. « Jean Maïr et ses élèves ont fondé à Montaigu la plus haute école terministe d’Europe... théoriciens de la logique formelle, éthiciens et politiques... armés pour la dispute, dédaigneux de tout ce qui n’entre pas dans le programme qu’ils se sont tracé [85]. » Telle est la philosophie négative qui sera responsable pour une bonne part de la sécheresse et du pessimisme du jeune prophète. Bremond a décrit la vogue de cette mystique : « Dans les milieux catholiques les plus fervents, des occamistes, au moins d’esprit, ardemment soucieux de maintenir, en face du naturalisme toujours menaçant, en face du paganisme éternel, la doctrine fondamentale du christianisme – la gratuité, la transcendance, la nécessité du don qui nous fait enfants de Dieu – tiraient de ces vérités essentielles des conséquences inacceptables, concevant de la façon la plus dure les droits de Dieu, les principes de la morale, la misère de l’homme déchu. Un Dieu terrible façonnant au gré de son caprice les lois morales qu’il pourrait tout aussi bien remplacer par un code tout contraire ; l’intelligence humaine raisonnant à vide, condamnée à ne produire que des concepts abstraits et purement « nominaux », incapable d’atteindre à une réalité quelconque ; la foi en contradiction flagrante avec la raison, la surnature avec la nature ; bref, en religion, la terreur ; en morale, le rigorisme ; en philosophie, le scepticisme. Luther, et Calvin plus encore, ont sans doute exagéré cette doctrine inhumaine, mais ils ne furent pas les premiers à la soutenir [86]. »
Toujours avide de chercher les meilleures occasions de s’instruire, l’étudiant prodige de Noyon fut certainement attiré par les célébrités du moment. Sainte-Barbe est à deux pas de Montaigu. Calvin aura donc été impressionné, comme tant d’autres, par le triomphe du professeur Jean Celaya, de Valence, connu sous le nom de « Docteur très résolu », décidé en tout cas à concilier ensemble Thomas d’Aquin, Scot et Occam. Il a pu prendre dès lors conscience qu’il avait, lui aussi, lui surtout, l’étoffe d’un « Docteur résolu », encore plus pressé d’offrir, comme synthèse définitive, un arrangement dialectique des doctrines les plus diverses amalgamées et réduites à leur plus simple expression.
Pour comble d’obsession, les méthodes éducatives de Montaigu poussent le jeune clerc dans le sens où il ne demande qu’à dépasser la mesure : l’amour de la dispute et de la controverse. Malgré un règlement formel de l’Université soulignant la nécessité de ne pas sacrifier la métaphysique et les autres disciplines à la dialectique, il semble bien que cette mutilation ait été commise à Montaigu. La satire de l’humaniste espagnol Vivès ne se vérifiait que trop. « Une dispute par jour ne suffisait pas. Deux repas suffisaient, mais il fallait plus de deux disputes. On dispute pendant le dîner, et, une fois nourris, on dispute encore ; on dispute pendant le souper et on dispute encore après l’avoir pris [87]. » L’horaire officiel arrêté par Standonck prévoyait, en effet, quatre discussions par jour, la première commençant déjà à dix heures. Ces répétitions dialectiques devaient graver pour toujours dans l’esprit, sinon les connaissances, du moins les formules et les distinctions verbales apprises pendant trois cours de deux heures chacun. On devine si le futur curé laïque de Pont-l’Evêque fit des progrès accélérés sur la pente même de son naturel picard et cauvin. Il était doué comme pas un pour ces joutes excitantes. Il devait briller dans l’art de surprendre ses camarades en défaut, de relever toute distraction, tout oubli des lois sacrosaintes de la syllogistique.
La légende concernant le surnom d’« Accusatif » qu’on aurait donné à Calvin, à cette époque, chagrine beaucoup Doumergue et ses disciples. Rien de plus anodin cependant. N’aurait-il été inventé qu’après coup, ce titre est plus suggestif, il évoque mieux le caractère du jeune prodige qu’un témoignage de bonne conduite dûment signé et estampillé par Pierre Tempeste, le sombre Principal « grand fouetteur d’escoliers au collège de pouillerie de Montagu », pour parler comme Rabelais [88]. Si non è vero... Bèze lui-même, si habile à magnifier la mémoire de son maître, ne voit aucune difficulté à transformer l’« Accusatif » en certificat de vie exemplaire. En 1575, il se rappelle avoir entendu dire par des témoins oculaires autorisés que le jeune Calvin avait été severus omnium in suis sodalibus vitiorum censor [89]. L’euphémisme « censeur sévère de tous les vices qu’il observait chez ses compagnons », sous la plume du grand admirateur de Calvin, en dit plus long que le petit « Accusatif » de la tradition. Censeur de tous les vices : vices de conduite et vices de langage, vices de forme et vices de méthode, rien ne trouvait grâce aux yeux du sévère « Accusatif ». Admettons donc, avec la sereine objectivité d’Imbart de la Tour, que « Calvin fut initié à un système de contrainte, de discipline extérieure dont il ne perdit pas le souvenir. Est-il téméraire de penser que les méthodes d’inquisition qu’il établit plus tard à Genève ont, en partie au moins, leur origine dans l’esprit et les procédés qui régnaient à Montaigu [90] ? » Calvin prend un goût excessif à l’émulation, aux rivalités et peut-être à la délation édifiante, dont il se sert pour tout à Genève. Il exerce sans ménagement son talent redoutable pour la riposte et l’argumentation ad hominem.
Et, à supposer que cet hypersensible et ce surmené eût jamais quelque loisir pour rêver de transformer le monde, ses songes auraient préfiguré un Montaigu immense, une ville entière organisée à la Standonck, une république dans laquelle un nouveau Tempeste ne battrait plus des « escoliers innocents », mais condamnerait aux verges et au pilori les femmes dévergondées et récalcitrantes, les libertins et les joyeux compagnons. Il n’a pas seulement rêvé, ou projeté. Il a réalisé, sous la hantise probable de Montaigu, un contrôle absolu, presque inconcevable avant cette expérience, de la vie publique et privée, du régime de la table et de l’habillement, des jeux et des conversations, grâce à une surveillance étroite d’un chacun par tout le monde.
Il est temps que Calvin quitte Montaigu. Il est en passe de devenir trop vertueux, un modèle contre nature. Heureusement que ses talents exceptionnels lui permettent de fasciner, là où son manque de cordialité risquerait de jeter un froid. Il est reçu, après les pesantes démonstrations de Doumergue, de parler de la « séduction » du Réformateur. Dans cette ambiance raréfiée, il rayonne de lui, sinon un attrait sympathique, du moins un charme tout intellectuel. Le jeune Calvin fut entouré et recherché. Il était un de ces chefs de file, au regard magnétique, à la parole autoritaire, qui éblouissent et dominent leur entourage, sans cesser de les inquiéter, sans obtenir la dernière adhésion du cœur. Un long séjour dans l’humanisme lui donnera peut-être l’allure du prince charmant de Hanau. D’ores et déjà, il possède le don du verbe, la clarté, une mémoire et une capacité de travail qui lui assurent la supériorité et un ascendant peu banal. Ses compatriotes, professeurs et étudiants de la « Nation de Picardie », sont fiers de lui. Avec le recul du temps cependant, le Réformateur se verra toujours, dans ce cercle d’admirateurs, « timide, sauvage et honteux, aimant le recoi et la tranquillité », c’est-à-dire moins sûr de lui que son agressivité le fait paraître, tyranniquement attaché à cette coterie de familiers qu’il transforme inconsciemment en partisans [91].
CHAPITRE III
L’amoureux et le lettré
________
I
L’AMOUREUX
Alors qu’à vingt ans Calvin est déjà un critique rompu aux habiletés de la discussion et aux artifices de la dialectique, Ignace de Loyola reste, jusqu’au-delà de la trentaine, un esprit naïf, ouvert à tous les enthousiasmes. Il agit pour la joie de vivre elle-même, sans chercher des explications, ni des problèmes théoriques à coller sur la vie, ni des prétextes à amplification. Le démon oratoire ne tentera jamais ce Basque au sang chaud, mais bien le démon du plaisir et de l’amour. La parole n’est pas, pour lui, l’arme décisive dans l’attaque et la défense, l’art subtil d’avoir toujours le dernier mot. C’est l’instrument de choix pour commander aux hommes et pour plaire aux dames. Calvin n’a pas son pareil pour « cette merveilleuse dextérité d’esprit » que nous admirons avec Bèze, « pour voir incontinent le nœud des matières et soudain les développer » avec une virtuosité qui oblige l’adversaire à perdre le souffle et à s’avouer vaincu. Les novateurs se promettaient un secours efficace pour la Réforme de cette « grande subtilité », de cette éloquence capable de « parler de tout abondamment [92] ».
La finesse que cultive Loyola appartient à une forme de vie sociale et à une mentalité qu’il nous est difficile de nous représenter : celle de l’utopique chevalerie espagnole, qui aspire à être noble et raffinée à l’excès, tout en étant sentimentale, romanesque et fougueusement passionnée. Loyola n’est qu’un amateur et un amoureux. Son comportement paraît enfantin, comme celui de tous les amoureux et même davantage. Toutefois il prend absolument au sérieux cet amour qui est toute sa vie et même sa religion. Il aime. Il n’a pas d’autre pensée, ni d’autre ambition, et son amour plane au-dessus des nuages. Il aime une princesse lointaine, qui est « beaucoup plus que marquise, plus que duchesse », une princesse, une fille de roi [93].
Après beaucoup d’autres, Fülöp-Miller a imaginé sur ce thème une brillante mise en scène, basée sur le fait que la protectrice d’Inigo avait été la confidente préférée de la reine Germaine de Foix. Maria de Velazco « réussit à rendre à sa souveraine le séjour d’Arévalo toujours plus agréable et à devenir une confidente et une amie indispensable. Mais les visites toujours plus fréquentes de Germaine dans la maison de Cuelar... offrirent au page Inigo de Loyola assez d’occasions de lui présenter la coupe à genoux pendant les repas, ou de lui porter le manteau quand elle partait, ou de la précéder avec un candélabre... Quand il fut armé chevalier, et quand, suivant l’usage général, il dut se choisir la dame de ses pensées, il porta son choix sur la reine. Dans les solennités et les tournois, il portait ses couleurs ; la plus haute récompense qu’il pouvait espérer, c’était un mouchoir de dentelles lancé de sa main sur la piste du chevalier vainqueur. Quand il la rencontrait, il prenait bien garde de ne pas enlever sa toque, pour observer les conventions de l’amour courtois, selon lequel cet oubli était interprété comme un hommage follement passionné [94] ».
Cette reconstruction est parfaite. Elle n’a qu’un défaut : d’être un roman. Inigo nous avoue lui-même qu’il était « très adonné à la lecture des romans de chevalerie », mais celui-ci n’était pas encore assez romanesque pour lui. Il est vrai que Germaine de Foix « ne pouvait passer un jour sans voir doña Maria de Velazco » et que celle-ci avait fort à faire pour organiser des banquets continuels aussi copieux que coûteux. Mais en nous avouant que son amour visait plus haut qu’une duchesse, Inigo est loin d’affirmer qu’il se soit épris de cette reine « plantureuse et amie du vin », si l’on peut traduire ainsi Pierre Martyr, qui nous la décrit pinguis et bene pota [95]. Veuve deux fois et à bref intervalle, elle s’en fut se consoler de ses deuils légers, dans la lointaine Valence.
Mais Inigo put connaître à la même époque des reines plus dignes de la flamme d’un chevalier exalté. Il connut d’assez près l’aventure touchante d’une Infante toute jeune et toute belle, Catalina, fille de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, sœur de Charles-Quint. Elle est promise au roi Jean III de Portugal et sera une des grandes bienfaitrices de l’Ordre des Jésuites. Elle entretiendra plus tard avec Ignace une correspondance directe. Au temps où Inigo suivait la cour, c’était à peine une adolescente, « la plus belle des enfants de Philippe le Beau, et celle qui ressemblait le plus à son père ». Elle attirait les sympathies et la pitié par le sort qu’elle partageait avec sa mère, dont l’amour avait sombré dans la folie à la mort de son mari, et qui vivait enfermée dans la forteresse de Tordesillas. La pauvre recluse, dans sa fureur, ne tolérait pas d’être séparée de sa fille, vivante image de son bien-aimé. L’Infante obligée d’assister aux divagations et aux crises de sa pauvre mère, passe son temps dans un isolement misérable. Du haut d’une fenêtre, elle se distrait parfois à regarder les enfants de Tordesillas qui viennent jouer au pied de la muraille, parce que, certains jours, pour les attirer, elle leur jette de la menue monnaie. Dans ce palais hanté, le majordome Jean Velasquez et sa femme ne manquèrent certainement pas à la malheureuse princesse, qui leur était attachée par des liens intimes. En qualité de première dame d’honneur, c’est Marie Velazco qui accompagnera la jeune reine dans son voyage de noces au Portugal en 1525. Et bien loin de l’abandonner depuis, elle pense encore à elle dans son testament, léguant à la souveraine une relique naïve reçue de la reine Isabelle : un des trente deniers pour lesquels fut vendu Notre-Seigneur [96].
Cette princesse lointaine dut exercer sur l’imagination et le cœur de Loyola toute la fascination d’une geste chevaleresque à la fois réelle et impossible. Comme page et écuyer, Ignace a certainement pu voir doña Catalina, non seulement en épiant de loin la silhouette de la prisonnière à une fenêtre du château, mais de tout près. Il lui a sans doute offert de remuer ciel et terre pour l’aider. Quel chevalier-servant n’aurait eu pitié d’elle, en l’apercevant si délaissée, « vêtue d’une blouse tout ordinaire et d’une simple mantille, la coiffe recouverte d’un voile blanc ». Il n’est pas exclu qu’il ait monté la garde sous quelque fenêtre, le soir, qu’il se soit faufilé, le jour, parmi les niños pour attendre l’apparition de sa coiffe blanche et saisir comme un talisman une piécette tombée de sa petite main.
Quand il pense à doña Catalina, victime de Jeanne la Folle qu’un sortilège a certainement privée de raison, Inigo est plus ému qu’Amadis rêvant d’Oriana, ou Tristan tourmenté par l’amour d’Yseult. Par quel exploit pourrait-il délivrer la jeune beauté innocente et prisonnière ?
Son énergie et sa fougue espagnoles ne se croient pas soumises aux limites du possible. Il se laisserait briser plutôt que de plier sa volonté hautaine, plutôt que de reculer ou de s’incliner devant quelqu’un qui n’a pas le droit de lui commander [97]. Mais aura-t-il jamais la chance de se signaler autrement que dans des faits d’armes en miniature, comme la prise du pont de Durana ?
Enfin voici mieux que toutes les prouesses anecdotiques. Une apparence d’épopée. Pour le frère de doña Catalina, pour le souverain qui est comme le maître de la terre, sur l’empire duquel le soleil ne se couche pas, il faut défendre Pampelune, la porte de l’Espagne, attaquée par les Français. Mais la Navarre en effervescence est dégarnie de troupes. Le conseil de la ville de Pampelune décide de capituler et il est sur le point d’ouvrir à l’envahisseur les portes de la ville. Inigo est sans doute le seul qui n’hésite pas. Avec quelques gentilshommes qui se replient sur la citadelle, il est résolu à se battre, même si la ville ne se défend pas. Par pure fidélité au Souverain, à la cause de Charles-Quint, si mal représentée, il persuade son chef, l’alcade Herrera, de tenir au moins pour l’honneur, et il va combattre avec ses compagnons d’armes aussi longtemps que le castillo restera debout. Il tint six heures. « L’attaque durait depuis un bon moment, dira-t-il plus tard avec sobriété, quand je fus atteint par un boulet qui, passant entre les deux jambes, en blessa l’une et brisa l’autre [98]. » En même temps que le chef de la résistance, s’effondre le courage inutile de la garnison.
L’officier blessé fut recueilli et soigné avec courtoisie par les Français, qui le confièrent aux médecins de leur armée, après « l’avoir ramené à la maison qu’il occupait avant de s’enfermer dans la forteresse. Il reçut de fréquentes visites des gentilshommes et des soldats français. Pour leur témoigner sa reconnaissance, il leur fit cadeau de ce qu’il avait en fait d’armes de prix et d’objets de valeur [99] ». Nous sommes en pleine chevalerie.
Avec ces armes ciselées et ces souvenirs de combat, c’est tout son passé qu’Inigo dépose entre les mains des chevaliers vainqueurs. Il se libère sans le savoir, pour commencer une vie absolument nouvelle. La métamorphose s’opérera par la découverte d’un nouvel amour. Mais il est bien toujours de « la race insensée des amoureux » » que le jeune Calvin, refoulé, dédaigne avec hauteur [100]. Inigo avoue s’être abandonné jusqu’à vingt-six ans (ou même trente) à toutes les vanités du monde, et le rappelle sans amertume. Il va réparer les désordres d’une jeunesse malgré tout brillante, éclairée de beaux rêves et de beaux gestes, de belles formes et d’un fol idéal. Il a cédé jusqu’ici sans résistance à la grâce des créatures. Cet amour de l’élégance et de la beauté va lui coûter un véritable martyre. Il souffrira n’importe quoi pour plaire aux dames, pour ne pas cesser en particulier de mériter le regard de celle qu’il aime de loin, la reine de son cœur.
Les chevaliers français ont transporté le blessé jusque chez lui, à Loyola. Mais l’opération du chirurgien de campagne a sans doute été hâtive. L’os brisé se déplace. Inigo ne peut se résigner à la pensée de rester avec une jambe difforme. Quoi qu’il en coûte, il faut que le résultat soit parfait. Les médecins recommencent. « Ce fut une véritable boucherie », dit-il laconiquement plus tard [101]. Mais au moins il sait souffrir en beauté. « Sans pousser un gémissement, en serrant seulement les poings. » Il aurait pu en mourir, si au dernier moment, saint Pierre, pour lequel il avait une dévotion toute poétique, ne l’avait secouru. La jambe malheureusement a pauvre allure. Avec un os qui dépasse au-dessous du genou, Inigo pourrait-il être encore un chevalier courtois ? Il faudra scier l’os, étirer la jambe raccourcie, prolonger pendant des semaines affreuses ce sacrifice offert à la beauté et à l’amour.
Comment garder bonne contenance ? Il s’évaderait volontiers dans les romans de chevalerie, dans les aventures d’Amadis. Mais la bibliothèque du château ne possède que des livres du pieux moyen âge, amenés par la femme du frère aîné, la dévote Madeleine Araoz. À défaut de mieux, il se fait apporter les quatre épais in-folio de la Vie du Christ par le chartreux Ludolphe de Saxe, et la Légende Dorée du dominicain Jacques de Voragine, et commence à lire, en amateur et en amoureux, comme il aurait lu n’importe quelle belle histoire inconnue [102]. Il y mêle des rêveries interminables sur la vie mondaine, des souvenirs de femmes et de guerre. Il lui arrivait d’arrêter sa pensée pendant des heures, ne songeant qu’à la Dame qu’il s’était choisie, imaginant « ce qu’il aurait à faire à son service, aux moyens à prendre pour la rejoindre au pays où elle était, aux devises et expressions emblématiques (motes), aux paroles qu’il lui adresserait, aux faits d’armes qu’il accomplirait en son honneur », sans réaliser combien « tout cela était impossible, à cause même du très haut rang de cette dame [103] ». Plus son corps est immobile, plus sa pensée s’envole au loin, vers l’Infante mignonne et victime d’un sort néfaste, vers la sœur de celui qui est presque maître du monde, qui vient, pour des raisons uniquement politiques, de disgracier son bon serviteur le duc de Najéra, qui ignore et oublie les chevaliers qui se battent et meurent pour lui. Y a-t-il quelque part un roi tout à fait chevaleresque et idéal ?
Comme le Seigneur des Évangiles est différent des rois qu’il a servis ! Et comme les soldats du Christ, les François, les Dominique ressemblent peu à lui-même et à ses compagnons d’armes ! Pendant de longues journées de patience, ce n’est que de l’étonnement, de l’ébahissement. Ce nouveau monde, le surnaturel, est plus différent de celui qu’il aime tant que le Nouveau Monde de Colomb l’est de l’Espagne. Il n’a eu de regard jusqu’ici que pour des ombres brillantes, des reflets de beauté fugitive glissant sur l’eau. Il lève les yeux sur l’autre rive et fait, à sa grande surprise, la découverte d’un immense paysage inconnu. Mais un brouillard redescendait sur ses yeux chaque fois qu’il revenait à ses belles idoles. Les anciennes amours lui laissaient le cœur vide et triste. Mais quand il s’appliquait à observer l’autre côté, quand il se proposait d’imiter les saints chevaliers du Christ, « imaginant quantité de choses qui lui paraissaient bonnes, et se représentant toujours les choses difficiles et pénibles... ils ont fait ceci et cela, je le ferai donc moi aussi [104]... », une joie claire entrait dans son âme. Inigo est frappé de cette différence de lumière, de l’inconsistance des beaux mirages de ce monde, et de la solidité durable du paysage évangélique. Comme François d’Assise prisonnier et malade, comme Thérèse d’Avila jeune fille, Inigo saisit que le merveilleux de l’imagination est incolore auprès du merveilleux de la foi. C’est la découverte d’une intelligence et d’un amour nouveau : « le discernement des esprits » se fait jour peu à peu. La grâce lui est révélée, autrement que par la clairvoyance d’un esprit subtil attentif à critiquer ses songes. Un jour, Cervantès, héros de Lépante et prisonnier des Arabesques, analysera sans illusion l’idéalisme de don Quichotte, du fol amoureux, aveugle sur la véritable identité de sa Dulcinée.
Inigo ne va pas s’assagir et se calmer comme un infirme désenchanté et « revenu de tout ». Il prend seulement conscience de l’inanité de ses efforts à poursuivre l’héroïsme superficiel et l’amour folâtre des poètes. Ses rêves sont décevants et impossibles parce qu’ils ne vont pas assez loin, ni assez haut. « C’est l’amour infini qui le tourmente. » Sur la foi des premiers compagnons d’Ignace, le Père Bernard constate qu’il « transposa et purifia cette passion amoureuse, qui est le principe le plus noble de nos actions, comme la source de nos vertus [105] ». Loyola se convertit lui aussi à « la joie parfaite ». Il connaît les émotions vives et fugaces de l’amour humain. Leur souvenir soulève en lui un double mouvement, de plaisir et de regret. Il est surtout frappé par cet arrière-goût de « désolation ». Les joies de l’amour divin se paient d’abord par un effort pénible, mais elles parfument alors l’âme d’une paix, d’une « consolation » profonde et sans mélange.
Pour retenir ces clartés nouvelles il se met à transcrire « amoureusement », comme un artiste écolier, sur du papier lisse et bien ligné, les paroles de la Vierge à l’encre bleue, et celles du Seigneur à l’encre rouge, remplissant ainsi jusqu’à trois cents pages de texte. Jamais un détail ne sera trop soigné pour cet amoureux [106]. « Tout était bien écrit, car il avait une très bonne écriture. » Aucune rancœur ne se mêle à cette « conversion ». On ne pourrait guère imaginer un plus complet changement de décor que celui qui va suivre, mais il se fait sans bruit et comme avec le sourire d’un homme qui a vraiment découvert « la dame de ses pensées », la Mère de Dieu elle-même. « Étant une nuit éveillé, raconte-t-il à son confident Gonzalès de Camara, je vis clairement une image de Notre-Dame, avec le saint enfant Jésus. De cette vue, pendant un espace de temps notable, je reçus consolation jusqu’à l’excès. Et je demeurai avec un tel dégoût de toute la vie passée, et spécialement de l’impureté, qu’il me semblait que de mon âme étaient arrachées toutes les impressions qui jusque-là y étaient comme gravées. De ce jour jusqu’au mois d’août 1555 (où les confidences sont rédigées), jamais plus il ne donna au péché impur le moindre consentement [107]. »
La découverte de la pureté est la révélation d’une valeur éminemment positive : c’est le moyen de pratiquer l’amour absolu. Ainsi s’éclaire le curieux paradoxe : les « puritains », les négatifs, nous dirions presque, à certains moments, les refoulés, Calvin et Farel par exemple, préconisent sans exception le mariage des prêtres, alors que l’ancien chevalier dissolu devient le champion du célibat ecclésiastique et de la virginité. Il ne renie pas son ancien rêve d’amour. Il saisit seulement, dans une intuition qui illumine toute sa destinée, à quel don total doit s’élever l’amour parfait.
C’est un autre homme désormais et cependant toujours un chevalier. Courtois, distingué, mais résolument chrétien, il est pressé de communiquer à d’autres sa joie : il s’applique à réconcilier les membres de sa famille et les gens du voisinage. L’air un peu distrait et pensif, il médite, plus que jamais, de réaliser de grandes choses. « Tout mon but était de faire de ces grandes œuvres extérieures parce qu’ainsi avaient fait les saints pour la gloire de Dieu, et sans m’inquiéter de quelque autre circonstance particulière [108]. »
Voici donc la « chevalerie divine », la caballeria a lo divino qui exigera de lui de grands gestes de privation, de souffrance et d’héroïsme. Il a décidé de conquérir le royaume de Dieu, en compagnie des saints « chevaliers apostoliques ». Il lui faudra montrer son attachement personnel à Notre-Seigneur et à Notre-Dame, « en menant rude guerre » comme il le chantait autrefois à Najéra, d’après les cantilènes de Montesino [109]. À cette aventure tout peut servir. Il appréciera un jour le bienfait d’avoir perdu la santé : « Si j’avais été vigoureux, personne n’aurait pu me suivre [110]. »
La longue convalescence lui fournit le temps de réfléchir, de prévoir l’emploi de sa nouvelle vie, tandis qu’il contemple très avant dans la nuit : « Mon plus grand plaisir était de regarder le ciel et les étoiles, et je le faisais souvent et longuement, car par là, je me sentais un très grand élan vers le service de Notre-Seigneur [111]. » Par ces beaux soirs d’été 1521, priant au sommet du château, il entend comme un nouveau croisé l’appel des grands chemins, au delà des montagnes et de la mer, vers Jérusalem. Il part un jour, comme un amoureux, à l’aventure.
II
LE LETTRÉ
Calvin est un esprit lucide et passionné à froid. L’intelligence a pris un tel degré de perfection cérébrale que l’amour ne semble plus avoir beaucoup de prise sur son cœur. Peut-être éprouva-t-il un sentiment secret pour quelque sœur de son ami Daniel à Orléans, ou pour sa première fiancée de Strasbourg, qui lui fera peur parce qu’elle est trop riche et trop jolie pour sa prudence. « Je n’appartiens pas à la race insensée des amoureux qui couvrent de baisers les vices eux-mêmes, une fois qu’ils se sont épris de la forme. La seule beauté qui me délecte, c’est une femme qui serait pudique, de bon caractère, indifférente au luxe, économe et patiente et qui me donnerait l’espoir de soigner ma santé [112]. »
Quand il formule cette curieuse déclaration d’amour, le Réformateur de Genève a le même âge que le blessé de Pampelune, trente ans. Comme d’autres censeurs amers du célibat ecclésiastique, il ne paraît pas tout à fait bien épanoui dans sa vie affective. Le mariage de Calvin ressemblera fort à un arrangement pratique. Farel attend la vieillesse pour épouser une jeune fille mineure. Viret vient à peine de perdre sa première femme, que Calvin s’offre déjà à lui en chercher une autre. Il se donne beaucoup de peine pour lui trouver un spécimen de beauté classique qu’il a vue deux fois... « dans tout le maintien de son corps merveilleusement belle ». L’intrigue, qui avait pour but d’évincer un projet de Perrin, finit assez ridiculement par une brouille avec celui-ci, et avec la famille de la jeune fille que Calvin avait officiellement promise et engagée sans en avoir reçu le consentement [113].
Dans le premier aveu que nous surprenons de l’émoi de son cœur, le jeune prétendant Calvin ne saurait se montrer plus utilitaire et plus terne. Quelle poésie chercher dans le reste de sa vie, surtout lorsqu’il aura effectivement épousé la dévote « économe et patiente qui se dévouera à soigner sa santé » ? Malgré son but d’édification, cet amour est devenu si sérieux et si bourgeois qu’on peut se demander s’il l’a jamais touché autrement que pour raidir sa fière timidité et pour figer les replis de son éducation. Il aura été avec les femmes, quelquefois pour leur plus grand divertissement, encore plus « enseigneur », plus discoureur qu’avec ses amis eux-mêmes [114].
Il séjourna cependant dans le royaume joyeux de la basoche : son père l’envoya à Orléans dès qu’il découvrit que le « droit mène plus loin que la théologie sur le chemin de la fortune et des honneurs ». Calvin sait se tenir : il ne se mêlera nullement aux folies que commet si volontiers la « race insensée des amoureux ». Etiamsi omnes ego non... Il se tient à l’écart. Par conscience et par ambition, mais aussi peut-être par une sorte de complexe antiféminin, il ne rêve sans doute rien de plus glorieux que de devenir célèbre, à la manière des illustres célibataires Érasme, Lefèvre et de tels jurisconsultes alors au zénith de la renommée [115]. À étudiant prodige, maître exceptionnel. Calvin suit les cours de Pierre de l’Estoile.
La période orléanaise fut sans doute la plus ensoleillée de la vie de Calvin. Après la conversion, même pendant le « paisible » séjour strasbourgeois, on chercherait vainement des impressions aussi sereines que celles que les amitiés de la vingtième année ont gravées dans son souvenir. L’étouffante atmosphère de Montaigu s’est dissipée. Il est libre d’étudier ce qu’il veut. L’humanisme goûté jusqu’ici à la dérobée, comme un fruit dangereux, s’offre largement à lui dans un cadre radieux. Il trouve enfin la science digne de ce nom. Il fréquente des compagnons d’élite, des familles distinguées. Tel de ses amis, « le très sage et très cultivé » François de Connan, jouit d’une autorité qui donne à ses avis une force décisive sur l’esprit de Calvin, comme il le reconnaît dans la préface de son commentaire sur Sénèque [116].
La culture intellectuelle de l’humanisme le fascine pour elle-même. Il ne partage pas la nouvelle vision des choses, qui était « essentiellement une tendance à la glorification de la nature humaine ». La joie de vivre, de rire, de s’ébattre au jeu de la paume ou du poussovant dans les îles de la Loire, de danser et faire grande chère, comme Rabelais nous le décrit, loin d’attirer Calvin, lui répugne. « Il n’est pas de ces rustres escoliers qui festoient et ne travaillent mie. » Lui, il doit jeûner sans doute et se rompre la tête à étudier [117].
Humaniste forcené du XVIe siècle et non contemplatif qui se complaît amoureusement dans la beauté, Calvin, en lisant les grands maîtres de l’antiquité, « s’enivre d’orgueil plus que de plaisir ». Son enfance grise et Montaigu ont enlevé pour toujours à Calvin la confiance humaniste en la nature. Mais Bremond a-t-il raison de conclure : « Helléniste distingué, grand écrivain, Calvin nous humilie et nous accable, il désespère de nous : il n’est donc pas humaniste [118] » ?
Le juriste orléanais, de toute façon, ne désespère pas de lui-même. Il ne semble connaître que deux passions : le culte de la science et celui de l’amitié, confondus dans un même culte du moi. Dans cette Renaissance qui fait fleurir la licence gauloise, en même temps que la science latine, il tend de toutes ses forces à devenir un surhomme de l’intelligence et à sacrifier tout ce qu’il faut à ce but. Il a une haute estime de lui-même, et il suffit de toucher à ce qu’il regarde comme son honneur pour s’en apercevoir. Avec d’habiles litotes, il soulignera en négatif la bonne opinion qu’il a de lui-même : « Je ne prétends m’attribuer aucune pénétration, aucune érudition, aucune prudence, aucune habileté, et pas même de l’application [119]. »
Avec Pierre de l’Estoile, Calvin découvre la majestueuse construction du droit romain et la maîtrise intellectuelle. L’érudition est tout pour lui. Désormais il distinguera nettement et sans appel entre les profanes et les initiés, les « eruditi, les eruditissimi, qui ont pénétré plus profondément dans les mystères du droit [120] ». Quand il se donnera comme le porte-parole de la cause réformée, ce sera avec le sentiment très vif de parler au nom du Droit et du savoir, avec la conscience d’appartenir à une classe tout à fait supérieure de l’esprit. Le versificateur qui introduit son « Antidote au Concile de Trente » exprime bien toute cette suffisance de lettré et de légiste :
Plus l’ignorant s’efforce à comparoir
Entre savants afin d’être en estime,
D’autant fait-il sa bêtise apparoir
Et à bon droit son audace on réprime...
...Ainsi pourra l’homme plein d’ignorance,...
Mais si quelqu’un de saine intelligence
Vient éplucher les édits malheureux (du Concile) [121]...
Avec Pierre de l’Estoile, un adversaire de l’hérésie que Calvin ne peut s’empêcher d’estimer, l’épluchage de la Loi se fait consciencieusement. Comme le héros de Rabelais, peut-être se disait-il « que les livres des lois lui semblaient une belle robe d’or, triomphante et précieuse à merveille... Car au monde il n’y a livres tant beaux, tant ornés, tant élégants, comme sont les textes des Pandectes [122]... » Il paraît que Calvin de même « profita beaucoup en la faculté des lois » «...tellement, ajoute le panégyriste, qu’on ne le tenait pas pour escolier, mais comme l’un des docteurs ordinaires ; comme aussi il était plus souvent enseigneur qu’auditeur, et lui fut offert de passer docteur pour rien, ce que toutefois il refusa [123] ».
Pour accréditer et soutenir une pareille réputation de génie précoce, aucun travail ne pouvait être épargné. Longtemps après son passage à Orléans, on racontait que « souvent il étudiait jusques à minuit et pour ce faire mangeait bien peu à souper. Puis le matin, étant réveillé, il se tenait encore quelque temps au lit, en remémorant et ruminant tout ce qu’il avait étudié le soir... Il prenait ces heures-là pour les principales, afin de pouvoir continuer plus librement et sans être interpellé. Et je crois, conclut Bèze, que ces études-là ont été le fondement du grand savoir qu’il avait dans les lettres, et une aide de la singulière mémoire, qu’on a puis vue être en lui [124] ».
Ainsi, en sacrifiant ses forces et sa jeunesse, en compromettant sa santé, (car, « il n’y a point de doute que de telles veilles ne lui aient bien offensé sa santé »), il pourra dominer les autres étudiants et s’imposer à l’attention quand il discute entre futurs avocats : « Calvin s’y révéla orateur véhément, prompt à la riposte, jamais à court d’arguments, faisant alterner l’éloquence la plus châtiée avec les saillies les plus mordantes, captivant l’auditoire par une diction impeccable [125]. »

LE JEUNE ÉVANGÉLIQUE
Le prodige fascinant, au regard dur et inquiétant. Le penseur infaillible de la première Institution, paré du double prestige du savoir universel et de la volonté de puissance. Tel apparut peut-être à la reine Marguerite et à la duchesse Renée de Ferrare, le brillant ambassadeur de la cause réformée.
Virtuosité de débutant qui ne fait pas d’illusion à Calvin. Il est assez intelligent pour mesurer le peu de profondeur de sa science. À côté de l’Estoile, « le plus aigu jurisconsulte de tous les docteurs de France [126] », il veut entendre une autre célébrité, Alciat, qui, à Bourges, inaugurait une méthode plus souple, plus vivante, qui tenait compte de l’évolution concrète des lois. Mais cette vision historique du Droit n’a pas l’heur de lui plaire. « Calvin préférait le professeur clérical et moyenâgeux d’Orléans, au brillant innovateur italien de Bourges [127]. » Il sera toujours pour le texte, contre l’expérience, à l’opposé de Loyola qui sera pour les données du réel avant d’être pour un livre quelconque. Notre lettré préfère la philologie. « Un excellent personnage, professeur de lettres grecques, aux gages de la feue reine de Navarre, lors duchesse de Berry, Melchior Volmar, qui voyant que Calvin avait faute des lettres grecques, fit tant qu’il s’appliqua à les apprendre [128]. » À Bourges, dans le voisinage de la sœur de François Ier, Calvin fut certainement renseigné sur le mouvement religieux et littéraire, dont la « Marguerite des marguerites des princesses » favorisait le développement. Mais il est évident que Calvin, à l’âge de 50 ans, embellit le portrait de sa jeunesse, quand il dit : « Par nature, j’étais assez porté à la poésie, mais je lui ai dit adieu et depuis vingt-cinq ans, je n’ai rien composé, si ce n’est qu’à Worms, à l’exemple de Philippe et de Sturm, je fus amené à écrire, par amusement, ce poème que tu as lu [129]. » Il s’agit de l’Epinicion, en latin, qui, comme les psaumes qu’on lui attribue, révèle un versificateur facile, dont toute l’inspiration est oratoire [130]. La faveur populaire préférera les rimes plus cordiales de Marot. Calvin est un admirable prosateur ; il a une mémoire prodigieuse, un don étrange pour susciter et exploiter les discussions, l’étoffe d’un avocat supérieur et d’un « lettré », mais les sourires de la muse et de l’amour lui ont été refusés.
En revanche le parti protestant a déjà repéré le brillant sujet, qui donnerait éventuellement un propagandiste de première force [131]. Du Moins, il semble bien qu’il faille interpréter ainsi une lettre de Bucer, signalant les capacités d’un ami d’Olivétan. Cependant rien ne prouve que le sentiment religieux de Calvin ait déjà changé. En « léguant aux descendants un monument de sa reconnaissance », le commentaire de la seconde épître aux Corinthiens, « au maître et enseigneur » Wolmar, « qui lui inculqua les rudiments du grec et permit ainsi à son intelligence de s’orner plus tard plus complètement », Calvin ne dit pas un mot du rôle religieux que ce maître luthérien a pu jouer dans sa vie [132]. C’était bien l’occasion de témoigner sa gratitude, la « pure doctrine » ayant aux yeux du réformateur plus de valeur que la philologie. Il est vrai qu’il se gardera toujours de laisser soupçonner une dépendance à l’égard des Luthériens.
Il ne semble avoir de goût que pour la culture humaniste : ses modèles sont Lefèvre et surtout Érasme, plutôt que Luther. La Bible n’est encore qu’un livre, parmi d’autres livres, sans doute une des sources privilégiées et principales de la vérité, mais non l’unique nécessaire. Cependant la fermentation des idées aux environs de 1530 ne peut le laisser indifférent. Il prend vraisemblablement connaissance des publications bibliques d’Estienne, de Lefèvre, du projet que son cousin Olivétan caresse de réviser la traduction de la Bible, pour laquelle, un jour, il écrira une éloquente préface [133]. Il est impressionné comme tout le monde par les évènements qui suivent l’attentat sacrilège contre la Vierge de la rue des Rosiers, par les processions imposantes, par le concile de Sens, dont Clichtove publie les actes en 1529. La répression contre les « Bibliens », l’exécution de Rieux, de Louis de Berquin, coïncident presque avec la publication du De Clementia de Sénèque, par les soins d’Érasme que la mort édifiante de Berquin avait vivement frappé [134].
La curiosité des « intellectuels », comme dans toutes les révolutions, est d’autant plus excitée que la réaction est plus intransigeante. C’est dans cette agitation que le « licencié ès lois et vénérable maistre Jean Cauvin, curé de Pont-l’Évêque », est appelé au chevet de son père mourant et excommunié [135]. La perte qu’il fait le bouleverse moins, sans doute, que les lugubres tractations nécessaires avec les gens d’Église, pour obtenir que le cadavre ne soit pas enterré, comme celui d’un païen, en dehors du cimetière. À quatorze ans de distance, Calvin se surprend à consoler un ami par ces étranges considérations : « Vous avez commencé à mourir au monde... il vous faudra apprendre dorénavant ce que c’est d’être enseveli. Car la mort n’est rien sans la sépulture [136]. »
Pour se consoler de son amertume, Calvin, libre désormais de conduire sa vie comme il lui plaît, décide de se plonger davantage encore dans l’étude des lettres. La mort de son père « fut cause qu’il abandonna ses études de lois ». Il vint à Paris, et « lors il composa un docte et singulièrement beau Commentaire sur le livre de Sénèque touchant la vertu de Clémence [137] ». Ce qui ramène Calvin dans la capitale, c’est, bien sûr, le succès de l’œuvre que patronne François Ier, les cours des Lecteurs royaux, première ébauche du Collège de France, le désir de s’inscrire dans cette haute caste de l’intelligence humaniste, à laquelle le roi, la reine Marguerite, l’élite de la nation et de la chrétienté, s’intéressent plus qu’à tous les Scolastiques et Légistes ensemble. Mais c’est aussi la tentation de la publicité, la séduction du livre, de l’« art divin » de l’imprimerie, dont la nouveauté encore récente exerçait alors une fascination inouïe. Il a déjà aidé à lancer contre Alciat l’Antopologie de son ami Du Chemin ; il faut qu’il aborde sans tarder cette carrière qui assure une renommée durable.
Le premier livre auquel il songe est tout de suite un livre d’actualité. Érasme et Berquin lui fournissent un sujet « brûlant », « un moyen commode pour attirer l’attention du roi, de l’opinion publique, ou plutôt l’opinion des hommes cultivés [138] ». Le De Clementia lui permettra de briller, en relevant « des choses qui ont échappé au grand Érasme », et peut-être en insinuant discrètement des allusions sur l’inclémence du gouvernement de François Ier [139]. Cet écrivain est encore plus « un avocat subtil » qui use « d’un artifice pour faire comprendre, de façon détournée, ce qu’il n’osait dire ouvertement ». Il n’a encore pris parti que pour lui-même. « Le commentaire du De Clementia est un très bon travail d’étudiant sérieux.... attentif à ce qui se passe soit dans le monde des lettres, soit dans les évènements contemporains [140]. » Un Cauvin sait choisir son heure et ne se compromettre qu’avec de bonnes chances de succès. Sa grande préoccupation, c’est de ne pas « mettre au monde quelque fœtus abortif [141] ». La dédicace adressée à un ami d’enfance, Claude Hangest de Montmor, abbé de St-Éloi, à Noyon, trahit un petit complexe d’infériorité supérieure. « Jusqu’ici, mon obscurité roturière m’a tenu à l’écart du public. Je compte cependant pouvoir satisfaire les lecteurs avertis, bien que je ne sois qu’un petit homme de la plèbe, d’une érudition médiocre, ou plutôt moyenne et que je ne possède rien en moi-même qui puisse exciter l’espoir de la célébrité [142]. »
L’essai sur Sénèque révèle chez Calvin une incontestable virtuosité à maîtriser les différentes disciplines, à en assimiler le côté formel, extérieur, la méthode, sans avoir la patience de goûter la réalité intérieure des choses qu’il étudie. Son œuvre reste une étude littéraire superficielle. « S’il n’était pas devenu un célèbre réformateur, son commentaire serait complètement oublié [143]. »
« On le jugea présomptueux, plein de lui-même... il se heurta un peu partout à une froide désapprobation. Il en fut déçu et dépité plus qu’on ne devrait penser », dit le professeur Wendel [144]. Il réussit trop vite dans tout ce qu’il tente pour pouvoir unifier ses nombreuses connaissances en une personnalité harmonieuse. Il aura beaucoup de facettes et il sera difficile à saisir, non parce qu’il est trop profond, mais parce qu’il est trop rapide. Il aura trop de facilité pour échapper « en se jouant » dans les discussions, en changeant subitement de personnage, tour à tour rhéteur, avocat, philologue, théologien, moraliste et toujours dialecticien.
Du moins, cette intelligence, « une des plus vigoureuses et des plus cultivées de son siècle, mais... non des plus complètes » a-t-elle encore le grand mérite de la recherche sereine et désintéressée. Le jeune auteur catholique de vingt-quatre ans, qui plaide la thèse de la clémence à l’égard des Évangéliques, est sans contredit plus sympathique que le réformateur qui écrira la Defensio contra Servetum [145]. On ne peut pas imaginer un contraste plus violent. Comment le même homme, qui aborde le public par un plaidoyer en faveur des persécutés, pourra-t-il couronner son œuvre par une justification de la cruauté ? Maintenant, Calvin est en bonne compagnie. Tout l’humanisme catholique penche vers la clémence. Pour expliquer la dureté de Calvin à Genève, il ne suffit pas d’évoquer les répressions du Parlement et de l’Inquisition. Le commentateur de Sénèque a connu un autre climat, une autre mentalité. Quand était-il plus humain, plus chrétien, à vingt-quatre ou à quarante-cinq ans ? Suffit-il de se rallier à un parti persécuté, pour acquérir le droit de persécuter à son tour ? Calvin ne raisonne encore principalement qu’avec la simple logique du bon sens, commune à Sénèque et à tout le monde. Demain, il argumentera avec une dialectique savante, obligée de concilier, bon gré mal gré, les exigences du pouvoir et de la propagande avec celles de la Bible et des Ordonnances.
Contrairement à son attente, le livre passa presque inaperçu. Il pensait, comme tout jeune auteur, qu’il ferait sensation. La parution est annoncée à un ami, avec le ton de Cicéron apostrophant Catilina, et le geste de César passant le Rubicon : « Tandem jacta est alea... Enfin le sort en est jeté. Mon commentaire vient de paraître. Mais à mes frais. Il a coûté plus d’argent que tu ne saurais l’imaginer. Maintenant il faut tacher d’en récupérer quelque chose [146]. » Il faut tout de suite assurer la mise et le bon renom de l’auteur en faisant appel à « ces amis loyaux et fidèles, prêts à tout admirer avec une candide naïveté », comme il le dit lui-même [147]. À Paris, il fréquente assidûment des personnages avantageusement connus et pleins de bienveillance pour lui, comme les Cop et les Budé. La manière dont il stimule la publicité littéraire et commerciale trahir l’homme d’affaires de Noyon et présage l’habile propagande du futur meneur de la Réforme. « J’ai poussé plusieurs professeurs de Paris à se servir de mon livre pour leur cours. À Bourges j’ai persuadé un ami d’en faire le sujet d’une défense publique. » Le sens pratique du jeune auteur devait réjouir les mânes de Gérard Cauvin : « Je t’enverrai cent exemplaires, ou ce qui te semblera bon. En attendant, voici un exemplaire pour toi. En le recevant ne pense pas que je veuille te dicter la loi. Ma volonté c’est que tu sois libre en tout [148]. »
Calvin a de bons amis, dont il peut demander beaucoup, sauf de le suivre jusqu’au bout, quand il deviendra fondateur d’Église. Les Daniel, de Connan, Du Chemin, du Tillet semblent presque se mettre à son service. À court d’argent, comme il ne l’a jamais été, il souffre dans sa fierté et écrit des suppliques embarrassées. Il ne saura jamais, comme Marot, ou d’autres humanistes, « en pleurant tâcher de faire rire ». Mais il tente au moins, dans ce sens, des efforts plus méritoires que ceux par lesquels, un jour, en riant, il tâchera de faire pleurer ses adversaires. Tout n’est pas amical dans cette amitié qui ignore la confiance et la jovialité. Il prend vite les choses au tragique. Il prévoit tout, il observe tout, il tient compte de tout. Ses correspondants ne peuvent se permettre la moindre négligence sans s’attirer des semonces. Lefranc le souligne sans ménagement : « Inflexible sur le chapitre (de la correspondance) Calvin s’aigrissait, et il fallait l’intervention d’un ami commun, pour obtenir le pardon du retardataire... il n’est pas de lettre où il n’exprime de plainte à ce sujet... Calvin était très susceptible. D’une politesse scrupuleuse, il attachait une importance exagérée aux moindres manquements... Le fait d’avoir oublié de lui envoyer quelque salutation amicale par un camarade (de passage) prenait à ses yeux une véritable gravité [149]. »
Nous croyons volontiers, avec tous les biographes et panégyristes de Calvin, que c’était là l’effet de sa trop grande sensibilité, de sa « tendresse féminine ». Malheureusement, si l’amitié des humanistes dilate pour un moment ce cœur si tendre, le droit et l’agitation religieuse vont de nouveau le refouler et l’obliger à se raidir. Car, après le demi-échec de son Sénèque, le jeune écrivain se détourne des lettres et se rabat sur son « premier amour », la jurisprudence. Il revient à Orléans, où son renom lui vaut l’honneur de représenter, comme procureur, la nation de Picardie. Cette nomination aurait dû être arrosée abondamment à ses frais. Mais il n’a pas le caractère jovial. Il ne veut pas qu’on festoie ; cependant, pour ne pas paraître mesquin, il verse au fonds de la bibliothèque, ce qu’on s’attendait à le voir dépenser en folâtreries. Ce n’est plus seulement le « censeur sévère » des vices de ses compagnons, c’est déjà un réformateur au petit pied, soucieux de frapper les esprits et de faire la morale. Ignace de Loyola, dans une circonstance analogue, après une dizaine d’années de pénitence, lors d’une promotion, se ruinera pour payer les banquets et les cadeaux d’usage [150].
La conversion d’Ignace le fait progresser dans la bonté et l’amour des hommes. Celle de Calvin ne semble pas améliorer son caractère, durci encore par la forme d’un esprit essentiellement juridique. C’est Jacques Pannier qui en fait l’observation : « Le commentaire du De Clementia a déjà ce trait commun avec les futurs commentaires des textes sacrés, qu’on y reconnaît la méthode d’un étudiant rompu aux discussions juridiques plus encore qu’à l’étude de textes littéraires. Il commente maintenant Sénèque, il commentera plus tard S. Paul... comme il a d’abord, sur les bancs de la faculté de droit, à Orléans.... appris à commenter les Institutes, dix ans avant d’écrire l’Institution [151]. »
Pour devenir d’Église, cet homme de robe n’aura pas besoin de se changer beaucoup. Car l’Église se présente à lui presque exclusive-nient sous des dehors juridiques, voire politiques. Seule une conversion intérieure pourrait le ramener tout à fait à sa mission spirituelle : une réforme qui devrait avoir la vie de parfaite charité pour terme et pour objet. En passant des mains des « spirituels » à celles des lettrés et des légistes, la révolution religieuse se déroulera simplement sur le même terrain inhospitalier où l’Église officielle se maintient de préférence, celui des combinaisons politiques, des campagnes d’opinions, des conflits d’intérêts et des menées sociales.
________
CHAPITRE IV
Deux conversions
Le pèlerin solitaire et le prophète malgré lui
_______
I
LE PÈLERIN SOLITAIRE
Calvin glisse insensiblement vers la « Réforme » : sa conversion s’achève par l’adhésion brusquée à un mouvement révolutionnaire extérieur, pour lequel il faut prendre parti et répondre. Cette crise oblige bien à réviser les idées, mais n’implique pas nécessairement un changement de la vie profonde.
La conversion d’Ignace de Loyola sera une révolution tout intérieure et personnelle, n’intéressant pendant longtemps que lui seul. Les influences du dehors n’ont guère de prise sur ce mystique et ce volontaire. Ignace n’a pas eu les mêmes raisons que Calvin de nous laisser dans le vague au sujet de ce moment décisif [152]. Les confidents qui savent tous les détails de sa vie ne manquent pas. Au terme de sa carrière, il a même consenti à raconter d’une manière suivie, à Gonzalès de Camara, ses souvenirs circonstanciés, connus sous le titre « Récit du pèlerin » ou « Mémorial ». Le mal comme le bien que nous savons de lui, nous le tenons de la bouche d’un homme ennemi des superlatifs et des développements oratoires. Dans un style d’officier, sans fioriture, sans la moindre trace de passion ou de polémique, il fait le relevé des principales étapes de son itinéraire, parlant de lui à la troisième personne, comme s’il s’agissait d’un étranger qu’il juge sans illusion. Nous sommes renseignés exactement sur ses aspirations et sur ses états d’âme, sur l’impression que lui font les hommes et les choses, le bon et le mauvais esprit, la nature et la « Divine Majesté ».
C’est autre chose que le simple passage d’un camp dans un autre. Non seulement tout le décor de ses actions se transforme à vue d’œil, mais c’est surtout dans le caractère et dans l’âme d’Inigo que se produit la métamorphose. C’est presque un changement de personnalité. Entre le chevalier orgueilleux et sensuel et le mendiant, nouveau type de croisé, les différences embarrassent le psychologue. Calvin converti est entraîné hors de lui-même, vers le public auquel il est pressé de communiquer ses idées, ses projets de réforme, ses mots d’ordre partisans. Loyola rentre toujours plus vers l’intérieur, vers la citadelle qu’il faut emporter de haute lutte, à l’exemple des bons et vaillants « chevaliers de Dieu » dont il s’est épris en lisant le Flos Sanctorum : « J’en revenais toujours à me dire : saint Dominique a fait cela, et moi aussi je dois le faire ; saint François a fait ceci, et donc moi aussi je le ferai. »
Comment satisfaire ce besoin de solitude et d’héroïsme ? – Entrer dans un couvent ? – Dans cette hypothèse, Ignace de Loyola ne peut imaginer que le choix le plus dur. La Chartreuse, celle de Burgos, ou mieux, celle de Séville, plus éloignée, lui permettrait de cacher son rang, son passé, de prendre sur lui le maximum d’austérités, de « vaincre toutes les répugnances de sa nature, de vivre ignoré, méprisé, ne mangeant que des herbes [153] ». Un serviteur envoyé en exploration, lui rapporte que la Chartreuse de Miraflorès répondrait bien à ses goûts de pénitence. Mais dans un cloître, lui permettrait-on d’assouvir toute « la haine qu’il avait conçue contre lui-même » ? Sur les routes lointaines parcourues autrefois par les croisés, aujourd’hui par les pèlerins mendiants, n’y aurait-il pas davantage d’occasions de se faire mépriser et maltraiter par les hommes, d’endurer le froid, le chaud, les fatigues et les affronts ? Quel sommet rivalisera avec la hauteur de Jérusalem on le Christ a souffert telle et telle chose pour lui, où le serviteur apprendra « les degrés de l’humilité » requise « pour se mettre en dessous du Maître [154] ».
Ce rêve de croisade évangélique, cette nostalgie du pays, des chemins, des collines et des vallées qui portent la trace du Christ, le hante encore treize ans plus tard, quand, avec ses compagnons de Montmartre, il promettra d’aller en Terre Sainte, de demeurer si possible au pays du Christ et d’essayer de convertir les Infidèles au prix même de sa vie [155]. Médiéval, il veut se mesurer avec tous les héros chrétiens qu’a tourmentés, avant lui, le souvenir du Tombeau du Christ. Il pense peut-être à cette couronne d’épines qui inquiétait Godefroy de Bouillon, aux efforts de François, ou de Louis IX, le royal pénitent, plus soucieux de montrer aux infidèles ce qu’était un chevalier chrétien, que de conquérir des places fortes. Il reprend le rêve émouvant et naïf de tant de voyageurs anonymes, désireux de chercher au Saint Sépulcre une raison de vivre et de mourir.
« Vêtu selon son rang, avec ses armes, suivi de deux domestiques », il a quitté le château paternel, emportant sur son cœur ardent l’image de Notre-Dame de Pitié. Son bagage comprend le livre d’heures, l’office de la sainte Vierge, dont lui fit peut-être cadeau sa belle-sœur, Madeleine de Araoz, le registre de trois cents feuillets calligraphiés, résumant pour son plaisir les plus belles scènes de l’Évangile ou de la vie des Saints. Comptant bien ne jamais revenir, il s’est arraché à tout ce qu’il aimait, pour rencontrer l’Inconnu, pour aller au rendez-vous que le Seigneur lui a donné dans son pays.
Voici deux grands voyageurs, deux messagers. Calvin parcourt différentes régions et se mêle à beaucoup de milieux, mais fréquente principalement des cercles partisans, des intellectuels passionnés pour les mêmes opinions, picards ou « évangéliques », que les nécessités semblables de lutte ou de propagande enrôlent dans le même mouvement.
Les pérégrinations d’Ignace, au contraire, sont des voyages d’exploration qui le mettent en contact avec les courants humains les plus originaux. Il traverse ainsi les élites et les foules, les écoles et les hôpitaux, l’aristocratie médiévale, la bourgeoisie marchande, les classes influentes de la Renaissance, les citadelles du silence monastique et la misère des pauvres, des malades, des fugitifs que la peste ou la guerre poussent devant elles. Il longe ainsi non seulement les rivages méditerranéens, l’Espagne et l’Italie, mais il connaîtra la France, qui deviendra en quelque sorte sa patrie intellectuelle ; il poussera jusqu’aux Pays-Bas et en Angleterre [156]. Il n’oubliera jamais que le royaume de Dieu est ouvert sur le monde entier, aussi bien sur l’Orient et le Midi, que sur le Nord ou les Indes. Calvin, en revanche, n’a peut-être jamais vu la mer ; s’il connaît quelque chose en dehors de la culture française et latine, c’est toujours avec un point de vue étroitement français.
Ignace de Loyola marche de découverte en découverte. En voulant se perdre et disparaître, il peut se faire tout à tous, s’instruire aux situations et aux rencontres les plus inattendues. Sur les routes, ce chemineau considère les hommes dans leur réalité étrange, avec leurs bons et leurs mauvais côtés, avec le jeu infiniment varié du péché personnel et de la grâce individuelle. Alors que Calvin, dans ses relations, se préoccupe surtout d’amorcer quelque discussion en faveur de la Cause, de soumettre les hommes et les évènements aux principes de son idéologie, Loyola « expérimente », une à une, les leçons élémentaires d’un Évangile réaliste : soigner les malades, convertir les pécheurs, vivre en s’abandonnant à la Providence, attendre de la main de Dieu nourriture, logis et habillement, prier, s’humilier, servir le Seigneur dans ses frères, s’épuiser de privations et de sacrifices. Pendant des années, ce ne sont que surprises et aventures : mais quels que soient ses illusions et ses déboires, la joie le porte en avant. Il « réinvente » l’Évangile pris sur le vif et non étudié avec les lunettes du philologue ou du juriste. Voyons quelques étapes symboliques de ces pèlerinages.
Il a tourné le dos à sa famille et à son pays, et marche en direction de Barcelone, avec, comme but lointain, Jérusalem. Mais les points de l’itinéraire sont vagues encore. Il les précise en cours de route, d’après les indications du hasard, c’est-à-dire de la Providence. Pour lui, encore bien plus que pour Calvin, rien n’arrive sans une disposition divine. Ce n’est encore que son « enfance spirituelle », pleine d’images enthousiastes et de naïves exagérations. En passant par le sanctuaire de Notre-Dame d’Aranzazu, cher aux Guipuzcoans, il s’arrête pour faire une veillée d’armes, avez un frère qui l’avait suivi jusque là. Il veut exécuter la volonté d’un cousin défunt, dont le testament demandait qu’on envoyât « une bonne personne pour y faire une veillée nocturne ». En signe d’adieu à son pays, il faut qu’il acquitte cette dette oubliée par les siens. Une nouvelle fidélité, une nouvelle noblesse l’obligent [157]. À Navarette, on lui remet les arriérés de sa solde, dont il fait deux parts. Il réserve l’une pour payer ce qu’il doit à ses gens et il consacre l’autre « à très bien orner une image de Notre-Dame qui avait besoin d’être restaurée ». Les souvenirs de la tradition revivent intensément dans son cœur renouvelé.
La chevalerie l’absorbe encore tout entier sur le plan religieux. Son culte à Notre-Dame s’en inspire. Il la priait naguère avant d’aller se battre en duel [158]. Sur cette route même « où il avait souvent succombé à des tentations de luxure », il pense à la Vierge et lui confie un vœu de chasteté. Plus loin, il chevauche en compagnie d’un cavalier maure, avec lequel une conversation religieuse s’engage. Évidemment on parle de Notre-Dame. Malgré tous ses efforts, le chevalier chrétien ne parvient pas à convaincre le musulman de la virginité de la Mère de Dieu. Bientôt le Maure « prend les devants et s’éloigne avec tant de vitesse qu’il disparaît aux regards ». Le fils des Loyola est bien perplexe. Quelles sont les exigences de la chevalerie surnaturelle en pareilles circonstances ? Doit-il poursuivre l’infidèle et le provoquer en duel, comme il aurait sans doute agi autrefois, si quelqu’un avait insulté la dame de ses pensées ? Mais cette manière expéditive de résoudre les problèmes est-elle encore de mise au service de Notre-Dame ? Le code de l’honneur divin, il le pressent, est fait de nuances plus subtiles. Ignace a recours à un expédient pour résoudre son cas de conscience. Au prochain croisement de routes, il laisse à sa monture le soin de choisir pour lui : soit la poursuite du mécréant et un combat en règle pour venger la dignité de la Vierge ; soit l’oubli et l’abandon de l’affaire à la Providence. Le cheval d’Inigo se décida pour le chemin de la tolérance et du pardon... « J’étais bien aveugle dans les choses spirituelles, malgré un généreux désir de servir le Seigneur en tout ce que je pouvais connaître [159]. »
Comme il n’y a pas de passion égoïste dans sa naïveté, Dieu le préserve de mal faire et le guérit de ses errements par ses erreurs même.
Après quinze jours de chevauchée, il se trouve assez loin sur la route de Barcelone, pour n’avoir plus à redouter qu’on reconnaisse en lui un chevalier de Loyola. Il peut « prendre la livrée et les nouvelles armes de son Seigneur », sans craindre de passer pour un saint personnage. Au village d’Igualada, il achète une tunique en toile de sac, lui descendant jusqu’aux pieds, un bourdon, une calebasse et une paire d’espadrilles qu’il accroche à la selle. Ainsi équipé, il monte vers l’abbaye bénédictine de Montserrat. Sur ces rochers de vertige où naîtra Parsifal, il veut être armé chevalier avant de partir pour sa croisade. Le bain rituel, la veillée, la communion, la bénédiction, la remise de l’épée sont tels qu’on pouvait l’attendre d’un pénitent sans pitié pour lui-même, mais dont « l’esprit est encore tout rempli d’Amadis des Gaules ». « Après avoir fait oraison et traité avec mon confesseur, je lui fis par écrit une confession qui dura trois jours. . Puis la veillée commença : « J’allai le plus secrètement que je pus à un pauvre et me dépouillai de mes habits » de gentilhomme. Ensuite « prenant mon sac de pénitence, j’allai me mettre devant l’autel de Notre-Dame », – c’était la veille de l’Annonciation –, et « tantôt à genoux, tantôt debout, le bourdon à la main, je passai toute la nuit [160] ». Il donna vraisemblablement à la communion et à la bénédiction un rôle que ne soupçonna jamais sa chevalerie mondaine. La remise de l’épée et des armes se fit en sens inverse. C’est lui qui remit son épée à Notre-Dame et lui confia ses armes, et avec elles tout son passé purifié et son avenir vierge d’égoïsme. Il ne demanda en retour que la croix de son Seigneur et ses armes, c’est-à-dire des haillons [161].
Dès que le matin de l’Annonciation parut, le chevalier mendiant repartit. Mais il a besoin de silence, loin des grandes routes, pour noter différentes choses dans le cahier personnel « qui ne le quittait pas et dont il était fort consolé ». C’est ce qui l’amène dans la solitude mariale de Manrèse. Il ne pensait y rester que quelques jours, mais la sainte Vierge l’y retiendra près d’une année. Manrèse est un gros bourg, dans un vallon verdoyant arrosé par le Cardoner. C’est un grand fief de Notre-Dame qui porte ici une couronne gracieuse de titres humbles et chers. Non contente de régner sur le Séo, son siège de souveraineté, collégiale splendide, elle veut encore s’appeler tour à tour Notre-Dame du Cloître, Notre-Dame de Valldaura, Notre-Dame du Peuple, Notre-Dame del Romey, Notre-Dame de la Guia, Notre-Dame de Joncadella, Sainte-Marie de la Guardia, Sainte-Marie de Monistrol, Sainte-Marie de Plano, Sainte-Marie de Mataderch, Notre-Dame de Villadordis [162]...
Inigo de Loyola n’est plus maintenant que « l’homme au sac », sur lequel les enfants exercent leurs railleries, tandis qu’il va d’un sanctuaire à l’autre. C’est un mendiant qui prend au sérieux sa décision de se faire mépriser : pendant un certain temps, lui, autrefois si soigneux de sa personne, laisse pousser les cheveux, la barbe et les ongles, comme les Pères du désert ; il jeûne et s’évertue à contrarier la nature et à la faire souffrir de toutes les manières. Cela ne l’empêche pas de se dépenser auprès des malades de l’hôpital de Sainte-Lucie et de vaquer à ses dévotions. Il suit avec ferveur la psalmodie des moines qui l’inonde de joie. Ce sera un vrai sacrifice pour lui, plus tard, de renoncer au chœur. Il parcourt fidèlement les Heures de Notre-Dame et différents auteurs spirituels, peut-être l’Exercitario de Cisneros, qu’on vient de publier à Montserrat, mais sûrement l’Imitation de Jésus-Christ, dont l’influence sur la vie intérieure d’Ignace ne saurait être surestimée [163]. La prière tient une place immense dans ses journées et ses nuits sans sommeil, non seulement les offices et la prière vocale, mais encore l’oraison mentale à laquelle il consacre sept heures par jour, à genoux [164].
Tous les excès de cette ascèse et de cette spiritualité violentes sont la réaction d’un autre chevalier de la Roche pauvre, contre le mondain de la Renaissance, qui hier encore goûtait l’exaltation d’un naturalisme « sans péché ». Inigo de Loyola affirme durement que l’homme ne saurait se suffire et devenir un Dieu par le seul épanouissement de ses énergies naturelles. Cet effort d’abaissement et d’humiliation a laissé des traces bien visibles dans les Exercices, surtout dans le texte des premiers manuscrits : « Satan... repaît les hommes de la petite volupté du moment, de la douceur des richesses et des honneurs, sans mentionner ni les peines éternelles, ni la brièveté de la vie humaine... ces aveugles ne considèrent plus ni ne recherchent l’honneur éternel... ils jugeront malheureux ceux qui suivent le Christ par le vrai chemin, tout en se croyant heureux, eux seuls, qui triomphent en ce monde... aboutissant à un orgueil arrogant [165]. »
Le remède à cette ivresse, c’est « la pauvreté actuelle, c’est le désir de souffrir pour le Christ des injures, des afflictions et des opprobres, d’où naît le mépris de soi, l’humilité ». Mais cet héroïsme négatif a, lui aussi, ses limites. L’ascète passe des mois dans un vertige étrange : la joie et les élans généreux alternent avec des tentations compliquées et des angoisses effrayantes. Il ne sait plus que penser. Il se disait souvent : « Quelle vie nouvelle est ceci... Bien des fois j’eus de véhémentes tentations de me précipiter par une grande ouverture que je voyais dans ma chambre... mais je criais à haute voix : Seigneur, je ne ferai rien qui vous offense. » À bout de forces, il tombe à genoux et s’écrie : « Seigneur, secourez-moi, car je ne trouve aucun remède auprès des hommes. Oh ! si je le pouvais trouver, rien ne me coûterait. Montrez-moi vous-même, Seigneur, où est le remède. Fallût-il suivre un petit chien, pourvu qu’il me conduise au remède, j’irai [166]. » Dans sa candeur, le pèlerin redouble d’austérité.
On peut admettre le jugement de Laynez sur cette enfance spirituelle, sur ce qu’Ignace appelait lui-même sa « primitive Église » : « Il lui semblait alors qu’on pouvait mesurer entièrement la sainteté à la dureté extérieure de vie, et que ceux-là devaient être aux yeux de Dieu les plus saints qui faisaient les pénitences les plus rudes [167]. » Sur cette manière de se « vaincre soi-même », Laynez ajoute que « pendant les quatre mois qui suivirent son départ de Loyola, Ignace ne connaissait pour ainsi dire rien aux choses de Dieu ». Sa conversion avait bien commencé par une lueur sur la différence des esprits, sur la qualité diamétralement opposée de la joie naturelle et surnaturelle. Mais le renouveau intérieur consistait « davantage dans une simple intention et une bonne volonté que dans la lumière de l’entendement [168] ». L’analyse consciencieuse de ses états d’âme, les notes spirituelles, les conseils des confesseurs auxquels il se soumet avec une docilité parfaite, ne suffisent pas à l’éclairer sur les mouvements de son âme [169].
C’est le Seigneur lui-même qui doit « le réveiller comme d’un rêve » et le prendre par la main, le conduire « comme fait un maître d’école pour son enfant [170] ». La plus révélatrice de ces « explications », c’est celle qui se produisit, un jour, en chemin : « Une fois que j’allais, pour ma dévotion, vers une église qui était à un peu plus d’un mille de Manrèse, par le chemin qui longe la rivière du Cordoner, je m’assis en route en face de la rivière qui coulait profonde. Et là, les yeux de mon entendement commencèrent à s’ouvrir. Ce ne fut pas une vision. Mais il me fut donné de comprendre beaucoup de choses, soit spirituelles, soit de la foi, soit des lettres humaines ; et dans une clarté si grande que tout cela me semblait nouveau. Impossible de dénombrer les points particuliers qui me furent alors enseignés ; ils sont nombreux. Il suffira de dire que je reçus une grande lumière dans l’entendement. En sorte que si on mettait ensemble tous les secours qui me sont venus de Dieu dans ma vie et tout ce que j’ai pu acquérir de savoir, en tout cela à la fois, il ne me semble pas avoir autant acquis que dans cette unique circonstance [171]. »
Une des grâces les plus précieuses fut, sans contredit, le don de discerner continuellement à leurs effets les influences du bon et du mauvais esprit. Il possède bientôt un art consommé pour distinguer si les inspirations intérieures portent le signe serein de la charité, ou le stigmate brillant et raffiné de l’astuce « de l’ennemi de la nature humaine ». Ce « discernement », ou encore cette discreta caritas, cet amour éclatant, sera le génie de Loyola, qui, mieux que le savoir ou l’esprit critique, distingue les invites du Seigneur, à travers les « consolations et désolations », à travers les fluctuations incessantes de la lutte spirituelle. Dès que son âme s’agite, il sait contrôler sa direction, pour que « le commencement, le milieu et la fin de ses pensées, pour que tout le cours de ses intentions, soient droits et purs d’amour-propre ». Combien mieux que Calvin il déjoue les finesses, les ruses et les « manœuvres féminines » par lesquelles le Malin éprouve le point faible de chaque caractère, pour le pousser à bout, en le faisant simplement abonder dans son sens [172].
Mais cette sagesse surnaturelle, il la paie du même prix que Calvin avait payé sa virtuosité dialectique : en sacrifiant sa santé. Cependant c’est pour s’élever aux honneurs et dépasser les autres que le lettré de Noyon, en jeûnant et veillant, pose « les fondements de ce grand savoir et de cette singulière mémoire » qui assurèrent sa supériorité. Mais c’est pour s’abaisser et se vaincre lui-même que le pèlerin de Manrèse « refuse toute satisfaction à son corps » dont « la résistance et la bonne constitution furent mises à une rude épreuve [173] ». Ainsi la vie intérieure d’un homme simple et droit qui « réfléchit dans son cœur » le ramène au sens du réel et aux justes proportions. Les exigences de la gloire de Dieu doivent s’accorder avec celles du salut des âmes. L’amour du prochain retranche peu à peu les excentricités de son ascèse. Il recommence à se tailler les ongles et les cheveux, à manger de la viande, à interrompre son silence pour parler de choses spirituelles et à communiquer aux hommes qui les recherchent les secrets de sa joie [174].
Malgré les grâces insignes et les visions dont la Sainte Trinité le favorise, il est à l’abri de l’exaltation mystique qui soulève alors les alumbrados. Ne se souviendra-t-il pas de ses expériences de pèlerin, quand il affirmera que « la plupart des personnes qui s’adonnent à de trop longues oraisons aboutissent à des impasses [175] ». Mais la valeur du sacrifice demeure, aussi bien pour garantir le désintéressement dans la prière, que pour barrer la route à l’illuminisme : « Un homme vraiment mortifié, dira-t-il, devrait pouvoir, en un quart d’heure, s’unir à Dieu dans l’oraison... Sur cent personnes faisant profession de haute oraison, quatre-vingt-dix au moins sont dans l’illusion [176]. »
Sans doute qu’à cette époque Ignace de Loyola était moins réservé. « Alors qu’il n’était qu’un homme simple, nous dit Laynez, qui ne savait que lire et écrire, il n’en commençait pas moins à écrire un livre », les Exercices [177]. Il n’y sera guère question de mystique et de théologie, mais d’expérience : une « Imitation de Jésus-Christ », transformée en méthode militaire pour les nouveaux croisés désireux de suivre leur Roi, partout où il irait, sur les chemins des privations et du déshonneur, puisque le Christ fut effectivement pauvre et méprisé. Il ne voit pour l’instant rien de plus dur que de prendre la mer et de « monter à Jérusalem », pour y souffrir, avec le Christ, tout ce que peut lui promettre la brutalité des Infidèles.
Voyage insensé et prodigieux. Ignace fait fi de toutes les précautions de la prudence humaine [178]. Avant de s’embarquer, il s’aperçoit qu’il a oublié de vider ses poches de quelques piécettes reçues en aumône. Il revient au rivage pour les déposer sur un banc. S’il n’avait pas trouvé de bateau prêt à le prendre pour l’amour de Dieu, il aurait essayé de faire la traversée sur une planche [179]. À l’aller et au retour de Palestine, sur les routes d’Italie, parcourues par les armées en guerre et l’épouvante de la peste, il va droit son chemin, ne se laissant attendrir que pour aider des compagnons de misère à l’âme moins chantante que la sienne. Car ce n’est pas un chevalier à la Triste Figure, mais un clochard mystique qui se réjouit d’être abandonné seul dans la nuit, ou d’être arrêté, fait prisonnier, dépouillé, malmené, bafoué. Et, à cette folle insouciance, jamais rien de fâcheux n’arrive. À Venise, le médecin lui prédit la mort prochaine s’il embarque, malade comme il est. Et c’est le mal de mer qui le guérit. Il échappe ainsi aux brigands italiens, aux corsaires, au naufrage, aux menaces de mort des Turcs pillards.
Enfin Jérusalem : « En voyant la ville, le pèlerin éprouva une grande consolation [180]. » Quelle joie de fouler la terre sainte, pleine encore du souvenir des patriarches et des prophètes, de suivre les chemins que le Fils de Dieu a lui-même parcourus. Les yeux du Christ se sont arrêtés sur la ligne de ce paysage, sur ces rochers et ce torrent. Il a respiré cet air lumineux. Il a causé avec ces fleurs des champs et ces figuiers, il a dormi sous des oliviers tout pareils. Une procession de moines accueille les pèlerins, et leurs chants accompagnent la marche des voyageurs aux abords du ciel. À voir la vivacité avec laquelle il se représente, dans les Exercices, les scènes de l’Évangile, les personnages, leurs attitudes et leurs conversations, on peut imaginer si notre pèlerin a respiré, senti, regardé et touché le mystère et ce qu’on a appelé « le sacrement de Jérusalem [181] ».
Il voudrait rester toute sa vie dans le voisinage du Saint-Sépulcre, de Béthanie et du Jourdain, sans protection, sans moyens de subsistance, comme un vrai disciple de celui qui n’avait pas de quoi reposer sa tête, mendiant au milieu des Infidèles. Mais le Provincial des Franciscains, parlant comme délégué apostolique, lui intime, au nom de l’obéissance, l’ordre de repartir avec les autres, au bout de quinze jours. Il faut donc qu’il revoie exactement, pour les graver dans son cœur, le sommet du rocher où fut plantée la Croix, les dimensions du Cénacle, la misère de la grotte de Bethléem... Au dernier moment, il risque de tomber entre les mains de cavaliers détrousseurs qui surveillent les abords de Jérusalem, pour sortir rapidement, tout seul, jusque sur le mont des Oliviers, parce qu’il avait oublié de noter « de quel côté se trouvait le pied droit du Christ ou de quel côté le pied gauche au moment de l’Ascension ». On peut bien le battre au retour, car il s’est mis en retard, mais lui ne voit que le Christ présent partout devant ses yeux : il emporte comme un trésor quelques fleurs, quelques pierres, quelques rameaux en souvenir du « campement que le Christ Notre-Seigneur, aimable et beau, a établi dans un endroit modeste près de Jérusalem [182] ».
En abandonnant la carrière des armes, l’Espagnol, le chevalier courtois devenu pèlerin, n’en reste pas moins un « dur ». Mais sa violence ne s’en prend plus qu’aux ennemis intérieurs, orgueil de la vie, concupiscence. Son cœur, détaché des idoles de chair, déborde de tendresse et de joie pour les pauvres, les malades et surtout pour les personnes ardemment aimées du Roi et de sa Mère. Le pèlerin est plus que jamais amoureux ; il pleure souvent, mais jamais de chagrin : la consolation, la joie du Seigneur, alimente en lui des sources de bonheur, dont l’excès se traduit par des larmes abondantes [183].
À l’opposé, l’influence de l’humanisme avait adouci l’âpreté de Calvin, jusqu’â le rendre « séduisant ». Mais la conversion va faire sourdre en lui une colère qui imprégnera jusqu’aux plus belles pages du génial écrivain. Dans cette indignation cependant, les exigences morales d’une immense multitude vont se reconnaître.
Aussi Calvin ne regrettera-t-il jamais ce beau cri de protestation qu’approuvent les échos les plus sincères.
Dans ses longs entretiens, seul à seul avec Dieu, Loyola met beaucoup de temps à revenir aux hommes. Calvin, tout de suite, s’abandonne sans retour au vertige d’un mouvement collectif qui a toutes les apparences de ne tendre que vers Dieu.
Après s’être perdu, Loyola se retrouve changé. Calvin se défait en quelque sorte de son âme, pour ne plus être que cette flamme commune entre tous les croyants et fidèles persécutés. Ainsi croit-il renoncer définitivement à lui-même, en continuant, avec toujours plus de passion, à servir la cause de Dieu. Il ne pense plus à lui-même, il s’oublie, il se donne tout entier. Cependant, il est bien toujours là, d’autant plus présent et important qu’il ne veut plus faire attention à lui-même.
II
LE PROPHÈTE MALGRÉ LUI
1. L’état d’âme
Un des historiens calvinistes des mieux renseignés et des plus clairvoyants, Abel Lefranc, a dit de Calvin : « Cet homme d’un caractère si entier, doué d’une activité si extraordinaire, n’a jamais eu d’initiative. Il fallait qu’une impulsion lui fût donnée pour le décider à agir. Mais cette dernière une fois reçue, sa puissante nature se manifestait dans toute sa plénitude. C’est dans ce sens qu’on peut dire que l’homme qui codifia la croyance protestante et organisa la révolution religieuse, a été, pour ainsi parler, réformateur malgré lui [184]. »
S’il faut en croire J. Pannier, il serait passablement oiseux de chercher à savoir quelles furent les causes profondes et les motifs personnels qui amenèrent Calvin, lors du discours de Cop, à rompre avec l’Église : « Ce qui se passa dans le for intérieur de Calvin vers la mi-octobre 1533, nous l’ignorons, et nous l’ignorerons toujours [185]... » Les aveux tardifs du réformateur sur sa conversion sont presque toujours indirects ; ou bien ils sont trop réticents, ou bien ils disent trop, déformés qu’ils sont par son penchant pour la satire et l’hyperbole. Il est probable cependant que ces causes furent multiples, intérieures et extérieures, et que toutes les influences ont agi pour leur part dans le même sens, aussi bien l’ambiance familiale que les relations picardes, aussi bien l’entraînement des milieux humanistes que les préférences de son caractère.
Dans son entourage, Calvin a déjà recueilli toutes les impressions déterminantes en faveur, sinon d’une révolte, du moins d’une séparation. Le père, Gérard Cauvin, représente, dans sa lutte avec le clergé, les tendances sociales et économiques d’une bourgeoisie avide de s’émanciper aux dépens de l’Église. « Peu de municipalités furent aussi nettement laïques » que Noyon [186]. Le fils aîné incarne l’individualisme et l’indiscipline obstinée de beaucoup de gens d’Église à cette époque : excommunié pour avoir battu un massier et un clerc, pour avoir foulé aux pieds ses obligations ecclésiastiques, il meurt en refusant les sacrements et sera enseveli sous les fourches patibulaires (1537). Son proche parent Robert Olivétan, qui le devance à l’Université, lui ménage des relations évangéliques et le présente à des correspondants réformés étrangers, entre autres à Bucer. D’autant plus qu’à Noyon, « il existait depuis des années un mouvement protestant des plus sérieux », capable de tenir en échec toutes les tentatives de répression ecclésiastique [187]. Mais Abel Lefranc n’exagère-t-il pas ? « Ce qui ressort d’une étude attentive des faits, c’est que Calvin est déjà sorti protestant de sa ville natale... Nullement l’initiateur de ce mouvement de la réforme (noyonnaise), il n’a fait que s’y rallier tardivement sans doute ; il s’est trouvé entraîné et forcé de suivre les siens... » Bref, « dans la grande affaire de sa conversion, le Réformateur n’a fait que suivre l’impulsion donnée par son entourage [188] ».
Après avoir été « obstinément adonné aux superstitions de la papauté [189] », c’est-à-dire consciencieux jusqu’au scrupule, après avoir cherché en vain dans une religiosité formaliste le remède à ses angoisses, au tourment que des faiblesses cachées renouvellent sans cesse, il désespère de trouver dans les sacrements et les pratiques l’efficacité magique que sa sensibilité attendait. La recherche de « l’apaisement des consciences » joue un trop grand rôle dans la formation de la doctrine de Calvin pour qu’elle ne corresponde pas à une préoccupation fondamentale. Mais sa nature impressionnable, à laquelle une éducation répressive insuffla cette morne inquiétude, avait beau exiger de sa piété rigide le « soulas et le confort » qu’elle ne pouvait lui donner. Il restait toujours « bien eslongné d’une certaine tranquillité de conscience. Car toutes fois et quantes que je descendais en moi, ou que j’élevais le cœur à toi, une si extrême horreur me surprenait qu’il n’était ni purifications, ni satisfactions qui m’en pussent aucunement guérir. Et tant plus je me considérais de près, de tant plus aigres aiguillons était ma conscience pressée [190] ».
Calvin a vérifié le principe de Loyola : « La tiédeur excessive, aussi bien que la ferveur exagérée, engendrent les maladies de l’âme. » La conversion suit un retournement de ses besoins affectifs, un renversement des valeurs, opéré par la déception, l’ennui et l’esprit critique. Après en avoir trop fait, en vrai Cauvin, il passe à l’extrême opposé, se moquant des efforts tentés « pour appointer Dieu par des œuvres de surérogation ». Les « moyens de sanctification » multipliés par une dévotion mal éclairée, les outrances d’éducateurs « bigots », se vengent par le dégoût. Comment cette quantité surabondante de pratiques peut-elle avoir pour résultat une baisse dans la qualité de la vie religieuse ?
Le clergé et les moines offraient depuis longtemps une cible trop facile aux traits des humanistes. Calvin retourné n’y ajoutera qu’un peu plus de vigueur et d’indignation : « Ils mettent toute leur sainteté en de menus bagages que Dieu ne requiert point et ils laissent ce que Dieu commande par sa Loi... Quand ils font plus que Dieu ne leur a commandé, il leur semble... qu’ils le contentent d’un tel payement : ils font leur compte là-dessus ; quand ils auront jeûné leurs vigiles, quand ils n’auront point mangé de chair le vendredi, quand ils auront fait beaucoup d’agios, ouï la messe... pris l’eau bénite... il leur semble que Dieu ne leur doit plus rien demander et qu’il n’y a plus rien à redire en eux [191]... » Comme tout intellectuel dont la foi ressemble plus à une culture de l’esprit qu’à un abandon de l’amour-propre, il regarde de très haut les simples qui n’en ont jamais assez, « qui ayant ouï une messe pensent devoir retourner à la seconde et faire tant de cérémonies que rien plus, et puis ceci, et puis cela, et telle offrande et puis telle dévotion à un tel Saint et puis aller en un tel pèlerinage, à un tel jour de fête... il faudra faire tant de mea culpa, prendre tant d’asperges d’eau bénite, que ce n’est jamais fait. Et puis en leur confesse, ils n’en auront jamais assez dégorgé, c’est toujours à recommencer [192] ».
Victime de la contrainte et du surmenage qu’il s’impose dans tous les domaines, Calvin étouffe sous le joug du seul devoir. Or, c’est l’angle sous lequel il s’est habitué à envisager toute la religion : il n’y a vraiment pas d’issue dans la forêt des lois. À force de donner un sens juridique aux mille règles de la liturgie et de la piété, il s’exaspère de se trouver prisonnier du filet qu’il a lui-même tissé. Un angoissé, un scrupuleux : tourmenté d’ailleurs par un puissant instinct de domination, il ne connaîtra qu’en se révoltant un « soulas » à ses inquiétudes. Ces problèmes n’ont de solution que dans une religion d’amour et de confiance. Les mystiques, dont Loyola, qui cherchent le progrès dans la ligne de la charité, ne sont pas gênés, mais au contraire favorisés par les inventions innombrables de la piété traditionnelle. Elle leur permet effectivement de « toujours recommencer » dans la joie, comme si « rien n’était jamais fait », comme si une ardeur inépuisable les animait.
La vivacité avec laquelle le jeune converti « luthérien » combat la distinction entre le péché mortel et le péché véniel, semble remonter à des blessures anciennes. Mais là où de jeunes consciences timorées s’élargiraient en déclarant que le péché n’est rien, Calvin, plus aigu, ou plus atteint, de toute façon plus épris de seule « justice », se console, dans sa ligne pessimiste, en affirmant que tout est péché mortel, « qu’il ne s’est jamais trouvé œuvre d’homme (même) fidèle qui ne fût damnable ». Le « soulas et confort » consiste à transformer la nécessité de péché en un motif universel de confiance. Les « moindres concupiscences » sont mortelles... Au lieu que la consolation spirituelle soit un simple fruit de l’amour, une récompense accessoire en vue de laquelle le mystique se gardera bien d’agir, elle occupe ici le centre de la perspective. Il faut échapper au désespoir de l’impossible perfection obligatoire, en se réfugiant dans cette foi littéralement gratuite et consolante que les péchés des élus, eux, sont véniels [193].
Ces états d’âme, que nous ne pouvons que schématiser, n’aboutiront à la conscience claire que par un long et obscur cheminement. Le jeune intellectuel aspire à la noble satisfaction de la liberté évangélique. Le mot et l’idée faisaient alors fureur, depuis que Luther, après Érasme, avait tenté de condenser en elle « toute la somme de la vie chrétienne ». Mais la protestation de Luther, si émouvante et si terrible contre l’extériorisation et le formalisme de l’Église, recevra, en passant par la tournure d’esprit de Calvin, une sorte de transmutation de valeur. Il y a déjà loin de Paul à Luther ; et de Luther à Calvin la distance ne sera pas moins négligeable, malgré l’idéal commun d’édifier une « somme de la religion chrétienne [194] ».
Le jeune juriste n’en est pas encore là. À la veille de la Toussaint 1533, Calvin est sans doute un de ces « bibliens évangéliques » indécis que l’humanisme a rendus critiques à l’égard du passé catholique. Sa désaffection tient du désenchantement et de la suffisance. Très idéaliste, incapable de médiocrité, il voudrait être aussi parfait que le croient ses admirateurs. « La conscience pressée d’autant plus âpres aiguillons, il ne lui demeurait d’autre soulas, ni confort que de se tromper soi-même en s’oubliant [195]. » Toujours laïque, il garde sa « cure au Pont-l’Evêque où il a prêché parfois avant qu’il se retirât de France ». Émule des Briçonnet, Roussel, Lefèvre, il est retenu dans la tradition par le « respect de l’Église » et par les titres et bénéfices qui lui assurent crédit et indépendance.
Désenchanté des « Rhétoriciens et Philosophes, Démosthène ou Cicéron, Platon ou Aristote, qui attirent, délectent et émeuvent jusques à ravir l’esprit, mais dont l’efficace n’est que fumée », il attend que les Écritures viennent « le poindre, percer son cœur et se ficher vivement au-dedans de lui [196]... ». Il attend d’être « engagé ».
Pour Calvin, l’attachement à la cause évangélique reste une curiosité platonique et incertaine, aussi longtemps que le poids des instincts et des tendances affectives n’a pas été déplacé par une violente secousse. Mais le choc qui fait chavirer la balance de ses sentiments bascule par-dessus bord la théologie mal construite du curé laïque de Pont-l’Evêque. Et voilà pourquoi l’intervention de Calvin dans la Réforme française entraînera, malgré lui, l’Évangélisme du plan idéaliste sur le plan politique et même sur les confins de la psychose collective. Cette passion de justice et de vengeance, malgré ses motivations généreuses, se mêle, à la source, à des revendications troubles et sourdes qu’il sera presque impossible de purifier.
Une nature exceptionnellement sensible et puissante réussira, de la sorte, à créer le mythe religieux auquel vont s’accrocher les instincts élémentaires des foules. Sans préjuger de la valeur théorique du message calviniste, nous parlons de « mythe » pour caractériser son point de départ souterrain, le mélange de facteurs instinctifs qu’il charrie et le développement qu’il produira dans la mentalité collective chrétienne. Aussi grandiose que puisse paraître ce « mythe », sa nature est typique et ne saurait être confondue avec les « mystiques » antérieures ou contemporaines à base de don volontaire et de sereine charité.
Le professeur protestant E.G. Léonard observe qu’on « se représente souvent à faux, dans les milieux protestants, le sens de l’évolution de la spiritualité chrétienne... Disons qu’à la veille de la Réforme la religion était devenue une vie [197] ». Assurément. Et c’est à cette vie que les novateurs ont puisé le meilleur de leur substance. Cependant le même idéal religieux a une résonnance toute différente dans l’âme d’un contemplatif maître de ses instincts, ou dans le moi hyperémotif d’un révolté. Le même Dieu, la même révélation alimentent ici un amour, un désir d’union qui réconcilie tous les contraires, alors qu’ils excitent ailleurs une réaction de défense et un besoin de revanche.
Quand se produisit cette conversion, ce renversement de sympathie, ce « court-circuit » ? Mieux vaut s’en tenir aux dates certaines, puisque le principal intéressé n’en connaît pas, ou les voile sous des formules vagues « à peu près toujours les mêmes », telles que « commençant à sortir des ténèbres de la papauté... ayant acquis un léger goût de la saine doctrine » etc. [198] Voici les précisions les plus plausibles établies par Pannier : « Ouvertement, officiellement en quelque sorte, Calvin a rompu les liens qui l’attachaient aux cadres de l’Église romaine le 4 mai 1534, jour où il a résigné ses bénéfices ; publiquement déjà il a rompu avec l’esprit de cette Église le 1er novembre 1533, jour où il a fait prononcer par Cop son discours sur les « pauvres en esprit ». C’est bien cela, sauf que cette rupture de la Toussaint 1533 n’en aurait pas été une, si elle n’avait été d’abord émotive et sentimentale. Rien ne prouve d’ailleurs qu’il soit l’auteur du fameux discours [199]. »
Jusqu’à la fin du mois d’octobre 1533, son esprit, bien que hardi et inquiet, cherche dans tous les sens des certitudes cohérentes, dans le moralisme de Montaigu, dans le légalisme de l’Estoile, dans la phraséologie d’Érasme, dans la ferveur biblique de Lefèvre et de Luther : toutes ces ébauches de solution se confondent, aussi longtemps que le fixatif d’une émotion violente n’aura pas dessiné la courbe indélébile de ses préférences. Le 1er novembre, quand ce nerveux éprouva la surprise de voir un triomphe se muer subitement en danger et en panique, il en conçut une telle colère que son cœur ulcéré ne s’en remit jamais [200].
Malgré les délits des siens, on lui offre à Noyon, sans doute pour le rattacher à l’Église, le poste de confiance d’official, de juge en matière de foi. Un peu plus, le jeune Calvin aurait pu être chargé, dans son propre pays, de poursuivre les hérétiques, c’est-à-dire la faction à laquelle les siens appartenaient. Même pour cet hypersensible, chez lequel les instincts de pitié et de cruauté voisinent et alternent, cette option n’était pas impossible. Mais pour réagir, il lui faut d’autres stimulants et des objectifs chargés d’une autre valeur émotionnelle. Entre l’Église et la Réforme il ne voit probablement pas encore de choix à faire : les deux pourraient très bien coïncider. Bien sûr, il se sent tiraillé entre l’orthodoxie et les novateurs, et cette tension ne va pas « sans gémissement, ni sans larmes », ni sans plaisir non plus ; car le danger attire, exalte en lui ce besoin d’arriver, d’arriver il ne sait pas où, mais le plus haut possible [201].
Cependant l’hérésie et le schisme sont toujours à ses yeux des « crimes très griefs » qui l’épouvantent : « Moi, offensé de cette nouveauté, à grand-peine ai-je prêté l’oreille ; et si je confesse que, au commencement, je y ai vaillamment et courageusement résisté. » Cette « révérence » et le sentiment très net de sortir de l’unité tiennent en suspens son besoin de s’affirmer. Rétracté, il ne se libérera qu’avec une détente violente ; émotif et sentimental, si jamais cet agressif se déchaîne, il poursuivra une justice revendicative ; scrupuleux, il ne cédera au besoin de nouveauté qu’en se couvrant des apparences de la soumission, du service et de la fidélité. Il ne quittera jamais l’Église, SON Église : non ! « Contre cette Église, nous n’entreprenons nulle guerre [202]. »
La fidélité de ce génie, dont l’instabilité psychique égale la fixité intellectuelle, pourrait, avec un peu de chance, se maintenir longtemps sans trouble, bien qu’elle ne tienne qu’à un fil. Mais que ce fil, par accident, vienne à se rompre, et c’en sera fait pour toujours. Comme tant d’autres clercs, à cette époque, Calvin aurait volontiers continué dans cet attentisme critique et frondeur, sans cesser de se croire un homme d’Église : « Il y a bien grande différence entre se départir et abandonner l’Église et se travailler à corriger les vices dont l’Église même est souillée et contaminée. » Il n’ambitionne que de « réduire la Profession chrétienne en sa propre source, alors que ceux qui étaient reçus pour intendants de la foi, ni ils n’entendaient Ta parole, ni ils s’en souciaient beaucoup [203]. » Il imagine se ranger « du côté de pasteurs et d’évêques qui se considéreraient comme voleurs s’ils utilisaient, à leur profit, plus de biens ecclésiastiques que ce qui convient à leur honnête entretien ».
Partout dépaysé, à cause aussi bien de l’inquiétude incurable de son cœur que de la force incisive de son esprit ; toujours inadapté à la simplicité de n’importe quel milieu ordinaire, Calvin n’appartient, au fond, à aucune famille spirituelle. Il ne s’appartient qu’à lui-même et tentera de plus en plus de s’approprier, où qu’il se trouvera, toute la réalité ambiante. Il ne s’assimile pas plus intérieurement, aujourd’hui, la doctrine catholique, qu’il ne pourra, demain, s’accorder avec la pensée de Luther et de Zwingli. Sur le plan affectif, le même ressentiment soudera leur coalition contre Rome, mais sur le plan spirituel, ils seront bien en peine de se rallier à une mystique commune, et même de savoir où tendent positivement leurs efforts immenses de Réforme.
2. Le tournant
La conversion de Calvin a deux sens bien différents et souvent confondus. Tantôt il s’agit de la décision définitive de rompre avec les milieux catholiques. C’est la subita conversio, dont il est question dans la préface aux commentaires des psaumes [204]. D’autres fois, on entend par ce mot toute la longue évolution intérieure et extérieure, qui amena le clerc studieux à se mêler aux querelles d’opinions qui divisent peu à peu la France religieuse en deux partis, au sujet desquels le cœur et la tête de Calvin ont beaucoup de peine à se mettre d’accord. Un coup de théâtre inattendu le force à se compromettre et bientôt, malgré lui, à sortir de l’Église pour en fonder une nouvelle.
J. Pannier note avec subtilité que le mot conversio subita pourrait bien avoir un sens passif : « La conversion “subite” dut être en tout cas une conversion “subie” [205]. » Comment subit-il cette opération d’être chassé à l’improviste hors de l’Église ? Vers la fin d’octobre 1533, il raconte à son ami Daniel la farce jouée au collège de Navarre contre Roussel et la reine Marguerite. Il en parle d’une façon impersonnelle, en spectateur curieux, semblant redouter que « ce très mauvais exemple puisse stimuler la passion de ceux qui recherchent les nouveautés ». Calvin n’est pas du tout fixé. Dans quelques jours, un évènement « providentiel » va dégager le prophète malgré lui « du bourbier, dont il était bien malaisé qu’on le pût tirer [206] ». Que s’est-il passé ?
Calvin a un brillant ami, Nicolas Cop, médecin, jeune recteur de l’Université, qui vient de déclarer la guerre à la faculté de théologie. La Sorbonne a mis à l’Index le « Miroir de l’âme pécheresse » de Marguerite de Navarre, sans même observer les formalités qui prévoyaient que la censure fût communiquée aux autres facultés. Le roi alerté exprime son mécontentement et Nicolas Cop en profite pour dresser un blâme public aux théologiens téméraires et pour les humilier en les obligeant à désavouer la censure prononcée irrégulièrement. La joie de Calvin en racontant cette victoire a, pour une fois, quelque chose de juvénile. Mais ne pourrait-on pas transformer ce succès en triomphe ? La fête de la Toussaint offre une occasion apparemment encore plus favorable de remettre les théologiens en place. Avec la collaboration de Calvin, Cop prépare un discours à la fois évangélique et exaspérant [207]. Il prêche les béatitudes, la simplicité, la douceur, avec un style suffisant et agressif ; il exhorte à l’humilité, à la paix et à la concorde avec des pointes qu’on dirait calculées pour être blessantes. « Rien n’y fait penser que l’auteur songeait à s’exclure de la communauté romaine. » Les deux amis voulaient profiter de la conjoncture politique, qu’ils croyaient propice, « pour poursuivre devant le grand public la discussion des principes qui s’étaient heurtés à la séance universitaire du 24 octobre [208] ». C’était une épreuve de force, qui ne semblait pas devoir être aussi dangereuse. Si le discours est vraiment de Calvin, il n’est qu’un pauvre manifeste en faveur de l’Évangélisme, un témoignage trop calculé pour être habile, rendu par personne interposée, une de ces audaces réticentes, comme sa vie en offre de nombreux exemples, qui exposent, plus que sa propre personne, le truchement dont il se sert [209]. Mais la provocation était maladroite. Les théologiens, les moines, saisissent l’occasion de la revanche qui leur est offerte et, pour venger le double affront qu’ils viennent de recevoir du nouveau recteur, le traduisent devant le parlement. Cop, hier sûr de son impunité, est menacé d’arrestation et de pire encore. Il s’enfuit avec tant de précipitation que, dans son désarroi, il emporte le sceau de l’université. Calvin, lui-même, a si peu prévu cette tournure des évènements qu’il prend peur et se cache, tandis qu’une cinquantaine des amis de Cop sont arrêtés.
Le discours de Cop contenait bon nombre de formules héroïques, empruntées aux thèmes spirituels en vogue, qui passeront dans la vie et les écrits de Loyola et de Xavier : « Ne chercher que la gloire de Dieu ; ne rien faire par crainte du châtiment... Le Seigneur exige un cœur libéré de toute attache à la créature... Il faut mépriser tous les biens et tous les honneurs humains... Faut-il craindre ceux qui peuvent perdre le corps, mais non l’esprit [210]... » Ce mépris de la vie et de ses biens, qu’Ignace et ses compagnons pratiqueront joyeusement et sans phrases, ne présente pour Calvin qu’un charme littéraire, qui s’évanouit à l’approche des huissiers. L’ami du Tillet le blessera sûrement un jour en lui disant franchement : « C’est devant ceux à la plus grande part ou aux principaux desquels vous savez que votre doctrine est agréable, non pas ailleurs que vous la maintenez. Car vous avez abandonné votre nation, parce que vous ne l’y avez osé divulguer et maintenir publiquement [211]. »
Calvin qui, hier encore, ne savait pas bien ce qu’il voulait, sera bientôt sûr de son affaire. L’Église refuse de se laisser conduire et transformer par l’éloquence d’un médecin, soutenu de l’érudition d’un docteur ès lois : c’est un signe que Dieu le veut ailleurs. Tout n’est que le jeu de « la Providence secrète » qui, ayant des vues particulières sur le prophète de la prédestination, « le fit finalement tourner bride d’un autre côté ». Que cette « volte spirituelle », en réveillant les catholiques fascinés par l’Évangélisme, ait sauvé l’Église traditionnelle en France, c’est un aspect de la question qui n’intéresse pas Calvin [212]. Il l’a échappé belle : « Jamais notre Seigneur ne m’a amené jusque là, qu’on m’ait demandé profession de foi... je loue le Seigneur qui... a supporté mon infirmité, en ce qu’il ne m’a jamais éprouvé par examen, ni par prison [213]. » Les justifications théologiques ne lui feront jamais défaut. Cependant le sermon de la Toussaint était un échec, dont le coup était capable de convertir un Cauvin.
Du jour au lendemain, il cesse d’être un simple intellectuel, curieux de sensation. Il partage désormais le sort des suspects et, sans l’avoir cherché, se trouve confondu dans les rangs d’un parti encore très mêlé, dont les velléités de « réforme » et les appréhensions communes serraient les liens de sympathie. « Persécuté », le jeune avocat s’intéresse tout différemment à la cause, qui devient maintenant la sienne.
Les différentes orientations de la vie de Loyola, depuis sa conversion, ont toutes été mûries dans une méditation personnelle, et le choix des étapes successives est fixé suivant les règles d’une « bonne élection », telles qu’il les a consignées dans les Exercices : « Avec un regard simple, dirigé exclusivement vers le but de louer Dieu... avec la certitude que l’objet du choix est bon en soi, ou au moins indifférent et situé dans les limites permises par la sainte Mère, l’Église.... en suivant docilement les mouvements intérieurs de l’Esprit et de la grâce et, sauf inspiration spéciale, dans un temps tranquille... quand l’âme n’est pas agitée par les divers esprits, quand elle peut se servir de ses puissances naturelles, librement et tranquillement [214]... » L’évolution de cette âme, même quand elle paraît étrange et tâtonnante, se poursuit sans trouble, dans la clarté.
La première volte-face de Calvin, en revanche, a été subie, et ce qu’il nous avoue de ses déterminations ultérieures renforce encore cette impression de fatalité. Ce n’est pas l’amour du paradoxe qui nous amène à constater que Calvin est devenu « prophète malgré lui ». Il suggère d’ailleurs assez clairement lui-même, plus tard, comment les choses se sont passées. Chassé de Paris par la subita conversio, dans sa cachette, dans « le nid paisible de Chaillot », puis dans la solitude confortable et la belle bibliothèque de son ami du Tillet, il se met à étudier fiévreusement les questions pour lesquelles, avant de les connaître, il avait dû prendre parti. Mais le discours de Cop et le bruit qu’il provoqua attirent sur son confident Calvin, l’attention des « partisans ». On le recherchait tellement que « toutes les retraites et lieux à l’écart m’étaient comme écoles publiques ». On imagine facilement comment à Claix, à Angoulême, à Orléans et ailleurs, les Évangéliques auront félicité l’ami et l’inspirateur de Cop, le dialecticien et l’avocat si bien doué. Ne s’est-il pas vu sollicité par tout le monde, comme un jour Pascal devait l’être par Arnauld : « Vous qui avez une si bonne plume, vous pourriez faire quelque chose pour nous, pour la cause. »
Il se sent de plus en plus solidaire : trop de braves gens comptent sur lui pour qu’il puisse se dérober. La préface de la Psychopannychia, écrite encore avant le départ de France, souligne bien la force de cet entraînement : « Si dans cette nécessité, je dissimulais ou me taisais, je serais traître à la vérité [215]. » Cependant, cette réfutation d’une erreur secondaire des Anabaptistes n’est encore qu’un passe-temps. Mais ce jeune prophète, un peu sauvage, parlait une langue véhémente et magnifique. « Or je fus tout ébahi que devant que l’an passât, tous ceux qui avaient quelque désir de la pure doctrine se rangeaient à moi pour apprendre, combien que je ne fisse quasi que commencer moi-même [216]. » Aveu explicite de la précipitation avec laquelle s’est décidée cette immense révolution religieuse.
Qu’un étudiant du même âge, poussé par un parti de réforme, se fût aventuré, à Genève, à prêcher une refonte de l’Église de Calvin, aussi radicale que celle qu’il entreprend à 24 ans, quelle n’aurait pas été l’indignation du prophète picard ! Pas n’est besoin de se livrer à des conjectures pour connaître l’attitude du réformateur devant un adversaire éventuel « qui lui aurait ressemblé comme un frère ». Calvin s’est exprimé brutalement dans un sermon sur le Deutéronome : « Voici un homme, un bigot, qui voudra inventer une religion nouvelle... comme si on voulait (ici) mettre l’Alchoram de Mahomet. Or celui-là, sans rémission, doit être mis à mort. Dieu l’ordonne. Et si on dit que c’est cruauté, il faudra s’adresser à Dieu, et on verra si on pourra gagner son procès [217]. »
En attendant, Calvin, beaucoup plus idéaliste, et combien plus sympathique, s’aventure à plaider ce procès paradoxal. Il est pris dans le mouvement, et il devient peu à peu le chef d’une réforme, d’une Église qu’il connaît à peine, qu’il apprend à connaître au fur et à mesure qu’il l’édifie. « Il lui semble (en méditant l’Institution chrétienne) que la Providence de Dieu l’avait contraint à affronter la publicité qu’il n’aurait pu éviter sans être infidèle à son devoir [218]. » « Je ne pouvais m’excuser qu’en me taisant (sur la répression des Evangéliques), je ne fusse trouvé lâche et déloyal. Et ce fut la cause qui m’incita à publier mon Institution de la religion chrétienne [219]. » La défense des « fidèles et saints personnages », qu’on brûlait en France et qu’on essayait de discréditer à l’étranger « sans que personne ne pût en avoir compassion », ne joue dans le plaidoyer de Calvin qu’un rôle secondaire. Ce n’est que le prétexte occasionnel, « providentiel », dont Dieu se sert pour amener le prophète sur la scène : « Lors Moi, voyant que ces pratiqueurs de cour... »
Le plaidoyer devient un réquisitoire contre l’Église traditionnelle. Bien mieux, brûlant les étapes, le docteur ès lois propose une nouvelle constitution chrétienne, une codification nouvelle de la doctrine, de la morale et du droit de l’Église, une théologie et un système ecclésiastique neufs, qui prétendent ne s’appuyer que sur la Bible. Il va sans dire, cependant, que cette législation de la vie chrétienne est construite suivant des catégories abstraites, empruntées à sa mentalité de juriste, ou à des thèses gratuites des réformateurs, des nominalistes, autant qu’aux textes de la Bible. Le temps matériel nécessaire pour une étude approfondie des abondantes sources de la Révélation a manqué au jeune auteur pressé par la controverse. Aussi la synthèse brillante à laquelle il aboutit, n’aurait-elle jamais trouvé grâce devant des connaisseurs désintéressés, qui s’étaient penchés toute leur vie sur les Saints Livres, comme Lefèvre ou Érasme. Mais pour Calvin, cette doctrine audacieuse qu’il vient d’élaborer à la hâte, n’est pas seulement un essai, un point de départ. Il a fixé définitivement les principes du Calvinisme. Il se contentera de l’appliquer à toutes les situations, à toutes les découvertes de la Bible et de la vie.
« Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. » Calvin aura de plus en plus une confiance inébranlable en Dieu et en lui-même, c’est-à-dire dans sa vocation. Les déclarations les plus théocentriques s’accordent bien avec une sorte de retournement ; car, si cette conversion est une évasion hors du passé, elle n’est nullement un oubli de soi, une sortie de soi-même. En s’opposant toujours plus à sa jeunesse, il ne fait que s’affirmer davantage tel qu’il a toujours été. « La conversion avait été pour lui une rupture ; une rupture avec ses études antérieures et, du moins le croyait-il, avec cet humanisme en qui il avait placé jusque-là le but de sa vie... Calvin dut nécessairement interpréter sa conversion comme un changement total d’orientation... il s’aperçoit qu’il y a solution de continuité entre la philosophie des anciens et le christianisme [220]. » Le libre arbitre, la grandeur et l’autonomie de l’homme sont rejetés, mais par un puissant retour sur soi, ses propres expériences « bibliques » du péché, de la corruption totale, de la soumission aux décrets de la prédestination se dressent en dogmes souverains.
Il se met donc à enseigner aux fidèles une doctrine qu’ils ignoraient, mais pour laquelle ils croient souffrir et mourir. Il ne fallait rien moins que la prédestination des Stoïciens, de Duns Scot et de Bucer pour justifier un pareil mystère d’élection. On comprend que Calvin fasse de cette attitude subjective une de ses thèses favorites à laquelle il tiendra comme à la prunelle de son œil. « Cependant que j’avais toujours ce but de vivre privé, sans être connu, Dieu m’a tellement promené et fait tournoyer par divers changements, que toutes fois il ne m’a jamais laissé de repos en pieu quelconque, jusqu’à ce que malgré mon naturel, il m’a produit en lumière et fait venir en jeu comme on dit. »
Avant de mourir, il se rendra encore le même témoignage : « Il suivit sa vocation comme étant contraint [221]. » Cela ne vaut pas seulement de l’installation définitive à Genève, mais de tous les tournants principaux de cette étrange destinée. « Guillaume Farel me retint à Genève, non pas tant par conseil et exhortation, que par adjuration épouvantable... qu’il plût à Dieu de maudire mon repos et ma tranquillité... Lequel mot m’épouvanta et ébranla tellement, que je me désistai du voyage que j’avais entrepris... » La passion partisane, la peur et la contrainte, intérieure ou extérieure, prennent une place démesurée dans l’inspiration de ce prophète. « Étant en liberté et quitte de ma vocation » Bucer « usant d’une semblable remontrance et protestation qu’avait fait Farel auparavant, me rappela à une autre place. Étant donc épouvanté par l’exemple de Jonas, lequel il me proposait, je poursuivis encore la charge d’enseigner ». Et le retour en Suisse n’est pas moins providentiel et involontaire : « Contre mon désir et affection la nécessité me fut imposée de retourner à ma première charge [222]. » Partout où il passe, il trouve des Églises qui « l’obligent à s’arrêter quelque temps [223] ».
Autant Calvin aura d’audace pour prendre en mains la vie des autres et diriger leur destin, malgré les protestations qu’ils pourraient opposer, autant il aime charger autrui de ses propres responsabilités. C’est son père qui dispose de lui pour ses études, ce sont ses premiers auditeurs qui lui découvrent sa vocation d’Évangéliste, ce sont ses amis qui arrangent pour lui les questions les plus personnelles et les plus intimes, comme son mariage, son ministère : « Combien que toujours je continuasse à être semblable à moi-même, c’est à savoir de ne vouloir point apparaître et suivre les grandes assemblées, je ne sais comment toutefois on me mena par force aux journées impériales, ou bon gré mal gré, il me fallut me trouver en compagnie de beaucoup de gens [224]. »
Cette insistance a quelque chose de « merveilleux », comme aussi le rôle attribué à la « nécessité et à l’épouvante » par ce violent qui aime à se donner comme un « escholier timide, craintif, sauvage et honteux... ». Il est surtout réticent et concentré et ne se livre que dans des éclairs instantanés auxquels ses interventions doivent une part de leur magique pouvoir. Les quelques explications biographiques que nous tenons de lui font partie d’une vaste démonstration qui tend à établir une comparaison avantageuse avec le roi David, avec le prophète, dans lequel il « contemple, comme en un miroir, tant les commencements de sa vocation que le discours et la continuation de sa charge [225] ». Tout a été prédestiné et voulu directement par Dieu, spécialement les détails de la vie du réformateur. Il ne manque pas une occasion de s’en prévaloir, attribuant à la Providence le meilleur et le pire, ses audaces et ses erreurs, les fautes et les passions qu’il s’est ainsi dispensé de corriger.
« Dieu a voulu pour nous attirer à soi... que nous soyons familièrement enseignés par des hommes mortels semblables à nous... en disant qu’il envoiera toujours un prophète en Israël du milieu du peuple, c’est pour nous montrer qu’il ne faudra pas chercher fort loin et qu’il tiendrait un moyen pour converser privément au milieu de nous. [...] Quant est de l’office des prophètes, nous ne l’avons pas aujourd’hui en telle excellence... non pas que cependant (Dieu) ne se montre autant libéral comme il est requis pour notre salut... nous ne sommes pas dignes que ces trésors soient déployés... voilà pourquoi il nous en donne en petite proportion... Les prophètes expositeurs de la volonté de Dieu avaient une intelligence plus haute beaucoup des Écritures, que n’avaient les Docteurs communs... Quoi qu’il en soit, il y en avait dans chaque Église et ce don doit être préféré à tous les autres [226]... »
Calvin se sent en bonne et haute compagnie. Doué des dons les plus rares, il ne lui manque ni science, ni zèle, ni bonne volonté. Il a tout, sauf l’oubli de soi-même, sans lequel il est si facile de se méprendre sur l’inspiration du Saint-Esprit et sur l’action authentique de la grâce. Plus il avance dans sa conversion, plus il devient lui-même, subjectif et personnel. Pour être sublime, son moi n’en sera que plus envahissant. À l’extrême opposé de l’union divine longuement recherchée par les mystiques traditionnels, il s’achemine rapidement vers cette identification avec Dieu qui donne à la théocratie genevoise son caractère inquiétant.
En devenant prophète malgré lui, Calvin voit toutes ses tendances naturelles comblées. Le disciple de Montaigu, des Légistes et des Stoïciens, connaît la satisfaction de s’abandonner à la conduite visible, extérieurement du moins, de la « puissance absolue » « qui est loi à soi-même ». L’austère dévot, l’ascète doloriste et volontariste, habitué à refouler une sensibilité féminine, se croit sincèrement forcé et dominé par la main de Dieu, quand il s’arme du fouet vengeur de la Parole pour mortifier la nature humaine. Le génie supérieur, blessé dans son amour-propre d’auteur par le dédain des humanistes, va prendre sa revanche sur l’exégèse d’Érasme. Le clerc distant et aristocratique, le moraliste sévère, le dialecticien curieux de tous les problèmes difficiles et insolubles s’élève, d’un seul effort, au point de vue central où culminent toutes les antithèses, toutes les contradictions du rationalisme et de la foi, de l’obéissance et de la liberté, du credo quia absurdum et de la somme de toute sagesse [227].
Le prophétisme de Calvin coïncide avec la tentation d’intervenir en maître dans « un des plus grands procès de l’histoire ». Tant d’influences le sollicitent, tant de raisons militent en faveur de cette cause idéaliste : la reconstruction de la cité chrétienne à moitié démolie. Quel avocat français, quel Cauvin surtout, pouvait refuser d’atteindre à la gloire subite (et subie) en attachant son nom à l’entreprise politico-religieuse qui passionne tous les esprits ?
Orateur et meneur avant d’être prophète, Calvin se donne des convictions en persuadant les « fidèles », en dessinant des contours précis autour de leurs aspirations religieuses. Mais, une fois formulées, ses vues deviennent des dogmes immuables. Dans un second regard, il considère, après coup, ses options comme le résultat d’une intervention divine spéciale ; tel le procès de Bolsec qui lui fournit la lumière complète sur la « tant salutaire doctrine » de la prédestination. Dans le canal de la dialectique tracé par les nécessités de l’action, se déversent le trop plein d’une piété contenue et tout le torrent d’une faconde moralisante. La fixité de sa mémoire et sa frémissante sensibilité font le reste : ses formules et ses attitudes le lient sans retour. Sa foi exclut jusqu’à la possibilité d’un doute ou d’un changement. Et sa croyance à sa mission personnelle ou à la prédestination est aussi sincère qu’exaltante.
Quelle dévotion et quelle fidélité cette assurance a suscitées dans le monde protestant, l’aveu de Newman lui-même nous le dit expressément : « J’avais quinze ans... je tombai sous l’influence d’un credo défini et je reçus, dans mon esprit, ces premières impressions dogmatiques que, Dieu merci, plus rien ne devait jamais effacer ni obscurcir. Comme moyens humains de cet appel à une foi divine, je note les entretiens et les sermons d’un homme excellent, et plus encore les livres que celui-ci me donna à lire. Ces livres étaient calvinistes... Un des premiers qui me furent mis entre les mains enseignait la doctrine de la persévérance finale. J’admis d’emblée cette doctrine. Je venais de me convertir. J’étais sûr de ce fait (et aujourd’hui encore j’en suis plus certain que de l’existence de mes mains et de mes pieds). Je crus donc que cette conversion durerait jusqu’à l’autre vie et que j’étais élu pour la gloire éternelle. Je ne sache pas que cette croyance ait en rien contribué à me rendre négligent dans la pratique de mes devoirs... Elle me servit à me fixer, à me faire reposer dans la pensée de deux êtres, tous deux uniques, suprêmes, tous deux attestés par une évidence éblouissante, moi-même et mon créateur [228]. »
La prédilection de Calvin pour les types hyperboliques de l’Ancien Testament, l’âpreté de la bataille engagée contre la tradition et le caractère agressif du réformateur, ont accentué le côté violent du prophète malgré lui. Sa vocation n’est pas pure de tout alliage, comme celle de l’homme intérieur qui dit : « Pendant que je me regardais comme prédestiné au salut éternel, je m’isolais de la contemplation des autres hommes et je ne me disais pas que d’autres étaient prédestinés à la mort éternelle. Je ne pensais qu’à la miséricorde dont j’étais moi-même l’objet [229]. » Lorsque Calvin évoque les étapes de sa conversion, il rappelle davantage une déclaration de guerre au papisme, que la libération d’un courant mystique personnel. Soulevé par des tendances profondes de la piété évangélique, il limite et rétrécit l’esprit de ses devanciers en même temps qu’il l’extériorise. Les Calvinistes « en se proclamant sauvés, affirment ou sous-entendent que la faveur divine les sépare de la foule des maudits (Ibid.) ». Et dans la psychose de la guerre religieuse, cette menace eschatologique aida sans doute encore à accréditer la mission prophétique du jeune réformateur, à garantir le sérieux tragique de son bon vouloir.
Il y a mille et une manières de se convertir. La route suivie par Calvin ne pourrait, semble-t-il, être plus rapide, plus droite et plus séduisante. La vocation du prophète comporte une vision hardie une intuition qui lève, comme par enchantement, tous les doutes devant les chercheurs fatigués des longs détours. Enfin, on respire et on avance. Plus de mystérieuse sainteté, plus de quête sans fin. Il n’est requis que de croire en la justice divine.
Car la foi sauve et soulage la conscience joyeusement tremblante. Que celle-ci se persuade, comme son guide s’est persuadé, en convainquant les autres. Qu’elle s’abandonne à cette confiance dans la Providence. Qu’elle s’engage publiquement, qu’elle professe partout cette certitude libératrice. Ainsi cette grande Idée triomphera... à condition de n’en point douter, de ne pas la soumettre à l’examen qu’on vient de faire subir aux vérités moins claires de la Tradition. Croire, c’est affirmer, comme Dieu s’affirme dans son prophète.
_______
CHAPITRE V
Le converti écolier et le converti « enseigneur »
_______
I
LE VIEIL ÉCOLIER
Le projet de croisade apostolique au milieu des infidèles s’avère aussi irréalisable pour Loyola qu’il l’avait été pour François d’Assise. Aussi, « dès que le pèlerin eut compris que c’était la volonté de Dieu qu’il ne restât pas à Jérusalem, il allait souvent se demandant à lui-même ce qu’il devait faire ; en fin de compte il inclinait davantage à étudier pendant quelque temps pour pouvoir aider les âmes [230] ». Cette confidence situe, pendant le pèlerinage en Palestine, une des orientations essentielles du futur fondateur de la Compagnie : l’apostolat par l’étude. « Il comptait sur sa doctrine spirituelle pour renouveler par le fond les âmes sur lesquelles il aurait de l’influence [231]. » Mais comment s’assurer quelque ascendant sur le prochain sans étayer la réforme intérieure du crédit que donne le savoir ? Loyola n’est pas un de ces génies oratoires capables, comme Calvin, de transformer en « écoles publiques toutes retraites et lieux à l’écart ». La tentation de la facilité et de l’engouement lui sera toujours épargnée. Son souci, c’est la « limpidité », la certitude claire et « solide ». Mais il devra défendre avec beaucoup d’efforts son équilibre, (« solidarse, limpiarse, traer a equilibrio ») [232] entre la fièvre des études qui secoue la Renaissance espagnole et l’exaltation des alumbrados enclins à ne goûter que les lumières d’un mysticisme extravagant. Le savoir paraît indispensable dans un pays qui, en un siècle, a fondé vingt universités ; mais Ignace a certainement aussi noté le début de l’Imitation de Jésus-Christ : « Qui veut pleinement et savoureusement comprendre les paroles du Christ, doit s’appliquer à lui conformer toute sa vie... Si tu savais par cœur toute la Bible et tous les discours des philosophes, que te servirait tout cela, sans l’amour de Dieu et sans la grâce [233] ? »
Pour échapper à la malédiction de « la science qui ne tend pas à aimer », Ignace de Loyola, revenu en Espagne, continue tous les excès de pénitence dont il avait l’habitude. Mais pour se prémunir, d’autre part, contre les illusions d’une piété mal éclairée, il étudie avec une application obstinée, jurant plusieurs fois de se soumettre à tout ce que ses maîtres voudraient bien lui imposer [234].
Il ose cependant conseiller et éclairer les gens qu’il rencontre, malgré le monopole que les théologiens espagnols, émules de ceux de Paris et d’ailleurs, se réservent dans les questions religieuses. Avec des âmes bien disposées, Loyola expérimente, ici et là, les trouvailles de ses « Exercices ». Ce faisant, à Barcelone, pendant deux ans, il évite, grâce à la générosité d’Isabelle Roser et aux leçons particulières du pieux bachelier Ardebalo, les conflits avec les corps organisés du savoir ecclésiastique. Mais quand ses guides spirituels jugèrent bon de l’envoyer étudier la philosophie à l’université d’Alcala, le vieil écolier trop dévot, trop évangélique, éveilla les soupçons des tribunaux de la foi. L’Inquisition ne se formalisait pas de voir les prélats mener presque publiquement un train de vie scandaleux, une jeunesse cléricale se livrer à la dissipation. L’agitation et la licence que suppose la présence de véritables armées de jeunes clercs inutiles, comme dans l’évêché de Calahorra qui en comptait parfois jusqu’à 18.000, préoccupaient moins les autorités, que la mendicité d’Ignace et de ses compagnons de la première heure, assez audacieux pour vivre d’aumônes, pour paraître en bure uniforme et pour donner de bons conseils aux âmes pieuses, sans attendre d’avoir parcouru quatre ans de théologie.
Le vicaire général mande à son tribunal ces confrères singuliers, dans leur accoutrement d’ermites, d’autant plus originaux que l’un d’entre eux était très long, un autre de petite taille et que leur chef boitait visiblement. « Le vicaire nous dit (après examen) qu’on n’avait rien trouvé de faux dans notre doctrine, et que partant nous pouvions continuer comme auparavant. Mais puisque nous n’étions pas religieux, il n’était pas recommandable que nous allions tous vêtus de la même façon [235]. » Les tribulations ne faisaient que commencer. Il ne peut manquer de subir le contrecoup des remous suscités par la vogue des « parfaits, des abandonnés », avec lesquels, un jour, en examinant sa doctrine de « l’indifférence », on voudra le confondre. Aussi, par amour de l’orthodoxie et de l’Église, chaque fois que l’occasion se présente, devant l’Inquisition de son pays, et plus tard en France et en Italie, il insiste pour qu’on vérifie sa doctrine spirituelle et il s’efforce de collectionner des approbations, ou au moins de faire protocoler les sentences favorables de ses juges. Il tient plus à une déclaration d’orthodoxie qu’à sa liberté ou à la vie.
Les tracasseries renaissent souvent. Ignace importune le vicaire général :
« Nous voudrions savoir si on a trouvé en nous quelque hérésie.
– Non, dit Figueroa, si on en trouve, on vous brûlera.
– Et vous aussi, on vous brûlera, répond tranquillement Ignace, si jamais on vous trouve hérétique... »
Sa bonne volonté et ses intentions étaient parfaites. Mais il n’avait pas encore perdu toute illusion concernant, en particulier, la dévotion des femmes. Avec plus de zèle que de clairvoyance, il communique certaines de ses méthodes d’oraison à des âmes qui paraissaient généreuses. Certaines, malheureusement, n’étaient que des exaltées, quand ce n’étaient pas des hystériques tourmentées par des transes suspectes (1). La sagesse ne s’acquiert pas d’un coup. Loyola a reconnu lui-même la patiente élaboration de ses Exercices : « Ils n’ont pas été faits tout entiers en même temps. Les choses que j’observais m’avoir été utiles, je les notais à mesure par écrit, parce que je pensais qu’elles pourraient aussi être utiles à d’autres [236]... » Il avait un don spécial pour amener les âmes par des entretiens personnels, « à la connaissance et au goût des choses spirituelles ».
Parfois il fallait payer d’audace pour établir le contact.
Un jeune dignitaire ecclésiastique scandalisait son entourage d’étudiants par le désordre de sa conduite. Ignace, désolé que nul n’intervienne, se met en prière, puis décide de tenter personnellement une démarche pour « réformer » ce personnage influent. On lui accorde sans enthousiasme l’entrevue confidentielle qu’il a demandée. Seul à seul, au risque de se faire jeter dehors, avec autant de fermeté que de courtoisie, Ignace commence à brosser devant les yeux de ce noble dégénéré le tableau exact de la situation. La stupeur et l’indignation du coupable sont d’abord sans limites. Mais bientôt, il s’apaise, subit l’ascendant de son interlocuteur, se laisse toucher et convaincre. Il retient son censeur à dîner et, quand Ignace partit, il eut même la coquetterie de lui donner une escorte d’honneur pour le reconduire à cheval, à la grande confusion du vieil écolier mendiant [237]. Tous les essais du convertisseur n’auront pas ce dénouement facile, à la manière des Fioretti.
Quel tapage ne produisit pas, par exemple, la disparition de deux dames, mère et fille, veuves, parties en pèlerinage, qu’on imaginait avoir été subtilisées, égarées ou dévoyées, par le pèlerin de Loyola. Pendant quarante-deux jours, il est jeté en prison, sans qu’on veuille même lui dire le motif de son arrestation, jusqu’à ce qu’au bout de deux semaines Figueroa se décide à lui demander s’il connaissait Maria del Vado et sa fille Lucia, et s’il savait ce qu’elles étaient devenues :
« Voilà le motif pour lequel vous êtes ici, en prison, ajoute joyeusement le grand vicaire en mettant la main sur l’épaule de Loyola.
– Voulez-vous que je vous parle plus longuement, sur cet article ? demande le prisonnier. Sachez donc que ces deux femmes m’ont importuné bien des fois parce qu’elles voulaient aller par le monde servir les pauvres dans tels ou tels hôpitaux. Toujours je les ai détournées de ce projet, vu que la fille est jeune et belle, etc., et je leur ai dit que si elles voulaient visiter les pauvres, elles le pourraient faire à Alcala [238]... »
Le zèle d’Ignace pour la réforme du prochain lui attire, à lui et à ses compagnons, les inconvénients classiques des directeurs de consciences inexpérimentés ou naïfs qui, dans leurs débuts, se laissent accaparer par le public féminin : conciliabules prolongés, visites importunes, exaltation factice [239].
Le procès aboutit à cette conclusion assez paradoxale qu’Ignace et ses amis étaient reconnus innocents et leur foi orthodoxe, mais qu’il leur était désormais « défendu d’enseigner qui que ce soit, en public ou en secret, isolément ou en assemblée, pour un intervalle de trois ans, sous peine d’excommunication majeure ou d’expulsion du royaume [240] ». En lui intimant l’ordre de reprendre des habitudes de vie plus normales, la Providence favorisait le but que s’était fixé le converti, « d’étudier pour mieux aider les âmes ». Car les pénitences, le service des hôpitaux et les pauvres, les longs entretiens spirituels, pouvaient bien lui conférer une certaine sagesse pratique, mais de lettres, de philosophie et de science, il ne pouvait être question dans une existence aussi encombrée. Plus tard, Loyola insistera pour que ses étudiants, les « scolastiques », soient libérés de tout souci matériel et de toute tension d’esprit. Mais il a besoin de quelques expériences répétées, de poursuites, d’enquêtes, de prisons, d’interrogatoires, de déceptions et d’épreuves de toutes sortes, pour réaliser que « la grâce ne détruit pas la nature », et que la culture de l’esprit et celle de l’âme profitent, toutes deux, d’une saine harmonie.
En attendant, Ignace de Loyola s’obstine à vouloir mener de front l’étude et l’apostolat... Il emploie les grands moyens. Il s’adresse directement au primat d’Espagne, Alonso de Fonseca, archevêque de Tolède, « grand seigneur mondain et peu édifiant », qui écoute distraitement les projets du réformateur et d’un grand geste débonnaire lui conseille d’aller à Salamanque : « J’ai là-bas des amis et un collège, je mets tout cela à votre disposition. » Puis il le congédia gratifié de quatre écus d’or [241].
Mais décidément, ce mystique espagnol avait besoin d’achever, ou plutôt, de reprendre toute sa formation humaine à Paris. Providentiellement, le séjour de Salamanque devient bientôt aussi peu encourageant que celui d’Alcala.
À peine arrivé dans la ville, le vieil étudiant s’était choisi un confesseur dominicain du couvent de Saint-Étienne. Mais douze jours ne s’étaient pas écoulés que le confesseur lui réservait une surprise invraisemblable :
« Les Pères de la maison voudraient vous parler, dit-il à son pénitent.
– Au nom de Dieu, soit, répond Ignace.
– Alors cela ira bien. Vous viendrez dîner ici, dimanche. Mais je vous préviens d’une chose : les Pères voudront vous poser beaucoup de questions [242]. »
C’est que l’université de Salamanque, entraînée dans le mouvement humaniste, était agitée de discussions bruyantes entre les « frayles » et les partisans d’Érasme et de Vivès, alors en grande faveur. Durant ses premiers essais de latin, Ignace avait été troublé par les satires de l’Enchiridion militis christiani contre les moines et les usages de la piété traditionnelle. Il mettra plus tard les siens en garde contre le charme sceptique du grand humaniste de Rotterdam [243]. C’est d’autant plus piquant de voir le vieil écolier, ascète et mendiant, confondu avec les Érasmiens ; alors qu’il n’a aucun goût pour cet humanisme, il est inquiété par des moines mis en état d’alerte au seul nom d’Érasme, que probablement personne n’a lu. On le presse de questions : « De quelles choses de Dieu parlez-vous donc ? – Nous parlons tantôt d’une vertu, tantôt d’une autre, et ce faisant, nous nous efforçons de les recommander ; et tantôt d’un vice, tantôt d’un autre pour les blâmer. – Vous n’avez pas fait d’études, et vous parlez de vertu et de vice. Or, on ne peut en parler que de deux façons : ou bien au nom de la science, ou bien par la vertu du Saint-Esprit. Mais dans votre cas, ce ne peut-être au nom de la science, c’est donc par la vertu du Saint-Esprit. Et c’est ce que nous voulons savoir, c’est ce qui en vous vient du Saint-Esprit. »
Le dilemme était aussi triomphant que tant de pareils dont se prévaudra la dialectique de Calvin. Loyola ignore l’art subtil de la discussion. « À ces mots, confie-t-il, je me mis sur mes gardes. Cette façon de tirer des conclusions ne me plaisait pas beaucoup. Je réfléchis un moment, puis je dis qu’il n’était pas nécessaire de parler davantage de ces choses. » Mais on insistait : « Ainsi, à une époque où tant d’erreurs d’un Érasme et de beaucoup d’autres circulent et égarent le monde, vous ne vouez pas vous expliquer sur ce que vous enseignez ? » – « Père, je n’ajouterai pas un mot à ce que j’ai dit, à moins que ce ne soit devant mes supérieurs qui peuvent m’y obliger [244]. » – « Eh bien, restez ici, cria le sous-prieur, nous ferons bien en sorte que vous disiez tout. » Les moines se dispersent en hâte, ferment toutes les portes de la chapelle où le débat avait lieu, et attendent le résultat du rapport envoyé aux juges ecclésiastiques. Le proviseur de l’évêché décide d’emprisonner les suspects : « Nous fûmes enfermés dans une chambre haute, raconte Ignace avec son calme habituel ; ce local, choisi pour nous distinguer des malfaiteurs, avait encore assez de saleté, car il était ancien et inhabité depuis longtemps. On nous attacha, avec mon compagnon, tous les deux à la même chaîne, chacun par un pied. La chaîne était fixée à une poutre au milieu de la salle ; elle avait une longueur de dix ou douze palmes. Chaque fois que l’un de nous devait se déplacer, l’autre était obligé de l’accompagner. Il fallut veiller toute la nuit. » Bientôt, avec la permission de recevoir des visites, le sort des prisonniers s’améliora. Un grand personnage, le futur cardinal de Burgos, vint lui témoigner sa sympathie : le vieil écolier n’a aucune envie de se plaindre. Le traitement dont il est l’objet n’est-il pas une garantie qu’il est à la bonne école de l’imitation de Jésus-Christ ?
« Je dois vous répondre ce que j’ai déjà répondu à une darne distinguée qui m’adressait des paroles de compassion en me voyant emprisonné. Je lui dis : on voit bien, à vous entendre, que vous n’avez pas le désir d’aller en prison pour l’amour de Dieu. La prison vous paraît-elle donc un si grand malheur ? Pour moi, je vous assure qu’il n’y a pas tant de fers et de chaînes, à Salamanque, que je n’en désire encore porter davantage par amour de Dieu [245]. »
Si des humanistes ont été attirés par ce procès curieux, comme le laisse deviner la présence d’un personnage tel que le futur cardinal Don Francisco de Mendoza, ils ne purent qu’admirer l’attitude de ce « soldat chrétien », combien plus virile et éclairante que la pâle silhouette dessinée par Érasme... Elle ne réussit cependant pas à gagner tels jeunes dominicains, alors à Saint-Étienne, entre autres Melchior Cano et Juan Martinez de Siliceo, qui poursuivront un jour le fondateur de la Compagnie et ses Exercices, de leurs implacables syllogismes. Le procureur Frias poussa son enquête à fond. Les notes de l’inculpé furent examinées par quatre censeurs qui, leur analyse achevée, interrogèrent longtemps l’auteur des Exercices sur bien des questions abstruses de la théologie, voire du droit canon. Après vingt-deux jours de prison, le jugement fut prononcé. Ignace, qui ne pouvait donner aucune indication concernant la provenance de son savoir, en particulier sur les différences marquées entre le péché mortel et le péché véniel, attendait sans la moindre passion fanatique : « C’est à vous de voir, disait-il à ses juges, si c’est juste ou faux. Si quelque chose est faux, condamnez-le. »
La conclusion ne le satisfit point complètement : « Il n’y avait pas d’erreur, ni dans notre vie, ni dans notre doctrine. Nous pouvions continuer à enseigner la doctrine chrétienne et à parler des choses de Dieu dans nos conversations, mais, avec la restriction que nous ne définirions jamais : “Ceci est un péché mortel et ceci est un péché véniel”, jusqu’à ce que nous ayons étudié davantage pendant quatre ans [246]... » Les mêmes docteurs qui intimaient à chaque fidèle l’obligation de confesser les fautes graves, supposant ainsi la compétence requise pour les distinguer des fautes légères, estimaient dangereux que de pieux laïques s’aventurent à aider le prochain dans ces questions élémentaires.
Cette logique avait de quoi dérouter le bon sens d’un Loyola. « Sans rien condamner, on me fermait la bouche, en m’empêchant d’aider le prochain dans la mesure de mon pouvoir. » On avait beau multiplier les signes de bienveillance à son égard, et le presser de reconnaître la sentence, il se contentait de répéter : « Aussi longtemps que je serai sous la juridiction de Salamanque, j’observerai ce que vous m’ordonnez. » Une seule question semble l’obséder : « aider le prochain » par les moyens de fortune que lui suggèrent la Légende Dorée et ses expériences personnelles. Qu’un tel apostolat ait été absolument incompatible avec les études sérieuses, il ne l’a pas encore compris. Il valait la peine d’aller à Paris pour faire cette constatation et élargir son horizon chrétien. « Quinze à vingt jours après être sorti de prison, Inigo partit seul, emportant quelques livres sur un petit âne [247]. »
Il repasse par Montserrat et Barcelone. Ses amis, désolés de le voir s’éloigner, lui dépeignent avec épouvante les dangers inévitables d’une traversée des frontières, au moment où l’Espagne et la France sont en guerre. Quelle folie, pour un Espagnol de son âge, de se rendre à ce moment dans la capitale du pays ennemi pour y continuer ses études ! Mais lui se contentait de sourire aux bonnes âmes qui s’étaient attachées à lui et tout en larmes voulaient le retenir. Il leur recommande l’esprit de foi et la patience et part, seul, à pied, pour « l’Université qui compte un nombre infini d’étudiants... et d’excellents maîtres dans toutes les branches, qui professent avec grande promptitude et diligence [248] ».
À Paris, l’ignorance de la langue le libère de l’empressement des âmes dévotes. Il est obligé de fréquenter presque exclusivement les milieux intellectuels, du moins les compatriotes espagnols de la « Nation de France ». Il se heurte aux dures nécessités de l’existence, dépouillé qu’il est, par l’indélicatesse d’un faux ami, du peu d’argent que les bienfaiteurs avaient mis à sa disposition. L’étude et la santé réclament aussi leur dû. On lui conseille un moyen pratique de concilier son amour de la mendicité et les exigences d’une formation intellectuelle où, comme pour le jeune Calvin, tout doit être repris par la base. Il ira chaque été se pourvoir de fonds de secours auprès de marchands espagnols, dans les Flandres et jusqu’en Angleterre. Avec tes aumônes, il recueille aussi les dernières pièces de sa sagesse, apparemment assez composite, en particulier le « Principe et Fondement » érasmien qui soutient désormais l’ensemble de ses pensées religieuses. L’homme est fait pour Dieu et toutes les créatures pour l’homme, afin de l’aider à atteindre le but pour lequel il a été créé. Dans ce théocentrisme, « il faut que l’homme se serve de toutes choses dans la mesure où elles l’aident à atteindre sa fin, et qu’il s’en débarrasse dans la mesure où elles l’en empêchent [249]... ».
Parmi l’immense variété des moyens, « en vue de servir Dieu et le prochain », il s’agit de découvrir les meilleurs et les plus efficaces. Loyola aura de moins en moins le temps de s’occuper de ces converties, dont, plus tard, il recommandera même de se défier, parce que les émotions religieuses qu’elles recherchent ne sont pas toujours de bon aloi. Les études, il le voit peu à peu, « réclament tout l’homme » et le progrès n’y est assuré qu’en observant le ne quid nimis entre la tiédeur et la ferveur excessives [250]. La compétence et la discrétion présentent des avantages substantiels que n’offre pas l’ascèse rustique. Les Exercices qu’il donnait hier indifféremment à toute âme de bonne volonté, à Alcala et Salamanque, ne transformaient pas les esprits aussi profondément que ceux qu’il destine à des caractères d’élite, dans le milieu universitaire de Paris. Sa méthode s’est dépouillée et assouplie. Il réussit, en se simplifiant, à communiquer l’harmonie et l’unité religieuse de sa vie à quelques rares amis sur lesquels se concentre toute son influence, depuis qu’il doit renoncer au zèle intempestif de ses débuts « pour se consacrer à l’étude avec plus de profit [251] ». Laynez, Pierre Favre, Xavier ne sont pas brusquement confrontés avec la retraite complète, mais seulement stimulés sans cesse vers une perspective centrale. Favre rappelle cette bonne fortune aux étudiants de Paris, entrés dans la Compagnie : « Je me réjouis beaucoup du grand avantage dont vous jouissez, en comparaison de nous, ou au moins de moi, du fait qu’avant de commencer vos études, vous avez déterminé le but vers lequel vous dirigerez ces études [252]. »
Loyola ne parvint pas sans peine à cette vision nette du but et des moyens de perfection voulus par Dieu. Les étudiants qu’il entreprend regimbent avant de devenir ses meilleurs disciples, tel Xavier qu’il ne gagne qu’à force d’attentions touchantes, ou Nadal qui lui réplique en lui montrant le Nouveau Testament : « Je veux suivre ce livre ; vous, je ne sais où vous voulez aller. Cessez de me prêcher et ne vous mêlez plus de mes affaires [253]. » Il va mendier pour soutenir son brillant compatriote François, dont il ne reçoit que dédain. Il recrute des étudiants au jeune professeur et va lui-même s’asseoir à ses leçons de philosophie. Et quand, ayant gagné la confiance de quelques compagnons, il réussit à les persuader de mettre un terme à leurs « affections désordonnées » pour l’honneur mondain ou les bénéfices, il est confondu avec les « mal sentants » [254].
Mais quels obstacles pourraient arrêter ce vieil écolier qui se complaît dans les humiliations les plus répugnances, s’expose à la contagion pour mater la nature qui tremble, et veut même subir les coups et les affronts de la « salle » ? Si le Principal du Collège de Sainte-Barbe n’avait pas reconnu l’inanité des accusations portées contre son orthodoxie, Ignace aurait été obligé de paraître au réfectoire, devant tous ses compagnons réunis, le corps nu jusqu’à la ceinture, pour recevoir une correction infamante en passant entre les deux rangées de maîtres armés de verges cinglantes. Ces exploits d’humilité héroïque frappent davantage les hagiographes que les confidents de ses dernières pensées [255]. Polanco note tranquillement : « La Providence enseignait Ignace qui se trompait avec une sainte intention, afin qu’il ne permît pas à ses disciples, plus tard, de faire les mêmes erreurs [256]. »
En racontant au roi Jean III de Portugal les procès auxquels il a été mêlé, Ignace de Loyola témoigne d’un seul motif de fierté : « Par la grâce et la miséricorde de Dieu, on n’a jamais rien réprouvé dans sa doctrine », nunca fuy reprobado de una sola proposición, ni de syllaba alguna.... il n’a jamais fréquenté hérétiques, schismatiques, alumbrados ou luthériens ; il ne les connaît même pas. On enquêta sur son compte pour savoir comment, malgré son ignorance des lettres, il pouvait s’entretenir si abondamment des choses spirituelles. Il n’a jamais pris d’avocat (ni solicitador, ni procurador, ni avogado) autre que Dieu [257]. La candeur a été pour lui, pendant cette dizaine d’années d’expériences, le comble de la prudence. Ses « erreurs » sont d’ordre pratique : excès de générosité, outrances d’un mystique assoiffé de sacrifices.
Mais Paris a déjà commencé l’unification de sa vie spirituelle et intellectuelle. Le climat de l’Île de France exerce son influence modératrice et désencombre le médiéval du superflu. Aussi l’Université de Paris laisse-t-elle dans son esprit une profonde empreinte [258]. Elle concilia la « science infuse » du contemplatif et la « science acquise » sur les bancs de Montaigu, à Sainte-Barbe surtout, et aux cours des Lecteurs royaux. L’ordo parisiensis, l’ordre et la manière d’enseigner de Paris, passera ses traditions à la pédagogie de la Compagnie, en attendant la synthèse des méthodes du XVIe siècle, opérée par la ratio studiorum des Jésuites de la seconde génération [259]. Loyola a fait patiemment le tour des disciplines et des connaissances que Calvin a traversées comme un brillant météore. Il prend le grade de maître ès arts et paie, de ses dernières ressources, les réjouissances d’usage en pareille circonstance dans la gent écolière, sans rien renier cependant de son idéal personnel de pauvreté et de pénitence. Il recherche les contacts d’une élite, qui n’est pas celle que cultive Calvin ; non pas des lettrés et de beaux esprits, mais des hommes de Dieu.
Il recommande à ses amis « les rapports avec les gens les meilleurs et les plus spirituels, en s’écartant des autres qui vous contredisent [260] ». Il ne s’agit pas de lancer ou de suivre un mouvement, de plonger fougueusement dans les remous de ces discussions littéraires et doctrinales où triomphent les esprits les plus excités et les plus excitants. Au milieu de l’effervescence générale, les Évangéliques tentent de rallier, par tous les moyens de la propagande écrite et orale, une élite de l’intelligence capable d’entraîner les masses. Loyola est profondément convaincu que le mal, comme le bien, sont des problèmes de la conscience individuelle. Il ne conçoit rien d’autre sous le mot si répandu de réforme, que la nécessité pour chacun de se changer lui-même, avant de vouloir changer le monde. Les germes de ruine menacent les âmes les plus nobles, les plus hautes ; ils se propagent, à la faveur des inclinations désordonnées, par les illusions et les connivences les plus subtiles [261]. Loin des emballements collectifs, Loyola limite ses efforts à un apostolat personnel, à une action discrète et patiente d’homme à homme.
Ainsi débute cette première compagnie, ce groupement fraternel, sans règle et sans liens particuliers, de quelques étudiants épris du même idéal de perfection. Ils mettent en commun leurs connaissances, leurs économies et leurs bonnes inspirations. Ils cherchent à avoir les uns sur les autres l’influence la plus bienfaisante. N’était le danger d’anachronisme, nous dirions volontiers que le candide renouveau spirituel suscité par Loyola au milieu des étudiants parisiens s’apparente par bien des aspects au « réarmement moral » d’un Frank N.D. Buchman [262]. Ce sont des Français et des Basques, des Espagnols et des Portugais qui se trouvent rapprochés par Ignace et communient à cette mystique fort répandue par les « spirituels » de cette époque, par exemple autour du pieux Le Fèvre dont ils semblent avoir connu les conseils : « s’exhortant l’ung l’autre à aymer Dieu et principalement ès lieux et aux personnes où (vous) povez seulement édifier et nul offenser [263] ».
Nulle cabale, nulle agitation ne les exalte. Les hommes qui demain défendront la doctrine ecclésiastique de Clichtove, ne se sont-ils pas inspirés de la mentalité de son ami, le théologien évangélique d’Étaples : « Suyvans la doctrine de l’esprit de Dieu, qui est doulx, bening, amateur de paix, ayez amour avec tous, fors avec (le) péché ? » Ce sont, en tout cas, des volontaires paisibles, qui rêvent de vivre, sans compromis, l’héroïsme de l’Évangile, cet idéal fabricien des béatitudes qu’on trouve égaré dans le discours de Cop. Ils montrent à des signes concrets leur désir de donner leur vie pour la conversion du prochain, surtout pour les moins fortunés, les pauvres, les malades contagieux, ou bien pour les Infidèles, comme ils finissent par le promettre, lors du vœu de Montmartre, le 15 août 1534.
La dévotion et l’humanisme faisaient alors bon ménage. Les réunions pieuses, les visites de sanctuaires, les pèlerinages appartenaient à un vaste ensemble de croyances pittoresques et touchantes, auxquelles un Le Fèvre lui-même trouvait beaucoup de profit. Farel nous le montre faisant en sa compagnie « les plus grandes révérences aux images, demeurant longuement à genoux, priant et disant ses heures devant icelles [264] ». Avec ces dévots personnages, les compagnons de Loyola vont sans doute aussi se répétant : « Il faut que le monde soit changé. » Et ils sont aussi « persuadés qu’ils verront ce changement » s’ils veulent bien y mettre le prix.
Dans son pays déjà, Ignace a souvent entendu parler d’Érasme. Il a lu le « Soldat chrétien » qui a troublé la paix de son âme. Il a évidemment rencontré certains de ces « milliers d’Espagnols qui firent de l’Enchiridion le plus lu de tous les livres de piété, avec l’Imitation [265] ». À Paris, les compagnons comme Xavier, Salmeron, Nadal, Favre, Lejay, ont connu la ferveur évangélique et l’ivresse humaniste. Loyola, appliqué comme il l’était à prendre son bien partout où il le trouvait, n’a certainement pas boudé cet enthousiasme. Il apporte seulement à cette exaltation le contrepoids de la sagesse : « Que sert à l’homme de gagner l’univers ? » L’exemple typique de l’amitié reste pour lui cet échange de connaissances et de biens spirituels ou matériels, tel qu’il fut pratiqué par les étudiants parisiens. « Si l’un des amis possède la science, il en donne à celui qui n’en a pas ; si les honneurs, si les richesses, et ainsi l’un à l’autre tour à tour [266]. »
Raisonnable et imperturbable comme un Socrate, il a cependant le cœur ardent d’un mystique, prêt à se plonger dans un lac glacé pour arrêter un ami sur le chemin de l’inconduite, prêt à se sacrifier sans réserve. Un compatriote le dépouille de ses ressources et, trompant sa confiance, retourne au pays. Mais, en route, le malheureux voleur tombe malade et écrit à Loyola. Celui-ci entreprend un voyage épuisant, trois jours de marche, à jeun et pieds nus, afin de mériter la joie de retrouver son enfant prodigue. Il le soigne et le remet en état de s’embarquer, veillant encore avant de se séparer de lui que des amis, sur sa recommandation, l’accueillent fraternellement à son retour.
L’excès de charité assure l’équilibre de bien des contraires qui se heurtent dans sa personne. La raideur et le rigorisme du dévot pénitent, par un curieux paradoxe, favorisent une indulgente compréhension pour les aspirations et les expériences de son époque. Partout règne une mentalité dédaigneuse du monachisme médiéval qui retardera longtemps l’adoption par la Compagnie d’une vie régulière commune. Cette répugnance érasmienne s’abstient cependant du mépris et s’accommode d’une ascèse renforcée. Les premiers compagnons réalisent encore mieux que le prince de l’humanisme combien « le christianisme est une vraie et parfaite amitié [267] ». Mais ils ne sauraient convenir qu’il n’est que cela. Au contact des Lecteurs royaux et des beaux esprits, Loyola devient plus humain et se rapproche même des goûts populaires. Le plébéien de Noyon juge avec une hauteur plus qu’aristocratique les sentiments religieux du « vulgaire ». Le seigneur de Loyola les défend. Devant de grands humanistes, comme Vivès, qui plaisante les mets recherchés qu’impose l’abstinence, il réplique : « Ceux qui se traitent bien en carême pratiquent en effet fort mal la pénitence... mais il n’en est pas ainsi de la foule des hommes ; et c’est aux intérêts de la foule que l’Église a entendu pourvoir [268]. »
La place des lettres dans le programme d’études des futurs jésuites, l’importance donnée à la connaissance des langues, le juste équilibre entre la théologie spéculative et la théologie positive, la spiritualité psychologique et la formation rationnelle, tout dans l’idéal ignacien s’oriente vers une via media qui intègre le moyen âge et la Renaissance, l’humanisme d’Érasme, de Sainte-Barbe, avec l’intellectualisme des dominicains de la rue Saint-Jacques. Car à quarante-cinq ans, ce vétéran se charge d’une solide armure thomiste. « Toutes les créatures à la surface de la terre peuvent et doivent servir à la gloire de Dieu. » L’optimiste embrasse tout, récupérant même ce qui peut servir dans l’expérience du péché. « Que celui qui a commis une faute et s’en rend compte ne perde pas courage : les fautes elles-mêmes servent à la santé (de l’âme) [269]. »
Mais la santé d’Ignace est bientôt compromise. Il est forcé d’interrompre ses études à Paris et d’essayer les vertus curatives de l’air natal. Dans quelques mois, l’Espagne et surtout l’Italie achèveront la formation de cet esprit réaliste et universel. Un des témoins d’Ignace les plus autorisés, son ami et successeur Laynez, apprécie adéquatement la valeur de la culture assimilée par le maître ès arts Inigo de Loyola :
« Bien qu’il eût plus d’empêchements que les autres pour l’étude, il y mit cependant une telle application qu’il profita, toutes choses égales, autant et plus que ses contemporains, atteignant à une honnête moyenne de connaissances, comme le manifestèrent ses examens publics et les disputes avec les écoliers de son cours [270]. »
Il aura surtout progressé dans cette attitude aimante et discrète qu’il recommanda un jour à ses amis, en prenant congé d’eux : « Nous veillerons à maintenir notre cœur en grande pureté dans l’amour de Dieu, de manière à ne rien aimer sinon pour lui, à ne souhaiter de rapports qu’avec lui, avec le prochain que pour son amour, non pour satisfaire nos goûts et nous divertir... Que nul n’ambitionne la réputation de beau parleur, ni ne se fasse valoir comme distingué, judicieux, cultivé [271]... »
Le pèlerin convalescent qui reprend la route de son pays après sept ans d’études a conquis, pour lui-même et pour les compagnons parisiens, « l’équilibre le plus solide » et le plus souriant de sa vie émotionnelle, de sa culture intellectuelle et de sa sagesse religieuse, fondues dans l’humble idéal du service des âmes.
« Nous ne discuterons avec personne de façon opiniâtre ; mais en toute patience, nous donnerons les raisons de notre opinion, dans l’intention d’exposer la vérité et pour que le prochain ne tombe pas dans l’erreur, non pour nous faire valoir. Une des choses que nous devons assurer, pour être agréables à Notre Seigneur, sera de bannir de nos cœurs tout ce qui peut les éloigner de l’amour de nos frères, nous appliquant à les aimer d’une charité profonde, car la Vérité souveraine l’a dit : À ce signe, on vous reconnaîtra pour miens. »
Avec ce cœur et cette mentalité renouvelés, avec cet esprit libre d’ambition et d’égoïsme, il lui reste à chercher le rivage où Dieu veut qu’il porte l’amour. « À n’importe quel endroit du monde, chez les Turcs, chez les païens », ou chez les chrétiens, il faudra toujours « se faire tout à tous [272] ».
II
LE JEUNE MAÎTRE
Pour s’être rencontré, par hasard, dans des milieux fréquentés par les alumbrados, les érasmiens ou les évangéliques, Loyola fut maintes fois poursuivi et malmené. Il n’en garde aucune rancœur, malgré des vexations humiliantes, dont le fervent disciple d’Érasme, Calvin, n’eut, pour ainsi dire, rien à souffrir. Longtemps encore après le discours de Cop, en 1534, il circule à travers la France sans être inquiété.
Mais le choc du 1er novembre 1533 avait heurté trop brutalement la fierté et les illusions de ce jeune intellectuel de vingt-quatre ans, conscient d’une supériorité incontestable. Ulcéré par la résistance des théologiens, encore plus qu’il ne l’avait été par le dédain des humanistes devant son « Sénèque », il ne voit bientôt plus l’Église qu’avec les veux du ressentiment : tout en elle devient trop vert, son enseignement, son culte, sa morale, ses institutions ; tout prend à son regard une couleur négative et rebutante. Le plus urgent, dans cette disposition d’esprit agressive, ce n’est pas de se réformer soi-même, mais de proclamer le retour à une Église d’opposition, la restauration d’une « pure doctrine ». La primauté du spirituel, entendu comme le triomphe de ses propres idées, domine toutes les autres préoccupations. Ce préjugé idéologique justifie les mesures les plus radicales, le schisme et la révolution. C’est ce qu’il affirme avec une éloquence amère dans la préface de la Psychopannychia, alors que, sans doute, il médite déjà l’Institution : « Nous ne reconnaissons d’autre unité qu’en Christ et d’autre charité que celle dont il est le lien ; dès lors le principal moyen de conserver la charité, c’est que notre foi demeure intacte et inviolée. »
Toute la tragédie calviniste, toute la tragédie religieuse de cette époque s’appuie sur ce paradoxe : aimer presse moins que croire. La charité peut attendre que la foi et l’orthodoxie soient restaurées. Entre croyants, entre partisans de la même doctrine, l’amour redeviendra possible. Mais cette lutte acharnée pour la foi contre les « hérétiques rebelles et contumax, dont sont issus tous les papes, cardinaux, évêques, abbés et prêtres », rétrécit et trahit au départ la vraie foi, c’est-à-dire la croyance à l’universalité de l’amour chrétien [273].
Et quelle est cette pureté doctrinale dont Calvin se fait le champion ? La réforme de Luther, de Zwingli, de Bucer, de Melanchthon et surtout l’Évangélisme français, embrassent la variété de toutes les tendances qui se réclament de la Bible, à l’exclusion de la tradition catholique, qui a fait le canon de la Bible. On peut même dire que c’est cette aversion de l’Église romaine qui donne au mouvement réformé une bonne part de sa force et de son unité. En se convertissant, Calvin découvre le sens de cette révolution qui attend beaucoup de lui : une théologie cohérente, une stratégie, une organisation. De tous côtés on lui reconnaît des talents extraordinaires : il est « prédestiné » pour devenir le docteur, le maître, le penseur de cette réforme encore si confuse. Il affirme qu’il n’a jamais eu d’ambition [274]. Il est difficile de le croire sur parole : « Il supportera si mal les contradictions et plus mal encore les attaques personnelles. Demain, à propos d’une question qu’il est tout prêt à considérer comme de minime importance, il préférera, par sa raideur, courir le risque de détruire la jeune Église de Genève, plutôt que de céder, ne fut-ce que temporairement [275]. »
La réflexion de Brunetière contient plus qu’une boutade : la conversion de Calvin fut... « une conversion à ses propres idées. Par une réflexion réciproque du mouvement sur son jeune chef, et de celui-ci sur le parti réformé, l’animation même de la lutte accroît la confiance en la justice de la cause que l’on défend, outre que la nécessité de répondre aux attaques, ou de les prévenir, oblige à mieux connaître cette cause elle-même [276] ». Avec l’adhésion au parti réformé tout lui fut subitement donné. Une fois surmontée la peur de manquer à la charité, la « révérence de l’Église » ne lui rappelle plus la menace d’Augustin contre « ceux qui, faute d’amour, déchirent le Corps du Christ ». Il se demande d’autant moins ce que l’Évangile pourrait exiger de lui personnellement, qu’il s’efforce davantage de découvrir ce qui manque à l’Église.
Parfois sur les chemins de la propagande réformée, il hésite sans doute « attendant ce que le Seigneur voudra faire de moi [277] ». Sa question est sincère, mais superficielle : il demande que le Seigneur lui indique des tâches à accomplir, au lieu de l’interroger d’abord sur ce qu’il doit être intérieurement. Il n’a plus d’autre regard que pour ce qu’il doit faire et, une fois lancé dans une action dévorante, il se persuade aisément : « Je sentais la vocation de Dieu qui me tenait lié. » Entre le séjour en Saintonge et l’arrivée à Bâle, il se dépense inlassablement. Il prêche, il compose des sermons évangéliques pour des curés sympathisants. Il étudie l’hébreu et le grec, il compose les premiers chapitres de sa théologie, il se répand dans tous les milieux capables de l’enrichir. Il est présenté au patriarche Le Fèvre d’Étaples et à la reine Marguerite, il approche Gérard Roussel, il cherche à disputer déjà avec le prestigieux médecin espagnol, Michel Servet, mais sans succès ; peut-être a-t-il même pu se mesurer avec Marot, Amyot et Rabelais ? Il dispute avec qui veut l’entendre et distribue ses lumières aux petits cénacles réunis par amour du grec ou par haine des moines. Il voyage beaucoup non en pèlerin mystique, mais en polémiste qui fait sa cueillette d’arguments et d’anecdotes, aliment de ses diatribes futures contre les scandales, les reliques, les « idoles papistes ». Il passe et repasse par la capitale. Il loge même chez le marchand La Forge, qui meurt sur le bûcher après son départ.
Il aurait sans doute continué cet apostolat sélectif si l’orage déchaîné par les Placards, le 19 octobre 1534, ne l’avait persuadé de sauver sa précieuse vie, en allant à l’étranger proclamer la nécessité de la « résistance ». L’insolente audace de Marcourt venait de faire perdre à l’Évangélisme une bataille. Mais Calvin méditait déjà de gagner la guerre, en mobilisant au service de la Cause tous les idéalismes et toutes les colères.
C’est un jeune maître, un génie précoce qu’on peut se représenter sous les dehors « séduisants » et inquiétants des portraits plus ou moins flattés : un front bien dégagé, droit, d’intellectuel cérébral. Le regard fixe et sûr de lui, confiant dans une mission supérieure ; le visage tendu, la bouche autoritaire déjà marquée du pessimisme et de la magie du verbe [278]. Porte-parole officiel, il ne se compromet qu’à bon escient, dans les circonstances décisives, afin de surgir avec un relief inattendu. Son message électrise ceux qu’il atteint. Sans incarner toutes les aspirations profondes de l’Évangélisme, il réussit à déclencher le glissement sur la même pente de toutes les diverses forces révolutionnaires mûres pour cette avalanche. C’est un chef que chacun sollicite un peu à la manière de Bucer : « Toi qui es si magnifiquement doué, auras-tu la conscience de repousser la charge qui t’est offerte [279] ? » Ce don sur lequel on fonde, malgré ses craintes, ses vocations successives, c’est un talent incomparable pour plaider la cause de la Réforme.
Avocat de la Cause. Tel il a été choisi par ses partisans, tel il demeure à tous les niveaux de sa mentalité. Ce caractère d’avocat, avec lequel Calvin, à vingt-cinq ans, codifie, une fois pour toutes, les articles de son invariable doctrine, fixe le réformateur lui-même dans une attitude fâcheusement négative et « protestante ». Autant qu’à restaurer l’Institution chrétienne primitive, l’effort surhumain qu’il déploie est un impitoyable travail de démolition. Il fallait évidemment déblayer bien des choses. Mais rien n’est épargné de ce qui, avec un peu de compréhension et de patience, aurait pu être sauvé. Hiérarchie, tradition, liturgie, art sacré, rien ne subsiste. Tout est reconstruit à neuf, d’après un idéal abstrait et inflexible, sans souci de continuité, avec des produits de remplacement, avec des dogmes, un culte et une discipline, réinventés de toutes pièces, d’après des schèmes rigides qui emprisonnent juridiquement la substance vivante de la Bible. Et c’est toute la chrétienté que son prosélytisme veut endoctriner et rééduquer suivant le système définitivement arrêté dès 1536.
« Nous sommes procureurs de Dieu », dira un jour Calvin pour justifier les observations qu’il adresse au prétendant Antoine de Bourbon [280]. Voici la Cause incomparable, dont le retentissement dépassera tous les procès connus, à laquelle il ne manque plus qu’un avocat général. Calvin découvre ce qu’il cherchait en vain dans les lettres et les publications savantes : un sujet infaillible pour frapper l’opinion, une controverse qui passionne tous les milieux de tous les pays. C’est un débat immense qui touche à tous les domaines, à l’humanisme et à la science, à la politique et à la morale, au droit et à la théologie. C’est une cause idéaliste. Il s’agit de défendre les « pôvres fidèles et saints personnages » qu’on brûle en France, dont « le bruit est venu aux nations étrangères [281] ». C’est une cause émouvante et pittoresque tout à la fois. En opposant les martyrs de l’Évangile et leurs adversaires, ceux qu’il a bien connus, les saints lecteurs de la Bible, comme La Forge, et les théologiens bornés et têtus, comme Béda, Calvin pourra colorer son réquisitoire de teintes hallucinantes. L’heure est solennelle. Les bûchers qui s’allument contre les iconoclastes et les provocateurs des Placards confèrent au plaidoyer calviniste une chaleur communicative : « Si dans cette nécessité je dissimulais ou me taisais, je serais traître à la vérité... Je ne pouvais m’excuser qu’en me taisant je ne fusse trouvé lâche et déloyal [282]. »
Il sera donc le défenseur des martyrs. Mais pour combien de temps ? À quelle profondeur pénètre son amour de la liberté des consciences ? Il ne veut pas trahir la vérité, mais en se défendant, il passe immédiatement à l’attaque et trahit la charité. Vengeur des méchants, il ne peut pas être déloyal, et cependant, il poursuivra bientôt non seulement ses adversaires, mais ses partisans, ses concurrents, avec le même fanatisme intolérant qu’il dénonce [283]. Il ne se pose pas le problème du martyre en termes d’humanité ou de philanthropie, comme le ferait un Castellion, ou en termes de charité, comme le font, en ce moment tant de spirituels et d’évangéliques. Il est théologien et juriste. La pensée qu’il y ait des martyrs dans les deux camps ne le bouleverse pas. Il trouve normal que chacun vénère ses propres martyrs et accable ceux d’en face. Les martyrs sont plus des partisans que des témoins au sens primitif du mot. Le même individu peut fort bien, à cette époque, avec une mentalité de persécuteur, subir le martyre, ou prendre sa revanche du martyre en devenant, à son tour, persécuteur.
*
* *
Tout en supposant la légitimité de la répression des hérétiques et des ennemis de l’ordre, Calvin écrit l’« Épître au Roi de France » et l’« Institution chrétienne » pour démontrer que les victimes du parti sont innocentes et que l’orthodoxie est uniquement de leur côté. « L’Épître au roi est un éloquent plaidoyer pour les adhérents de la nouvelle doctrine, tandis que l’Institution chrétienne est, en quelque sorte, le dossier des pièces justificatives à l’appui de ce plaidoyer [284]. » Si l’apologiste gagne son procès devant le tribunal de la France et de l’opinion mondiale, il sera bien entendu que les accusateurs recevront le châtiment qui ne tombe encore que sur les faux coupables, de faux rebelles.
Le succès du chef-d’œuvre surprit l’auteur lui-même, qui, à vingt ans de distance, tient à affirmer son parfait désintéressement. « Que je n’eusse point ce but de me montrer et acquérir bruit, je le donnais bien à connaître, parce que, incontinent après, je me retirai de là (de Bâle) : joint mêmement que personne ne sût là que j’en fusse l’auteur : comme aussi partout ailleurs je n’en ai point fait semblant (quod etiam alibi semper dissimulavi !) et avais délibéré de continuer de même jusqu’à ce que Farel me retînt à Genève... par une adjuration épouvantable, comme si Dieu eût d’en haut étendu sa main sur moi pour m’arrêter [285]. »
Ainsi s’est accréditée la légende que la première Institution aurait été anonyme. En réalité elle porte bien visible le nom de l’auteur : « Joanne Calvino, Noviodunensi autore [286] ». Tandis que Calvin séjourne à Bâle et voyage incognito, c’est probablement pour des raisons de sécurité qu’il se cache sous des pseudonymes, tels que Martianus Lucanius, d’Espeville, etc. Non par modestie, mais pour assurer un retentissement souterrain et prolongé de ses ouvrages, il agit souvent par personne interposée. Pour fuir la gloire, il était inutile de quitter Bâle, du moment qu’il était là « comme caché et connu de peu de gens », sous un nom d’emprunt. En contraste avec l’oubli qui recouvre ses premiers essais, l’accueil émerveillé que rencontre son manifeste de mars 1536 ressemble à un évènement providentiel, qui confirme la thèse édifiante de la prédestination : « Comme David fut pris d’après les bêtes, et élevé au souverain degré de dignité royale, ainsi Dieu, de mes petits et bas commencements, m’a avancé jusqu’à m’appeler à cette charge tant honorable de ministre et de prêcheur de l’Évangile... ut præco essem et minister [287]. »
Le héraut de l’Évangile semble répondre victorieusement aux mesures draconiennes prises en France contre la rébellion qu’on voyait dans l’affaire des Placards. Ses tirades sur l’obligation qu’a le prince de respecter la foi authentique de ses sujets enchantent l’élite et la foule réformées. On ne prévoit pas le contrecoup : un raidissement de la politique française contre la Réforme. Peu d’hommes auront autant contribué à sauver la France du protestantisme que le jeune auteur de l’Institution. Sa réussite préserve son parti de l’anarchie et du discrédit, mais elle coalise aussi contre lui tous les esprits hésitants. Personne ne peut plus se méprendre : avec Calvin, il est sûr désormais que la Réforme ne pourra plus se continuer dans l’Église. À Ratisbonne, en 1541, Bucer et Melanchthon nourrissent encore des espérances que le schisme n’est pas irrémédiable. Pour Calvin, en 1536, il est déjà définitif. Il annonce la sortie d’Égypte et cherche pour son peuple élu une terre promise et, pour lui-même, un point d’appui, une tribune, comme ni Bâle, ni Strasbourg ne pouvaient lui en offrir. Nous ferons honneur à Calvin en supposant que des raisons plus décisives que les imprécations tonnantes de Farel l’ont fixé à Genève. « L’épouvante et l’ébranlement » provoqués par ces malédictions étaient plus propres à exciter qu’à modérer le penchant d’un Cauvin pour les considérations pratiques. Il ne lui a certainement pas échappé que cette ville indépendante était un carrefour de premier ordre, un trait d’union entre le monde latin et le monde germanique, une ville d’expression française, comptant vingt mille auditeurs éventuels, alors que Strasbourg, avec l’émigration, ne réunit que quelque quinze cents Français. Ailleurs, en dehors de son propre pays, pour lui qui ne comprend pas l’allemand et ne fera jamais rien pour l’apprendre, où trouver un piédestal pareil ?
Il a résigné ses bénéfices en mai 1534 et, sur les chemins de l’exil, il attend la réalisation de l’idéal d’une chrétienté nouvelle. Comme son cousin Louis Olivier, il porte au cœur des sentiments d’un mysticisme amer : il n’a plus rien à perdre et tout à gagner, et pense que tel est le sort de l’Église entière : « En avant donc pauvre petite Église qui as encore eu état de chambrière sous les furieuses trognes et magistrales menaces de tant de maîtres renfrognés et rébarbatifs ; va décrotter tes haillons tout poudreux et terreux d’avoir couru, viré et tracassé par le marché fangeux des vaines traditions ; va laver tes mains toutes sales... va nettoyer tes yeux tout chassieux de superstition et d’hypocrisie... Viens hardiment avec les plus braves et mignons de ta cour, tous faits exécration pour Christ, non pour leurs méfaits ; desquels titres sont ceux-ci à savoir : Injuriés, Blâmés, Chassés, Décriés, Désavoués, Abandonnés, Excommuniés, Anathématisés, Confisqués, Emprisonnés, Géhennés, Bannis, Echellés, Mitrés, Décrachés, Chaffaudés, Essoreillés, Ténaillés, Flétris, Tirés, Traînés, Grillés, Rôtis, Lapidés, Brûlés, Noyés, Décapités, Démembrés et autres semblables titres glorieux et magnifiques du royaume des cieux [288]. »
Calvin est admirable quand il quitte son pays avec Louis du Tillet pour cause de religion ; il le sera déjà beaucoup moins quand il s’emportera contre ce même ami, coupable seulement de ne pas approuver l’excommunié d’hier si pressé d’excommunier à son tour ses adversaires, le fugitif qui va tout de suite s’arroger la mission de proscrire les propres partisans de la réforme, rebelles à certains raisonnements de son système [289]. Il est émouvant de lire les déclarations de Calvin dans sa préface à la Bible d’Olivétan :
« Sans l’Évangile, nous sommes inutiles et vains... sans l’Évangile, nous ne sommes chrétiens... Mais par la connaissance de l’Évangile, nous sommes faits enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, combourgeois des saints, citoyens du royaume des cieux, héritiers de Dieu... L’Évangile est la parole de vie et de vérité. C’est la puissance de Dieu au salut de tous croyants. Et la clef de la science de Dieu qui ouvre la porte du royaume des cieux aux fidèles, les déliant de péchés : et la ferme aux incrédules, les liant en leurs péchés... Malheureux ceux qui ne la veulent ne ouïr, ne ensuivre : car ils sont enfants du diable... Quelle chose donc sera-ce qui nous pourra étranger et aliéner de ce saint Évangile ? Seront-ce injures, malédictions, opprobres, privations des honneurs mondains ? Mais nous savons bien que Jésus-Christ a passé par tel chemin, lequel nous devons suivre, si nous voulons être ses disciples, et n’est pas à refuser d’être contemné, moqué, abaissé, rejeté devant les hommes : pour être honoré, prisé, glorifié, exalté, au jugement de Dieu. Seront-ce bannissements, proscriptions, privations de biens et de richesses ? Mais nous savons bien que quand nous serons bannis d’un pays, la terre est au Seigneur. Et quand nous serons jetés de toute la terre, que nous ne serons pas toutefois hors de son règne... Bref si nous avons Jésus-Christ avec nous, nous ne trouverons chose si maudite, qui ne soit bénie par lui ; chose si exécrable qui ne soit sanctifiée : chose si mauvaise qui ne nous tourne en bien [290]... »
« Quelle ampleur déjà et quelle richesse d’expression chez un écrivain de vingt-cinq ans ! » note John Viénot. En effet, cette éloquence est admirable, presque trop belle. Elle gagnerait en chaleur et en transparente vérité si elle était moins calculée, moins habile et fuyante. La pensée glisse : « Qui nous séparera de l’amour de Jésus-Christ », devient « qui nous séparera de l’Évangile », puis « qui nous séparera de l’Évangélisme ». Des bouffées de ressentiment interrompent les tirades les plus mystiques : « Les enfants du diable, pervers, rebelles et réprouvés qui auront contemné et rejeté ce saint Évangile » marquent trop nettement le parti des mal pensants qui ne reçoivent pas sa parole pour celle du Christ. Et plus suspecte encore que cette agressivité toujours latente, ce qui met un lecteur moderne mal à l’aise et charmait sans doute les hommes de la Renaissance, c’est une dialectique brillante, sinueuse et compliquée et surtout une étourdissante rhétorique, un moulin à paroles et à antithèses, qui ne s’arrête qu’après avoir épuisé le discours.
« Tout ce qui se pourrait penser ou désirer de bien est trouvé en ce seul Jésus-Christ. Car il s’est humilié pour nous exalter, il s’est asservi pour nous affranchir, il s’est appauvri pour nous enrichir, il a été vendu pour nous racheter, captif pour nous délivrer, condamné pour nous absoudre, il a été fait malédiction pour notre bénédiction, oblation de péché pour notre justice, il a été défiguré pour nous figurer. Il est mort pour notre vie. Tellement que par lui rudesse est adoucie, courroux apaisé, ténèbres éclaircies, injustice justifiée, faiblesse vertueuse, déconfort consolé, péché empêché, mépris méprisé, crainte asseurée, dette quittée, labeur allégé, tristesse réjouie, malheur bienheuré, difficulté facile, désordre ordonné, division unie, ignominie anoblie, rébellion assujetie, menace menacée, embûche débuchée, assaux assaillis, effort efforcé, combat combattu, guerre guerroyée, vengeance vengée, torment tormenté, damnation damnée, abîme abîmé, enfer enferré, mort morte, mortalité immortelle. Bref miséricorde a englouti toute misère et bonté malheureté, etc. [291] »
D’une manière ou de l’autre, par la vitesse et la puissance du verbe, par la quantité des citations, par le poids et la violence des arguments, l’apologiste fait toujours impression. Mais quelle est la qualité de ce message si peu intérieur, si occasionnel ? À son point de vue unilatéral, l’Institution tendait essentiellement à démontrer que les martyrs réformés ne devaient pas être confondus avec les Anabaptistes et « gens séditieux ». Une seule cruauté et « effusion du sang innocent » l’indigne. Une seule « compassion et sollicitude » partiale le touche [292]. Que des chrétiens s’entre-tuent, pourvu que les uns aient raison et s’attribuent seuls la palme du martyre !
Cette déviation de l’idéal chrétien du martyre étonnera beaucoup de gens cultivés et même le peuple. Elle ne trouble pas des doctrinaires, pressés de lire dans la Bible tout ce que leur dicte leur subconscient. On ne demandera pas non plus à Calvin d’être toujours conséquent avec lui-même. En passant par le canal de Montaigu et les finesses des légistes, l’objectivité se fait bien relative. Un arrangement extérieur, oratoire et dialectique, suppléera la cohérence et la logique réelle, surtout chez un plaideur pressé de choisir les arguments en fonction de leur seule efficacité. Aux différents états du procès, les mêmes raisons peuvent servir tantôt dans un sens, tantôt dans un autre.
Caroli devait, un jour, blesser le réformateur au vif : « On voit bien qu’il a été avocat au Châtelet. » Pour le démentir Calvin écrit un réquisitoire dont la violence atteint le paroxysme et qui trahit son avocat mieux que l’acte le plus officiel. Le pamphlet de la plume de Calvin se présente pudiquement sous le nom de son ami Nicolas des Gallars qui lui sert encore de truchement pour ruiner la mémoire de Bolsec, de Servet, un peu comme Cop lui a peut-être déjà prêté sa voix courageuse pour affronter les théologiens de Paris. Voici donc la pièce fabriquée qu’il verse au dossier de son plaidoyer pro domo : « Caroli affirme que Calvin a été avocat au Châtelet, à Paris. Mais je sais, moi, (Gallars-Calvin) que Calvin n’a jamais vu ce tribunal. Tous ceux qui le connaissent ici savent qu’il n’a jamais plaidé une cause dans sa vie, et que, ni par profession, ni par le titre, il n’a jamais été avocat [293]. » Vétille qui ne méritait pas un tel barrage d’artillerie si elle n’avait pas justement touché le point faible de Calvin. Les dénégations concernant les procès anodins du Châtelet ne font que mettre en évidence le fait capital : le réformateur a plaidé toute sa vie. On imaginerait difficilement un homme qui soit plus « avocat » sinon par le titre, du moins par l’esprit, par l’éducation, par le caractère et même par la doctrine.
Il ne peut faire autrement : il sait qu’il peut être le premier et le plus fort chaque fois qu’il prend la parole ou la plume. Et tout naturellement, à son point de vue juridique, avoir raison, c’est avoir gain de cause, c’est débouter le contradicteur. Supériorité qui requiert moins la compréhension véritable des problèmes que l’habileté d’un joueur d’échecs, l’exploitation systématique de toutes les chances de gagner, en affirmant son point de vue, en imposant son jeu. Peu importe s’il faut exagérer sa propre pensée et fausser, à force de violence, les positions des adversaires. Dans toutes ces disputes, et Dieu sait s’il eut le don d’en susciter, la « force » de Calvin consiste à trouver le point faible de la partie adverse, à éluder les objections qui reviennent sans cesse, toujours les mêmes, toujours aussi peu approfondies [294]. Il en jaillit, comme d’un projecteur, des faisceaux de lumière très vive, mais très étroite, où seuls quelques aspects de la réalité éclatent et aveuglent.
Il faudrait analyser tous les aspects de cette personnalité multiple, son style, ses principes de raisonnements, ses méthodes de propagande et de gouvernement, ses attitudes religieuses elles-mêmes, pour mesurer à quel point la mentalité juridique pénètre tout, les détails du vocabulaire, les images et les symboles employés. « Dans sa plus ancienne lettre connue... Calvin emploie le langage de l’école de droit, même en écrivant familièrement à ses amis [295]. » Il est toujours occupé à présenter quelque « point de défense », à établir la « connaissance d’une cause », qui, avant lui, a été évoquée « sans nul ordre et droit », sans « gravité judiciaire ».
« Calvin, nous dit Pannier, dans l’Institution même, reconnaît expressément ce qu’il doit aux études de droit, de philosophie, de logique qu’il a faites de longues années. Quoique les études de droit n’aient pas été les premières en date, ce sont elles que l’étudiant, conscient de ce qu’il leur doit, met en première ligne dans l’énumération ci-après, et peut-être à certains égards, pour la formation de son esprit, de sa méthode, de sa langue, les études juridiques ont-elles été les premières en importance. » Et l’auteur clairvoyant des « Recherches sur la formation intellectuelle de Calvin » de citer le témoignage significatif : « Pourrons-nous nier que les anciens jurisconsultes n’aient eu grande clarté de prudence en constituant un si bon ordre et une police si équitable ?... Dirons-nous que ceux qui nous ont enseigné l’art de disputer, qui est manière de parler avec raison, n’aient eu nul entendement ?... Au contraire nous ne pouvons lire les livres qu’ils ont écrits en toutes ces matières, sans nous émerveiller [296]... » Le droit et l’art d’avoir raison représentent aux yeux de Calvin, le sommet de la perfection humaine, de la sagesse et de la culture naturelles.
Tous les historiens qui retracent l’évolution de notre réformateur, depuis Michelet jusqu’à Choisy et Pannier, signalent l’influence prépondérante de la formation et de l’inspiration juridiques dans la mentalité de Calvin. Il n’a consacré, dans sa jeunesse, à aucune discipline autant de place qu’à la jurisprudence. En comparaison des longues années occupées par le droit, ou par des études auxiliaires du droit, la préparation théologique qui précède l’Institution ne lui a peut-être demandé que quelques mois [297]. Ce n’est qu’à Bâle qu’il peut s’y consacrer avec des loisirs suffisants. Il ne commentera pas différemment Sénèque et saint Paul, avant appris dans les Institutes comment mettre sur pied une Institution de la cité chrétienne idéale.
Il appartient à cette classe d’avocats qui, en France, occupent le devant de la scène dans toutes les périodes de crise et, comme le dit Madelin, sont les « revenants de toutes les révolutions ». La révolution du XVIe siècle étant essentiellement religieuse, Calvin devient le chef d’une réforme et d’un mouvement confessionnels. Mais en tout temps, son génie révolutionnaire aurait percé. Ce converti a tout du légiste ; sa parenté avec les saints reste éloignée. Si brûlant que soit son zèle, si ardente que soit sa foi, il y a un point mort et glacé au centre de lui-même qui ne fond jamais entièrement. Le jeune scrupuleux, qui se tourmentait de la gravité plus ou moins sérieuse de certaines fautes, semble plus attachant que le réformateur emporté dans la tourmente sous le pauvre couvert juridique de l’« imputation de justice », ou de la justification forensique, pour parler le jargon de l’école. C’est ici que font halte les Lefranc, les Pannier, les Lecoultre, les Wernle, les Viénot et tant d’autres admirateurs d’un Calvin que le calvinisme n’a pas encore... transformé. Le reste, c’est-à-dire la vie publique, toute la réalisation de la dictature théocratique, ne présente plus le même intérêt. Il semble, en effet, plus « évangélique » dans ses débuts de réforme, qu’au terme de son voyage à travers la sombre forêt des Écritures.
Il fait encore figure de héros, de libérateur intellectuel, tandis qu’il s’applique à défendre et « à purger ses frères desquels la mort était précieuse devant le Seigneur... » afin qu’« on fût averti quelle foi ils tenaient ». Cette foi, les « Saints martyrs » supposent qu’elle se trouve simplement dans leur Évangile. Le jeune avocat démontre qu’elle doit se confondre, ainsi que la Bible elle-même, avec sa doctrine personnelle. « La forme particulière de l’esprit de Calvin, plus constructeur qu’imaginatif », lui permet de fabriquer, dans le style humaniste, un ensemble monumental de certitudes prélevées sur le capital collectif des opinions les plus différentes : points de vue augustiniens, stoïciens, scolastiques, réformés, érasmiens, etc.
On ne connaît pas d’ouvrage comparable à cette Institution chrétienne. Rien d’aussi original, d’aussi définitif dans son assurance catégorique. Rien d’aussi emprunté. L’Institution semble appartenir à tout le monde, mais cette compilation juvénile n’incarne que la mentalité de Calvin à l’exclusion de tout autre. Son système fait de pièces détachées est monté si solidement que toutes les parties s’emboîtent à la perfection. C’est une synthèse à laquelle rien ne manque et dont rien ne saurait être séparé. « Les idées en apparence les plus neuves et les plus révolutionnaires doivent leur originalité beaucoup plus à un arrangement nouveau de conceptions connues qu’au pouvoir créateur » du jeune maître. Il emprunte la prédestination à Augustin, aux nominalistes et à Bucer ; la volonté souveraine de Dieu à Duns Scot ; la notion de la foi et de la morale à Érasme et à Luther ; les vertus théologales, la doctrine des Sacrements et la christologie à Melanchthon ; la discipline, la liturgie, la prière, la doctrine eucharistique et ecclésiastique à Bucer, etc. [298]
Avec ce travail d’amalgame théologique, une autre transmutation, celle des valeurs catholiques, va de pair. Ici Calvin s’arrange encore plus librement : « On ne saurait nier, dit Brunetière, qu’il ait fait preuve d’une subtilité qui ressemble souvent à de la sophistique, si le triomphe en est l’art de déplacer les questions... Calvin tantôt en brouillant habilement les termes, tantôt en s’arrogeant sur ses adversaires la supériorité de l’insulte, excelle, non seulement à déplacer les questions, mais vraiment à en dénaturer le sens : et aussi, comme on le voit, les questions, après comme avant son argumentation, demeurent-elles entières [299]. »
Est-ce dire qu’il n’est pas sincère ? Il a toute la bonne foi passionnée, sinon éclairée, des partisans obligés de se convaincre à la lumière fumeuse de la colère. C’est, en outre, la sincérité d’un avocat pro domo qui ne voit plus rien que sa cause. Il s’est exprimé tout entier dans sa devise : « Prompte et sincere » ; il est violemment sincère, avec tout ce que cela comporte parfois d’aveuglement instinctif.
Il avait d’ailleurs beau jeu. Les temps étaient mûrs pour une épuration radicale de l’Église. Tout particulièrement à la tête, une réforme semblait s’imposer. La bureaucratie romaine, l’asservissement de la hiérarchie au jeu des puissances, discréditaient l’autorité centrale, profanaient les pouvoirs d’ordre et de juridiction. Le magistère lui-même avait perdu de son prestige. Comme indifférente à sa mission essentielle, Rome laissait les théologiens défendre le monopole de la foi, dans des querelles souvent absurdes qui semblaient vouloir vider la piété du meilleur de sa substance. La capitale de la chrétienté, utilisée comme comptoir d’échanges entre biens temporels et spirituels, encourageait presque le dédain des novateurs. Si, comme le disaient les flatteurs curialistes, au règne de Vénus (Alexandre VI) avaient pu succéder celui de Mars (Jules II) et celui de Pallas Athenê (Léon X), pourquoi la Bible de Luther ou la Moïra calviniste n’auraient-elles pas leur tour [300] ? L’Église pour laquelle le jeune Calvin élevait la voix, attirait les consciences honnêtes éprises de justice et de dignité. Au reste, ce n’est que pour la seule Église véritable que le jeune réformateur recrute des fidèles. Il la veut « purgée de ses macules », surnaturelle, morale, exemplaire [301]. Elle apparaîtra d’autant plus parfaite, dans l’abstrait et l’utopie, qu’il chargera davantage l’Église réelle de tous les vices de son imagination.
Qui pourrait prévoir, devant tant d’idéalisme, que la réforme attendue serait un nettoyage par le vide absolu de tout symbolisme, de tout sens du mystère et du sacré ? Le vénérable édifice présentait sans doute le désolant spectacle de l’abandon. Les couches de poussière et les toiles d’araignée s’étalaient un peu partout. Calvin s’évertue à gratter la muraille jusqu’à la pierre nue qui lui suffira. Pas de surcharge, pas de décoration, pas d’inventions humaines. Il ne se doute pas que sa main n’atteint que les nefs latérales de l’ancienne Église. Parallèlement à celle-ci et comme en doublure, en quelque sorte dans son sein, il organise une vie ecclésiastique très stricte qui, tout en protestant contre les abus de l’autorité, lui substitue l’arbitraire « pur ».
L’homme qui dit : « Sans docilité et sans modestie nous ne savons ce que c’est que d’être chrétiens », enchaîne presque immédiatement contre un candidat au ministère de Loudun qui n’est pas de son goût : « S’il avait dextérité angélique en savoir et éloquence, malheur sur lui, quand il ne se voudra assujettir à la foi commune... Quand vous seriez les plus aigus du monde, en quelle école avez-vous appris que gens privés puissent élire un homme à leur poste ? Telle licence sera toujours maudite, vu qu’elle ne tend qu’à rompre l’union de l’Église. Mais pour vous en dire le vrai, jusqu’à ce que votre moine nous ait convaincus du contraire, nous le tiendrons pour une bête aussi sotte que fière [302]. » Calvin s’est donc persuadé qu’il avait, non seulement « dextérité angélique en savoir et éloquence », mais tous les titres juridiques et publics requis pour gouverner l’Église.
Il n’a cependant guère pris conseil que de lui-même pour constituer sa dogmatique et son droit canon, les Ordonnances. Et il va dicter urbi et orbi, à des Églises sur lesquelles il n’a aucune autorité, des ordres plus impérieux, des anathèmes plus cinglants que ceux du Pontife romain. Au moins, quand un mauvais pape envoie ses messages pleins de « formules pieuses, de superlatifs et d’onction, parsemés de citations bibliques », son Nous majestatif représente une tradition, une pensée collective. Calvin ne s’en préoccupe guère, tant il est sûr de parler au nom de Dieu. Les autres peuvent s’égarer, Lui ne saurait se tromper, ni tromper son prophète qui tient les signes évidents de son élection.
III
EXAMEN DE CONSCIENCE
Porte-parole d’une mystique généreuse, Calvin est chassé de France avec tous ceux qui refusent de se soumettre au système et à l’autorité ecclésiastiques en vigueur. Il plaide éloquemment, dans l’« Épistre au Roy de France », en faveur d’une religion de l’esprit contre ceux qui « requièrent toujours une forme d’Église visible et apparente... nous, au contraire, affermons que l’Église peut consister sans apparence visible, et même que son apparence n’est à estimer de cette braveté extérieure, laquelle follement ils ont en admiration [303] ».
Il semblerait donc que le renouveau intérieur du « peuple des fidèles » soit le but de sa mission prophétique. Il n’en est malheureusement pas ainsi, parce que, dès le point de départ, la vision ecclésiastique de Calvin s’arrête sur des frontières qu’elle ne dépassera pas. Il tient trop aux définitions, aux marques formelles « à savoir la pure prédication de la parole de Dieu, et l’administration des Sacrements bien instituée ».
Le célèbre défenseur de l’Église invisible n’arrive donc à Genève, émancipée de l’autorité épiscopale, que pour se faire chasser par ceux-là justement qui avaient réalisé sa théorie. Ils avaient très bien compris « la tyrannie que a exercée le pape et... aucuns méchants évêques ». Mais ils ne saisissent pas, du premier coup, comment cette « excommunication, l’une des choses les plus pernicieuses et maudites qu’on voie au royaume du pape », puisse subitement devenir, entre les mains du jeune Calvin, « une des choses les plus profitables et salutaires que ait donné Notre Seigneur à son Église [304] ». Il faudra patienter encore longtemps avant que cette évidence s’impose à ces hommes libres, peu désireux de croire qu’« une Église ne peut consister en son vrai état sans garder cette ordonnance ».
S’il faut en croire le clairvoyant professeur E.-G. Léonard, quelle serait la principale cause de la Réforme ? Non pas « les vices de la papauté et du haut clergé mais leur autoritarisme et la rupture de la communion avec les masses des fidèles. Par les soins de l’Église catholique, l’individualisation de la piété s’était produite [305] ». Mais la piété personnelle, la connaissance directe de la Bible ne suffisent pas à Calvin. Il veut réussir là où le pape et les évêques semblent justement avoir échoué. Il rêve de transformer l’Église, comme ses adversaires de la première heure, de manière que cela « se voie présentement à l’œil [306] ». Moyennant une nouvelle « forme » d’excommunication, une nouvelle « forme d’oraisons publiques », moyennant force professions de foi et « bonne police », les gestes religieux officiels et les apparences de la moralité seront saufs. C’est toute son ambition.
Malheureusement la piété chrétienne pose tout d’abord un problème de réforme personnelle. C’est justement à cette tâche, pourtant essentielle, que le nerveux réformateur de l’Église se dérobe. Il déploie des efforts surhumains en vue d’assurer une refonte disciplinaire, doctrinale et politique de la chrétienté, mais il ne supporte pas qu’un ami lui rappelle le devoir de rentrer en lui-même.
À ce problème, Calvin, un jour, s’est heurté de front. Dans la crise qui suivit l’expulsion de Genève, son grand bienfaiteur, du Tillet, qui le connaît intimement et le suit depuis quatre ans, lui conseille de se recueillir, de laisser là, pour un temps, l’agitation et de réfléchir, à la lumière des expériences faites, sur sa mission et sur la volonté de Dieu [307]. Peut-il nier qu’il a hésité et qu’il hésite encore sur sa vocation de réformateur ? La réaction de Calvin fut très vive. Il répond par un plaidoyer passionné ; il se retranche derrière un argument juridique : l’avis « d’autorités non contemptibles », de partisans de la même cause (Bucer et Farel), le dispense de s’examiner personnellement. Des hommes entraînés dans la révolution religieuse l’assurent qu’il a un rôle à jouer, cela suffit pour qu’il se dispense de consulter son âme ; des encouragements intéressés, des comparaisons bibliques le disculpent des actes si peu évangéliques, provoqués par son passage à Genève. L’incident de la rupture avec du Tillet nous renseigne plus sur la vie intérieure du prophète que de longs traités théologiques [308]. Malgré la conclusion excessive qu’il en tire, l’historien hollandais Pierson l’a bien pressenti. N’en déplaise à Doumergue, du Tillet « a connu Calvin mieux que personne et le juge avec autant de perspicacité que d’affection ».
Dans les années tournantes de 1533 à 1537, peu d’hommes ont approché le réformateur aussi près. Depuis le discours de Cop, c’est auprès du curé de Claix qu’il se réfugie, c’est dans sa bibliothèque qu’il réunit les premiers éléments de sa théologie. C’est avec lui qu’il affronte l’opposition et l’exil. Nous les trouvons ensemble à Metz, à Bâle, à Ferrare, à Genève. C’est lui qui le présente à Farel et contribue à le fixer en Suisse. Pierson suppose même que cette intervention de du Tillet aurait été gratuitement imaginée après coup par Calvin, pour couvrir du nom de son ami infidèle sa vocation douteuse. Mais les hypothèses sont ici parfaitement superflues. Le témoignage de Louis du Tillet est suffisamment clair dans sa simplicité touchante. Il n’y a chez lui aucune trace d’animosité ou de polémique, mais une grande souffrance intérieure et tant de preuves d’une généreuse fidélité. Son jugement sur Calvin a d’autant plus de poids qu’il lui est adressé directement et que, par crainte de blesser sa susceptibilité, il ne dit que le minimum de ce qu’il croit devoir dire. Il lui fut très pénible d’ouvrir les yeux sur la réalité de la « réformation » à Genève et sur l’étrange esprit évangélique avec lequel Farel et Calvin se permettaient de résoudre violemment les plus délicats conflits de conscience. La bonté et la loyauté de son cœur subissent un rude désenchantement.
Louis du Tillet est un caractère modeste, tolérant, désintéressé, nullement emporté ni fanatique. Entre lui et Calvin il n’y a qu’une barrière : le sentiment que l’intransigeance de la nouvelle Église crée à Genève un climat encore plus étouffant que celui de la papauté. Du Tillet demande à son ami de s’expliquer sur le côté objectif du désaccord. La vie chrétienne des catholiques sincères est-elle dépourvue de toute valeur ? N’y a-t-il que du mal dans l’Église qu’ils ont quittée, et que du bien dans celle qui essaie, avec tant de vacarme, de se constituer à Genève ? La Tradition est-elle une quantité négligeable ? Les talents et les dons extérieurs des novateurs peuvent-ils suppléer à ce manque de continuité, à l’absence de délégation authentique ? Les vocations au ministère évangélique ne dépendent-elles que du mandat que chacun peut donner en consultant ses titres philologiques, ses talents, ou encore en se rangeant simplement, comme le fait Calvin, à l’avis d’hommes qui n’ont pas plus d’autorité que lui ?
Calvin ne répond pas directement [309]. Il se contente, suivant un procédé habituel aux polémistes, de déplacer la question, de se rabattre sur son thème favori de l’abomination de l’Église papiste, comparée, dans un élan de rare condescendance, à la synagogue, « bien qu’il reste sur elle beaucoup moins de bénédictions divines ». Il ignore avec hauteur le cas de conscience de son ami vilainement « révolté », comme si le bienfaiteur d’hier était subitement devenu un sujet félon. Du Tillet cependant, n’ayant pas eu le cœur de risquer une brouille avec son trop sensible ami, s’était éloigné discrètement, sous prétexte de voyage, avant même que le premier acte du drame genevois n’eût atteint son amer dénouement, causant malgré lui « grande fâcherie » : « Plutôt que je sois enlevé du monde terrien que d’approuver votre fait, lequel je connais être damnable en soi, et outre cela plein de ruine, ou pour le moins de merveilleuses offenses envers plusieurs... J’aime mieux de prier le Seigneur que son plaisir soit de vous délivrer de tous scrupules [310]... » Ainsi Calvin reprend sévèrement du Tillet que, par ailleurs, il trouve absolument digne de confiance : « Je vous estimais tant confirmé et résolu en cette affaire... vu la constance et la fermeté que vous montriez... je pense connaître en vous une telle crainte de Dieu qu’il me faudrait voir de grands arguments pour m’ôter la persuasion que j’en ai reçue... »
C’est comme si du Tillet, après avoir été l’initiateur et l’entraîneur de Calvin sur le chemin de la nouveauté, le laissait tout désemparé en le privant d’un soutien moral et matériel qui lui avait été bien précieux : « Vous m’avez de longtemps donné à connaître que le vôtre était mien. » Du Tillet avait recommandé à Farel ce jeune ami qui se révéla bientôt leur maître. Et voilà qu’il lui retirait, pour autant que cela dépendait de lui, cette investiture apostolique que les partisans se communiquaient les uns aux autres pour se rassurer réciproquement dans leurs audaces : « Je vois la promptitude que nous avons, pour nous justifier, d’induire les autres à faire le semblable. » Ce reproche de promptitude et de prosélytisme intéressé, Calvin aurait mieux fait de se l’adresser à lui-même, lui qui va chercher à Berne, Zurich et Bâle une approbation disant « que dûment et fidèlement nous avons administré notre charge... » à Genève [311].
« Ce témoignage est-il une sentence légitime pour fermer la bouche aux malins », qui lui disent avec toute l’amitié et toute l’« expérience de longues années » par la bouche de du Tillet : « Je doute que vous eussiez juste vocation de Dieu [312]... » Il ne formule cette conclusion qu’après avoir vu à l’œuvre ces nouveaux évangélistes. Il se tourmente d’avoir, à la légère, poussé en avant un réformateur qui avoue s’être, lui aussi, résolu avec anxiété : « Les plaintes que vous avez autrefois ouï de moi, dit Calvin, ne venaient pas de feintise : lesquelles testifiaient qu’il s’en fallait beaucoup que je fusse capable de soutenir la charge que j’avais [313]. »
Ces scrupules auraient dû être pris davantage au sérieux, pense du Tillet : « J’estime que les choses qui vous sont advenues ont été traitées et poursuivies par mauvaise affection de personnes qui tendent plus aux fins de ce monde qu’ils n’ont considération de Dieu. » Il y avait trop de politique dans leur réforme genevoise. « Je crois que vous avez plus à considérer, de votre part, si Notre Seigneur ne vous veut point avertir par là de penser s’il n’y a rien à reprendre en votre administration, et de vous humilier envers lui... » Les délégations encourageantes des chefs de file du parti ne créent encore aucune garantie intérieure. « Ma conscience n’a jamais pu s’apaiser de ce que, sans une certaine vocation de Dieu, je m’étais retiré » de l’Église catholique. Inquiétude « dont j’ai été mis en langueur que vous avez vue telle, que, pour les grandes et continuelles afflictions que mon esprit en a eu, j’ai été fait en tout ce temps-là (depuis plus de deux ans) inutile à toutes choses [314] ». Tout en voulant « garder union et amitié avec vous, ce que de tout mon cœur désire être perpétuellement.... proteste du Tillet,... si cette amitié doit durer... il ne faut pourtant pas que, pour suivre votre jugement, je délaisse celui de ma conscience ». Les « afflictions de conscience » ne sauraient être éliminées par des procédés juridiques : arguments tirés des textes, recours à des compétences ou à des « sentences légitimes... ». « Nulle conscience, pense du Tillet, ne se doit s’assurer devant Dieu, de la sûreté qu’un autre se y pense ou dit avoir, mais faut qu’elle se tienne à celle qu’elle-même a de Dieu. » Ce souci de conviction acquise par la voie intérieure de la réforme spirituelle et personnelle lui tient à cœur : « Quant à Jean (un frère ou un ami commun), il a sa conscience comme juge, comme les autres, et s’il la suit, soit pour ou contre votre conseil... il fera son devoir et sera toujours content. »
Du Tillet se permet de suggérer que la vocation d’un réformateur de l’Église universelle ne devrait pas reposer sur l’avis de tierces personnes intéressées, mais sur des certitudes reçues de Dieu dans la prière et la méditation paisible – exactement ce que Loyola conseille pour l’élection de tout état de vie. Il propose à Calvin le recueillement et la solitude : « Je loue et prise beaucoup votre délibération de vous arrêter pour le présent à Bâle, sans vous immiscer d’autre chose, en attendant que le Seigneur vous montrera vraiment où vous devez tendre... j’espère que par le temps vous penserez plus que n’avez peut-être encore fait... en invoquant Notre-Seigneur... ». Cette retraite devrait spécialement le protéger contre lui-même et sa passion, plutôt que « d’aigrir davantage les contentions » qui rendent toujours plus difficiles la compréhension de la vérité et la rétractation des erreurs. Une fois emporté par la controverse « chacun est bien aise de couvrir et de dissimuler sa faute [315] ».
Mais quelle vaine entreprise de recommander la réflexion calme et « recoite » à cette intelligence inquiète qui a besoin de disputes et d’agitation pour briller intensément. Lui fournir « une occasion de s’examiner soi-même » n’aurait de sens que s’il consentait à reconnaître sereinement ses torts. Il en est incapable. Il voudrait qu’on le « reprenne, mais que ce ne soit par simple et précise condamnation » ; il sait qu’il ne doit pas « se fier à son propre sens... ». « Car je sais ma portée telle, que je ne saurais si petit présumer de moi, que ce ne soit trop [316]. » Cependant, il se raccroche vivement au premier soutien qui lui permet d’avoir raison, sans rien perdre, ni de sa dignité, ni de son amour-propre : « Quand les plus modérés (Bucer) me menacent que le Seigneur me trouverait aussi bien que Jonas... je n’ai su que faire... en telle perplexité. » Il ne sait que faire... cependant reculer est impossible : « Touchant de ma retraite... (rentrer en France) rentrer où je serais comme en un enfer... » Certains sacrifices coûtent vraiment trop. Leur seule perspective efface toute hésitation : « Je vous prie de me permettre de suivre la règle de ma conscience, laquelle est plus certaine que la vôtre... »
Du Tillet est bien naïf de croire qu’un ami, comme le pense aussi Loyola [317], peut donner les meilleurs conseils sur une vocation s’il est désintéressé et en dehors des démêlés à résoudre. Calvin au contraire s’indigne de l’insistance avec laquelle son ami analyse tous les aspects de sa prétendue mission : « Quelle équité c’est qu’une personne fasse des arrêts en un cabinet, pour condamner tous ceux qui maintiennent journellement leur doctrine devant tout le monde ! » L’avis de ceux qui peuvent défendre leur doctrine en public doit prévaloir contre la réflexion solitaire. La sagesse d’un ami ne compte pas si les grands ténors du parti ont déjà formulé leur opinion. Le bon chanoine d’Angoulême s’entête doucement à croire qu’il peut amener Calvin « à bien s’examiner selon Dieu [318] ». Il défend les droits de l’esprit contre les prétentions de l’éloquence et de la dialectique : « Il n’est pas dit qu’une personne prêchant doctrine publiquement ne puisse faillir et que qui le connaît ne le lui puisse dire, en privé, par bonne équité. » Bien sûr, du Tillet n’a pas la dixième partie des talents polémiques et oratoires de Calvin : « Il ne s’ensuit pourtant pas que je ne puisse, en mon privé, voir et juger quelque chose de la vérité de Dieu touchant vous et autres qui enseignez tous les jours publiquement. » Il se croit tenu, en conséquence, de soumettre le réformateur à l’examen de conscience qu’il est si impatient d’éluder. Si jamais Calvin a eu un ami affectueusement attaché, loyal, naïvement soucieux de son bien, ce fut Louis du Tillet.
Le miroir qu’il met sans malice sous les yeux de Calvin reflète bien les traits réels du jeune maître de Noyon : « Il aime être quelque chose. Il se confie beaucoup, sans l’avouer, à la valeur de son jugement. Il a tendance à croire qu’il est le seul à avoir l’esprit de Dieu, ou qu’il en a plus que les autres. Il n’est pas libre de toute outrecuidance. Il désire que ce qu’il dit ou fait soit tenu pour être dit ou fait au nom de Dieu. Il est content de confesser des fautes légères qu’il voit en lui, pour faire croire qu’il n’en a pas d’autres. Il a un grand besoin qu’on l’approuve et ne supporte pas qu’on parle contre son sentiment ou qu’on le contredise... ». Quel drame ne soulèvera pas un jour la remarque de Bucer : « Nous jugeons d’après nos amours et nos haines [319]. » Du Tillet, comme tant d’autres, attendra en vain un signe d’amitié en réponse à sa franchise. On cesse d’être l’ami de Calvin, dès qu’on n’est plus de son avis.
De ce côté, son équilibre intérieur sera toujours fragile. Calvin n’en jouera pas moins le premier rôle dans la révolution religieuse de son temps. Le protestantisme doit peut-être sa victoire au fait que Calvin s’est refusé à rentrer en lui-même, pour pousser hâtivement une transformation extérieure des « institutions chrétiennes ». Dans son activisme fiévreux, il lui a manqué le regard serein du contemplatif ; il ne vit que pour sa cause. C’est pour elle qu’il peine et souffre, qu’il parle et écrit et répète, sous forme de prières, des professions de foi. Mais c’est aussi pour elle qu’il commet, après sa conversion, ses plus lourdes fautes, en se perdant dans l’action, comme le jeune homme qui, « pressé d’aigres aiguillons, chaque fois qu’il descendait en lui-même, ne trouvait ni soulas ni confort, sinon de se tromper soi-même en s’oubliant [320] ».
Cet « oubli de soi » qu’exige de lui la propagande réformée ressemble plus à une évasion qu’à une conquête de la paix intérieure. S’il a aimé « le recoi et la tranquillité », ce n’est qu’en rêve : « Je voudrais (irréel : cuperem) me cacher dans quelque retraite, si la fureur de ceux-là pouvait se calmer qui semble allumée par ma présence [321]. » Toujours on lui force la main. Toujours il se fait de sa mission une idée très haute, si haute que personne n’a le droit d’y toucher. Ne peuvent effleurer ce sujet que les amis complaisants prêts à dissiper au besoin les doutes qu’il pourrait concevoir lui-même. Mais, paradoxe constant : les efforts déployés pour moraliser les autres ne semblent pas lui profiter à lui-même. Sans cesse calculées pour un auditoire éventuel, ses prières mêmes, en dépit de formules parfois sublimes, tournent à la publicité, au discours. La réforme institutionnelle de l’Église, mise au premier plan, apparaît comme un obstacle à la réforme personnelle de son auteur.
DEUXIÈME PARTIE
DEUX LIVRES, DEUX RÉFORMES
_______
CHAPITRE PREMIER
Deux manuels de base
_______
À partir de 1536, deux petits livres commencent à travailler intensément l’élite de la Réforme et de la Contre-Réforme.
Il serait difficile de concevoir un parallélisme plus providentiel. Sans les Exercices, il n’y aurait jamais eu de Jésuites. Ignace n’a pu réunir sa « toute petite Compagnie », qu’après avoir gagné ses compagnons par sa méthode de la retraite ; et c’est le même idéal qui inspire les Constitutions de l’Ordre et ses innombrables réalisations apostoliques. De même, sans l’Institutio religionis christianæ que les voyageurs de toute sorte, étudiants, réfugiés, commerçants, vont colporter sous le manteau à travers les différents pays de l’Europe, Calvin n’aurait pas attiré sur lui l’attention du parti réformé. C’est ce petit ouvrage, ce résumé de la théologie protestante, qui consacre sa vocation de prophète. Grâce à ce manuel de piété, ce jeune intellectuel devient le chef doctrinal d’une nouvelle Église, conçue par lui comme la « Compagnie des fidèles élus » [322], soumise bientôt aux mots d’ordre de la « Vénérable Compagnie » des ministres genevois, serviteurs de la Parole, amplificateurs de son Verbe magistral. Deux petits livres que leurs auteurs ont sans cesse repris et retouchés, que leurs disciples ne cesseront d’utiliser comme les instruments de choix de leur propagande respective.
Le plus épais des deux livrets, l’Institution, fut composé, avec une rapidité étonnante, par un théologien autodidacte de 25 ans. En quelques mois, sans aucune préparation spéciale, le juriste de Noyon réussit à présenter au monde un système religieux définitif, absolument « moderne » et prétendument conforme aux textes originaux, une « religion en tous points raisonnable, raisonnée et rationnelle [323] ». Par contre, le livret passablement informe des Exercices ne fut jamais rédigé, mais seulement élaboré peu à peu, avec une lenteur et une patience invraisemblables, au cours d’expériences solitaires de la vie intérieure s’étendant sur plus de vingt années. Ces notes exclusivement personnelles, composées, c’est-à-dire disposées et classées en fin de compte suivant un certain ordre psychologique et théologique, tiendraient facilement dans une brochure deux fois plus petite que le « livret » de la première Institution.
À en juger par les apparences extérieures, c’est cette dernière qui est le chef-d’œuvre littéraire et « doctrinal », c’est elle qui récolta d’un coup le plus grand succès de librairie. Elle orchestrait le concert de toutes les revendications « évangéliques », des inquiétudes religieuses, des espérances humanistes ; elle jouait avec toutes les sonorités aiguës d’une éloquence encore juvénile, avec toutes les ressources d’une logique passionnée, d’un style de lettré un peu factice, nais aussi avec tous les éclats de voix du plaideur héréditaire. Impressionnés par le retentissement prodigieux de ce manifeste, les savants éditeurs des Opera Calvini, pourtant mesurés et clairvoyants, reprennent à leur compte l’emphase du Hongrois Paulus Thurius : « Depuis les écrits apostoliques, les siècles n’ont pas engendré de livre pareil [324]. »
Calvin et Loyola sont deux émules d’Érasme. Ils professent, chacun à leur manière, une « philosophie chrétienne », une sagesse évangélique, un art de vivre spirituel. Mais, alors que le jeune maître croit épuiser d’un coup la substance des Évangiles, le vieux converti n’a jamais fini d’apprendre dans les derniers détails la « science des saints ». D’une part, l’éblouissante synthèse d’un essayiste qui prêche, avec la dernière énergie, un idéal de sa propre confection ; de l’autre, le relevé pénible et presque informe des étapes suivies par les saints pour monter vers la perfection.
I
LES EXERCICES
Le livret de Loyola n’entre dans aucune catégorie littéraire. C’est une sorte d’agenda dont les observations schématiques ont été réunies après coup par ordre des matières, pour constituer une méthode aux apparences toutes techniques ; un aide-mémoire, une sorte de statut opératoire résumant les circonstances précises d’une expérimentation. Un « novum organum » de la spiritualité, où pas un mot n’est superflu, pas la moindre concession n’est accordée à l’amplification, à l’à peu près, au pathos. Cette rigueur et cette concision rebutent les profanes, les lecteurs qui, sans faire les Exercices, ne peuvent soupçonner derrière une façade gothique tant de richesses vivantes.
L’intérieur de l’édifice est très moderne. C’est un laboratoire de psychologie religieuse, où l’écueil n’est pas la précipitation superficielle, mais plutôt l’excès d’introspection et d’application. Car on peut aller trop loin à force d’analyser, non seulement la vie affective et pratique, mais encore les échanges les plus secrets entre l’esprit de Dieu et l’esprit de l’homme. Toutes ces observations minutieuses des impressions et des états d’âme, toutes ces règles, tous ces exercices chronométrés, sentent l’huile. Mais quels détails négliger, si l’on veut sérieusement se mettre à l’unisson de Dieu, et « disposer l’âme à échanger le désordre de ses tendances contre l’ordre de la volonté divine [325] ».
Il faut préalablement accorder l’instrument du Saint-Esprit, en purifiant méthodiquement la conscience, les inspirations des intentions les plus subtiles. Loyola s’obstine à réformer le dedans de l’homme, à réviser le plus soigneusement possible l’appareil à travers lequel Dieu parlera. La spiritualité n’avait jamais été ainsi dépouillée et concentrée : elle n’est pas un art bruyant, sentimental, spectaculaire. Elle n’est pas une profession de foi extérieure et publique, mais une réalité d’expérience personnelle, concrète et pratique. Loyola ne porte aucun jugement sur les questions profanes, si embrouillées, qui agitent alors tout le monde ; bien plus, il semble se désintéresser des aspects extérieurs de la religion : doctrine, hiérarchie, liturgie, sacrements, usages ecclésiastiques. Il ne s’occupe que du « cœur », de cette attitude centrale devant la vie qui commande tout l’homme. Quelles sont les dispositions profondes du retraitant ? Quelle est la direction de son esprit, où tend la fine pointe de sa volonté ? Les méditations, les examens, les contemplations, la direction, convergent toujours vers cette même orientation de la vie intérieure : disposer l’âme à s’unir à Dieu, favoriser Son action souveraine.
Réforme simplifiée et unifiée à l’extrême. Le fait qu’on ait souvent suspecté les Exercices, qu’on les ait comparés aux tendances des novateurs, révèle assez combien le premier Évangélisme était spirituel et soucieux de la vie intérieure. La douzaine d’enquêtes menées contre le manuscrit des Exercices et contre son auteur situe bien ce problème de la réforme personnelle qui, dans les deux camps, tenait à cœur aux « saints personnages », et celui de la réforme institutionnelle qui obsède les légistes et les canonistes. Mais on réclame un décor d’orthodoxie [326]. Pour tranquilliser les dénonciateurs de l’Inquisition qui ne désarment pas, Loyola affiche, en conclusion de ses Exercices, les marques les plus voyantes de son attachement à l’Église, les « règles pour sentir avec l’Église militante » visiblement empruntées aux décrets du concile de Sens de 1528. Défendue par ce bouclier d’orthodoxie, la retraite ignacienne ne sera plus tant inquiétée et poursuivra ses cures individuelles.
Loyola n’a jamais eu la prétention de devenir un auteur célèbre, encore moins l’auteur unique et par excellence de son temps. Ses notations laconiques n’ont pas été écrites pour être lues ou étudiées, mais pour être vécues et pratiquées. À une époque où, suivant Florimond de Raemond, seuls les « malhabiles » ne montraient pas de curiosité pour les nouveautés philologiques et évangéliques, le vieil écolier de Loyola continuait de penser que la piété n’était pas une question de grec, de style ou de mode [327].
C’est un homme averti qui a vu beaucoup de pays, rencontré bien des gens du monde et d’Église. Familiarisé avec ce que la chrétienté pouvait offrir alors de meilleur et de pire, ce dévot est incapable d’exaltation artificielle. Toute la jeunesse de Calvin tiendrait facilement dans l’intervalle employé par Ignace à faire cent fois l’épreuve et la contre-épreuve de ses Exercices. Le premier manuscrit des Exercices, qui précède l’Institution de Calvin, attendra une douzaine d’années encore les honneurs de l’impression [328]. La publication elle-même ne fut pas du tout un évènement. La masse des lecteurs qui court au sensationnel ignora cette méthode de renouvellement spirituel, dont les conseils, d’ailleurs, ne pouvaient satisfaire que des âmes prêtes à s’examiner sans ménagement sur la pureté de « toutes leurs intentions, actions et opérations », loyalement décidées à « ordonner leur vie sans tenir compte de leurs affections déréglées [329] ».
La forme, de plus, a tout ce qu’il faut pour décourager un simple curieux, même dans la version dite « élégante » du P. André de Freux. Le style original de l’officier Inigo de Loyola n’est pas celui d’un écrivain. « Basque de naissance et parlant basque, il écrit en un castillan grossier, incorrect et dense, où l’attention n’est excitée que de temps à autre par une certaine précision énergique avec laquelle il a frappé quelques idées en phrases concises et inoubliables : cette qualité est l’effet non pas de dons littéraires spéciaux, mais de cette faculté d’intuition avec laquelle il pénétrait les vérités d’ordre moral. Un écrivain espagnol de premier mérite (son biographe Ribadeneira) relève chez lui certains mots impropres ou inusités en espagnol, qui semblent inventés par un homme accommodant aux concepts de son esprit des mots latins en leur donnant une désinence espagnole... Il fait un emploi presque abusif des gérondifs qui donnent plus de rapidité à la phrase et aident à ramasser devant les yeux tout l’ensemble de la pensée..., il ne se fatigue pas de corriger et de retoucher ses expressions, non point pour chercher des beautés littéraires – il n’y pensa jamais –, mais pour arriver à ce que ses paroles ne disent ni un peu plus, ni un peu moins que ce qui est juste [330]. »
Il était si peu écrivain qu’on a pu dire de la première traduction latine établie par lui : « Pour un soldat qui n’avait abordé l’étude du latin qu’à un âge avancé, c’était déjà un bel exploit d’avoir appris les règles difficiles des grammairiens et d’avoir su les observer ; et personne ne pourrait exiger de lui un style coulant et élégant [331]. » Il ne compose pas un traité, il n’arrange pas une synthèse idéologique. Il rassemble des faits, des conseils, des observations multiples (annotations, additions, préludes, colloques, sujets à méditer, mystères à contempler, règles diverses, etc.) qui, malgré l’ordonnance rigoureuse des jours et des semaines, gardent leur aspect de forêt vivante.
Au cours des vingt-sept années qui séparent la conversion d’Ignace de la publication des Exercices, un bon nombre d’ouvrages spirituels ont dû défiler dans son esprit : des auteurs du moyen âge, comme Bernard et Bonaventure, Bernardin de Sienne ; des publications récentes telles que les compilations de Cisneros, l’Enrichidion d’Érasme, les recommandations de Clictove au clergé, etc. Mais deux œuvres avant tout l’ont marqué : les Évangiles arrangés en vie de Jésus par Ludolphe le Chartreux et l’Imitation de Jésus-Christ. Loyola ne dévore pas les livres, comme un lettré. Toute lecture doit autant que possible lui servir de « nourriture spirituelle ». Il ne retient que ce qu’il a longuement éprouvé devoir être bienfaisant. Tout naturellement, il offre aux autres ce qu’il a reçu ou découvert par lui-même, sans aucun souci d’originalité. Entre sa spiritualité et celle des mystiques antérieurs ou contemporains, la parenté va de soi. Le contraire serait surprenant chez un homme aussi soucieux d’orthodoxie, aussi rempli de la tradition, depuis les Pères du désert jusqu’à Thomas a Kempis. On pourrait retrouver les thèmes essentiels des Exercices et même leur mouvement et leur rythme progressif dans maint chapitre de l’Imitation [332].
Hugo Rahner a bien montré comment l’idéal des Exercices, la réforme intérieure par l’imitation de Jésus-Christ, l’amour des âmes, le service de l’Église, prolonge un courant mystique puisé par Loyola chez son patron Ignace d’Antioche, chez Basile, chez Benoît, chez Bernardin et Catherine de Sienne, bref, chez tous les représentants de la grande unité catholique [333]. Et Nadal de noter avec quel soin l’auteur des Exercices s’est appliqué à rester fidèle au mouvement vital de l’Église : « Ignace recourut aux livres et s’enquit de toute science théologique, tout au moins à partir du temps où il entreprit de rédiger ses Exercices, afin que ce qu’il avait reçu de l’inspiration divine plutôt que des livres, se trouvât confirmé par tous les livres, par les théologiens et par toutes les Saintes Lettres (Bible) [334]. »
Il n’est qu’un héritier, un continuateur, un serviteur : ayudar las animas, il veut aider les âmes « comme un noble chevalier du Christ », toujours à l’affût des occasions de se former. « Il était mené suavement où il ne savait pas, avançant pas à pas, comme dans une sage imprudence, dans la simplicité de son cœur », disent ses amis [335]. Idées primitives, service tout ordinaire, fidélité toute simple, en quoi donc Loyola est-il original ?
Non seulement la méthode de cet entraînement spirituel, la succession graduée et progressive des exercices, a quelque chose de très neuf, mais la substance elle-même est personnelle à la deuxième puissance : c’est la pensée vivante de celui qui a composé les Exercices, de celui qui les donne, mais ce doit être bien plus encore la pensée et l’expérience irremplaçable de celui qui les « fait ». « Son profit sera d’autant plus grand qu’il se séparera davantage de tous ses amis et connaissances et de toute préoccupation terrestre, par exemple, en quittant la maison qu’il habite pour aller dans une autre, ou dans une autre chambre qui soit le plus retirée possible [336]. »
Un des mérites de Loyola, c’est d’avoir à nouveau révélé au monde l’importance de la solitude, du silence et de la concentration spirituelle. À une époque où tout se décide dans le bruit des foules et par des « disputes », il apprend à une élite de volontaires la nécessité de réfléchir et de se taire en face de Dieu, pour n’interroger que lui seul sur le plan de notre destinée. Tout en exigeant des attitudes énergiques et précises, Loyola favorise les vues les plus larges et les plus libres. Les Exercices ne visent qu’à « préparer » le retraitant à penser par lui-même. Une fois réalisée la confrontation directe de chaque âme avec Dieu, son Seigneur, son Père, son Ami, le directeur doit s’effacer et abandonner le retraitant aux suggestions de l’Esprit. « Plus une âme se trouve séparée et solitaire, plus elle se rend capable d’approcher le Créateur [337]. »
Bien loin donc d’imposer à son retraitant un système doctrinal quelconque, il indique seulement à qui veut rentrer en soi-même comment on peut découvrir la volonté de Dieu et voir clair dans l’affaire capitale de la vocation. Ici, l’« école de Dieu » donne directement la parole au Maître et n’est pas une occasion de dogmatiser, encore moins un prétexte à discussion.
II
L’INSTITUTION CHRÉTIENNE
Nous savons comment Calvin s’est laissé dicter du dehors cette vocation sur laquelle son meilleur ami n’a plus le droit de lui poser des questions. Il a cependant retenu de son éducation catholique, peut-être même de Montaigu, bien des objectifs spirituels communs à Loyola. Il ambitionne, lui aussi, de ne servir que le Seigneur, de travailler à sa seule gloire et de soumettre les fidèles aux ordres de la volonté de Dieu. Mais les moyens pour y arriver sont tels qu’on peut les attendre d’un partisan passionné : le plus urgent pour lui, c’est de forger de toutes pièces un système doctrinal, disciplinaire et culturel, qui repose principalement sur l’autorité de Luther et de ses émules. Il ne s’agit de rien moins, en somme, que de remplacer « une tradition séculaire, respectable à plus d’un égard, par une coutume et des traditions nouvelles [338] ».
« N’oublions pas, nous prévient Imbart de la Tour, qu’à l’heure où Calvin paraît, les grandes théologies de la Réforme sont constituées, que Luther, Zwingli et Bucer ont écrit et ont parlé et qu’il les a lus, quoi qu’il en dise. Ce n’est point par la Bible qu’il a été amené à la Réforme, c’est bien plutôt par la Réforme qu’il a été conduit à interpréter les Livres Saints... On ne peut douter qu’il se soit détaché de la vieille Église sous l’influence du luthéranisme... Cet ascendant s’accuse dans la première Institution. Des six chapitres qui la composent, trois : la Loi, la foi, la prière, sont calqués sur le Petit Catéchisme de Luther, son Grand Catéchisme et le Betbüchlein, combinés avec l’exposition du Symbole et l’Oraison dominicale d’Érasme. Deux autres sur les Sacrements font de larges emprunts à la Captivité de Babylone ; le dernier, la liberté chrétienne, porte le nom du célèbre traité de Luther et s’inspire en partie de ses idées. Visiblement, dans cet exposé primordial de sa foi, c’est le réformateur allemand que Calvin a pris pour guide et pour modèle [339]. »
Le théologien de fraîche date ne pouvait faire autrement. Il promet beaucoup plus qu’il ne peut tenir. Il ne possède pas, si sûrement qu’il le pense, la « clef et ouverture » de l’Écriture Sainte. Car la Bible « qui contient une doctrine parfaite à laquelle on ne saurait rien ajouter » se laisse plus difficilement encore raccourcir et résumer avec des extraits tirés d’ouvrages partisans, fondus par un tout jeune apologiste en une « somme de ce que Dieu a voulu nous enseigner en sa parole [340] ». Sans doute est-il moins question de faire réfléchir sur le sens authentique de l’Écriture que de frapper vite et fort et de gagner le procès du parti réformé. Manuel de propagande, exposé de la « doctrine du parti », comme nous dirions aujourd’hui, l’Institution s’ingénie à prouver que les protestants ont une doctrine commune, cohérente, idéaliste. C’est une gageure invraisemblable. Calvin gagne son pari. Il réussit à mettre sous un même dénominateur des penseurs aussi différents que Luther, Érasme, Bucer, Zwingli, Melanchthon. On peut lui faire confiance : il trouvera une clef qui jouera pour tous les mystères, pour tous les livres sacrés. L’Institution remplit magnifiquement son rôle. Elle met la chrétienté, encore hésitante et inquiète, devant le fait accompli de la Réforme et de la Nouvelle Église. À force de charger le catholicisme et d’exalter l’Évangélisme, elle accentue encore la rupture et la rend définitive. Dépouillés de leurs contours vaporeux, les dogmes réformés nordiques apparaissent comme une armure sans défaut.
Une seule ombre au tableau : malgré les buts religieux qu’elle met à l’avant-plan, l’Institution n’en est pas moins un livre politique. C’est un manifeste destiné à rassurer le public, à faire entrer la révolution dans sa phase légale et à légitimer ainsi tous les bouleversements déjà réalisés en Allemagne et en Suisse [341]. Quant au revirement escompté pour la France, son échec est directement proportionnel au succès de librairie de Calvin. La menace était trop claire.
L’Institution est la théologie d’un laïc très pressé, d’un juriste amateur, qui a enfin trouvé l’objet de ses complaisances. Par dégoût ou par ressentiment devenu plus ou moins insensible aux autres études, le converti s’ouvre, par la lecture de la Bible, aux émotions inconnues d’un sentiment religieux plus intense, plus profond que le plaisir humaniste. « Que nous lisions Démosthène ou Cicéron, Platon ou Aristote, ou quelques autres de leur bande, je confesse bien qu’ils attireront merveilleusement, et délecteront, et émouvront jusques à ravir même l’esprit. Mais si de là, nous nous transférons à la lecture des Saintes Écritures, veuillons ou non, elles nous poindront si vivement, elles transperceront tellement notre cœur, elles se ficheront tellement au-dedans de nous, que toute la force qu’ont les Rhétoriciens ou Philosophes, au prix de l’efficace d’icelles, ne sera que fumée [342]. » « Cette simplicité rude et quasi agreste nous émeut en plus grande révérence que tout le beau langage des Rhétoriciens du monde... »
Telle est l’émotion créatrice sur laquelle se fondent toutes les certitudes du réformateur et toutes celles de ses disciples. Confiance mystérieuse, illimitée, qui n’a qu’un équivalent : l’illustratio magna, la révélation reçue à Manrèse par Loyola, près de la chapelle de Saint-Paul, au bord du Cordoner : « J’ai vu, senti, compris, tous les mystères de la foi chrétienne [343]. » « Si je recueille tous les secours que j’ai reçus de Dieu et toutes les choses que j’ai apprises durant toute ma vie, jusqu’à l’âge de soixante-deux ans passés, et si je les réunis en une somme, il ne me semble pas que cela atteigne ce que je reçus en cette seule circonstance. »
Calvin ne craint pas de présenter au monde une sorte d’absolu : « J’oserai hardiment protester, en simplicité, ce que je pense de cet œuvre, le reconnaissant être de Dieu, plus que mien [344]. » Il n’a pourtant pas eu de révélation particulière, inconciliable d’ailleurs avec son principe fondamental du biblicisme. Loyola qui, lui, croit aux visions et en eut encore un certain nombre depuis Manrèse, se garde bien de s’en prévaloir contre la foi universelle.
Il faudrait pouvoir comparer la valeur et le contenu objectifs de ces deux visions, de ces révélations de base. Mais un fait saute aux yeux. Calvin s’empresse de réaliser et de monnayer immédiatement son trésor, il en profite avidement sans attendre d’en avoir fait l’inventaire. Ne craint-il pas qu’on examine ses titres de propriété, qu’on soumette sa spéculation à un contrôle ? Loyola souhaite cette contre-épreuve et ne s’appuie sur les données de cette illumination exceptionnelle que lorsque toutes les chances d’illusion ont dûment été éliminées.
« L’émouvante simplicité biblique » dans laquelle Calvin croit reconnaître le souffle de l’Esprit, reflète trop clairement, en négatif, la philosophie humaniste. Même « quand il combat l’humanisme, il se sert encore de l’humanisme. Il met volontiers l’accent sur tout ce qui l’en sépare, mais il n’en reste pas moins humaniste par ses méthodes et par la forme particulière de sa mentalité intellectuelle [345]. » Il croit pouvoir dédaigner le savoir profane depuis qu’il s’aperçoit que la théologie, comme il la comprend, embrasse tout et permet, avant même d’en avoir fait le tour, de composer une somme de toutes les connaissances, « les matières principales et de conséquence... ». Wolmat avait raison : voici la science des sciences, dans laquelle un génie essentiellement subjectif va pouvoir se donner carrière. Plus rien ne le retient : le droit a ses règles gênantes et ses principes d’interprétation ; les lettres sont soumises au contrôle et à l’approbation de compétences bien établies. Mais dans cette chrétienté révolutionnaire, séparée de tout magistère et de toute hiérarchie, la vague autorité des Saints Livres se prête à tous les développements.
Calvin emprunte à Érasme, à Budé, à Laurent Valla, les principes d’une exégèse aussi renseignée sur les détails qu’elle est tendancieuse dans ses vues d’ensemble. Son siège est fait. Avant d’étudier de nouvelles parties de la Bible, il sait, parce qu’il cherche toujours, ce qu’il trouvera infailliblement. « Jean Calvin, nous dit Jean Sturm, en présentant l’Institution, est un homme d’un jugement qui pénètre jusques au bout, et d’une doctrine admirable, et d’une mémoire singulière : et lequel en ses écrits, c’est merveille comme il parle de tout et abondamment et purement [346]. » En un temps record, le brillant exégète a exploré cet immense ensemble hétérogène des Saintes Écritures. Il pense en connaître d’avance les idées directrices, les clés passe-partout, qui « donnent accès à tous enfants de Dieu à bien et droitement entendre » la révélation.
Malgré un mépris sans borne, mais tout théorique, de la nature humaine, il garde la confiance en soi d’un surhomme de la Renaissance. Il possède la « philosophie chrétienne » et l’enseigne avec autorité : « Celui qui en aura l’intelligence sera préparé à profiter en l’école de Dieu en un jour plus qu’un autre en trois mois, d’autant qu’il sait, à peu près, où il doit rapporter une chacune sentence, et a sa règle pour compasser tout ce qui lui est présenté... car je pense avoir tellement compris la somme de la religion chrétienne en toutes ses parties et l’avoir digérée en tel ordre, que celui qui aura bien compris la forme d’enseigner que j’ai suivie, pourra aisément chercher et se résoudre de ce qu’il doit chercher en l’Écriture et à quel but il faut rapporter le contenu d’icelle [347]. »
Ce sentiment excessif de supériorité explique à la fois le parti-pris et la monotonie de ce chef-d’œuvre : le feu de la passion, les allusions à l’actualité politique, l’information et l’érudition la plus exacte soutiennent péniblement l’intérêt. « Si vaste qu’elle soit, sa culture n’embrasse qu’une partie de l’immense domaine que la Renaissance découvre et exploite chaque jour. Tout un monde, celui de la nature, lui est fermé. Et par là, deux initiations lui manquent : celle de la science et celle de l’art [348]. » Cependant, la fascination de la « Parole » divine qu’il s’approprie, suffit à rehausser le prestige de ce grand rassembleur d’idées, de ce grand manieur d’hommes et constructeur d’Église. Il pourra même caresser l’illusion d’être un poète ; malheureusement, il a refusé d’être un mystique. Faute d’être comprise de l’intérieur, par une intelligence aimante, sa Bible ne sera que l’instrument d’un parti [349].
Comme le reconnaît Raoul Stéphan dans l’Épopée Huguenote, Calvin « choisit parmi ses sources, retenant les témoignages qui lui conviennent, repoussant les autres... se jugeant avec un mélange d’humilité et d’orgueil l’élu de Dieu... argumentant avec la fougue d’un perpétuel controversiste. Cette violence méprisante est le côté déplaisant de l’homme [350]. » Prompte et sincere : il ne doute de rien. Cependant demain, il exigera davantage de ses disciples, élèves de l’Institution, qu’il n’en demande de lui-même avant de la composer : « Si un homme veut faire un métier du premier jour et que jamais n’ait été apprenti, il fera de belles besognes ! Il se pourra bien avancer ! Si cela est aux arts mécaniques, que sera-ce de la doctrine de Dieu qui surmonte tout esprit humain [351]. » Comment une telle lucidité ne lui a-t-elle pas appris plus de modestie ?
Calvin, on ne sait trop par quelle illumination miraculeuse, croit pouvoir prononcer de tout et sans appel. Il s’érige presque subitement en interprète authentique de la Bible, en arbitre de la pensée des Pères, en juge d’une tradition plus que millénaire. À l’en croire, le reste des hommes ne recevra jamais assez d’enseignement biblique. Mais à lui personnellement, tout semble avoir été accordé d’un coup, dans une sorte d’inspiration globale.
Cela est d’autant plus inquiétant que Calvin n’est jamais plus revenu sur le fond de son système religieux. Après la première Institution, les parties s’amplifient, l’ordonnance des matières change, les formules restent souples, éloquentes, la présentation varie, mais l’esprit est comme cristallisé. Sur le plan des idées, il n’aura pour ainsi dire plus rien à apprendre : il est cliché. On peut s’en rapporter au jugement des savants éditeurs des Opera : « Le chef-d’œuvre de Calvin s’est enrichi, transformé... de petite ébauche qu’il avait été d’abord, il a fini par devenir un gros volume... l’esquisse populaire se changea en savant système, et pourtant à travers toutes ces métamorphoses qui ne laissèrent pas une page absolument intacte, l’idée, la conception théologique est restée la même, les principes n’ont pas varié. Vainement les adversaires... se sont-ils efforcés de découvrir des variations dans la doctrine enseignée dans ce livre. Calvin a ajouté, développé, précisé, il n’a rien retranché, ni rétracté. Et c’était avant d’avoir accompli sa vingt-sixième année qu’il se trouvait en pleine possession de toutes les vérités génératrices de sa théologie [352]... »
Bèze observait déjà avec fierté que « Calvin n’a absolument jamais rien changé dans la doctrine qu’il avait enseignée au début, demeurant constant avec lui-même jusqu’au bout, réussite accordée à peu de théologiens de son temps [353]. » Aussi peut-on conclure avec Kampschulte : « Les idées et les convictions de la première édition (de l’Institution) sont aussi celles de la dernière... Le jeune homme de vingt-six ans pensait, sur tous les points essentiels, comme le vieillard au terme de sa carrière [354]. » La mémoire prodigieuse de Calvin favorisait cette fixité en le rendant en quelque sorte captif de ses propres formules, comme le notent les éditeurs des Opera : « Nous l’avons déjà dit : personne plus que lui, ne s’est collé plus fidèlement à sa phrase une fois écrite ou imprimée [355]. »
Défini dans ses grandes lignes doctrinales dès la première Institution, enrichi par la suite méthodiquement de toutes les réponses données aux nombreux problèmes fournis par une carrière féconde en disputes, le système de Calvin « ne saurait se comparer, quant à la rigueur de la pensée, à l’œuvre d’un Spinoza, ni même d’un Aristote ou d’un Thomas d’Aquin... Il vaut mieux avouer que le système de Calvin n’est pas un système fermé, élaboré à partir d’une idée centrale, mais qu’il englobe toute une série de notions bibliques dont quelques-unes sont difficilement conciliables en logique.... (Il) expose l’une après l’autre les conceptions opposées et les montre liées par un principe supérieur... Que ces tentatives de conciliation soient parfois extérieures et artificielles, nous croyons qu’on ne peut le nier que par parti pris apologétique... elles ne peuvent effacer les oppositions dialectiques elles-mêmes, ce que l’on a appelé les “paradoxes” de Calvin [356] ». La liste de ces contradictions serait bien longue.
Le seizième siècle a cependant lu Calvin avec avidité, avec la soif qu’entretenait l’absence de sources vraiment vivantes. « Aux fontaines du désir » il dispensait des richesses qui semblaient inépuisables, celles-là même que Benoît, Barth, Wendel et tant d’autres exploitent encore, sans trop marquer les catégories qui les renfermaient. Oui, le réformateur a touché à tous les problèmes, mais ses solutions sont souvent verbales. Il a assimilé à peu près toutes les connaissances religieuses de son époque et il les a exposées d’une façon qui est rarement vulgaire et souvent magistrale : « Bien peu d’hommes ont aussi peu changé, mais peu se sont autant développés », a-t-on dit [357]. Mais si les explications se développent, c’est toujours en spirale autour des mêmes centres. Si les raisonnements et les commentaires enrichissent la science exégétique, c’est pour aboutir aux conclusions fixées d’avance. Et il faut bien, par conséquent, retenir comme doctrine personnelle, non pas ce qu’il emprunte au milieu ambiant, mais ce qu’il inculque sans cesse, comme croyance essentielle, indispensable. Or cette synthèse fondamentale, sujette à caution, nous la devons à un jeune présomptueux, s’il est permis de juger Calvin sur sa propre sentence :
« Il eut donc semblé... que quand nous aurions été enseignés un an ou deux, cela nous dût suffire, et que chacun serait assez grand clerc pour se passer d’instruction... Prenons le cas que nous fussions si habiles gens de connaître tout ce qui nous est utile au bout de deux ou trois ans, si est-ce que nous sommes volages, que tantôt chacun de nous se pourrait égarer, sinon que nous fussions retenus... Dieu veut donc que sa parole soit prêchée jusqu’à la mort... Ceux qui commencent à étudier... les chrétiens volages, quand ils auront au bout de la langue quelques mots de l’Évangile, les voilà comme des demis-anges... Mais ceux qui appliquent toute leur étude à toujours apprendre à l’école de Dieu, ceux-là connaissent au bout de dix ou vingt ans ce qui leur défaut... Dieu ne veut point que pour deux ou trois ans seulement nous ayons instruction de l’Évangile... Quand nous vivrions cent ans et plus en ce monde, toujours il nous faut être écoliers [358]... »
Calvin certes n’est pas volage. C’est un sérieux étudiant de la Bible, qu’il continue à méditer, moins sans doute pour lui-même que pour les autres. Car, à voir le cas qu’il fait de ses premières thèses, on pourrait penser qu’il l’a comprise tout entière et d’un coup.
Tout est dit dans un latin précis et élégant avec une facilité oratoire peu commune. Ceux qui goûtent le style néo-classique, à la mode un peu recherchée d’Érasme, ne peuvent assez admirer cette virtuosité magnifique. Mais le style, c’est l’homme, et Calvin, que sa Réforme n’a pourtant pas encore ulcéré, se montre déjà péniblement tendu, par une rhétorique haletante, monotone, qui ne le laisse pas souffler lui-même. Peu d’hommes auront continuellement ainsi été tenus en haleine par le besoin d’affirmer plus fort que la partie adverse. Bremond nous assure que Pascal ne cède jamais à la tentation du climax, de la surenchère, du faux sublime, Bossuet plus que rarement, Lacordaire quelquefois, Bloy toujours [359]... On ne médira pas de Calvin en disant qu’il y cède tellement volontiers qu’il a fait de l’antithèse systématique un des principes formels de sa théologie : la « géniale ogive » calvinienne.
Toutefois, ce chef-d’œuvre qui « marque un tournant dans l’histoire de l’Église occidentale [360] » apportait bien ce qu’il fallait à la Réforme à cette date critique : un résumé substantiel, clair et ardent, de la religion protestante, qui éclipsait, par sa logique et sa vigueur, les Loci theologici de Melanchthon et les exposés de la foi nouvelle que le brillant Zwingli envoyait aussi au Roi de France : une justification habile, un réquisitoire cinglant et digne contre les persécuteurs des fidèles. La littérature religieuse de cette époque ne connaît rien de pareil.
« La France et l’Allemagne, nous explique Doumergue, reçoivent, lisent avec un étonnement mêlé d’admiration et de colère, les pages du fameux livre et de la lettre qui lui sert de préface. Or, le livre, c’est l’arme la plus solide que le protestantisme ait encore forgée contre la papauté ; et la lettre, c’est la proclamation audacieuse, solennelle, par laquelle ce jeune homme de vingt-six ans prend en main, plus ou moins consciemment encore, le commandement du protestantisme contre tous ses ennemis et ses persécuteurs [361]. »
Ce ne fut probablement pas le dogmatisme du système calviniste qui valut immédiatement à l’Institution une si large audience. Ses mérites étaient d’ordre plutôt extérieur. Sa maîtrise littéraire en faisait un instrument de propagande incomparable. L’habileté de ses formules fouettait les espérances politiques les plus audacieuses. Sous sa plume, les passions partisanes se parent des motifs religieux et moraux les plus nobles. De solennelles déclarations de principes, des appels à la charité, à la clémence, au martyre, font passer l’amertume de la satire et du sarcasme, l’indignation agressive, l’invitation voilée à la lutte et à la révolte. Le tyrannicide lui-même est prédestiné : « Aucunes fois (Dieu) suscite manifestement quelcuns de ses serviteurs et les arme de son mandement pour faire punition d’une domination injuste et délivrer de calamité le peuple iniquement affligé [362]. »
Ce défenseur est aussi un justicier. Il brandit la foudre, à la manière des porte-parole de l’histoire juive. Dans les plis de sa toge de rhéteur latin, il cache la paix ou la guerre. Il exalte le goût du sublime de ses partisans, mais tout aussi bien, par des menaces calculées, bibliques, par des sous-entendus transparents, il évoque la possibilité « providentielle » de réactions violentes. Il sollicite, par la magie de son verbe, les instincts de vengeance que l’Évangile devait justement apaiser : « Dieu suscitera des vengeurs éclatants du milieu de ses serviteurs... ou bien mettra en œuvre la fureur d’adversaires qui machinent une révolution [363]... » Si les Supérieurs « viennent à commander quelque chose contre lui », (le Seigneur), cela « nous doit être de nulle estime : et ne faut avoir en cela aucun égard à toute la dignité des supérieurs ». Ces fières protestations firent peut-être plus que tout le reste.
*
* *
Bientôt le manifeste de Calvin va provoquer de puissants remous dans les masses populaires : quand il aura été traduit en français, en italien, en néerlandais, en anglais, en allemand ; quand ses diatribes toujours plus mordantes disposeront de la langue, sans contredit, la plus éloquente et la plus moderne du XVIe siècle [364]. L’esprit aussi pénétrant que négatif du rénovateur accrédite un christianisme réformé, c’est-à-dire épuré, approfondi dans certains aspects, mais rétréci, en bien des points, par une piété « plus paulinienne que saint Paul, plus biblique que la Bible, plus chrétienne que le christianisme [365] ».
Mettant en œuvre une connaissance d’accueil et de sympathie, Loyola va s’appliquer, avec plus ou moins de bonheur, à ranimer les valeurs traditionnelles dont il veut tout sauver. De là cette apparence informe, ce genre littéraire spécial des Exercices, qui évoquent, aux yeux de H. Bernard, le « style plateresque. L’ensemble laisse une impression composite [366] ». Côte à côte voisinent les inventions de la Légende Dorée, les thèses subtiles des théologiens et des exégètes, signalées d’un mot surajouté. Dans aucun autre ouvrage peut-être, les moindres détails sont chargés d’autant de substance à l’état brut. Ainsi s’explique l’étonnante variété d’interprétations dues à la hâte ou à la légèreté : école de volonté, guide vers l’union divine, système de dressage psychologique, ascèse, ascétisme, etc.
La vogue n’entre pour rien dans les premiers succès que l’opuscule de Loyola recueille à Paris, à Venise et à Rome et bientôt dans tous les milieux cultivés de l’Europe catholique. Des intellectuels, des professeurs, des hommes influents du clergé, de la magistrature, de l’aristocratie, se convertissent, l’un après l’autre, séparément, sous l’effet de longues méditations solitaires. Les vérités fondamentales évangéliques, agissant par elles-mêmes, opèrent une transformation paisible, à tête reposée, troublée par le moins de commentaires possible. Ce sont toujours des résultats individuels, de grande qualité morale, d’une inspiration vraiment saine, parce que la préoccupation dominante de Loyola est d’exclure, autant que faire se peut, les influences profanes, les séductions et l’entraînement du milieu, les enchantements de la « publicité ».
CHAPITRE II
« À l’école de Dieu »
_______
Nous n’avons encore examiné l’Institution et les Exercices que de points de vue généraux. Arrêtons-nous sur les attitudes particulières qu’ils préconisent en vue de la réforme religieuse et morale. Ils ont ceci de commun, qu’ils se présentent l’un et l’autre, avec toute l’insistance possible, comme une école de piété et d’éducation spirituelle, comme une initiation à l’Évangile.
Une expression revient souvent sous la plume de Calvin : « À l’école de Dieu. » Loyola poursuit le même but. Il vaut la peine de regarder de plus près ce théocentrisme, la spiritualité, la morale, la méthode exégétique propres aux deux réformateurs.
Mais une remarque s’impose d’ores et déjà. La plupart des courants mystiques de la Réforme ont fait leur apparition avant 1535. Calvin ne doit plus payer le même prix que Luther pour approfondir cette nouvelle raison de vivre et de croire qui lui fut donnée assez brusquement, de l’extérieur, comme un choc, comme une découverte toute faite. Il s’agira moins, pour lui, de continuer une recherche que d’en compléter la démonstration, d’exploiter, d’une manière rationnelle et pratique, les conclusions qui se dégageaient de la révolution religieuse et morale en cours.
Combien plus personnelle et plus coûteuse la réforme des « Exercices » !
I
DEUX HOMMES DE DIEU
Le théocentrisme, c’est-à-dire l’affirmation de la souveraineté absolue de Dieu sur toutes choses, comporte des vues familières aux « spirituels » de tous les temps, mais surtout de cette époque. Il faut une certaine naïveté pour attribuer cette découverte à un chef religieux du XVIe siècle [367]. Il est sûr, par exemple, que même au « collège de pouillerie de Montaigu », dans une ambiance influencée directement par la devotio moderna, la mystique flamande et espagnole, ces lieux communs de la spiritualité chrétienne ont été foulés fréquemment [368]. Bréhier et Fèbvre estiment que le théocentrisme a été durant le moyen âge « la seule image, ou le seul système de l’univers ». Nos deux étudiants parisiens ont connu, dans l’un et l’autre camp, des maîtres pieux, qui leur ont confié la science des saints et le goût de devenir à leur tour des « hommes de Dieu », comme voulaient l’être Briçonnet, Lefèvre, Clictove, François le Picard et bien d’autres.
Les Exercices ne sont que le journal de route de cette quête de Dieu, entre 1522 et 1540. Il faut aller très loin dans les profondeurs de soi-même pour le trouver. « Le propre de Dieu est d’agir à l’intérieur de l’âme : le démon y est impuissant : et il a coutume de tromper par des phénomènes extérieurs apparents et faux [369]. » L’homme qui veut être à Dieu s’armera d’un « grand courage et d’une grande générosité, offrant à son Seigneur tout son vouloir et toute sa liberté, laissant la divine Majesté disposer entièrement de sa personne et de tous ses biens suivant son bon plaisir [370] ». Théocentrisme immédiatement pratique et expérimental : « Les choses que j’observais m’avoir été utiles, je les notais à mesure, par écrit, parce que je pensais qu’elles pourraient aussi être utiles aux autres [371]. » L’idée de la souveraineté de Dieu et de son bon vouloir est partout agissante.
Pour la suggérer avec plus de relief, Loyola recourt à des moyens d’expression et à des représentations de l’imagerie médiévale. Il préfère les comparaisons populaires, ou encore les symboles de la chevalerie aux définitions terministes. Il évoque souvent la Divine Majesté, le roi éternel de gloire au milieu de sa cour céleste, comme pouvait le retracer le courtisan de ces souverains dont le soleil ne quittait jamais l’empire. Dieu n’est pas seulement une idée grandiose, ou encore la Grande Idée, mais une présence perçue d’une manière si vive qu’elle pénètre chaque mot et chaque geste d’une onction cordiale. Toute l’attitude habituelle d’Ignace respire le même élan que la prière intime : « Donnez-moi une humilité aimante, donnez-moi le respect et la vénération [372]. »
Entre Dieu et l’âme, il n’y a plus d’intermédiaire, ni de barrière. Et cependant, Loyola et son retraitant conversent, dans l’oraison et le grand silence de trente jours, avec un grand nombre de personnes : les anges, les saints, la Vierge. On voit les trois personnes divines penchées à la fenêtre du ciel pour regarder l’étendue de la terre et son universelle misère. On suit le Seigneur dans ses courses avec ses amis, les apôtres. Mais toutes ces figures familières à l’histoire de Jésus, envisagées comme contemporaines à notre histoire de tous les jours, n’interviennent que dans leur rôle d’introductrices. Elles créent la véritable intimité, elles nous rendent présent ce Dieu qui est tout à ceux qui s’aiment et, par là, vivent en Lui, dans l’Amour. Ce contact direct avec les « personnes, les paroles et les actions », donne au monde surnaturel des Exercices une chaleur communicative.
L’Évangile n’est pas d’abord une « philosophie chrétienne », ni une théodicée savante, ni une théocratie disciplinaire, mais avant toute autre chose, une incarnation actuelle, une aventure mouvementée que Jésus, le Baptiste, Marie, Joseph, Pierre, Jean, André et tous les autres, recommencent avec notre propre participation. C’est aujourd’hui que se jouent l’Annonciation et la Rédemption, pour nous et avec nous. Chacun est admis à contempler comment Dieu crée le monde, comment les autres choses doivent s’ordonner à la surface de la terre. Chacun pénètre de plain-pied dans la maison de Nazareth et dans la grande salle du Cénacle ; et à chacun, la Sainte Trinité fait des avances et des confidences personnelles.
Entre Calvin et Dieu, il n’y a pas tous ces intercesseurs, tous ces témoins familiers, mais il y a un plus grand obstacle à une vraie rencontre : entre la transcendance de Dieu et la corruption infinie de l’homme, pour accuser encore l’éloignement, il y a l’abstraction, la discussion, l’étalage du moi de Calvin. Ignace répète au seuil et à la sortie des Exercices : il faut supprimer en soi l’écran de l’esprit mondain et de l’amour-propre et « laisser le Créateur converser directement avec sa créature et la créature avec le Créateur [373] ». À chacun de réaliser intimement la présence bienveillante de « l’Éternel Seigneur de toutes choses » et d’écouter docilement les intraduisibles inspirations du bon esprit. Sous le regard de Dieu, Notre-Seigneur, pas de discours : des actes attesteront la véritable compréhension et l’amour authentique. Loyola invite donc ses disciples à pousser toujours plus loin la connaissance vécue des mystères, sans se laisser prendre au filet des belles formules et de la phraséologie. Ainsi l’expérience des perfections divines soulève l’âme au-dessus des créatures et la découverte du Deus semper major s’opère par une transformation progressive de tout l’homme. Le Christ se révèle au fur et à mesure que son règne est accepté [374].
Établir la domination de Dieu sur notre vie : nos deux réformateurs ne semblent pas vouloir autre chose et ils l’affirment souvent en termes équivalents [375].
Ainsi les quatre semaines de la retraite ignacienne sont articulées vigoureusement au moyen de quatre journées-programme, comprenant chacune une seule méditation essentielle que le retraitant doit ruminer longtemps et sur laquelle il ne saurait assez revenir. Il est pour le moins étonnant de constater que des thèmes semblables parcourent sans cesse la dialectique calvinienne. Les idées théocentriques du fondement, sur le sens de notre destinée, du règne, sur la question de notre vocation, de la nécessité d’une humilité toujours plus grande devant Dieu, et de la contemplation de son amour universel, sont si peu originales, du point de vue littéraire, que Calvin pourrait nous en fournir immédiatement plusieurs formules parallèles. Malheureusement, bien vite une antithèse, ou un aperçu polémique, une apostrophe amère, viennent chasser une première impression contemplative.
Le « Principe et Fondement » exprimé par l’éloquence de Calvin deviendrait ceci : « Puisque tu es sa facture, peux-tu douter que par droit naturel et de création tu es sujet et soumis à sa domination ? (que) ta vie doit être adonnée à son service ? que tout ce que tu te proposes, tu dis ou tu fais, se doit à lui rapporter ? S’il en est ainsi, il s’ensuit que ta vie est mauvaisement corrompue, sinon qu’elle soit réglée à l’obéissance de sa sainte volonté, vu que c’est bien raison que sa seule volonté nous serve de loi [376]. » Ignace sera plus optimiste à la fois et plus pratique en observant, sans mouvement oratoire, que « toutes choses à la surface de la terre ont été créées pour l’homme, pour l’aider à servir, louer et adorer Dieu ». Ce but, voulu expressément de Dieu, n’est pas un idéal rendu impossible par notre misère. Non, l’homme doit lui-même « se faire indifférent », c’est-à-dire tendre vers Dieu de toutes ses forces, le recherchant purement et exclusivement pour lui-même, avec un « cœur également dépris des créatures et également prêt à s’en servir [377] ». Mais surtout Ignace proposera des exercices concrets pour opérer ce détachement et cette liberté intérieure en face « de la santé ou de la maladie, de la richesse ou de la pauvreté, de l’honneur ou du mépris... et ainsi de suite en toutes choses, afin de ne désirer et choisir que les moyens les meilleurs pour atteindre le but pour lequel nous avons été créés ».
Le « Règne de Dieu », c’est pour Calvin un état statique de l’humanité, abstraite en quelque sorte des contingences du temps, et soumise métaphysiquement au « sceptre de la sainte parole ». C’est le royaume d’un peuple prédestiné, dans lequel les élus sont perdus au milieu des infidèles : il semble mieux constitué au temps de David qu’à l’époque de Notre-Seigneur. L’héroïsme auquel nous sommes invités avec Calvin laisse un arrière-goût amer : « Comme David se moque hardiment de l’audace des ennemis... les fidèles prendront courage, quand ils verront l’Église être opprimée : pource qu’elle a un Roi qui la gardera... Le règne du Christ (veut) que nous passions s doucement et en patience le cours de cette vie, sous beaucoup de misères, faim, froid, mépris, opprobres, toutes fâcheries et ennuis, nous contentant de ce bien seul, d’avoir un Roi qui ne nous défaudra jamais qu’il ne subvienne en nos nécessités, jusques à ce que ayant achevé le terme de guerrayer, nous soyons appelés au triomphe [378]. »
Dans l’appel du Roi ignacien, le disciple veut et désire aussi « imiter son éternel Seigneur en supportant toutes injures, tout opprobre et toute pauvreté ». Les formules se rencontrent souvent, au point, qu’elles semblent puisées aux mêmes sources : même idéal de fidélité, de confiance, de soumission totale. Mais entre les deux mentalités, quel contraste ! D’un côté, la résignation et le courage agressif, le pessimisme et le ressentiment à peine voilé ; de l’autre, l’enthousiasme volontaire et la joie. D’un côté, les nécessités pénibles d’une guerre sainte qu’on a l’air de subir de force, mais qu’on soutient, coûte que coûte, avec un désespoir passionné. De l’autre, une conquête pacifique où « ceux qui voudront faire preuve de plus d’amour et se signaler en tout service de leur Roi éternel et Seigneur universel, non seulement s’offriront tout entiers à la tâche, mais encore engageront la lutte contre leur propre sensualité et contre ce qui les attache à la chair et au monde [379] ».
Apparemment, le royaume de la théocratie calviniste refoule toute compromission matérielle : périlleux angélisme qui « n’a rien de terrien, rien de charnel ». Ces hyperboles puritaines ne tardent pas à retomber sur elles-mêmes, car le royaume spirituel autorise toutes les ingérences dans la sphère du temporel. Quelle Église empiétera davantage sur les fonctions de l’État ? Ce royaume qui professe si hautement qu’il n’est pas de ce monde, se dessine, dès qu’il le peut, un territoire et des remparts, non seulement pour observer une attitude défensive, mais surtout en vue d’une attaque bien déterminée contre une partie de la chrétienté, combattue sur le plan terre à terre de la révolution politique, sociale et militaire. Dans ce Règne de Dieu, Calvin se confère d’avance le rôle de porte-enseigne (comme dans l’Épître à Sadolet) ou de Roi-prophète (dans les commentaires des psaumes) gouvernant son peuple, le peuple de Dieu, avec le double sceptre de la discipline et de la parole.
Le Règne du Christ, dans la vision de Loyola, ne risque pas d’être aussi facilement confondu avec un parti. L’effort de conquête qui vise la soumission du monde entier au « Roi éternel et universel », poursuit comme unique objectif le salut et la libération individuelle des âmes, de toutes les âmes, par les seules armes du sacrifice, de l’humilité, de la charité. Le danger de réveiller le trouble des instincts et des passions collectives n’existe pas, car il n’est pas question d’embrigader des partisans en masses compactes, mais de mettre chaque conscience volontaire en face de son propre destin surnaturel. On ne parle pas d’ennemis, mais seulement de « l’ennemi de la nature humaine ». Les adversaires ne sont jamais des hommes, mais les démons, les mauvais esprits avec lesquels chacun est aux prises. Les seules batailles envisagées sont d’ordre intime et personnel : faire triompher le Christ, c’est être humble, pauvre, obéissant avec lui.
L’humilité de l’homme devant Dieu a été affirmée avec une telle insistance par le réformateur que le pessimisme d’un Schopenhauer ou d’un Sartre pourrait difficilement encore renchérir sur cette théologie du néant. « Celui a très bien profité en la connaissance de soi-même, lequel par l’intelligence de sa calamité, pauvreté, nudité, ignominie est abattu et étonné... Car il n’y a nul moyen que l’homme se démette trop fort... il ne peut s’attribuer un seul grain de bien outre mesure, qu’il ne se ruine en vaine confiance, qu’il ne soit coupable de sacrilège, en ce qu’il usurpe la gloire de Dieu... L’homme n’est que pourriture et vermine inutile et abominable... ce qu’on juge communément être justice, n’est que pure iniquité devant Dieu : ce qu’on juge intégrité n’est que pollution... cette humilité n’est point une modestie, par laquelle nous quittions un seul poil de notre droit pour nous abaisser devant Dieu... mais c’est une déjection de notre cœur... Quand nous oyons tant de fois le nom d’Affliction, il nous faut entendre comme une plaie dont le cœur soit tellement navré, que tout l’homme en soit abattu en terre sans se pouvoir élever [380]. »
Telle est la marque de la foi, la conversion qui purifie, la réforme essentielle qui maintient le fidèle dans un douloureux sentiment de crainte et de mépris de soi. Est-ce une expérience personnelle ou un a priori théologique ? C’est, de toute façon, l’inquiétude constante de Calvin. Pour glorifier Dieu, diminuer l’homme. Pour inculquer la nécessité de la grâce, nier absolument tout mérite humain, au point que les bonnes actions des saints eux-mêmes ne sont que misère et péché. L’homme ne se sauve que si on le dépouille de toute prétention, si on le force à se courber sans cesse. « Si cela ne se fait, nous serons humiliés par la main puissante de Dieu en notre confusion et honte. » Malheureusement ces protestations d’humilité générale et abstraite, commune à tout le monde, cette conscience d’un état de misère immuable, pourquoi ne sont-elles pas plus efficaces contre l’orgueil de l’esprit, le pire de tous ?
Pour soumettre l’homme à Dieu, Loyola connaît une méthode plus positive, plus réaliste. Les degrés d’humilité volontaire qu’il dresse au centre des Exercices, loin d’abattre la bonne volonté, élèvent l’homme vers l’amour de Dieu et, par là, le font sortir du cercle vicieux de l’égocentrisme. Le moi qu’on accable de tous les termes du mépris, comme flatté de l’attention et de l’importance qu’on lui accorde, joue presque le rôle d’un rival de Dieu, d’un pôle opposé. Pour être marqué d’une sorte de signe infini négatif, il n’en garde pas moins une bien grande place dans ce système antithétique. L’humilité de Loyola n’est plus du tout un aveu alternatif de misère et de confiance infinies. C’est une délivrance. L’obsession du moi ne disparaît que lorsque le regard s’attache à un être aimé devant lequel il s’oublie.
Les Exercices y poussent spécialement au centre de la retraite, en décrivant les trois degrés d’humilité comme une progression dans l’amour. Celui-ci est d’abord fidélité rigoureuse à l’essentiel de la loi divine, puis recherche toujours plus délicate de la perfection et enfin, au troisième degré, attachement à la seule personne de Notre-Seigneur choix cordial de tout ce qu’il peut préférer de plus difficile et de plus dur : « À supposer que la gloire de Dieu me laisse libre de choisir, être prêt à prendre la pauvreté avec le Christ pauvre, l’humiliation avec le Christ couvert d’affronts... pour imiter de plus près le Christ Notre-Seigneur et pour lui être en réalité plus semblable [381]. » Au lieu de réclamer sans cesse piteusement « soulas, confort » et miséricorde, l’âme libérée du souci d’elle-même s’applique seulement à prouver chèrement son amour, en épousant de grand cœur toutes les préférences du Christ humble et sacrifié. Tant mieux si elles coûtent !
Le « tant mieux » de Loyola et le « tant pis » de Calvin marchent côte à côte tout le long du chemin : c’est la même souveraineté absolue de Dieu, la même soumission totale de l’homme, la même préoccupation centrale du salut et de la vocation, le même aboutissement à l’union divine qui sont offerts en positif et négatif, en mode majeur et mineur de part et d’autre. La « contemplation pour obtenir l’amour divin » clôt les Exercices et ramène le retraitant dans la vie quotidienne, vie désormais transfigurée par la reconnaissance de tous les biens reçus du Seigneur amicalement présent et agissant en toutes choses. Que Calvin ait parsemé ses écrits de magnifiques tirades sur la présence et l’action universelle de Dieu, des livres dithyrambiques comme ceux de Léon Wencélius l’ont assez démontré [382]. Oui, il y a une esthétique calvinienne et cette esthétique c’est le théocentrisme de Calvin. Car le contempteur des humanistes ne dépasse pas leur niveau de la contemplation platonicienne : « Le meilleur ordre qu’on puisse tenir pour chercher Dieu... c’est de le contempler en ses œuvres, par lesquelles Il se rend prochain et familier à nous et se communique... » ; puis citant Platon : « Le souverain bien de l’âme est la similitude de Dieu, quand étant parvenu à la contemplation d’icelui, est en lui du tout transformée... Si on cherche la cause, par laquelle il a été induit à créer toutes choses, que à les conserver après leur création, on trouve qu’il n’y a pas d’autre cause que sa bonté, laquelle quand elle serait seule, nous devrait amplement suffire à nous attraire à son amour [383]. »
Tout l’idéalisme de la Préréforme rayonne ici. Toujours, d’ailleurs, les développements sur la ressemblance divine et sur la transcendance enchantent l’humaniste. Il est peut-être vrai de dire que personne, à cette époque, n’a parlé comme cet homme. Parler de Dieu, c’est devenu sa mission, son besoin, sa vie. Mais cette preuve ne suffit pas pour nous garantir l’authenticité du sentiment religieux du réformateur. Parler surabondamment de Dieu et de théologie, prêcher même jusqu’à cinq serinons par semaine, démontre sans doute à l’évidence le sérieux de ses convictions et surtout l’invraisemblable facilité de Calvin. Mais pour bien contempler Dieu en toutes choses, ne faut-il pas commencer par le regarder avec bienveillance dans le prochain ? Or, cet homme qu’on dit avoir été toujours « ivre de Dieu », comment a-t-il cherché Dieu dans ses frères les hommes ? Quand on parle de contemplation et d’amour, observe pertinemment Loyola en tête de sa célèbre considération, « il est bon d’abord de remarquer qu’il faut mettre l’amour dans les œuvres plus que dans les paroles [384] ».
Le réformateur a parcouru en tous sens la Bible entière à la recherche de Dieu. Il aurait peut-être mieux fait de s’arrêter, à la manière des saints, sur telle petite vérité indispensable, par exemple sur le mot de Jean l’Apôtre : « Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en action et en vérité... celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » L’intarissable prédication de Calvin sur Dieu a-t-elle, en fin de compte, rapproché Dieu des hommes et les hommes de Dieu ? A-t-elle rapproché les hommes entre eux ?
Accordons au professeur J.-D. Benoît que le Dieu de Calvin est le Dieu de la Bible ; c’est le Dieu vivant. Mais est-il le Dieu de l’Évangile ? « Ce Dieu appelle, ordonne, envoie, châtie et bénit, il jette les hommes dans la poussière et les relève pour des tâches qu’ils n’avaient point rêvées, forts d’une force qui n’est plus désormais la leur. Tout s’efface devant son regard ébloui par l’aveuglante clarté de la majesté divine... il contemple avec adoration le Dieu vivant, dont la volonté s’accomplit en dépit des méchants et par ces méchants mêmes. » Sans doute. Mais pourquoi multiplier indéfiniment le nombre des méchants et restreindre celui des hommes de bonne volonté ? Il est étrange que les « méchants », pour qui sait lire entre les lignes, ce soient toujours les adversaires du biblicisme calviniste, les adversaires du parti. Cette prévention fréquemment suggérée, et surtout subconsciente, devance une misanthropie théologique qui s’exprimerait tout aussi bien par la formule : « L’enfer, c’est les autres. » La souveraineté du Tout-Puissant est-elle vraiment rehaussée par la rancœur qu’on lui prête : « Ces ennemis qui écument de si grande rage ne feront rien, quoi qu’ils s’efforcent, sans le congé du souverain Maître... il est bien certain que si Dieu lâchait la bride à Satan et à ses suppôts, ils ne vous pourraient ainsi molester... il les tient enchaînés comme des bêtes sauvages... Dieu le tient lié et serré des cordes de sa puissance, il ne lui permet de rien exécuter, sinon ce qu’il lui plaît [385]. »
Que valent les protestations du respect quand les sublimations les plus choquantes tiennent lieu d’inspiration prophétique ? Un jour, projetant son ombre sur le ciel, le réformateur s’imaginera voir Dieu lui-même « crachant sur les services » qui ont remué la bile du Picard [386]. On ne combat pas efficacement l’anthropomorphisme de certaine tradition avec des images et des symboles encore plus compromettants pour la transcendance de Dieu. À peine vitraux, statues et tableaux ont-ils été détruits par les iconoclastes, que les réformateurs s’efforcent de fixer, dans l’imagination des croyants, des représentations d’un Dieu vengeur et jaloux, faites à leur propre ressemblance. Les disciples de Doumergue reconnaissent que le dogme favori du réformateur, la prédestination, est une « doctrine de combat », inspirée, dirait-on, par le besoin de galvaniser le courage des martyrs. Ils puiseront, comme plus tard les pionniers du puritanisme, une force irrésistible dans la certitude gratuite d’être « les élus de Dieu ». Mais on ne vit pas impunément sur pied de guerre. En temps normal, une théologie aussi martiale et belliqueuse, souvent simplifiée en slogans de propagande, nous frappe par son caractère forcé. Le Dieu de Calvin, qui tient tout dans sa main, n’a qu’un défaut, celui d’avoir les mains de Calvin et de mettre la main à tout, comme un deus ex machina au service de son prophète.
À l’opposé de ce qui se produit dans l’union mystique des « spirituels », la transcendance du Seigneur s’efface au fur et à mesure que diminue la distance entre la parole de Calvin et celle de Dieu. Dans une sorte de surenchère théologique, la souveraineté divine semble atteindre d’emblée le maximum : on lui attribue le plus de perfections possible. Mais ce total est obtenu par une accumulation de valeurs disparates : la toute-puissance y voisine avec l’arbitraire, la sagesse avec une prévision soumise aux formes relatives du temps. La miséricorde doit obéir aux conditions du pardon juridique, aux schèmes de l’imputation gratuite. La majesté de Dieu repose sur une base fragile, s’il lui faut, pour se maintenir, le piédestal de l’impuissance et de la déchéance totales de l’homme. La plénitude de l’Être Divin par laquelle débute l’Institution (nulla prorsus alia sapientia, justitia, bonitas, misericordia, veritas, virtus et vita) rejoint bientôt le fond du non-être, le néant du péché voulu directement, comme moyen et instrument de Sa justice [387]. Dieu semble faire sien tout le bien et tout le mal, l’erreur et le péché inévitables des justes eux-mêmes. Dans un pareil déterminisme, tout se ramène à un même vouloir divin absolu : comment distinguer encore entre la volonté qui se termine à l’élection et celle qui aboutit à la damnation, celle qui coïncide avec la révélation infaillible de Calvin et celle qui a décidé l’aveuglement incurable des papistes ?
Le « tant mieux » de Loyola encourt le reproche d’humaniser. Dieu, de trop accorder à la nature et à la liberté. Effectivement, l’homme sort élevé et enrichi de la retraite. Quant à la Majesté divine, elle garde tous ses secrets et son mystère. L’auteur des Exercices déconseille la spéculation, les vaines discussions sur la prédestination ; en revanche il suggère sans cesse de « demander à Notre Seigneur la grâce de n’être pas sourd à son appel, mais prompt et diligent pour accomplir sa très sainte volonté [388] ». Pas de théorie systématique, pas d’abstraction, ni d’a priori. Rien que l’effort personnel et volontaire pour changer de vie, pour se rapprocher du modèle concret, Jésus, dans sa vie cachée, publique, souffrante et glorieuse.
Le « tant pis » de Calvin, au lieu de tenir sa promesse, de nous montrer, dans la Bible, la divinité regardée en quelque sorte face à face, comme si « nous contemplions à l’œil l’essence de Dieu en icelle », se résigne, en fin de compte, à nous payer de mots. Ainsi quand il se flatte, avec une distinction nouvelle, tombée de sa plume, de résoudre l’immense problème de la prédestination et du mal : hac distinctione implicitus ille nodus dissolvitur [389]. Il est humaniste, lettré et philologue, donc enclin à la critique et à l’abstraction. Et plus encore peut-être, quand sa dogmatique est en jeu, dialecticien asservi à la « vieille mécanique logicienne » dénoncée par Lucien Febvre. « Farel et Calvin ne raisonnaient pas comme nous. De la doctrine de Servet (ou de n’importe quelle doctrine) ils déduisaient mille conséquences possibles. Ils développaient jusqu’à l’absurde mille propositions qui nous semblent anodines. Et la conclusion à laquelle leur suite de raisonnements les avaient conduits, ils l’identifiaient tout naturellement avec leur point de départ. Ils voyaient Z dans A puisque de A à Z, ils avaient marqué tous les échelons intermédiaires [390]. »
Nous sommes au siècle privilégié de la dispute et de la controverse. Calvin triomphe sur toute la ligne. Théologien armé de pied en cap par Montaigu et Orléans, il est bardé du plus redoutable « esprit de logique déductive » et de la passion la plus ardente. « Tout lui est bon contre ses adversaires ; la sainteté de sa propre thèse l’absout. » Humaniste, il possède encore toutes les armes alors modernes d’une rhétorique formelle ; il escompte la victoire, non pas de l’objectivité et de l’exactitude des preuves, mais de la sonorité, et de l’abondance des formules. Aussi Doumergue note-t-il justement : « Quand il parle, sa personne dégage une impression d’autorité momentanément irrésistible [391]. » Oui, momentanément. Mais après avoir, par son magnétisme extraordinaire, plongé ses disciples dans une sorte d’état second, Calvin se heurte, au réveil, à une résistance renaissante. Le sentiment religieux des chrétiens se redresse après avoir été courbé de force. On se rappelle avoir lu un autre Évangile que celui de ce Dieu particulariste : combien de fois, ne verra-t-on pas les plus chauds partisans de l’Institution secouer cet envoûtement, pour devenir des adversaires acharnés que Calvin considérera toujours comme les ennemis de « son » Dieu, à Genève, à Berne, en Allemagne.
Attirés sans fascination et devenus volontairement « amis de Dieu », les retraitants des Exercices, près ou loin de Loyola, n’auront jamais à renier amèrement des certitudes intimes acquises par leur propre travail.
II
DEUX MORALISTES
« La Souveraineté de Dieu a, pour corollaire immédiat, le renoncement à nous-mêmes », observe J.-D. Benoît. Dans les deux réformes, le relèvement moral est, en effet, conditionné par la soumission à la volonté de Dieu. C’est par la parole et la foi que s’accomplira cette transformation en quelque sorte « magique », au sens que les protestants donnent à ce mot pour traduire la notion catholique de l’efficacité des sacrements ex opere operato. L’homme n’est qu’« imbécilité, misère, vanité, vilanie... pourriture, vermine... odeur puante d’iniquité [392]... ». Mais si Dieu lui fait la grâce d’entendre sa Parole, il est sanctifié comme par miracle, ou du moins regardé comme tel définitivement par la justice divine qui, se donnant le change à elle-même, jette sur le lépreux le manteau de Jésus-Christ. Toute sa vie, quoi qu’il fasse, les œuvres du juste restent dignes de damnation et de malédiction. Quelques élus seulement par « la grâce qui est faite aux membres de Jésus-Christ... étant unis avec leur chef, ne sont jamais retranchés de leur salut. – ... Comme il s’est allié avec nous, et qu’il y a cette union sacrée, laquelle ne peut jamais être rompue, quand nous croyons à son Évangile, il faut que nous venions là, afin d’être assurés de notre salut... L’Évangile se prêchera bien à tous, même aux réprouvés : mais cependant Dieu ne leur fait point cette grâce spéciale de les toucher au vif [393]. »
Dans ces conditions, la formation morale du fidèle est vite tracée : il s’agit de lui communiquer cette foi inébranlable dans le déterminisme universel de Dieu et dans sa miséricorde particulière à son égard. Il faut abattre profondément l’homme devant la majesté divine et redresser son entière suffisance en face de la création, pour nous forcer à ne nous fier qu’à Dieu, nous « amener à déjection, défiance, haine de nous-mêmes [394] ». Le croyant sera installé dans l’ordre absolu, quand le mépris le plus obsédant de la nature humaine donnera la main à l’assurance la plus inconfusible d’être choisi, élu, prédestiné.
Intérieurement, aucune transformation ne semble se produire dans ces cœurs toujours souillés et « poilus ». Aux yeux de Dieu seulement, ces misères trouvent grâce, parce que, en définitive, c’est lui qui les a voulues. Obtenir l’obéissance de la foi à la doctrine et à la discipline « bibliques » : toute la réforme morale calviniste tient à cela. Entreprise simple, claire, mais ardue. Car la soumission de l’esprit à ces points de vue contre-nature suppose une contrainte continuelle et le refoulement des tendances les plus saines : le besoin de joie et d’optimisme, l’exigence d’une unité vivante entre le monde naturel et surnaturel. Rien d’étonnant si la pédagogie morale de Calvin est surtout idéologique, oratoire et disciplinaire. Il faut créer artificiellement ce climat de tension spirituelle, entretenir l’obsession du mal, de dépendance inéluctable. « Il n’y a rien qui nous pique plus vivement, que quand on nous remontre qu’il nous faut rendre compte un jour... Par quoi il faut nécessairement que le message du dernier jugement résonne comme une trompette, pour nous ajourner à comparaître devant le siège judicial de Dieu. Car c’est alors que nous sommes vraiment réveillés et que nous commençons à penser à mener une vie nouvelle [395]. »
Puisque cette trompette réveille si bien, Calvin en sonnera chaque fois que la torpeur engourdit ses auditeurs. Il piquera par des menaces bien appliquées la masse indifférente à l’élection divine. Quand toutes les issues de l’âme auront suffisamment été assombries du côté de la nature, elle sera bien forcée de regarder la seule lumière et la seule consolation qui reste, en s’abandonnant... avec désespoir à la Providence. Ceux qui acceptent cette attitude stoïque, ou plutôt ceux que la Parole aura ainsi éclairés, pourront se reconnaître, jusqu’à un certain point, à des signes d’honnêteté, de correction morale et de fidélité « évangélique ». La conduite exemplaire de ces élus n’a évidemment aucune valeur en soi, mais on ne cessera de s’en prévaloir, si ce n’est devant Dieu, du moins devant les hommes, en face des « ennemis de la foi » qui ne sont souvent que de simples et naïfs contradicteurs de Calvin. C’est à inculquer cette suffisance craintive et ce fier pessimisme que le réformateur emploie les quelque trois cents sermons qu’il prononce en moyenne chaque année [396].
La première Institution est déjà dominée par cet esprit. Qu’il explique la Loi (le décalogue), ou la Foi (le symbole), ou l’Oraison dominicale, ou les sacrements, ou l’Église, toujours les thèmes de la déchéance totale, du pardon gratuit par la foi et la certitude inébranlable de la justification luthérienne, se répètent comme les leitmotive d’une incantation. Ce principe formel de la moralité calviniste tient compte de l’infranchissable distance qui sépare l’idéal de la réalité et tire de cette impuissance même, le motif d’une sainte inquiétude et d’une bourgeoise satisfaction. Calvin développe rigoureusement tout ce qu’exige, dans ses commandements, la justice parfaite de Dieu une charité intérieure et spirituelle s’étendant à tous les mouvements des passions et de la volonté ; une irréprochable équité, une délicatesse de conscience sublime, une pureté pénétrant toutes les forces conscientes et inconscientes de notre être : bref, ici comme ailleurs le maximum quantitatif.
Mais quand il a dessiné son idéal rigide, emprunté, comme il l’accorde avec empressement, à Moïse plutôt qu’au Christ ; quand il croit avoir dépassé avec son schème théorique la hauteur des « conseils évangéliques » inventés par les moines ; alors brusquement, il s’empresse de redescendre et de prouver avec entrain que cette vertu merveilleuse est impossible, même avec la grâce [397]. Car il n’y a, en réalité, qu’une illusoire différence entre le juste et le pécheur, sauf sur le plan de la morale publique.
Voici un semblant de distinction entre l’homme naturel et celui qui est régénéré. « L’homme naturel est bien aiguillonné par sa conscience pour ne s’endormir point du tout dans ses vices. Néanmoins il ne laisse point de s’y complaire de tout son cœur et d’y prendre volupté... ne craignant autre chose que la peine, laquelle il voit être préparée à tous les pécheurs. L’homme régénéré, de la partie principale de son cœur adhère à la justice de la loi, hait et a en exécration le péché qu’il commet par imbécillité ; il s’y déplaît et n’y a point son consentement, mais plutôt prend plaisir et délectation de la loi de Dieu et y trouve plus de douceur qu’en toutes voluptés du monde. Davantage, jamais ne pèche de son propre su que ce ne soit contre son cœur ; car non seulement sa conscience répugne au mal, mais aussi une partie de son affection [398]. » Il fallait s’y attendre : à une théologie de la divine « volonté de puissance », une morale aigre-douce, typique du ressentiment devait correspondre : l’homme de bien est celui qui, malgré lui, fait le mal que Dieu veut. Mais « il s’y déplaît ». Le réprouvé ne peut pas faire mieux, mais en se soumettant, « il s’y complaît ». Question de goût et de disposition innée, aimerait-on dire.
Tout se ramène au « bon plaisir » divin et au « mauvais gré » de l’homme. Car Dieu, lui, se complaît dans la contradiction. Les cœurs bien tournés qui ont plaisir au bien, il se complaît à les obliger à mal faire ; quand aux cœurs mal tournés, qui se complaisent au mal, il les force à faire le bien malgré eux. « Si on demande pourquoi Dieu a pitié d’une partie, et pourquoi il laisse et quitte l’autre, il n’y a pas de réponse, sinon qu’il lui plaît ainsi [399]... S’il advient qu’il sorte quelque chose qui ait l’apparence de bien (de notre cœur), néanmoins l’entendement demeure toujours enveloppé en hypocrisie et vanité et le cœur adonné à toute malice... tant envenimé de péché qu’il ne peut produire que toute perversité... Dieu prend tellement plaisir à notre obéissance, qu’il prononce tous services volontaires, c’est-à-dire que nous inventons de notre tête, être maudits, quelque belle apparence qu’ils aient devant les hommes [400]. »
L’homme une fois ainsi désaxé, abattu, totalement désorienté par la menace de ce mystère « qui doit nous épouvanter », impitoyablement dégoûté de tout ce qui est naturel et volontaire, il sera plus commode de l’engager. Qu’on lui suggère seulement une « vocation » avec force, il suivra peut-être cette conduite divine d’autant plus docilement qu’elle a été moins voulue. Ainsi le prédestiné peut dédaigner le reste des hommes et se mépriser lui-même, sans abandonner un brin de son assurance, tel le réformateur avant de mourir : « Misérable créature, pleine d’infirmité, ce que j’ai fait n’a rien valu... » Il demandera cependant qu’on ne change rien. Ses fautes elles-mêmes sont rassurantes : « Mes vices m’ont toujours déplu [401]. »
Ainsi « personne n’a affirmé plus fortement que Calvin, opine le professeur Benoît, la souveraineté absolue de Dieu, personne n’a affirmé plus résolument la responsabilité de l’homme. Il y a là deux pôles entre lesquels chemine sans cesse sa pensée... les évènements sont voulus par Dieu, prédéterminés par lui. L’homme n’en est pas moins coupable et responsable quand il fait le mal, bien qu’il soit, jusque dans ses fautes, l’instrument de la Providence divine. La contradiction est flagrante, peu importe. Calvin trouve ces deux données dans la Bible... C’est presque avec une joie farouche qu’il constatait qu’en poursuivant la ligne dans les deux sens, l’esprit borné de l’homme n’aboutit qu’à des contradictions [402]. » Il pense avoir découvert ce mystère dans la Bible... « Ce serait un sacrilège horrible de s’enquérir plus haut... ce serait une impiété... c’est être enragés fantastiques... et faire un grand outrage au Saint Esprit. »
« On ne dira jamais assez combien les préoccupations pratiques ont été prédominantes chez Calvin [403]. » Il faut que l’Écriture, telle qu’il la comprend et l’expose, commande toute la vie humaine, tout l’ordre public, toutes les attitudes personnelles. Tout service, tout effort qui n’est pas commandé par Dieu, lui est en abomination. Tout doit devenir un service commandé. Si contradictoires qu’ils paraissent, l’abandon et le sens des responsabilités se confondent pratiquement. Il faut répéter sans cesse que l’homme n’est rien, afin que tout ce qui peut se faire de bien, en lui et par lui, prenne exclusivement son origine en Dieu. Ainsi, en dehors de la grâce, tout est néant. Obéir à une vocation et délégation divines est donc la question essentielle.
Calvin libère de prodigieuses énergies en réclamant de chacun cette obligation d’être mandaté, autorisé par Dieu dans toutes ses entreprises. De splendides courants mystiques ont pu jaillir de cette source. Il faut reconnaître la force audacieuse et la simplicité du point de départ de cette réforme. Le seul moyen de transformation morale vraiment efficace aux yeux de Calvin, c’est de prêcher le déracinement complet de l’homme naturel et de le replanter sur le seul terrain fertile de la grâce. Sous peine d’être maudit, tout doit devenir « surnaturel », par la foi et l’abandon, par le mépris du monde.
La grâce ne suppose pas la nature, comme le pense la tradition catholique, mais au contraire c’est la nature, à tout moment, qui suppose la grâce, pour être maintenue au-dessus de l’abîme où la corruption l’entraîne fatalement. Il ne faut, par conséquent, s’appuyer que sur Dieu et sur sa Parole. Tel est l’idéal sublime : tout doit s’ordonner à partir de la volonté de Dieu et tendre vers la fin la plus désintéressée.
Les applications, hélas, ne sont que des compromis. Au lieu d’enregistrer, comme on aurait pu l’attendre d’une exigence aussi impérieuse, une plus-value de la grâce, c’est à une dévaluation qu’on assiste. Mise partout et requise pour tout, la faveur divine perd de son prix. Elle semble même dispenser du détachement réel et actif des créatures. S’il faut sacrifier le vieil homme, c’est plus par une attitude de défiance négative que par amour de la perfection et en vertu d’un choix meilleur. Les valeurs spirituelles sont pratiquement nivelées. Tout ce qui n’est pas défendu devient vertu, et tout ce qui est commandé est sacro-saint ; tout ce qui est interdit revêt la gravité d’une atteinte à l’autorité divine. Les nuances s’estompent : des peccadilles seront châtiées sévèrement et des fautes graves passeront inaperçues.
Loin de stimuler la générosité libre, Calvin exigera tout au nom d’un devoir à accomplir parfaitement. Nul dépassement de soi-même, aucune place pour un héroïsme gratuit, pour le don libre et cordial à Dieu, aucune compréhension des conseils évangéliques, de l’insouciance filiale. Le passif de l’homme et l’actif de Dieu, tous deux infinis, ne s’équilibrent que moyennant une sorte de concordat divin, garanti par une déclaration de faillite humaine. Pas d’illusion, pas de libération en dehors d’un aveugle abandon et d’une aveugle obéissance [404].
Ce contrat une fois établi avec la justice divine, la morale de Calvin se contentera d’une sagesse bourgeoise, de la Mediocritas aurea, chère aux humanistes. Il s’agit, en fin de compte, d’une honnêteté moyenne, qu’on peut constater et contrôler de l’extérieur par les enquêtes du Consistoire, et canoniser par les Ordonnances. C’est la vertu du puritain prédestiné et prémuni contre la peur de la damnation par le bouclier de la foi, qui s’assure, comme il peut, sa place au soleil, suivant ce que Calvin appelle la « vocation » : « Chacun doit réputer... que son état lui est comme une station assignée de Dieu. » Cette vocation est « un principe et fondement... une règle perpétuelle... Dieu distinguant ces états et manières de vivre les a appelés “vocations” [405]... ». Tout se ramène à une bonne morale professionnelle, celle-ci pouvant bien se concevoir dans les limites d’un honnête capitalisme. Dans le chapitre si sage par lequel s’achevaient certaines éditions de l’Institution, le réformateur rejoint, par les conclusions de son théocentrisme unilatéral, le point de départ anthropocentrique des humanistes : « Comment il faut user de la vie présente et de ses aides. » Se libérer de soi par l’alternance du mépris et de la fierté.
La réussite temporelle apparaît volontiers comme le signe des préférences célestes. L’étude prolongée de l’Ancien Testament accrédite dans le calvinisme l’espérance juive que le succès définitif, même sur le plan matériel, est promis aux fidèles, aux élus. Le puritanisme pragmatiste prend ici sa racine. Dans le ralliement du monde bourgeois à la Réforme, ce sens du réel fut probablement un allié utile. Centrales dans la perspective ignacienne, l’estime de la pauvreté et la crainte de Mammon ne jouent aucun rôle dans la réforme calviniste. Cependant l’attitude morale fut austère et sévère, ennemie du luxe et de tous les excès. Elle développa sans contredit les vertus domestiques et civiques. Elle façonna remarquablement la conscience publique. Elle habitua les fidèles à la docilité envers leurs gouvernements, ce que les autorités aiment toujours. Elle favorisa la distinction des classes sociales, règle chère à la bourgeoisie, sans diminuer les privilèges de l’aristocratie, réservant aux grands une place à part, par exemple, s’il s’agit de prendre l’initiative d’une révolution ou d’un coup d’État exigé par « l’Évangile » [406].
En somme, les vertus en honneur à Genève et dans le puritanisme, l’amour de l’ordre légal, la discipline, l’esprit de corps et la solidarité envers les « frères », l’esprit de devoir, la conscience et l’exactitude en affaires, ne font qu’appliquer les normes les plus communes du droit naturel. Cette religion aux formules hyperboliques, aux prétentions toutes surnaturelles s’accommode d’une moralité ordinaire où tout est clair, sensé, pratique : « Une religion raisonnable... pour hommes seuls », disait Brunetière. Voilà enfin des vertus qui peuvent se laisser voir, sur lesquelles les anciens pourront exercer leur censure, des valeurs qui permettent de comparer les hommes entre eux et surtout d’opposer les « purs », les « libertins », les impies de l’abomination papiste.
Cette conscience d’une supériorité morale et doctrinale, visible à l’œil nu, laisse sur le mouvement réformé une empreinte de suffisance dont les porte-parole du calvinisme contemporain n’arrivent pas à se défaire. Ils ont la certitude innée que « toutes les grandes œuvres qui ont pour but la lutte contre les fléaux moraux et sociaux qui désolent l’humanité ont eu pour fondateurs des protestants... le catholicisme n’a guère que copié en le démarquant, ce dont le protestantisme avait eu l’initiative [407] ». Ce slogan de la charité ou de la philanthropie exclusivement protestante est aussi vrai qu’il est modeste. Qui pourra jamais déterminer ce que la Croix Rouge, ou des œuvres similaires, créées à des siècles de distance, par des personnalités absolument indépendantes et d’ailleurs isolées de leur milieu, doivent à l’influence directe de... Calvin ? Entre cette inspiration humanitaire et universaliste du XIXe siècle et l’étroit fanatisme du XVIe, que d’intermèdes se sont joués, transformant la mentalité européenne : Rousseau, la Révolution française, le romantisme, le socialisme... sans oublier l’Église des Vincent de Paul, des François de Sales, des Pierre Claver, des Xavier et des Bosco.
Est-il si évident que « en réalité, et au fond, le protestantisme est plus moral que le catholicisme qui joue sur l’intérêt et le calcul [408] » ? Il y a toujours un certain danger de pharisaïsme à se comparer aux autres, avec la conviction d’appartenir à la race des « purs », surtout quand on relève d’une doctrine qui répète : « L’homme n’est rien qu’hypocrisie et abomination... tous damnés et maudits, qui fuerunt, sunt et futuri, dans le passé, le présent et l’avenir [409]. » Les déchets du clergé et des ordres religieux qui passèrent à la Réforme ne cherchaient pas seulement la perfection évangélique, mais l’apercevaient parfois, par exemple, pour nous servir d’un mot cruel de Calvin, « sous les traits d’une femme [410] ». Tous les réfugiés n’étaient pas des héros et qui discernera jamais tous les mobiles qui ont finalement converti les derniers Genevois au calvinisme ? « De ceux mêmes qui ont abandonné leur pays pour venir ici servir à Dieu, disait Calvin, il y en a qui s’y portent assez lâchement... Ils pouvaient bien vivre ailleurs en débauchés... il eut mieux valu qu’ils meurent sur leur fumier [411]. »
« Dieu (en la personne de son prophète) est venu visiter (les Genevois) dans leur nid », mais ils n’ont pas assez de reconnaissance pour le bienfait que le Seigneur « aît bâti son Temple et dressé son autel au milieu d’eux ». La morale de la ville reste ce qu’elle était. Les chefs de file de l’émigration, les Français choisis par Calvin comme pasteurs ou confidents, ne brillaient pas par leur mérite religieux. La conduite unanimement lâche des ministres de la Parole, au moment de la peste, certains préférant « aller au diable, ou être pendus à Champel » plutôt que de secourir les contagieux, la vie double de personnages comme Mairet, ou François Bonnivard, est une preuve par l’absurde que cette morale divine restait trop humaine. Si malgré leur vocation « certaine », les ministres de la foi peuvent esquiver un grave devoir que les magistrats et les anciens Genevois, élevés dans le catholicisme, regardent comme une obligation élémentaire et qui va de soi, quel fidèle ne pourra, dans des circonstances semblables, alléguer la même excuse théologique : « Dieu ne leur a pas donné la grâce d’avoir la force et la constance... Nous savons tous, voire trop, combien il est difficile aux hommes de s’oublier [412] » ? Le pessimisme qui, suivant la formule de Chesterton, « apprend plus à mépriser la terre qu’à priser le ciel », réagit subrepticement par les détours habituels du refoulement.
Le réformateur va mobiliser toutes les contraintes spirituelles et physiques pour instaurer la théocratie, pour défendre l’honneur de Dieu, plus indispensable « que le salut et la vie de centaines d’hommes [413] ». Une police religieuse et civile expéditive, qui utilise la délation et la provocation, établissent à la longue de belles apparences de fidélité et d’unanimité : les sermons sont obligatoires ; la tenue y est de plus en plus respectueuse, c’est-à-dire passive ; les Ordonnances sont observées, le magistrat obéi, les abus si bien réprimés qu’on ne les voit presque plus... Si, malheureusement. Cette puissante mise en scène d’édification ne réussit pas à empêcher que dans la sainte cité de Calvin, les scandales continuent, comme ailleurs, mais en se cachant plus soigneusement. Jusque parmi les membres de la Vénérable Compagnie, jusque dans la propre famille et l’entourage du réformateur, les adultères se répètent [414]. Ces données réalistes et d’autres sur lesquelles il nous faudra revenir en étudiant la personnalité du maître de Genève, posent la question de l’efficacité de ce système, le plus moralisateur qui soit.
Calvin ne néglige rien pour changer le cœur de l’homme, « ses pensées et ses sentiments intimes ». Mais si la force dût être employée, à cet effet, avec le résultat que l’on connaît, c’est que la persuasion lui fut trop souvent refusée. Son esprit a rapidement assimilé tous les genres littéraires et tous les modes de pensée, mais le produit extraordinaire de cette hybridation suscite l’étonnement ou même l’admiration, sans mûrir au fond des âmes les vrais fruits de la vie. Pour suppléer à cette absence d’adhésion et de chaleur, Calvin devra transformer la joyeuse ville épiscopale en une sorte d’internat pour adultes.
Si l’on fait abstraction d’expériences actuelles, l’entreprise de rééducation morale collective de Calvin n’a peut-être que deux équivalents dans l’histoire : Sparte et l’État chrétien modèle des jésuites dans les Réductions du Paraguay [415]... Grossières approximations sans doute, mais qui pourraient justement évoquer de gros problèmes : l’ordre public d’une société permet-il de conclure à la valeur de la philosophie de ceux qui la commandent de gré ou de force ? Le mot de la fin de François Wendel sur Calvin résume bien la question « Plus encore qu’un penseur, il a été un conducteur d’hommes » ; et suivant l’habitude des « conducteurs », il a remis de l’ordre dans tous les domaines où il est possible de soumettre extérieurement l’homme : la profession de foi, la discipline ecclésiastique, civile, sociale et domestique, le culte et les mœurs. L’attitude morale profonde peut être négative, la conscience en révolte : il suffit que la réforme soit publique, institutionnelle, édifiante. Il faut se contenter de « signes » d’élection, car intérieurement la malice de l’homme est incurable.
*
* *
Tout autre est le point de vue des Exercices. Loyola croit à la guérison de la maladie profonde et même au renouvellement actif et personnel de l’âme. Son point de départ est presque aussi peu flatteur que celui de Calvin : sans le Christ « tous les hommes descendaient en enfer [416] ». Mais la convalescence est promise. Il songe à des chrétiens, à des baptisés dont il croit pouvoir attendre beaucoup de bonne volonté. S’il reprend l’histoire de la déchéance humaine, et même de la chute des anges, ce n’est que pour saisir, dans une vision dynamique, la nature interne du péché, son caractère individuel. Il sait que les tirades éloquentes sur la corruption de l’homme en général risquent de ne faire réfléchir personne en particulier. Ce sont ses propres connivences et complicités avec le mal que le retraitant doit apprendre à déceler et à déraciner. Partout, dans les défaillances comme dans les efforts de progrès, Loyola insiste sur la liberté avec laquelle il faut répondre à la grâce. Il suppose que, si le retraitant s’offre avec humilité et courage à Dieu, pour faire toute sa volonté et rien que sa volonté, il aura bien assez compris la nécessité universelle de la grâce [417].
Mais c’est la sincérité de son sacrifice, la franchise de sa lutte contre le péché personnel, c’est la loyauté de son désintéressement et de sa charité, qui priment toutes les autres préoccupations. Loyola ne verrait aucune utilité à revenir sans cesse, par delà la nuit des temps et de l’éternité, sur la cause métaphysique du mal. Pas de discussion ; des actes immédiats contre les lâchetés libres, reconnues ; des actes contraires aux « affections désordonnées ». Les Exercices ne sont que la série de ces tentatives multiples et variées, pour s’entraîner peu à peu « à chercher la seule volonté de Dieu », pour mettre à l’épreuve le choix d’un état de vie, pour décanter le contenu de nos sentiments, de nos émotions, de nos jugements, de nos aspirations, de nos projets présents et à venir, pour « se vaincre et se ranger à l’ordre divin, sans se laisser déterminer par une tendance déréglée quelle qu’elle soit [418] ». Ici, la réalité et les idées doivent se rejoindre. Ici, le verbalisme et les spéculations troublantes sont écartées : « Ce n’est pas le grand savoir qui rassasie l’âme, mais la saveur interne des choses. » Toute vérité doit s’incarner dans une expérience vécue et toute expérience, toute action, se soumettre à l’inspiration de Dieu dans la conscience. Ainsi la vocation qui viendra toute de Dieu, doit également venir tout entière du cœur de l’homme. « Les choses que chacun découvre par lui-même contiennent plus de substance et portent plus de fruits que les longues explications » d’un autre, fût-il le plus habile des prédicateurs [419].
Envisageant le péché comme un manque d’amour et une défaillance de la volonté, c’est sur le plan de la liberté que Loyola poursuit sa réforme. Il n’est cependant pas d’abord volontariste : toutes ses expériences imbriquées les unes dans les autres constituent une théologie dont Przywara s’est efforcé de dégager la structure [420]. Il fait à l’intelligence une très large place : les Exercices sont remplis de réflexions, de méditations, d’activités spirituelles, que seule une élite formée peut mener à bon terme. Il n’est pas non plus un intellectualiste. Car les certitudes qui naîtront dans l’esprit du retraitant doivent pénétrer si profondément toutes les zones de la psychologie, dans ce qu’elle a de plus individuel et de plus sensible, qu’on a crié au subjectivisme. Il présente une doctrine sans l’imposer autrement que comme un point de départ. Il fait appel aux techniques de l’ascèse, de l’introspection, il recourt à toute la pédagogie de l’intuition, de l’imagination, à tout un art de la suggestion. Est-ce à dire qu’il matérialise la spiritualité ou, pis encore, qu’il la mécanise ?
Non, il est simplement convaincu que la vie intérieure doit être concrète et réaliste. Seule, à ses yeux, une adhésion libre est digne du nom de la foi. Le genre sermonneur lui est aussi étranger qu’il est cher à Calvin. Le retraitant, sur des sujets proposés en série variable, doit se faire à lui-même les exhortations et les remontrances qu’il jugera appropriées à son cas particulier. C’est à lui-même de s’expliquer, seul à seul avec Dieu, de prononcer la sentence que mérite son malheureux état d’âcre, sans recourir au palliatif de la misère universelle. Chacun doit « se réformer soi-même, remédier au désordre de ses opérations, ordonner sa vie, demander tout ce qui pourra l’aider à mieux suivre et imiter Notre-Seigneur ».
Telle est la méthode audacieuse de « réarmement moral » proposée par Loyola aux âmes désireuses de changer. Pendant un mois, dans un contact amical, personnel, « celui qui donne et celui qui reçoit les Exercices » s’en remettent l’un à l’autre, se règlent l’un sur l’autre. L’action de celui qu’on a depuis appelé fort malencontreusement le directeur, et qui n’est qu’une sorte de moniteur, d’entraîneur spirituel, semble, à première vue, décider de tout : du rythme, de la longueur, du choix des sujets. Il n’est, en réalité, que l’auxiliaire, l’intermédiaire, le témoin de la foi et de la tradition. Son rôle consiste à retracer, le plus exactement possible, les faits et l’histoire objective du salut, depuis la chute des anges et d’Adam, jusqu’à l’Ascension du Seigneur et à son retour [421]. Ces réalités ne sont que mentionnées, les mystères de la foi esquissés pour mémoire : chaque âme, éclairée par le texte évangélique et par la grâce personnelle, approfondira le contenu des connaissances et des souvenirs religieux les plus simples, jusqu’à ce qu’ils revivent et s’animent dans une expérience incommunicable. Le « directeur » peut même être un laïc, pourvu qu’il ait une bonne expérience de ces matières et un bon jugement surnaturel. Il n’ambitionnera qu’un titre d’excellence : la fidélité. Comme un « lecteur » dans les offices de la liturgie, il transmet sans commentaire le message pur et simple d’une Épître ou d’un Évangile, tel quel, sans brillants aperçus, le plus sobrement possible, pour que la révélation se découvre elle-même. Cet éclairage direct de l’Esprit et ce travail personnel du retraitant sont le point capital.
Toute la structure des Exercices est commandée par un but : choisir la meilleure forme de vie possible. Il s’agit de refaire, en sens inverse, le chemin parcouru loin de Dieu. L’itinéraire du péché passait successivement par la cupidité, par le besoin de se faire valoir (honneur mondain), par l’orgueil, pour aboutir, de là, à tous les autres vices. Dans cette perspective, le péché n’est pas une fatalité divine, c’est une aberration voulue, une lâcheté bien humaine [422]. La guérison de cette maladie du vouloir coupable s’effectue dans la direction diamétralement opposée : en traversant la pauvreté spirituelle et réelle, les humiliations, l’homme progresse dans l’humilité, et par elle, se dépouillant de lui-même, s’ouvre de plus en plus à l’amour désintéressé et à la ressemblance du Seigneur Jésus. S’il n’a pas la force de renoncer entièrement à la fortune, le retraitant doit au moins s’exciter à demander le désir de la pauvreté, la nostalgie d’une vie parfaitement détachée du moi, où il serait pauvre, par amour, avec le Christ pauvre, humilié avec le Christ comblé de mépris [423]. Le sommet des Exercices ne culmine pas dans l’art « d’user de la vie présente et de ses aides », dans l’honnêteté et la sagesse bourgeoise du juste milieu, mais dans la folie de la croix, dans l’abandon total et l’exacte imitation de Jésus [424].
Comme le puritain, le disciple de Loyola est stimulé par un comparatif exigeant qui ne lui laisse pas de repos. Mais ce n’est pas avec le « reste du monde » que le retraitant se mesure. Puisque chaque destinée est une histoire singulière, et que chacun doit se décider librement et répondre personnellement à l’appel, la comparaison ignacienne reste tout intérieure. Chacun se confronte avec son idéal vivant, avec le Maître présent, qui veut nous voir, chacun à notre manière, rivaliser d’amour et de générosité avec lui : « Va, vends tout et suis-moi... celui qui veut venir avec moi, doit partager les peines avec moi, pour avoir ensuite part au triomphe avec moi... Il a fait telle et telle chose pour moi, que ferai-je pour lui en retour [425] ? » Dans l’orientation générale de sa vie, comme dans la conduite des moindres détails, l’effort du disciple ignacien doit tendre à ne rechercher le Seigneur que pour lui-même, à ne travailler à sa gloire que « pour le seul amour » purement désintéressé de sa personne [426].
La sincérité de ce pur amour de Dieu est éprouvée sans cesse par un autre genre de comparaison. Le retraitant s’habitue à établir un parallèle sévère entre ce qu’il a été et ce qu’il aurait pu être et ce qu’il peut encore devenir avec la grâce. Les états de ferveur sont évalués, sans illusion, suivant les degrés d’humilité ou d’abaissement devant la volonté de Dieu. Cette humilité est l’étalon d’après lequel Ignace jauge le progrès spirituel. Elle n’a rien de sombre. C’est une « humilité pleine d’amour », qui se nourrit d’enthousiasme personnel pour le Christ. Tous ses élans sont positifs : au contraire, l’abandon obtenu par Calvin humilie et froisse davantage l’intelligence que le cœur. Loyola évite sans peine l’écueil qui attend les grands contempteurs de l’humanité. Souvent l’orgueil refoulé du moraliste qui fouaille sans pitié la nature déchue ne fait que monter d’un degré. Le prêcheur prophétise, il se prévaut d’une mission supérieure pour juger et condamner tout le monde plus sévèrement que ne le fait Dieu lui-même.
Loyola laisse au juge le soin d’intervenir dans chaque conscience. Et le retraitant s’offre à ce jugement intérieur, sans ménagement, sans échappatoire métaphysique. Il espère dans l’amour de celui qui l’invite à se racheter de ses défaillances présentes ou passées. Jamais la moindre polémique n’effleure la pensée d’Ignace et du retraitant. Bien plus, il faudrait faire abstraction du monde extérieur. La réforme collective attendue d’un brusque changement de religion ne préoccupe nullement cet esprit jamais pressé, soucieux de réaliser, avec toute la lenteur et la profondeur requises, le reflectere ad me ipsum, le retour en soi-même, l’application personnelle de la vie de Jésus au cas concret de sa propre vie. Les mots d’ordre de Loyola tournent toute l’agressivité du retraitant contre lui-même, contre le mal conscient et reconnu, contre « le désordre des affections » : tout revient à se vaincre soi-même, à réagir contre les passions et les tendances de l’égoïsme, à se rendre indifférent, c’est-à-dire désintéressé, détaché [427].
Réforme simple et constructive : rien de ce qui peut aider à servir, louer et adorer le Seigneur n’est dédaigné. L’ascète épanouit des sympathies universelles ; le fruste médiéval utilise avec beaucoup d’estime et un sens psychologique très moderne les méthodes et les procédés d’introspection déjà recommandés par Pythagore, Aristote et la Stoa [428]. Il fait appel à tout l’ensemble des motifs humains et surnaturels, capables d’épauler l’effort de redressement moral. Sans songer à édifier une morale autonome, kantienne, il apprécie cependant l’attitude de l’homme qui s’oppose au mal « même si le péché n’était pas défendu [429] ». Il évite de détraquer l’instrument si délicat de la conscience par des menaces et des adjurations impressionnantes. Il ne se contente pas de subtiliser sur les responsabilités de la concupiscence ; il s’occupe avec plus de soin que Calvin de parer aux premiers mouvements du tentateur, aux moindres sentiments contraires à la charité. Non seulement, il ne se fera jamais une arme de la médisance et de la satire, mais il proclame la nécessité d’une vigilance et d’une netteté scrupuleuse à l’égard du prochain : « Si je manifeste une faute grave qui n’est pas publique, je commets une faute grave ; si c’est une faute légère que je manifeste, ma faute est légère ; si je manifeste un défaut, je montre ainsi mon propre défaut [430]. »
La primauté de l’amour garantit l’authenticité de la réforme ignacienne. Les efforts les plus austères ne doivent jamais obéir au « tant pis » de la seule patience stoïque. Les Exercices s’appliquent à « faire aimer, par amour du Seigneur, ce qui répugne le plus à la nature, ce qui arrête habituellement dans la recherche de la perfection ». La pensée d’Augustin et de l’Imitation domine le prétendu volontarisme ignacien : « On n’a point de travail en ce qui est aimé, ou, s’il y a du travail, c’est un travail bien-aimé. » Pour prévenir les illusions trop fréquentes du sentiment, observe Pinard de la Boulaye, Ignace « n’emploie qu’avec grande parcimonie ce mot « amour » et lui substitue celui de « service » qui exprime la forme la plus sûre de l’affection due à Dieu ». Cependant, ce service sera d’autant plus parfait qu’il tendra à aimer Dieu « pour lui-même, en considération de l’amour et des bienfaits dont il nous a prévenus, plutôt que par la crainte des peines ou par l’espérance des récompenses ». L’idéal serait de pouvoir s’en remettre uniquement « à la loi d’amour et de charité que le Saint Esprit a coutume de graver dans les cœurs ». C’est pourquoi le retraitant ne cesse de demander dans les Exercices : « Accordez-moi, Seigneur, de vous connaître de façon de plus en plus intime, de vous aimer de façon de plus en plus ardente, de vous imiter de plus en plus fidèlement [431]. »
Ces formules typiques indiquent bien l’élan qui soutient l’ensemble des Exercices, où tout suggère un progrès psychologique, une ascension, une croissance vivante. Malgré les cadres méthodiques, ou plutôt grâce à eux, tout évolue et monte par degrés. Saisi par ce dynamisme rigoureux, le retraitant se sent humblement appelé à plus, avec la certitude qu’il pourra toujours davantage, s’il veut suivre la grâce « pour la plus grande gloire de Dieu, pour le plus grand service de Notre-Seigneur, pour le plus grand amour du Christ et du prochain ». Ce « plus » est la marque dominante de la mentalité ignacienne. Le secrétaire de Loyola, Polanco, voit dans cette majoritas, dans cette tendance à plus, le véritable esprit de son maître [432]. On a compté que la devise ad majorem Dei gloriam revient cent et quatre fois dans les Constitutions et, si l’on compte les formules équivalentes, on arrive au chiffre étonnant de trois cent soixante-seize. Dans le seul livret des Exercices, ce comparatif intervient quelque soixante-dix fois.
Cet élan qui par la suite a pu, ici ou là, dégénérer dans le vertige, mais aussi dans la grandeur du baroque, est, à l’origine, une mystique naïve et profonde. De toute façon, pour Ignace et ses premiers compagnons, la retraite qui se prolonge immédiatement en exercices concrets de dévouement auprès des pauvres, des malades, des ignorants, des malheureux, est bien cette « mystique de service et de religion, baignée tout entière dans l’amour » que nous décrit un des meilleurs connaisseurs de la spiritualité, J. de Guibert [433]. Le redressement moral ignacien réussit donc à « faire sortir l’homme de lui-même ». Alors même qu’il est question de salut ou de consolation, les mots n’ont jamais le sens subjectif d’un repli sur soi : « J’appelle consolation quand, dans l’âme, est produit quelque mouvement intérieur par lequel l’âme s’enflamme d’amour pour son Créateur et Seigneur, que par suite elle ne peut aimer pour elle-même aucune créature sur la terre, mais seulement dans le Créateur de toutes [434]. » Le retraitant demande et recherche la joie : « Toute augmentation d’espérance, de foi, de charité, et toute joie intérieure qui nous porte et nous attire aux choses célestes... ». Morale épanouie.
Que de fois Calvin ne soupire-t-il pas après la consolation ! Mais celle-ci a un tout autre sens. C’est le « soulas et le confort » dans la lutte, le répit dans la hantise du mal qui domine une activité immense, mais fiévreuse et maladive. À force de remontrances et de mesures policières il transforme une république, un monde : « La cité rieuse, satirique, changeante comme son lac... devint une ville étonnante, où tout était flamme et prière, lecture, travail et austérité, la grande école de la foi et des martyrs », comme l’idéalisait Michelet. Mais quel est cet esprit « nerveux et plein de trait, admirablement clair et qui ne s’attendrit jamais [435] » ? Un coup d’œil jeté sur les Index des œuvres complètes peut déjà nous en donner une certaine idée. Minime, d’après ces registres, la place accordée à la charité : quelques dizaines de lignes de références. La foi, la loi, l’Église, le péché occupent des colonnes entières, des centaines de lignes. Et phénomène plus curieux encore : l’attention évidemment toute négative prêtée à Rome et au pape prend l’aspect d’une véritable obsession ; elle s’étale sur neuf colonnes, tient autant de place que le Christ.
Le fidèle calviniste est entraîné dans une Église vraiment militante qui le façonne à son gré et le dispense de trop s’interroger, de s’occuper inutilement de lui-même. Avantage appréciable et certain de l’action extérieure. Cet esprit de croisade, cette mentalité puissamment dirigée, mobilise toute la vie spirituelle. La piété elle-même est engagée. Calvin répliquait au cardinal Sadolet qui exhortait trop longuement les Genevois à songer au salut de leurs âmes : « Cela sent peu son vrai théologien, de tant vouloir astreindre l’homme à soi-même... le commencement de bien former sa vie est désirer accroître et illustrer la gloire du Seigneur [436]. » Né pour la cause de Dieu, l’homme n’a qu’à bien se passionner pour elle ; le reste, le salut y compris, lui sera donné par surcroît.
La recherche de la perfection ignacienne n’exclut pas tout danger de narcissisme. L’ascète se mire volontiers dans sa belle âme, ou tout au moins risque de trop s’observer lui-même. Calvin a-t-il vécu ces états d’âme ? Après avoir traversé un désert de scrupules, il est décidé à couper court à tous ces mirages de la nature. Celle-ci doit absolument perdre toute importance aux yeux du chrétien. Plus de consolante illusion, plus de course aux mérites, plus de savantes et divertissantes ascensions. Rien que la dure soumission à l’ordre divin de la Bible et de la conscience. Le pécheur n’a qu’à marcher, sans relâche, sans espérer la moindre concession à la vanité. Morale stoïque.
III
DEUX MAÎTRES D’ORAISON
À l’école des Exercices se sont formés de grands Saints et des maîtres de la vie intérieure, non seulement des disciples de Loyola, comme Pierre Favre, François Xavier, François Borgia, Pierre Canisius, Bellarmin, Lessius, Suarez et tant d’autres ; mais aussi bien, en dehors de la Compagnie, nombre des mystiques modernes ont profité de leur spiritualité, comme Philippe de Néri, François de Sales, Charles Borromée, Vincent de Paul, Thérèse de Jésus, Madeleine de Pazzis, Alphonse de Liguori, Léonard de Port-Maurice... Évidemment des faits de ce genre ne pèseraient pas une paille pour Calvin, aux yeux duquel les catholiques, dans leur ensemble, ne savent absolument pas prier. À l’en croire : « Les papistes n’ont aucune expérience et usage pour savoir ce que c’est que prier Dieu... Je ne profiterais de rien de disputer contre eux, vu qu’ils montrent que jamais n’ont eu qu’une vaine imagination » (de la vertu de foi) [437]. Mais quelle sera donc cette prière parfaite dont le jeune avocat de vingt-cinq ans semble avoir une si profonde connaissance et une pratique si fidèle ? Il ne faut pas s’attendre à quelque surprise merveilleuse. Il est trop constant avec lui-même. Sa vie intérieure est le prolongement obligatoire de son système.
*
* *
La prière de Calvin n’est que l’application au dialogue entre l’âme et Dieu, des principes fixés dès les premières pages de l’Institution. Toute prière qui ne répond pas au type de la foi réformée est nulle et non avenue. L’oraison garde son sens latin de discours : c’est une prédication sous forme d’invocation, ou des invocations conformes à son enseignement, pour inculquer sans cesse la même doctrine. La seule préparation requise consiste à éveiller en soi des sentiments calvinistes orthodoxes : un homme qui ne partagerait pas son pessimisme et sa fierté déterministe ne saurait qu’insulter Dieu par ses rêveries [438]. Quand un chrétien parle au Père avec la tendresse d’un enfant, il ne doit jamais oublier que c’est le Dieu vengeur, qui écrasera l’Antéchrist romain [439]. Cette obsession de la thèse à prouver ne favorise guère l’assimilation des passages scripturaires. Pour se fondre tout à fait avec la vie personnelle, les formules « divines » devraient trouver un cœur plus complaisant.
Dans l’intention de l’auteur, le commentaire de l’oraison dominicale devrait suffire à tout, aussi bien à réfuter les aberrations papistes, qu’à exposer définitivement la doctrine et la pratique de la prière. Cet enseignement est de nouveau une démonstration de la supériorité intellectuelle de Calvin, mais aussi de la raideur et de la pauvreté de sa vie intérieure. Plutôt qu’une prière, le Pater est un code, une règle fixant les conditions de l’oraison publique, légale. Dans son besoin de simplifier, le jeune rhéteur transforme en discours et en institution les confidences les plus intimes du Maître. Au Décalogue réglant la conversation extérieure de l’homme, doit faire pendant une autre table de préceptes, une sorte de manuel de la conversation de l’homme avec Dieu. Cependant les deux tables se ressemblent comme deux copies dont il serait vain de chercher l’original [440].
Toute prière suppose donc deux conditions : « déjection », ou confusion sur ses fautes, et « fiance », abandon inconfusible en la bonté de Dieu [441]. Elle comprend deux parties : la confession des péchés et la profession de foi, qui sont l’avers et le revers de la même médaille. La confession hyperbolique et abstraite de la misère humaine doit confirmer le croyant dans une confiance absolue dans la seule miséricorde divine. Dieu est tenu d’aider le fidèle, ni plus ni moins qu’il n’a exaucé Pierre ou Paul, ou tout autre saint. La même loi uniforme, les mêmes promesses de la pitié divine entraînent pour tous les mêmes conditions dans la faveur égale du Père. La dialectique s’évertue, ici encore, à confondre les extrêmes du repentir et de l’union divine, comme elle parvient ailleurs à identifier la mentalité du Nouveau et celle de l’Ancien Testament, le péché et le pardon, le mépris et l’amour du prochain. Ainsi la prière privée et la prière publique se rejoignent : toute prière, en effet, doit être publique, en demeurant toutefois privée, c’est-à-dire parfaitement claire et intelligible pour chacun, comme une autre forme de prédication. Il sera d’ailleurs interdit d’aller prier au temple en dehors des heures du culte et la pratique de dévotions personnelles, différentes du schème universel, sera poursuivie et punie.
Calvin reconnaît cependant que la prière ne devrait pas être une dissertation. Il entrevoit que tout l’homme, « toutes les parties du corps humain pourraient être expressives » : David a bien prié en dansant. Mais le sens du mouvement, des diverses formes d’expression visuelle, auditive, sensible, échappe à cet esprit nourri presque exclusivement de livres et de théories. Il sait aussi que le langage du cœur existe et que, dans la prière, la première place devrait lui revenir. Ce verbomoteur ne s’y arrête pas : il est trop pressé d’apprendre à ses fidèles, non pas comment faire oraison, chacun pour soi, et intimement écouter Dieu, mais comment emprunter le style même et le « formulaire » que notre Père céleste nous a donné... « En suivant la règle nous prions quasi par la bouche de Dieu », à condition, bien entendu, de comprendre le Pater comme le Réformateur l’explique [442]. L’eau vive est canalisée dans des formules toutes faites et il sera difficile aux auditeurs du ministre de la parole de puiser aux sources, prisonnières sous la glace de l’incessante discussion.
Il prie et fait prier avec quantité de citations bibliques qui, loin d’être méditées et approfondies pour elles-mêmes, n’interviennent que comme dans un plaidoyer, à titre d’arguments et d’ornements du discours. Le second plan de la solitude cordiale, du mystère, lui reste étranger. Le recueillement intérieur est menacé à tout moment par l’intrusion de la polémique et par le bruit des passions criardes. L’entretien suprême de Jésus avec son Père servira encore de prétexte à blâmer les cérémonies et les prières excessives et à rappeler la « règle perpétuelle [443] ». Vinet disait bien : « Prier n’est pas haranguer Dieu. » À Strasbourg, ces oraisons haranguées se répétaient quatre fois par jour !
La fréquentation continuelle de la Bible et sans doute aussi l’éducation chrétienne première, comme la piété hypertendue de l’école de Standonck, ont façonné l’esprit de Calvin à la prière régulière, sérieuse, fidèle. Le principe du calvinisme, que Dieu dispose de tout, ne l’incline nullement à s’abandonner au fatalisme paresseux, mais au contraire, à recourir en toute circonstance à celui duquel tout dépend, les biens naturels comme ceux de la foi. Il faut continuellement lui demander, sous condition, les faveurs temporelles et, avec une certitude absolue, la miséricorde et l’accomplissement de son vouloir inéluctable [444].
La prière étant, à ses yeux, le meilleur exercice de la foi (le fruit et la fille de la foi), il est bien entendu qu’un croyant priera. Ce n’est qu’une tautologie : croire c’est prier et prier c’est croire. Les fidèles ne pourront s’en passer. Et justement, comme avocat de ces « pôvres fidèles », Calvin excelle dans la direction des âmes éprouvées, persécutées. La foi est tellement liée à l’idée de lutte, de persévérance que rien ne semble profiter autant à l’esprit de prière que cette atmosphère de crise, que ce climat d’apocalypse qui distingue le siècle de Calvin. Admirable professeur d’énergie, il établit, avec une assurance unique, toutes les volontés défaillantes, tous les martyrs de sa cause, sur le roc inébranlable de la protection divine.
Le fidèle sera forcé de prier et toujours dans le même sens. Il est poussé à bout. Il a perdu ses images, ses croix, ses livres et objets de piété, ses dévotions, tout le symbolisme liturgique et sacramentel. Dans son sublime isolement, menacé de toutes parts par Dieu, par Satan et... par les Anciens, ne sachant littéralement plus à quel saint se vouer, en désespoir de cause, pourrait-on dire, il est mûr pour l’abandon. Faisant fi de tous les intermédiaires, Calvin « regarde surtout au but... la prière est bien pour lui la voie unitive par excellence... L’union à laquelle il nous achemine est une union toute morale... union de volonté essentiellement faite de consentement et d’acceptation, de soumission confiante devant la souveraineté de Dieu[445] ».
Trois incertitudes subsistent quant à la perfection de cette vie unitive. Que valent, dans ce système, cette idée simpliste que l’on se fait de Dieu, cette attitude forcée que l’on impose à l’homme et cet acheminement abstrait qui mène de l’un à l’autre ? Le but le plus haut dans la théorie n’est pas toujours le plus réalisable, ni même le meilleur. Dans la prière, il est moins question de viser le plus loin possible que de rejoindre efficacement une présence aimante. Calvin le sait :
« Les saints bégaient souvent en priant, mais ce bégaiement est plus agréable à Dieu que toutes les figures de rhétorique, tant belles et luisantes qu’elles puissent être [446]. » Sur le terrain des belles phrases luisantes, notre réformateur n’a guère de rival. Que n’a-t-il balbutié plus souvent à la manière des saints ! Son Dieu, sans s’abaisser, se serait rapproché davantage de lui et de nous ; son amour radieux nous aurait éclairé et convaincu beaucoup mieux de sa majesté infinie.
Les réformés, autour de Calvin, ont continué à prier familièrement, personnellement, en dehors de la récitation des psaumes et des cultes officiels ; mais n’est-ce pas plus en vertu du sens chrétien commun alors à tous les baptisés, que sous l’effet des exhortations et de l’exemple mystique du réformateur [447] ? Dans l’attitude touchante de certaines âmes, comme Idelette de Bure exhalant ses dernières prières, on a l’impression que le sentiment religieux doit faire des efforts pour se dilater, malgré le corset dans lequel le réformateur cherche à l’enfermer.
Racontant la mort de sa femme, Calvin s’étonnera de constater une chose, somme toute assez rudimentaire, qu’elle puisse prier sans se servir de formules toutes faites. Elle disait : « Ô glorieuse résurrection ! Dieu d’Abraham et de tous nos pères, depuis tant de siècles les fidèles ont espéré en toi. Personne n’a été trompé. Moi aussi j’attendrai. » Il est frappé de la force avec laquelle elle lançait ces invocations. « Elle ne le faisait pas en s’inspirant des paroles suggérées par les autres, mais d’après les pensées qu’elle agitait en elle-même, attestant ainsi en peu de mots ce qu’elle méditait intérieurement. » Sentant que la parole allait lui échapper, elle suppliait : « Prions, prions... vous tous priez pour moi... » Là-dessus, Calvin arrive ; il a encore le courage de lui faire un petit sermon : « Je lui parlai encore brièvement de la grâce du Christ, de l’espoir de la vie éternelle, de notre séjour terrestre, du départ. » Puis il se mit à prier. Mais le dernier souvenir consolant qu’il garde d’elle, c’est qu’elle écoutait avec attention l’exposé de sa doctrine [448]. Même au chevet de sa femme mourante, il semble encore plus soucieux d’endoctriner que de prier.
Il sera bien naturel, dès lors, que les prières officielles en usage à Genève portent cette empreinte oratoire et « protestante » [449]. Calvin reste « enseigneur » et pense à son public, même quand il se tourne vers Dieu pour prier. Les Opera Calvini ont retenu une quinzaine de ses prières « occasionnelles », dans lesquelles on s’attendrait à le voir parler avec Dieu à cœur ouvert. Les oraisons qui servent de conclusions aux commentaires du prophète Jérémie, sont un ingénieux et brillant exercice littéraire. Il résume en une seule période, balancée au goût des humanistes, l’essentiel de la doctrine enseignée pendant le cours et en profite pour inculquer, avec des variations verbales élégantes, les idées-forces dont vit le mouvement, le parti réformé : reconnaissance pour la Parole de Dieu, confiance dans l’élection, lutte sans défaillance [450]. Les savants éditeurs strasbourgeois, après en avoir donné bon nombre de spécimens, renoncent bientôt à retranscrire ces « prières », toutes différentes pour la forme, mais absolument identiques pour le fond : utpote ubique sibi simillimas [451].
Les soupirs du réformateur mourant sont encore d’un raisonneur : « Seigneur, tu me piles, mais il me suffit de savoir que c’est ta main [452]. »
Et cependant, cette tension cérébrale continuelle trouve sa revanche dans une estime exagérée de l’émotivité et des impressions fortes. La foi et la piété lui paraissent d’autant plus authentiques qu’il s’y mêle davantage de passion. Il se contente souvent d’une foi partisane, de l’adhésion aveugle au credo du parti : certitude massive d’une qualité religieuse douteuse. Dans son besoin de paroxysme, il revendique, contre les « canailles » catholiques, un sentiment notoire et infaillible, une évidence physique et extérieure de la foi, pareille à celle que donnent les sens : il voit, il goûte, il touche la réalité de sa dévotion [453]. On peut le croire sur parole ; car il ne doit pas lui être difficile de se remettre sans cesse dans cet état d’émotivité factice. Il n’a qu’à reprendre ses lunettes sombres et répéter, par exemple, suivant la « forme des prières ecclésiastiques » : « Nous transgressons sans fin et sans cesse tes saints commandements... nous acquérons, par ton juste jugement, ruine et perdition... Toutefois, Seigneur, nous avons déplaisir... nous défaillons assiduellement... Qu’il te plaise de détourner ton ire de nous... de ne nous imputer point nos fautes... Quand nous voyons venir pestes, guerres et autres adversités, il nous faut reconnaître que Dieu est courroucé contre nous... Seigneur nous ne pouvons autre chose, sinon nous abattre et désespérer, comme si nous étions déjà en abîmes de mort... selon que nous sommes dignes, nous ne pouvons attendre que mort et damnation [454]... »
De ces impressions déprimantes, on passe sans transition à la plus grande assurance, en songeant qu’on est du parti de Dieu et qu’il défendra ses défenseurs : « Veuille donc avoir pitié de nous... nous sommes instruits de ta doctrine... veuille nous gratuitement pardonner... nous te prions... que tu sois Roi et Dominateur partout, conduisant ton peuple par le sceptre de ta Parole... confondant tes ennemis... que nous t’invoquions même du fond des enfers... il t’a plu de nous appeler à la connaissance de ton saint Évangile... nous délivrant de la maudite idolâtrie... singulièrement qu’il te plaise d’avoir l’œil sur ceux qui travaillent pour la querelle de la vérité.... etc. [455] »
L’objectif de Calvin, auquel il attribue d’ailleurs une importance théologique démesurée, c’est bien la « paix des consciences » : mais, pour l’obtenir, il n’a pas un grand choix de moyens : il faut en quelque sorte se surexciter, jusqu’à ce que cette autosuggestion spirituelle devienne instinctive et la certitude de foi définitive. « En l’oraison particulière, la langue même n’est point nécessaire, sinon d’autant que l’entendement n’est point suffisant à s’émouvoir lui-même [456]. » La ferveur dans laquelle se complaît ce sentimental refoulé sera, de préférence, d’un genre exclamatif et véhément : « ... aucunes fois les meilleures oraisons se passent sans parler, néanmoins souvent il advient que l’affection (la passion) du cœur est si ardente qu’elle pousse la langue et les autres membres » à gesticuler [457].
Évidemment, si, comme le pense Doumergue, la violence de la passion était une garantie de la parfaite sincérité spirituelle, on ne pourrait rien désirer de mieux que « l’ardeur et la véhémence de ce vouloir qui outrepasse tout ce que peut exprimer la langue [458] ». Mais surtout quand il s’agit de prière, on serait en droit d’attendre plus de sérénité, moins de déclarations outrées et plus de vrais sentiments de charité et d’oubli de soi. À quoi bon prêcher qu’en récitant le Pater, « il nous faut ôter volontairement de notre cœur, toute ire, haine, désir de vengeance... sans garder aucune malveillance contre personne... » si dans le même paragraphe on invective « ces nouveaux docteurs et follets... ces brouillons... sacrilèges... méchants... cruels... déloyaux [459]... » Peut-on s’approcher de l’autel pour faire une offrande, ou de Dieu pour prier, en nourrissant dans son cœur des sentiments de piété aussi « ardente » contre le prochain ?
*
* *
Ignace se situe dans un monde spirituel tout différent. Il est de ces « nouveaux docteurs », aussi vieux que le christianisme, qui ne craignent pas, en prêchant la perfection, « d’accabler les pauvres aces de désespoir [460] ». Là où Calvin voit un « commandement, une Loi » au-dessus des forces humaines et se transformant en malédiction à la moindre infidélité, Loyola découvre des possibilités indéfinies ouvertes aux âmes généreuses. Il s’applique efficacement à cette tâche, esquissée par Calvin et bientôt délaissée par lui : « Que l’âme soit vide de toute autre cogitation (opposée à l’amour de Dieu), que le cœur soit purgé de tout autre désir, que toutes les forces y soient appliquées [461]. » Loyola va le tenter, non pas immédiatement et tout d’un coup en s’armant d’une certitude infaillible, et en essayant de prier, sans analogie et sans préparation « comme avec la bouche de Dieu », mais en accordant l’instrument à l’action de la grâce, peu à peu, progressivement, en se dépouillant de son amour-propre, de ses « affections désordonnées » et en apprenant avec l’effort naïf d’un mystique les gestes, les actes, les sentiments parfaitement humains d’un enfant de Dieu.
Cependant l’entreprise d’Ignace de Loyola n’est-elle pas encore plus artificielle que celle de Calvin, commentant son « formulaire » et développant sentencieusement le « tableau » divin de la prière ? Comme toute méthode, les Exercices ont quelque chose de raide et de forcé au début. Mais cette discipline n’enchaîne pas l’esprit à une pensée étrangère. C’est avant tout la volonté qui est mise en demeure de se débarrasser de ses entraves et d’instaurer le plein « gouvernement de soi-même ». Programme ambitieux qui requiert l’esprit de suite, une tactique bien éprouvée. Il ne s’agit pas de « batailler au hasard » mais en sachant exactement à qui on a affaire et ce que l’on veut. Loyola connaît trop la stérilité des recommandations vagues. Ce n’est pas avec de beaux discours qu’on rend l’esprit capable de prendre son libre essor. Il faut le dégager du réseau de ses mauvaises tendances et l’habituer petit à petit à voler de ses propres ailes, « à se servir de sa liberté ». « Vous m’écrivez, dit-il à une religieuse, que vous trouvez en vous beaucoup d’ignorances, de lâchetés, etc. C’est là beaucoup savoir. Vous jugez que cet état provient de ce qu’on vous donne beaucoup d’avis, mais peu de déterminés. Je suis de votre opinion. Qui précise peu, comprend peu, et aide encore moins [462]. »
Une formule choquante revient invariablement au début de chaque exercice : petere id quod volo, « demander ce que je veux ». Avant chaque méditation, le retraitant demande à la Bonté infinie la grâce qu’il souhaite. Il ne suffit pas que la prière dirige et soutienne le bon vouloir. Cette volonté elle-même, avec tout son contenu, doit se changer en prière. La tension volontaire surnaturelle qu’on demande assure la confiance dans l’action divine et la parfaite droiture d’intention. Il faut non seulement vouloir un but avec énergie, mais surtout « laisser le Seigneur travailler immédiatement en soi-même », sans écran : dexe immediate obrar [463].
Tout art pratique exige pour commencer un entraînement sévère. Ce n’est qu’au terme de longs exercices qu’on peut s’attendre à voir les mouvements du nageur, du cavalier, du coureur, ou du soldat spirituel, devenir harmonieux et libres. N’importe quelle maîtrise se paie d’autant plus cher que l’exercice en est plus délicat : la maîtrise de soi, la maîtrise de l’esprit préconisée par Loyola, a le mérite sérieux de ne pas être facile. Aucun retraitant, d’ailleurs, n’est soumis à cette méthode si ce n’est de son plein gré. C’est le rythme personnel de chacun qui conditionne le nombre et la longueur, des épreuves, l’intensité avec laquelle chacun avance. Prières, conseils, examens, contemplations ne sont que « proposés » à titre facultatif. Le champ reste ouvert à toutes les autres possibilités (todo modo), à toutes les autres manières d’oraison, d’ascèse ou de discipline qu’il n’a pas indiquées. Loyola ne présente jamais sa méthode comme une « loi » inflexible, mais comme un ensemble de préparatifs dont il a expérimenté l’utilité avec beaucoup d’âmes ainsi introduites dans l’intimité du Seigneur.
Le chemin suivi par Loyola n’est d’ailleurs pas nouveau. Il n’est original que par le génie de la patience, le don d’observation et le discernement avec lequel il procède. Les Exercices parcourent trois étapes qui sont comme trois niveaux de la vie d’oraison : une période de purification de toutes les énergies humaines au service de la vie intérieure (vida purgativa) ; une période de transformation dans l’intimité de Notre-Seigneur (vida illuminativa) ; une troisième enfin d’union douloureuse et joyeuse avec le Christ qui, tour à tour, cache sa majesté pour se sacrifier à notre place, ou révèle sa gloire divine pour consoler ses amis. À tous les degrés, la conduite du Saint-Esprit est indispensable et son aide toujours plus nécessaire pour « disposer l’âme » à ne vouloir que ce que Dieu veut [464].
Mais il faut au préalable être parfaitement au clair sur les inspirations des divers esprits. C’est à dépister les subtilités du malin que les Exercices consacrent tant de précautions minutieuses, non seulement quand il est question de péché, mais surtout quand l’ennemi se joue d’une âme généreuse, en lui faisant miroiter de faux biens, en la captivant par un zèle illusoire, par le mirage de beaux sentiments « en la poussant toujours plus loin dans son sens propre [465] ». Loyola, optimiste jusque dans la défensive, a bien observé « la tactique générale de l’ennemi » avec les âmes de bonne volonté, moins astucieux « pour les faire tomber que pour les éloigner d’un meilleur service de Dieu et d’une paix meilleure ; suscitant des obstacles », comme de les tenir dans « une fausse humilité, ou de les jeter dans une extrême crainte, où elles s’arrêtent trop et s’occupent trop d’elles-mêmes [466] ».
Le monde intérieur exploré par Loyola est animé d’une vie multiple. C’est là le vrai champ de bataille du règne de Dieu contre l’ennemi de la nature humaine « qui n’a cure ni de dire vrai, ni de mentir, mais seulement de nous vaincre ». C’est une discussion qui met aux prises trois interlocuteurs, trois esprits. Si le débat est serré, même avec l’ennemi, il ne dégénère pas en dispute : « Si le démon parle de justice, moi, je parle de miséricorde ; si lui de miséricorde, moi, au contraire, de justice. Ainsi devons-nous cheminer pour éviter le trouble. Que le moqueur soit finalement moqué... Si l’ennemi nous élève, abaissons-nous, racontant nos péchés et nos misères. S’il nous abaisse et nous déprime, relevons-nous par la foi véritable et l’espérance dans le Seigneur, nous remémorant avec quel amour et quelle volonté il nous attend pour nous sauver. »
Ce « discernement des esprits », cet art de la clairvoyance ne représente qu’un aspect du vaste dispositif qui doit envelopper toute la retraite dans une ambiance de prière. Le contrôle des activités corporelles et de la sensibilité, du conscient et du subconscient, les attitudes, les associations, le régime de table et le sommeil, le décor et, à plus forte raison, la concentration des facultés supérieures, tout peut servir ou desservir le cœur à cœur de l’oraison.
Ces efforts réunis ne sont encore que des préludes à la prière, des attentions, des égards envers la Liberté de Dieu. Car la prière est, avant toute chose, Son intervention propre. « Quand les bonnes et saintes inspirations s’introduisent en nous (et nous devons leur ouvrir à deux battants les portes de notre âme), il n’est pas nécessaire de manier tant d’armes pour vaincre l’ennemi... » Loyola dit encore à François de Borgia : « Gardez d’ailleurs votre âme dans le calme et la paix, et prête à tout ce que le Seigneur voudra opérer en elle. Sans doute aucun, c’est plus haute vertu pour l’âme et meilleure grâce de Dieu, de pouvoir jouir de son Seigneur en divers offices et en divers lieux et non pas dans un seul (l’oratoire) [467]. » Les étudiants de l’Ordre veilleront à « chercher la présence de Dieu en toutes choses, dans les conversations, les promenades, en tout ce qu’ils voient, entendent, goûtent, et finalement dans toutes leurs actions, puisque sa divine Majesté est véritablement partout, par sa présence, sa puissance, son essence. Cette manière de méditer, en trouvant le Seigneur en toutes choses, est plus facile que de s’élever à la considération des choses divines plus abstraites [468] ».
Chacun peut envier cette liberté d’esprit que donne « la contemplation » ignacienne. La vie devient simultanément prière et service des hommes. Car « la dévotion n’est pas plus grande dans un acte de charité ou d’obéissance que dans une méditation, puisque tout est fait par amour du Seigneur, du moment qu’on ne peut pas douter d’être d’accord avec la volonté de Dieu [469]. » Ignace réalise l’idéal de Newman : « Religieux le matin, à midi et pendant la nuit. Sa religion est un caractère, une forme qui anime intérieurement toute sa pensée et son action... Il voit Dieu en tout et mesure tout à la volonté de Dieu. »
Cette prière obéissance n’a rien d’une soumission tremblante à une loi immuable ; c’est un échange d’amitié : « Dans la mesure où quelqu’un s’attache toujours plus à Notre-Seigneur et se montre plus généreux envers sa divine Majesté, dans la même mesure il se trouvera toujours mieux disposé à recevoir, jour après jour, des grâces et des dons de l’Esprit plus abondants [470]. » En effet, « pour ceux qui aiment le Seigneur sans réserve, toutes les choses deviennent un secours... pour s’attacher et s’unir toujours plus fortement à l’amour de leur Créateur et Seigneur, même si les créatures y faisaient obstacle [471] ».
Les obstacles ne sont qu’apparents. La prière et le service accordent le vouloir humain à l’action divine et réalisent « l’obéissance de la création » : l’harmonie cosmique, le rythme d’amour qui réconcilie toutes les parties opposées et l’ensemble de l’univers. « Telle est la manière par laquelle doucement la divine Providence dispose de toutes choses, dirigeant les choses inférieures par celles du milieu, et celles-ci par les plus hautes vers leurs fins propres [472]. » Cette obéissance contemplative équivaut à une liturgie, à un service divin. En montant jusqu’à l’homme et en le dépassant, l’ordre total doit devenir toujours plus spirituel, plus libre. Ainsi, au niveau supérieur de ce concert, les anges déployent la plus grande activité au service des hommes, sans jamais perdre Dieu de vue. Tel est aussi le secret ignacien pour s’établir dans l’harmonie, dans la « plus haute joie » : « Dans les œuvres entreprises pour le service de Dieu, Notre-Seigneur, il mettait en mouvement tous les moyens humains, y consacrant tous les soins et toute son attention, comme si tout le succès devait en dépendre. D’autre part, il s’abandonnait néanmoins à Dieu et se tenait soumis à sa Providence divine, comme si les moyens qu’il utilisait n’avaient pas eu la moindre importance [473]. »
Ainsi, après un mois de silence, le retraitant est censé capable de « contempler l’amour de Dieu » dans les activités de tous les jours. Les Exercices ne se ferment pas : ils ne sont qu’un point de départ. Commencés en vue de découvrir un plan de vie « inspiré par le seul amour de Dieu », ils ne sont encore, à la dernière page, qu’une offrande préparatoire : « Prenez, Seigneur et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Tout ce que j’ai et tout ce que je possède, c’est vous qui me l’avez donné. Seigneur, tout est à vous : disposez-en suivant votre bon plaisir. Donnez-moi seulement votre amour et votre grâce. Cela me suffit [474]. » Ignace ne demandait pas autre chose au seuil de la retraite : « Le retraitant gagne beaucoup a entreprendre ces exercices d’un cœur large et avec générosité envers son Créateur et Seigneur, lui offrant tout son vouloir et toute sa liberté, afin que sa Divine Majesté se serve de tout ce qu’il est et de tout ce qu’il a, selon sa très sainte Volonté. » Et c’est avec la disposition d’esprit qui a été inculquée sans cesse au début de chaque exercice que l’on passe de la retraite à la vie pratique : « Demander à Dieu, Notre-Seigneur, que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de Sa divine Majesté [475]. »
Après une bonne centaine de conversations amicales et familières avec l’Homme-Dieu des mystères évangéliques, le retraitant de Loyola retourne au milieu de ses frères les hommes, animé d’une bienveillance universelle, persuadé qu’on peut attendre beaucoup des bonnes volontés, si on cultive en elles ce qu’elles ont de meilleur. Vaut-il mieux leur donner l’obsession du pire ?
*
* *
Cérébrale et, par contrecoup, sentimentale ; radicale dans ses exigences théoriques et, par réaction, banale dans son uniformité bourgeoise, la piété de Calvin est celle d’un homme de tête, d’une tête chaude, capable de bien des excès. Elle est sans doute sous-tendue par une foi et un zèle ardents : elle veut absolument rendre au Christ la première place dans l’esprit et la vie des hommes. Mais toute théologique et disciplinaire, elle néglige trop l’amour, l’élan vital par excellence du christianisme. La spiritualité de Loyola, en revanche, éprouvée par un inlassable bon sens pratique, réalise une dévotion cordiale, c’est-à-dire le dévouement et l’offrande intime du cœur.
IV
DEUX ÉVANGÉLISTES
Calvin est « un homme de la Bible ». Sans être un philologue, au sens actuel du mot, il fut, sans contredit, un exégète, un grand commentateur de la Bible, le plus grand peut-être que la Réforme ait produit pendant des siècles. Loyola, au contraire, n’a rien d’un exégète. Il n’écrivit aucun commentaire de l’Évangile, mais il s’efforça de le revivre, sans glose et sans arrangement, comme une réalité actuelle. L’historien de la théologie catholique, Martin Grabmann, signale que « l’exégèse prit un essor si extraordinaire en Espagne et chez les jésuites, que, pour l’époque suivante, il ne restât plus grand’chose à faire, et qu’on pût pendant des siècles se nourrir des résultats acquis alors [476] ». Il n’est que juste d’attribuer une bonne part de cette renaissance à l’influence des Exercices. Ils ont, eux aussi, marqué le « siècle d’or de l’exégèse » ; ils ont inspiré le compagnon d’Ignace, Salmeron, et ses quinze volumes in-folio de commentaires sur le Nouveau Testament ; les études inlassables des jésuites, tels que le grand Maldonat et Tolet, qui gardent encore une importance actuelle, et surtout ces équipes « qui portèrent la connaissance de l’Écriture à la plus haute perfection », parmi lesquels on cite encore Jean de Pineda, Gaspard Sanchez, Bonfrère, Contzen, Bellarmin, Cornelius a Lapide, et toute la lignée ininterrompue des exégètes de l’Ordre.
Quand le jésuite Maldonat inaugura à Paris une méthode qui utilisait dans l’étude de la théologie biblique une sérieuse connaissance des sciences profanes et des langues orientales, les étudiants huguenots s’empressèrent de l’entendre. De même, bien des protestants goûtèrent l’exégèse édifiante et consciencieuse de Cornelius a Lapide. Quel commentaire biblique de Calvin un catholique pourrait-il lire sans être blessé ? Calvin est un savant dont la science biblique se dresse comme une barrière que les disciples n’oseront guère franchir. Loyola n’est pas un savant, mais sa compréhension et son amour des valeurs positives ouvrent la porte aux mille recherches de ses compagnons.
Les Exercices sont une réponse anticipée à l’accusation de la Réforme déclamant contre l’ignorance de la Bible par les catholiques. Simple initiation évangélique, ils opposent sans le savoir, avant de subir l’influence des controverses, la vie réelle de Jésus, son enseignement pratique, au biblicisme théorique des novateurs. L’étude philologique de la Bible dans les écoles catholiques de France et d’Espagne a devancé son utilisation partisane par les théologiens réformateurs. H. Naëf nous montre, dans l’ancienne Genève, des types de chrétiens évangéliques, telle la mère abbesse des Clarisses « sçachant bien la saincte escriture » et la méditant sagement dans son cœur [477]. La Bible avait été répandue dans le peuple avant la Réforme. Entre 1450 et l’avènement de Luther, on compte en Allemagne dix-sept éditions différentes de la Bible en allemand. Le succès de compilations du genre de Ludolphe le Chartreux, en Espagne, est de bon augure. La « Grande Vie de Jésus-Christ » dont se servit le soldat Loyola, sur son lit de convalescence, nous suggère déjà que les chrétiens les moins fervents, à cette époque, n’étaient pas réduits aux seules « idolâtries papistes des images, indulgences, etc. ». À condition qu’elle fût reconnue fidèle, complète et authentique, la Bible n’a jamais été interdite, comme on le répète trop souvent [478].
Dans les différents pays d’ailleurs, les premières recherches bibliques savantes ont été l’œuvre de catholiques que la Réforme essaya vainement de tirer à elle, tels que Lefèvre, Érasme. Il serait difficile de déterminer si la « Paracelsis » du prince de l’humanisme a eu une influence directe sur Loyola et sur ses compagnons ; toujours est-il que ce programme fut en partie réalisé par eux : « Le plus sûr moyen de rétablir et de consolider la religion est que les fidèles, par toute la terre, adhèrent pleinement à la sagesse du Christ, et qu’avant tout, ils apprennent à connaître la pensée de leur Maître, d’après les livres où la parole céleste vit et respire encore... Je souhaiterais que les femmes lisent l’Évangile, lisent les Épîtres de saint Paul, que le laboureur, que le tisserand les chantent à leur travail, que le voyageur se les récite pour oublier la fatigue du chemin.... la philosophie chrétienne est une vie et non une dispute, une inspiration plutôt qu’une érudition... la pure et simple doctrine du Christ se trouve avant tout dans l’Évangile et dans les Épîtres apostoliques. Ces livres seuls nous conservent sa vraie pensée ; nous y entendons sa voix, nous le voyons guérir les malades, mourir et ressusciter, si présent devant notre esprit que nous l’apercevrions moins clairement avec les yeux du corps [479]. »
Sur les routes, les compagnons prolongent le souvenir concret des évangiles. Leurs préférences vont au Nouveau Testament. Ils mettent tout en œuvre pour évoquer la présence vivante du Maître, pour retracer, dans la retraite, les moindres détails d’une existence chrétienne humblement identifiée à celle du Christ. C’est en 1515 déjà qu’Érasme, publiant son Nouveau Testament, adressait cette Paracelsis, non seulement aux savants, tels que Budé et Lefèvre, mais à l’ensemble de la chrétienté et à Léon X lui-même. En 1514, le cardinal Ximenès patronnait la première Polyglotte, celle d’Alcala, qui offrait le premier texte grec imprimé du Nouveau Testament. Pendant l’année et demie d’études disparates que Loyola parcourut en 1527 à Alcala, une grande dispute opposa les partisans d’Érasme et certains collaborateurs de la Polyglotte comme Zuniga. Il est impossible que le pèlerin studieux n’en ait pas été impressionné.
Peu soucieux d’originalité et d’érudition, Loyola penche vers une connaissance spirituelle, intérieure de l’Évangile. Il dépend trop de la tradition pour se piquer de vaine curiosité. Il est rassuré de se savoir en bonne compagnie parmi ceux qui « sentent avec l’Église », avec les Bernardin, les Bonaventure, les Thomas, les Cisneros et surtout avec Thomas a Kempis. On ne dira jamais assez tout ce qu’il doit à « l’Imitation de Jésus-Christ » [480]. Elle domine, sinon la structure, du moins la mentalité « évangélique » des Exercices. Elle leur fournit les éléments ascétiques et mystiques, les notions « d’affections désordonnées », l’estime du silence, de la solitude, de la vie intérieure, de l’abnégation, de l’humilité, de l’obéissance, des conseils évangéliques. Elle suit un peu la même progression qui va des considérations sur le péché, le repentir, la mort, le jugement, le changement de vie, jusqu’à la docilité à l’appel de Jésus, à son amitié « sur la voie royale de la croix » et enfin à l’amour de Dieu en tout et par-dessus toutes choses. Faut-il l’ajouter ? Loyola organise toutes ces matières avec un sens pratique beaucoup plus rigoureux et oriente plus nettement tous les efforts vers l’apostolat.
Mais c’est surtout dans l’étude de l’Évangile que Loyola s’inspire de l’Imitation. Rien ne sert « d’étudier la Bible en surface (scire exterius)... La vérité parle au-dedans, sans bruit de paroles... C’est dans le silence et la tranquillité que l’âme progresse et apprend les secrets de l’Écriture. ...Que ce ne soit pas Moïse ou quelqu’un des prophètes qui me parle, mais parlez-moi plutôt, vous, Seigneur, vous qui inspirez et éclairez les prophètes. Ils peuvent faire résonner des paroles, mais ne donnent pas l’esprit... ils agissent à l’extérieur, mais vous, vous instruisez les cœurs et les illuminez... Si tu savais toute la Bible par cœur... à quoi cela te servirait-il, sans l’amour et sans la grâce ? Notre curiosité nous gêne souvent dans la lecture des Saintes Écritures... Si tu veux progresser dans leur connaissance, lis humblement, simplement, fidèlement ; et ne te mets jamais en peine d’avoir le nom de beaucoup savoir..., etc. [481] » On disait de Loyola qu’il était une Imitation en acte, tant il la lisait et la citait, tant cette mentalité l’avait pénétré.
Il a vécu de ces recommandations et les a soigneusement transmises aux siens. Pour bien comprendre l’Évangile, il faut le lire avec l’esprit de celui qui l’a annoncé. La quantité des textes importe peu. Elle peut encombrer plus qu’aider, s’ils n’ont pas été approfondis avec assez de patience. Loyola cite parfois, de mémoire, des passages de l’Écriture, naturellement, comme on respire. Mais il ne pense pas qu’une vérité, pour être garantie, doit comporter plusieurs références bibliques. Il insiste sur la docilité à l’esprit de Jésus et s’applique à réduire au minimum les distractions et les préoccupations profanes. Cette sobriété et cette discrétion ont permis à l’Évangile d’exercer l’action la plus directe et la plus profonde. « Certaines pages qui ont eu sur les décisions et sur la vie d’une multitude d’âmes une influence hors de pair, demeurent ternes. D’autres, qui ont suscité nombre d’enthousiastes avides d’être humiliés et de souffrir comme Jésus, pour Jésus, avec Jésus, présentent tout juste l’éclat d’une flamme naissante... Ainsi en va-t-il, à plus forte raison, des maximes évangéliques : Bienheureux les pauvres en esprit ! bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice... Suis-moi !... Si quelqu’un m’aime, moi aussi je l’aimerai et me manifesterai à lui [482]... »
Ces textes connus, les expressions usées ou gauches des « mystères », se raniment comme par enchantement dans le cœur à cœur de la retraite. En conjurant son ancien confesseur d’Alcala et de Paris d’en faire l’essai et de « s’y mettre », Loyola, pour une fois, devient pressant et prometteur : « Si jamais vous veniez à vous en repentir, outre le châtiment que vous voudriez bien m’imposer et auquel je me soumets d’avance, tenez-moi pour mystificateur des personnes spirituelles à qui je dois tout... Je vous en supplie, deux, trois et autant de fois que je le puis... afin que finalement sa divine Majesté ne me demande pas pourquoi je ne vous ai pas conjuré de toutes mes forces. Ces exercices sont le meilleur de tout ce que moi, en cette vie, je puis penser, sentir et comprendre, pour mettre un homme à même de profiter personnellement, comme aussi de porter secours, aide et avantage au prochain [483]. »
Quand les réformés disent « rien que l’Évangile », souvent ils signifient « rien que l’Institution ». Lorsque Loyola semble affirmer « rien que les Exercices », il débouche en plein sur l’Évangile. Que veulent-ils en fin de compte, sinon amener le fidèle « à goûter intérieurement les réalités d’une histoire racontée le plus sobrement et fidèlement possible, afin que chacun trouve lui-même » l’esprit de Jésus. Car « c’est une conduite pleine de péril de vouloir mener toutes les âmes à la perfection par le même chemin. Qui agit ainsi ne comprend pas combien variés et multiples sont les dons du Saint-Esprit... Pour chacun cette part est la meilleure dans laquelle Dieu se communique davantage [484]. »
Les Exercices ne sont que cela : un entraînement pratique à l’imitation évangélique du Christ. C’est surtout au sortir de la retraite que Loyola espère voir son homme s’engager profondément dans la découverte progressive de l’Évangile. « Il n’est question ici, disent les Exercices, que de donner une sorte d’introduction et de méthode, afin de pouvoir dans la suite contempler mieux et plus complètement [485]. » Malgré la recommandation de « garder exactement l’ordre dans lequel ils ont été proposés », cette maïeutique chrétienne suppose une vivante souplesse. Le directeur de la retraite s’efface derrière le Saint-Esprit, qui, lui, pose les questions et conduit les « entretiens affectueux », les « colloques » où se joue toute la partie. Pour continuer un jeu de mots de Pinard de la Boullaye, nous dirions que cette initiation à l’Évangile est « un seul à seul avec Dieu, qui se transforme peu à peu en tête-à-tête, pour finir en cœur-à-cœur [486]... ».
Loyola ne fut ni professeur d’Écriture Sainte, ni même prédicateur : le jeune Ribadeneira se décourageait à corriger toutes les fautes d’italien qu’il faisait. Cependant les témoins qui observent le maître des Exercices sont frappés par cette caractéristique : « Ce saint homme médite continuellement la Sainte Écriture [487]. » Et ses vrais disciples ont appris, dans les Exercices, à aimer l’Évangile pour lui-même, sans visées apologétiques ou polémiques. « N’ayant plus l’esprit partagé entre de multiples objets, mais donnant toute son attention à une seule chose, à savoir le service de son Créateur et les progrès de son âme, (le retraitant) usera de ses puissances naturelles plus librement, pour chercher avec soin ce qu’il désire avec tant d’ardeur. » Dans les cinquante et une scènes évangéliques proposées à sa contemplation, le retraitant évitera de chercher la confirmation d’idées personnelles : mais il assistera et participera activement au drame, pour lui contemporain, de l’Incarnation, de la mort et de la Résurrection du Sauveur.
*
* *
L’Institution chrétienne tient-elle la promesse qu’elle fait d’introduire le lecteur au cœur de la Bible et de l’Évangile ? « Ceci est l’essentiel et la somme de tout ce que le Seigneur nous offre et nous promet par sa sainte parole ; c’est la limite qu’il nous a fixée dans ses Écritures, c’est le but qu’il nous a proposé [488]. » Elle est bien une clef très pratique, non seulement pour ouvrir la Bible et la Réforme, mais aussi pour fermer tout ce qui ne s’accorde pas avec cette « révélation ».
L’autorité du réformateur manque de base. Ou bien la Bible se suffit à elle-même, comme on le répète, et elle se présente avec la clarté évidente qui éblouit parfois Calvin : « L’Écriture a de quoi se faire connaître... comme ont les choses blanches ou noires de montrer leur couleur, et les choses douces et amères de montrer leur saveur [489]. » Oui, mais alors on ne voit pas pourquoi il faut tant parler, prêcher, écrire, mobiliser toutes les influences politiques et disciplinaires pour contraindre les fidèles à regarder la lumière du jour. Ou bien elle ne suffit pas, elle est pleine de mystères : et on ne s’explique pas non plus comment la virtuosité d’un amateur de génie a pu les dissiper tous en un clin d’œil.
La conclusion du professeur Wendel semble bien devoir s’imposer : « La vérité oblige à dire franchement qu’en dépit de sa fidélité à la Bible, (Calvin) a peut-être plus souvent recherché dans les textes scripturaires de quoi étayer une doctrine acceptée d’avance, qu’il n’a fait dériver cette doctrine de l’Écriture... ses précurseurs, même depuis la Réforme, n’avaient pas agi autrement... il lui est arrivé de faire violence au texte biblique. Son principe de l’autorité scripturaire le conduit alors à chercher dans l’Écriture des appuis illusoires, au moyen d’interprétations purement arbitraires. Ici intervient vraisemblablement le souvenir de ses études juridiques... À force d’ingéniosité (les juristes) en venaient à faire dire à leurs autorités à peu près ce qu’ils voulaient et qui n’avaient souvent que bien peu de rapports avec la pensée de l’auteur [490]. »
Les catégories juridiques, telle que la potestas absoluta, le princeps legibus solutus, la justice et la vengeance divine, priment les vérités religieuses. C’est avant tout le droit qui fournit à Calvin le fondement de son autorité, la base de son Église. « C’est à partir du jour où les Ordonnances furent acceptées que Monsieur Calvin devint Maître Calvin [491]. » Il n’y aurait pas eu, à son avis, de véritable Évangile à Genève, s’il n’avait pu, préalablement, y imposer sa discipline. « Quand je vins premièrement en cette Église, il n’y avait quasi comme rien. On prêchait et puis c’était tout. » Dans ses propres prédications, comme dans son enseignement théologique, « dans l’argumentation de ses discours, comme dans le gouvernement de Genève, il prouve combien il a profité aux leçons de Pierre de l’Estoile et d’Alciat [492] ».
La première Institution reflétait déjà suffisamment la mentalité particulariste du peuple hébreu, pour que, en 1543 l’exégète de Wittenberg, Aegidius Hunnius, ait dû relever ce caractère étrange : « Calvinus judaisans » [493]. C’est que l’Ancien Testament exerce effectivement une attirance excessive sur l’esprit du réformateur. Les amplifications des éditions suivantes, jusqu’en 1559, ajouteront plus de matière et de volume que d’idées nouvelles. Les savants éditeurs des Opera ne peuvent que constater cette utilisation uniforme de la Bible aux fins du plaidoyer moralisant : « ...presque à chaque page, même à chaque verset, l’auteur tombe dans les allures de la prédication », quand ce n’est pas dans celles de la satire et de la récrimination [494].
L’unification des différentes parties de l’Écriture ne va pas sans un nivellement théologique peu sensible aux nuances. Rien ne ressemble à un commentaire de Moïse par Calvin, comme un commentaire de saint Jean ou de saint Paul par le même exégète. Le réformateur idéaliste veut faire remonter le christianisme vers la source la plus limpide. Il tend en définitive à ramener la religion d’amour à l’étiage du judaïsme primitif. Les rapports du chrétien avec le Dieu fait homme ne diffèrent pas des sentiments qu’Israël entretenait avec Yahweh. Cette fixité oblige à distinguer trop souvent entre les aspects essentiels et les côtés négligeables de la vie de Jésus. L’arbitraire s’en mêle et le Christ est déduit comme une idée, au point que l’Institution a pu être décrite, non sans raison, comme « une codification de la religiosité réformée qui, étant donné sa nature dominatrice, servit à Calvin d’instrument pour son besoin de dominer [495] ».
La Bible dont il croit rétablir l’exclusive autorité est surtout, pour lui, le Livre de la Loi. Le légalisme de l’Ancien Testament s’apparente d’ailleurs admirablement bien à son tempérament et à la forme de son esprit. Ses intuitions ne sont ni variées, ni originales, ni très profondes. « Le christianisme de Calvin, déclare le protestant F. Buisson, consiste en cinq ou six grandes vérités... Dieu est tout-puissant, donc l’homme n’est rien devant lui ; l’homme a péché, il n’est pas libre ; il est foncièrement mauvais, donc il ne peut aucunement se justifier par les œuvres ; la volonté et le bon plaisir de Dieu est le dernier mot de tout [496]... » Sa force réside dans la puissante organisation qu’il réussit à donner presque instantanément aux doctrines hétérogènes cueillies un peu partout à travers la forêt des écrits luthériens, nominalistes, bucériens, humanistes, à travers toute la longue tradition patristique et biblique.
Mais quels principes dominent ? En théorie, les thèmes scripturaires ont seuls droit de cité. Ils devraient tout commander. Dans la pratique, le réformateur qui prétend « ne parler de Dieu que par sa Parole », se promène en tous sens dans l’Histoire Sainte récitant un monologue et, faute de recueillement, ne découvre la voix de Dieu que dans l’écho de sa propre voix. Son égotisme est inconscient, mais d’autant plus difficile à dépasser. Il croit être fidèle aux sources quand il s’acharne contre Castellion et ses pareils, coupables seulement de vouloir étudier la Bible indépendamment de son exégèse. Il parle ex cathedra et, mieux que Pierre, il lie et délie et s’attribue une autorité supérieure à celle de l’Église, supérieure à celle des conciles, supérieure évidemment à celle du pape, qui lui se contente « de la même infaillibilité que celle de l’Église [497] ». À Genève et dans le mouvement réformé qu’il va diriger, il sera bientôt le seul interprète authentique de la Bible. « Ceux qui s’efforcent de maintenir la foi de l’Écriture par disputes pervertissent l’ordre » ; néanmoins, par quel autre moyen l’a-t-il maintenue contre Bolsec, Castellion, Ochino, Servet, Gentilis, Westphal et contre une multitude d’autres adversaires qui voulaient sincèrement s’en remettre « au témoignage intérieur du Saint Esprit ».
La Bible avait peut-être été, dans les premiers temps de sa diffusion par l’imprimerie et spécialement dans les premiers espoirs de l’Évangélisme français, un instrument de libération. L’engouement, alimenté aussi bien par la curiosité que par le mysticisme, représentait une réaction très saine contre le formalisme des théologiens, contre la raideur de l’Inquisition et le fanatisme des partis ou des écoles. Mais voici qu’au nom de cette liberté biblique, un logicien de génie, encore plus redoutable que tous les autres mis ensemble, s’empare, pour son compte personnel, de l’autorité morale la plus haute qui fût alors reconnue : l’Écriture. Et sous couvert de « présenter quelque sommaire par lequel les consciences fidèles soient admonestées de ce qu’il faut principalement chercher de Dieu aux Écritures, et soient adressées à un certain but pour y parvenir », il se livre à une exégèse violente et intransigeante [498]. Il se substitue entièrement au pouvoir de réflexion de ces « consciences fidèles ». Il ne leur laisse guère de place pour des convictions personnelles : tout est prouvé, démontré, réglé, de manière à couper toutes les issues au « libre examen ». Avec une éloquence supérieure et un ton menaçant, il impose ses propres préférences, ses opinions, les résultats d’un travail précipité, comme des conclusions immuables et définitives.
Le réformateur a trouvé sa foi, sa certitude religieuse subjective dans une certaine perspective biblique. Il n’entrevoit même pas, pour autrui, la possibilité d’arriver à la foi par un autre chemin : « Les pauvres consciences qui cherchent fermeté de la vie éternelle » ont besoin d’un fondement qui ne soit pas « a mercy et bon plaisir des hommes ». Or « la doctrine que les Apôtres et Prophètes nous ont laissée... a cette certitude devant que l’Église commence à venir en être [499] ». Il n’y a plus à discuter, ni à se demander si les Apôtres et l’Évangile ne seraient pas peut-être impensables en dehors de l’Église, si la révélation isolée de l’Église s’impose avec l’évidence qu’on lui prête... « Je réponds que le témoignage du Saint Esprit est plus excellent que toute raison... Par quoi il est nécessaire que le même esprit qui a parlé par la bouche des prophètes entre en nos cœurs et les touche au vif pour les persuader... Ainsi que ce point soit résolu, qu’il n’y a que celui que le Saint Esprit aura enseigné qui se repose en l’Écriture en droite fermeté... elle commence lors à nous vraiment toucher, quand elle est scellée en nos cœurs par le Saint Esprit. »
C’est une « vérité inexpugnable » dont le prophète est « très certain », même si les raisons valent moins pour l’intelligence et le jugement que pour l’émotion : « C’est donc une telle persuasion laquelle ne requiert point de raisons... c’est un tel sentiment qu’il ne se peut engendrer que de révélation céleste. » Cette passion émotive ébranle un dynamisme tout extérieur et cérébral : le point de départ est une piété sentimentale et trouble ; le point d’arrivée immédiat, un système abstrait, accessible aux seuls élus. « Par-dessus tout jugement humain nous arrêtons indubitablement que (l’Écriture) nous a été donnée de la propre bouche de Dieu, par le ministère des hommes, comme si nous contemplions l’essence de Dieu en icelle... Il ne se faut ébahir de voir tant de stupidité et de bêtise au commun peuple... j’appelle commun peuple les plus expers et avancés, jusques à ce qu’ils soient incorporés dans l’Église... » Le « petit nombre de croyants » ne fait pas de difficulté : « Les mystères de Dieu ne sont compris que de ceux auxquels ils sont donnés [500]. »
Voyons de près comment le « commun peuple » fait place au peuple élu, comment on est incorporé dans l’Église et la théocratie.
_______
TROISIÈME PARTIE
DEUX CHEFS, LEURS LUTTES, LEURS AMITIÉS
Le chef de parti et le chef de compagnons
_______
CHAPITRE PREMIER
Calvin chef de parti
_______
I
COUPS D’ESSAIS À GENÈVE
Calvin a vingt-sept ans. La silhouette longue et maigre, le visage pâle, la santé déjà atteinte [501], il paraît plus âgé qu’il ne l’est en réalité. Il vient d’arriver à Genève, précédé par la renommée de ses livres et par la réclame que lui font des amis enthousiastes. Foudroyé par la voix tonnante du tribun méridional Farel, il s’arrête épouvanté et exalté tout à la fois, à la perspective des faciles triomphes que la Suisse réservait au parti réformé. Avec l’appui militaire de Berne, pressés de prendre la succession de la maison de Savoie, les agitateurs évangéliques avaient rapidement exploité, au profit de la Réforme, la révolution politique destinée à soumettre les pays romands [502].
Dans ces transformations sociales à peine ébauchées, toutes les chances s’offraient de jouer un rôle de premier plan : le prestige de Calvin, comme apologiste de la Réforme, comme diplomate et homme d’action, était reconnu par des hommes aussi considérables que Bucer et Capiton [503]. Le « lecteur en la Sainte Écriture », dont la foule connaissait à peine le nom, a tôt fait de séduire et d’envoûter son aîné Farel, qui, après s’être distingué comme meneur de disputes dans des villages et des bourgades de moindre importance, perdait pied au milieu des intrigues un peu plus subtiles d’une ville épiscopale. Au « bonhomme Farel », avec lequel « tout était en désordre », aussi habile à déchaîner les passions que maladroit dans l’organisation des idées et des institutions, le juriste génial de Noyon apporte l’appui inappréciable d’une doctrine cohérente, des schèmes disciplinaires, podagogiques, capables de sauver son autorité [504]. À l’ombre du missionnaire démagogue et en son nom, Calvin agit en silence, rédige le projet d’Articles pour le gouvernement de l’Église, le catéchisme, une confession de foi. Pour donner un peu plus de dignité et de force aux disputes religieuses, il prête au tribun exalté des idées claires et des arguments solides, des vues d’ensemble, une théologie [505].
La Dispute de Lausanne (1-8 oct. 1536) nous montre sur le vif à quoi tenait l’autorité de Calvin, en même temps qu’elle nous révèle avec quelle incroyable rapidité les conversions se décidaient collectivement à cette époque. Laissons Doumergue entonner ce péan de victoire :
« Le jeudi 5 octobre, Calvin n’avait encore rien dit... un catholique... reprochait aux ministres de mépriser les anciens et saints docteurs. Alors Calvin se lève, avec sa terrible ironie et sa science étonnante. Il affirme que souvent les catholiques « ne les ont pas en si grand honneur que nous, et ne daigneraient employer le temps à lire leurs écrits, que nous y employons volontiers. Comme se pourrait prouver, non pas à vous, mais à un qui serait un peu plus exercité ». Et immédiatement il se met à citer et expliquer les opinions de Tertullien, une homélie attribuée à Chrysostome, « la XIe homélie environ le milieu », un passage de saint Augustin, « en l’épître XXIIIe, bien près de la fin »... un autre « sus le psaume 98 »... un autre « au commencement de quelque homélie sur l’Évangile s. Jean, environ le 8e ou 9e, je n’en ai pas la mémoire certaine... » un autre « de fide ad Petrum Diaconum (combien qu’on doute si c’est de lui ou de quelque autre ancien... Finalement de l’épître à Dardanum, laquelle est assez ample et longue... » « Tout cela de mémoire ! » s’exclame Doumergue [506].
Pour apprécier à sa juste valeur cette « admirable connaissance des Pères », il faut cependant remarquer que si Calvin attendait depuis quatre jours l’occasion de prendre la parole, il ne s’était vraisemblablement pas contenté d’invoquer le Saint-Esprit pendant tout le temps qu’on lui avait laissé de prévoir les objections et de préparer les arguments. La Dispute avait soigneusement été orchestrée d’avance. De plus, cette magnifique riposte n’a pas été sténographiée. Entre « l’improvisation » de 1536 et le texte du discours revu et peut-être refait en 1548, les admirables citations patristiques ont pu subir une certaine mise au point, qui n’avait rien pour choquer la conscience littéraire de Calvin, peu scrupuleuse dans l’emploi des moyens de propagande. D’ailleurs, en publiant ces discours arrangés tardivement, les Éditeurs des Opera se refusent à les attribuer sans restriction à Calvin [507].
Si ce texte ne prouve nullement que Calvin possédait par cœur la littérature patristique, il atteste, en tout cas, le fait que le parti réformé avait trouvé un plaideur incomparable, prédestiné pour ces joutes oratoires où il est beaucoup plus question de frapper vite et fort, que d’établir patiemment la vérité objective. C’est à qui surprendra l’adversaire par son habileté dialectique et persuadera la foule par quelque tour d’éloquence. La victoire était d’autant plus facile pour les novateurs, que les Messieurs de Berne et de Lausanne avaient déjà pris toutes leurs dispositions en vue de la suppression du culte catholique, et que le clergé tant régulier que séculier s’abstint, faisant appel aux seuls juges compétents, à l’Église et au concile qui devait se réunir l’année suivante [508]. L’intervention occasionnelle d’un religieux réussit bien à tenir en échec Viret lui-même et à montrer que des questions aussi vastes ne se décident pas par des efforts de voix et des pétitions de principes. Mais, après avoir affirmé l’autorité de l’Église et de sa Tradition, Dominique de Montbouson ne pouvait que se rallier à l’attitude des chanoines et de ses confrères dominicains : se retirer en protestant que le problème était mal posé et niait d’avance l’essentiel du catholicisme.
Il était impossible pour des prêtres catholiques de se prêter à ce « simulacre de combat », de comparaître devant un tribunal de la foi présidé par des magistrats bernois et des laïcs, de participer à une sorte de « meeting contradictoire », condamné expressément par les autorités religieuses et politiques les plus hautes : par l’évêque et l’empereur. « L’issue de la dispute ne pouvait être douteuse pour le gouvernement bernois, dont la décision était déjà prise [509]. » Les « conclusions préparées par Farel et ses amis, pour être disputées à Lausanne, nouvelle province de Berne » obtinrent une « victoire facile contre des adversaires beaucoup moins bien préparés à la lutte », ou plutôt inexistants. Car, c’est à peine si quelques laïcs indignés, ou quelques vicaires, se risquèrent à improviser des objections mal formulées dont les tribuns de la Réforme triomphèrent à grand bruit [510].
La dispute tourna à la prédication unilatérale des thèses réformées. « Le trépied d’élite » manifestait sa puissance. Farel, Viret, Calvin s’étaient bien distingués comme agents de Berne. Il n’y avait plus qu’à attendre un décret de l’ambitieuse république alémanique, qui, ne pouvant s’appuyer sur une communauté linguistique ou culturelle, avait d’autant plus hâte d’unifier les Romands sur le plan religieux. Mais la force ne sait unifier qu’en nivelant : les Vaudois qui ne voulaient pas encourir « la male grâce et griève punition de Berne », devaient « sans dilation abattre toutes images et idoles, aussi les autels étant dans les dites églises et monastères ». C’était, au nom de l’Évangile, soumettre l’art religieux de la Suisse romande au vandalisme et au pillage [511].
Dans son enthousiasme devant les beaux résultats de cette spoliation, Calvin écrit à son ami Daniel : « Je conçois que le bruit de ces disputes ait été répandu au loin, en sorte que quelque brise n’aura pas manqué de parvenir jusqu’à notre ville... Déjà en beaucoup d’endroits on commence à renverser les idoles et les autels, et j’espère que bientôt tout ce qui reste encore soit aboli. Le Seigneur fasse que l’idolâtrie soit aussi ruinée dans les cœurs [512]. » Il est étrange qu’un homme aussi intelligent, redevable à la Renaissance catholique du meilleur de sa culture, non seulement ne déplore pas cette barbarie religieuse, mais l’encourage de tout son cœur : « J’espère bientôt que tout ce qui reste soit aboli. »
Calvin n’a probablement brisé de ses mains ni statue, ni vitrail, ni ostensoir ; mais son système aura plus d’influence pour stériliser l’art religieux que les violences iconoclastes. Le plus urgent, à ses yeux, c’est l’épuration de la doctrine, que suivra automatiquement la correction des sentiments et des mœurs. Vuilleumier reproche aux catholiques d’avoir montré, dans cette Dispute, « une notion de la foi dénaturée... purement intellectuelle ; croire c’est “tenir son credo” [513] ». C’est dans les mêmes termes qu’on pourrait parler des préoccupations religieuses de Calvin prenant en mains la Réforme de Genève. Il est pressé de dicter les normes d’une nouvelle orthodoxie, de légiférer et d’imposer un credo qui ne doit même pas être un « acte purement intellectuel » d’adhésion, mais une formule extérieure sur laquelle on peut faire passer des examens à tout le monde.
Le premier souci de Calvin, c’est qu’« on n’a point encore discerné quelle doctrine un chacun tient, qui est droit commencement d’une Église [514] ». À Lausanne, Calvin a sans doute admiré tout ce qu’on pouvait obtenir des consciences par l’emploi d’une politique ferme et expéditive. Cependant la mainmise des conquérants civils sur toute la vie publique religieuse et morale, l’exploitation des biens ecclésiastiques par ces Messieurs de Berne, n’était pas de son goût. L’autorité de la parole qui avait si merveilleusement servi l’autorité politique nouvelle, pouvait-elle continuer à se soumettre docilement ? Au contraire, au point de vue d’une vraie réforme, du « droit commencement d’une Église », n’est-ce pas aux ministres de la pure doctrine que devait revenir la première place dans la cité, du moins pour tout ce qui, de près ou de loin, toucherait à la religion, à la morale, à la discipline ?
On songeait depuis quelque temps à Genève, au Conseil, que « des édits devaient être faits pour l’unité de l’État ». Les « prêcheurs » sont priés de soumettre un projet. Ce texte présenté au nom des ministres, en janvier 1537, montre assez quelle unité religieuse Calvin voulait imposer à l’État : « ... Pour le trouble et la confusion qui était au commencement en cette ville... il n’a pas été possible de réduire tout du premier coup à bon ordre, vu que même l’ignorance du peuple ne le pouvait porter. Mais maintenant qu’il a plu au Seigneur de un peu mieux ici établir son règne, il nous a semblé avis être bon et salutaire conférer ensemble... quelle police il serait bon de tenir ci-après [515]. » Cette police religieuse devrait se servir de la Cène comme instrument de contrôle et de contrainte.
« Nous avons délibéré requérir de vous, est-il signifié au Conseil, que votre plaisir soit ordonner et élire certaines personnes de bonne vie et de bon témoignage entre tous les fidèles... lesquels étant départis et distribués en tous les quartiers de la ville, aient l’œil sur la vie et le gouvernement d’un chacun, et s’ils voient quelque notable vice à reprendre en quelque personne, qu’ils en communiquent avec quelqu’un des ministres pour admonester quiconque sera celui lequel sera en faute... S’il ne veut pas entendre, il sera temps que le ministre le dénonce publiquement... s’il veut persévérer en la dureté de son cœur, lors sera temps de l’excommunier... et qu’il soit dénoncé aux autres fidèles de ne converser point familièrement avec lui. »
Des surveillants chargés de surprendre et de dénoncer les récalcitrants auprès des ministres ; ceux-ci juges de la doctrine, censeurs de la conduite de tout le monde : on pouvait difficilement imaginer un moyen plus économique de réaliser l’unité. Quiconque aura des idées trop personnelles, manifestera une indépendance quelconque dans les actes ou les croyances, sera soumis de force à un nouvel organisme, qui, malgré tous les titres évangéliques dont on le décore, s’apparente davantage à une « police de parti » qu’à une institution chrétienne primitive.
« Il y a encore plusieurs habitants en cette ville qui ne sont aucunement rangés à l’Évangile, mais ils contredisent tant qu’ils peuvent, nourrissant en leur cœur toutes les superstitions contrepetantes contre la parole de Dieu (c’est-à-dire contre les prêcheurs)... ce serait une chose bien expédiente de commencer premièrement à connaître ceux qui se veulent avouer de l’Église de Jésus-Christ, ou non. » Il s’agit d’établir au plus vite un monopole de la prédication et de la doctrine, de confisquer au profit de la nouvelle mystique partisane, toutes les valeurs chrétiennes, le Christ, l’Église, le règne de Dieu, de manière à tout résoudre en une alternative simpliste : « Que tous les habitants de votre ville aient à faire confession et rendre raison de leur foi pour connaître lesquels... aiment mieux être du royaume du pape que du royaume de Jésus-Christ. »
Nous voyons déjà percer ici « cette identification de soi-même avec Dieu », que l’orgueil de connaître la Bible développe, à un degré déplorable même aux yeux du panégyriste Doumergue : « Moi et Dieu, nous sommes un... Avec effroi nous entrevoyons les conséquences de l’interversion des rôles. Qu’arrivera-t-il en effet, si l’homme qui est l’instrument de Dieu fait de Dieu son instrument à lui ? Reconnaissons-le. Calvin n’a pas échappé à cette épouvantable infirmité humaine, et le secret de sa force est en même temps le secret de sa faiblesse... il a été un de ces hommes qui ont eu les raisons les plus nombreuses et (je le note, dit Doumergue), les plus extérieures de se sentir l’instrument de Dieu [516]. » Les vrais mystiques chrétiens ont beau tendre à l’union divine de toutes leurs forces, le sincère oubli de soi les met à l’abri de pareilles aberrations. À Genève, il faut bientôt se contenter d’écouter Dieu par le seul truchement des prêcheurs et ne s’approcher de Lui qu’en passant par eux.
Comme on le voit dans tous les pays où la Réforme réussit à pénétrer, le catholicisme renaissant relâchait assez la discipline pour qu’on pût parler d’une tolérance négative ; dans ce sens, du moins, qu’on laissait les indifférents tranquilles, qu’on permettait à chacun, en son for intérieur, de penser ce qu’il voulait [517]. Seule l’opposition qui se livrait au prosélytisme et menaçait l’ordre établi était l’objet de répression. À Genève, ce sont les consciences qu’il s’agit de recenser et de convertir de force. L’intolérance s’aggrave d’une violence intellectuelle ; elle ne respecte aucune conviction privée ; elle semble d’autant plus odieuse aux Genevois qu’elle est commandée par des étrangers, des aventuriers qui se sont accordé à eux-mêmes, contre la religion traditionnelle, toutes les audaces de la pensée et de l’action. Mais on a toujours tort contre la doctrine du parti. Contre elle, on ne saurait faire valoir aucun scrupule, aucune délicatesse de conscience.
Des hommes aussi dignes de respect que l’ancien syndic Balard en feront la triste expérience. Obligé de déclarer s’il tient la messe pour mauvaise, il répond avec candeur qu’il n’en sait rien et ne veut pas juger témérairement ; « je réponds que je crois au Saint Esprit, à la sainte Église universelle et ainsi que iceux la croient, je le crois... » Sommé de s’exprimer plus ouvertement, il répète vouloir vivre selon l’Évangile, « mais ne peux répondre à cela que je ne sais ». Une troisième fois, mis en demeure de condamner la messe ou de vider la ville avec sa famille, il répond : « Puisque le pouvoir du Petit et du Grand Conseil est que je dise que la messe soit mauvaise, je dis que la messe est mauvaise et moi plus mauvais de juger témérairement de ce que je ne sais ; aussi je crie à Dieu merci et renie Satan et toutes ses œuvres. » Ce n’est pas encore suffisant. Il doit se déclarer une quatrième fois : « Je le déclare derechef, je ne peux pas juger de ce que je ne peux pas entendre ni connaître, et puisqu’il plaît à Messieurs que je dise que la messe soit mauvaise, je dis qu’elle est mauvaise ; mais qu’on ne peut pas juger du cœur des hommes et l’Évangile dit que tout ce qui sera de Dieu demeurera et que ce qui sera contre Dieu périra. »
« Qui ne sympathiserait, ajoute Roget, en racontant ce procès, avec un brave et ancien syndic, qui ne se rend qu’après avoir défendu, pied à pied, les droits de la conscience ? Il nous paraît bien représenter le point de vue d’un bon nombre de Genevois de cette époque, qui ne pouvaient pas se passionner pour une conception dogmatique ou ecclésiastique [518]. » Le fanatisme continuera à déplaire aux anciens Genevois aussi longtemps qu’ils auront encore le droit de parler librement dans leur propre ville.
Contre leur « libertinage », c’est-à-dire contre leur goût profond de la liberté, Calvin met en ligne une arme terrible ; la Cène, mystère d’union et de charité, est en passe de devenir un redoutable instrument politique. Elle gagne en pouvoir de domination tout ce qu’elle a perdu de contenu mystique, de présence réelle. Se servant de l’excommunication avec tout l’entrain d’un Grand Inquisiteur, le ministre de la parole va dire son mot décisif dans toutes les affaires de la Ville. Ni les magistrats, ni les sujets ne pourront se dérober à son droit de regard. Le point de vue de Calvin était clairement exprimé dans le catéchisme : « Quoi que d’autres puissent penser, nous n’admettons certainement pas, pour notre part, que notre rôle soit défini par des limites si étroites, qu’une fois le sermon donné, comme s’il s’agissait d’une corvée, nous n’ayons plus qu’à nous reposer. C’est d’une manière bien plus directe et plus attentive que nous devons veiller sur ceux dont on nous redemandera le sang, s’il est perdu par notre faute [519]. »
Le rôle « direct » et universel qu’il s’attribue dans l’ordre de la Ville-Église, c’est celui d’un législateur et d’un juge suprême, qui se réserve le droit d’intervenir quand il le veut, d’évoquer à son tribunal toutes les causes publiques et privées : il est responsable du sang des fidèles. On le verra bien plus tard. En attendant, les hommes d’État de Genève, le Conseil qui prend le pouvoir le 3 février 1538, observent que « l’on doit avertir les prédicants que ne se mêlent point de la politique, mais que prêchent l’Évangile ainsi que Dieu l’a commandé [520] ». On envoie « quérir Calvinus touchant de certaines paroles qu’il a dit au sermon, que le conseil, lequel allait tenir était conseil du diable » ; après quoi « l’on a défendu à Me G. Farel et Me Calvinus de ne point se mêler du magistrat ».
La guerre était déclarée. Les prédicants auxquels on ne reconnaissait pas le droit de veiller, par le consistoire et l’excommunication, à la police des mœurs et de la doctrine, gardaient encore une tribune très favorable à l’agitation : la « chaire de vérité ». L’aveugle Couraud servait de porte-parole aux ministres indignés et criait, comme un sourd, ses vérités évangéliques. Il fallut plusieurs fois l’enfermer « pour méprisance de la justice » et lui interdire de prêcher « parce qu’il a blâmé le magistrat souventes fois... proférant que les gouverneurs avaient les pieds de cire, et qu’il pense du Royaume des cieux, ils croient que c’est royaume de grenouilles. Et plusieurs autres paroles trop longues à raconter, aussi en les appelant ivrognes [521] ». Calvin et Farel approuvent le prédicant et prennent sa défense auprès du Conseil de Berne. Mais il était difficile de jouer une ville contre l’autre, car les magistrats s’appuient justement sur l’exemple de Berne pour se libérer des exigences de Calvin.
Avant de se laisser embrigader définitivement, le peuple genevois protestait et se donnait de l’air. Bien des gens dont la polémique des réformateurs salira la mémoire, revendiquent, pendant qu’il en est temps encore, la liberté de conscience : « On ne peut nous forcer d’aller au sermon contre notre conscience », réclame le conseiller Balard. « Je veux vivre selon l’Évangile de Dieu, mais je ne veux point user selon l’interprétation d’aucuns particuliers, mais selon l’interprétation du Saint Esprit, par la sainte Mère Église universelle, en laquelle je crois. » Et combien d’autres auront crié avec Richardet : « Personne ne dominera sur nos consciences... Nous ne voulons pas être contraints, mais vivre dans notre liberté [522]. »
C’était une épreuve de force. Farel clame bien haut ses prétentions : « Sans moi vous ne fussiez pas ainsi [523]. » Le Conseil Général, qui n’a pas encore abdiqué toute pensée personnelle en matière religieuse, pense toujours qu’on peut suivre l’Évangile et faire son salut sans adopter l’ordre nouveau, la discipline ecclésiastique radicale, sans laquelle Calvin ne peut concevoir l’existence d’une Église. C’était « un fanatique de l’autonomie de l’Église », remarque Doumergue lui-même [524], c’est-à-dire que l’idée qu’il se faisait du ministre, de l’Écriture, de sa primauté, n’admettait pas de compromis. Du moment que l’on veut toucher à la prérogative essentielle, à son droit de censeur public et qu’il ne lui est plus possible de faire des remontrances, ni d’assister au Conseil Petit, ni aux Deux Cents, le véritable Évangile se considère comme entravé, et les ordres des magistrats ne doivent plus être obéis [525].
La révolte des ministres, parmi lesquels Calvin apparaît de plus en plus comme le meneur, ne pouvait se terminer que par l’expulsion : « A été totalement résolu par plus grand voix (à la majorité du Conseil Général) qu’ils voulaient vivre selon les cérémonies accordées à Lausanne... A été proposé aussi touchant de Farel, de Calvinus et autres prédicants, que n’ont point voulu obéir au commandement du magistrat... La plus grande voix a arrêté qu’ils doivent vider la ville dans trois jours prochains [526]. » Calvin reçoit le coup avec une assurance superbe : il ne sera jamais à court de déclarations sublimes : « Est bien, à la bonne heure ; si nous eussions servi les hommes nous fussions mal récompensés, mais nous servons un grand maître qui nous récompensera [527]. » Il saura toujours se raidir en face des adversaires, mais intérieurement, son chagrin est amer ; les sentiments qu’il nourrit contre eux et même contre des ministres bernois qui ne l’approuvent pas sur toute la ligne, mais qui s’expriment cependant avec amitié sur son compte, sont remplis d’un tel fiel qu’un ami de Bâle, Simon Grynée, est obligé de rappeler à Calvin que, s’il parle beaucoup de la Bible, il oublie l’ABC de l’Évangile : « Ce que tu écris, cher Calvin, est extrêmement violent. Ah ! Jésus-Christ ! qui nous donnera ce sentiment que nous soyons disposés à céder à un frère quelque chose de nous mêmes et de notre droit, lorsque le bien de toute l’Église le réclame... Ce n’est certes point le fait d’un cœur et d’un esprit chrétien d’être à un tel point incapable de supporter quoi que ce soit de la part d’un frère. Ô Jésus-Christ, nous aurons plutôt fait de disperser mille églises que d’en réunir une seule, si nous ne sommes pas prêts à cacher tous les défauts de nos frères. Où irons-nous, Calvin, si nous avons une si haute idée de nous mêmes, que nous pensons orgueilleux et injurieux quiconque ne nous accorde pas tout ce que nous exigeons [528]. » Et il conseille à Calvin d’imiter Farel, dont la « sauvagerie » se calme avec l’âge.
Comme il est difficile de lui suggérer que tout n’est pas nécessairement parfait dans sa doctrine et sa personne ! Avec quels ménagements du Tillet, Bucer, Zurkinden, Grynée, s’ingénient à prêcher la modestie au jeune maître. S’il daigne s’humilier, ce n’est qu’à la manière du juste, de l’élu, qui, sans avoir rien à se reprocher devant les hommes, est obligé, dans l’épreuve, de reconnaître son impuissance : « Humilions-nous pour ne pas lutter contre la volonté de Dieu qui tend à notre humiliation [529]. »
Il est incontestable qu’il « fit preuve de trop d’impétuosité juvénile et d’inexpérience. Il est impossible d’affirmer que cette œuvre ait toujours été sage et habile [530] ». Cependant le jeune réformateur ne tempère aucune de ses prétentions. Il ne cessera de lancer à la patience des hommes le même défi autoritaire, par exemple au synode de Zurich, qui devait réexaminer cette question controversée des cérémonies et de la discipline ecclésiastique. Comme l’observe judicieusement Kampschulte, « ce que Calvin exigeait après sa défaite, c’était plus qu’aucune autorité spirituelle n’avait été en état d’imposer à aucune Église en Suisse ». Il était déjà persuadé que son système religieux venait de conférer à Genève la célébrité et « obligeait les adversaires les plus acharnés de notre religion à rendre gloire à Dieu ». « Il s’aveuglait jusqu’à supposer que les institutions qu’il venait d’ébaucher avaient déjà fait de Genève un point lumineux sur lequel l’Europe jetait les yeux [531]. »
Le système du jeune réformateur couronne, mais aussi achève sans pitié la ferveur spontanée de l’Évangélisme français primitif. Il n’est plus question de chercher avec Lefèvre, « dans une confiance absolue et une espérance parfaite », une conciliation harmonieuse entre l’Évangile, la culture humaniste et la Tradition. « La pensée de Calvin, telle qu’elle se dégage de l’Institution chrétienne, s’élève dans l’azur comme les cimes d’éternelles neiges, mais la terre se mêle à la neige quand il s’agit de matérialiser cette pensée en une Église. Et quelle déchéance quand le calvinisme devient un parti [532] ! » L’auteur de L’épopée huguenote, Raoul Stéphan, a peut-être raison de regretter cette déviation de la mystique en politique ; mais quel moyen de l’éviter, alors qu’elle inspire déjà le particularisme de l’Institution ? Son caractère picard, son esprit dialecticien et procédurier, sa mentalité de légiste, la révolte de son sentiment religieux, tout prédestine Calvin à devenir l’homme d’un parti. Il sera partial et partisan, même quand il défend l’universalité du christianisme.
Il n’est plus urgent, dans les rencontres de Berne et de Zurich, de favoriser l’étude libre de la Bible comme le voulaient Lefèvre, Érasme, Reuchlin et tant d’humanistes. Il s’agit avant tout d’imposer des cadres disciplinaires, de nouvelles formules dogmatiques, un nouvel ordre ecclésiastique aussi rigide et plus artificiel que le précédent. L’invective et les mesures agressives remplaceront trop souvent les conseils apostoliques du bon Lefèvre : « Si quelques-uns me condamnent publiquement au feu avec mon livre, j’implorerai contre le feu la rosée céleste pour l’éteindre. » Les procès et les disputes, les libelles anonymes ou signés de faux noms, tout le tapage de la polémique et de la propagande, succèdent à la recherche de la vie intérieure, de la vérité évangélique qui semblait si facile à Lefèvre : « Toutes les oppositions tomberont d’elles-mêmes ; il y a beaucoup plus de chance, à mon avis, de connaître la vérité sans dispute qu’avec dispute [533]. »
Le parti réformé remportera encore de sensationnelles victoires ; mais c’en est fait d’ores et déjà de sa pénétration pacifique en France. Raoul Stéphan pose sincèrement la question : « On peut se demander si une réforme inspirée par Érasme et Lefèvre d’Etaples n’aurait pas eu plus de chance de réussite au pays de l’humanisme... dont le génie s’accordait plutôt avec l’insinuante séduction d’un François de Sales qu’avec la discipline entière d’un Calvin [534]. » La conversion de la Suisse romande à la Réforme ne se serait jamais imposée sans l’appui des armes de Berne. Mais à Genève, une fois la révolution accomplie, on était en droit d’espérer une détente que devait apporter le grand humaniste frais émoulu d’Orléans et de Paris. Tout au contraire, la violence s’accroît et forcera les retraites les plus intimes, au point que la rigueur du jeune maître étonnera les rudes Bernois eux-mêmes. Un connaisseur du passé genevois, H. Naëf, résume ainsi l’évolution qui aboutit à la révolution calviniste : « La Réforme est un phénomène complexe. À son avènement les hommes ont travaillé de mille manières et, les plus nombreux, sans le savoir [535]. » Les Genevois qui chassent Farel et Calvin commencent à ouvrir les yeux. On leur a fait parcourir une distance énorme et l’objectif qu’on leur promettait est tout différent de celui devant lequel ils se trouvent. Ce n’était pas là qu’ils désiraient aboutir. Ils ont l’impression de s’être fourvoyés loin de toutes leurs traditions, loin des rêves d’indépendance des Berthelier, des Bezanson Hugues, de toute l’ancienne Genève. Mais après avoir coupé tous les ponts derrière eux, et détruit, pour n’avoir point à les regretter, les anciens autels, ils ne savent plus de quel côté se tourner. Dans le désert religieux où il les laisse, Calvin pourra les reprendre bientôt. Le peuple élu, absolument désorienté, menacé de nouveaux bouleversements, s’en remettra à ce nouveau Moïse qui reviendra de Strasbourg avec plus d’assurance que l’autre descendant du Sinaï.
Cependant ne semble-t-il pas décidé à s’humilier ? « Je me retirerai à Bâle, en attendant ce que le Seigneur voudra faire de moi... Je crains sur toutes choses de rentrer en la charge dont je suis délivré, réputant en quelles perplexités j’ai été du temps que j’y étais enveloppé. Car comme lors je sentais la vocation de Dieu qui me tenait lié, en laquelle je me consolais, maintenant au contraire, je crains de le tenter, si je reprends un tel fardeau lequel j’ai reconnu m’être importable [536]. » Les « épouvantables remontrances et protestations » de Bucer, les objurgations de Capiton et de ses amis, ne le laisseront pas longtemps douter de lui-même. Le parti a trop besoin d’un homme pareil pour ne pas lui trouver au plus vite une mission providentielle.
II
LA FORMATION POLITIQUE INTERNATIONALE : STRASBOURG
L’échec devient une victoire, s’il ouvre les barrières régionales, et permet d’atteindre à la notoriété mondiale. Libéré de Genève, Calvin promène son éloquence et sa dialectique à travers les Églises de Suisse et y fait grande impression. On l’invite à Strasbourg, une des villes les plus savantes de la Réforme, comme le remarque Bossuet. « On aurait difficilement pu trouver, note Kampschulte, un endroit mieux approprié pour développer le Réformateur novice, et capable de lui offrir, à un si haut degré, la possibilité de compléter ce qui lui manquait encore, et de le fortifier dans ses tendances fondamentales. La place occupée par cette ville dans le grand mouvement spirituel de cette époque correspondait parfaitement à son exceptionnelle importance politique et à sa situation géographique privilégiée. Après Wittenberg, écrivait Bucer à Berne, il n’y a peut-être pas d’autre ville qui ait pareillement en vue les intérêts de l’Évangile et se laisse conduire à ce point par des préoccupations d’ensemble. Dans une lettre à Calvin, les Zurichois appellent Strasbourg, l’Antioche de la Réformation. Touchée en même temps par les flots de la Réforme de Wittenberg et de la Réforme de Zurich, participant, par l’intermédiaire des réfugiés français qui la regardent comme la Nouvelle Jérusalem, aux remous de l’opposition ecclésiastique des pays latins, Strasbourg offrait à l’étranger un observatoire incomparable pour embrasser d’un seul regard l’évolution des évènements et pénétrer plus profondément le sens de cette grande lutte [537]. »
Dans l’entourage d’une élite intellectuelle, avec les Sturm, avec Bucer, Capiton, avec de vrais savants, Calvin retrouve un peu de l’atmosphère de Paris et d’Orléans ; il s’épanouit, il donne sa pleine mesure. Strasbourg, c’est l’initiation décisive : moins au point de vue religieux que sur le plan de la propagande et de la politique. Là s’effectue son ascension à la renommée européenne, son élection au rôle de « super-réformateur » si l’on peut désigner ainsi son dessein déjà bien net de réformer la Réforme. Il va se mesurer de près avec Bucer, Melanchthon et sentira instinctivement qu’il est plus fort qu’eux et son assurance prophétique en sera confirmée d’autant : « Luther n’est pas le seul dans l’Église de Dieu qui mérite l’attention [538]. »
Quelques rayons de joie, des lueurs d’amitié et de sympathie féminine, éclairent par intervalles ce visage d’inquisiteur. Il devient bon prince. Il prêche la conciliation, par exemple, entre les luthériens et les réformés suisses, oui, même entre les ministres de Genève, ces indignes qui n’ont pas cru nécessaire de se solidariser avec lui, et leurs ouailles récalcitrantes. Loin de la mêlée, il domine la situation générale du protestantisme. On le croirait assagi : moins violent, plus rarement fanatique, il parle d’accommodements et de concessions [539]. Les éclats de colère, encore terribles, se font plus rares. Cette métamorphose amène E. Doumergue à se demander : « L’expression lune de miel est-elle déplacée ? » En effet, le refoulement de Calvin cède jusqu’à accepter un mariage de raison que ses parrains spirituels décident pour lui. L’élue de son cœur, ou plutôt celle qu’il trouva « par le moyen et conseil de Bucer », commence à réjouir le foyer suivant les vœux de Calvin, en s’occupant de sa santé [540]. Dieu « pour prévenir les excès de joie a pris soin de tempérer l’allégresse » du prophète et de la veuve Idelette Stordeur de Bure, en les accablant, l’un et l’autre, de fièvres, d’accès de bile, d’indigestions, de catarrhes, de vertiges, de vomissements et de dysenterie [541]... Mais, du moins pour un temps, l’esprit et le cœur de Calvin semblent faire bon ménage, et, dans ce sens, Doumergue peut se représenter une lune de miel. Le divorce d’une âme déchirée entre le sentiment religieux et l’instinct de domination ne trouve pas à se manifester dans cette petite communauté française (ecclesiola) qu’on lui confie. Il goûte le grand esprit de famille qui unit facilement des Français hors de France. L’ignorance complète de l’allemand le dispense de se mêler aux petites affaires de la cité impériale.
Une activité fiévreuse dévore toutes ses énergies. Car, prenant à cœur les affaires du parti, comme si elles étaient exclusivement sa chose, et inversement identifiant ses moindres soucis aux intérêts universels du protestantisme, « de l’Évangile », l’avocat de la cause réformée ne voit plus rien que sous un angle déterminé. Il plie, selon ses vues, la personnalité de sa femme, de ses paroissiens, de ses pensionnaires, de ses étudiants : tous ne devraient être que les instruments dociles d’une même idée. Il entoure d’une « affection rigide et grave, qui ne s’abandonne, ni ne s’attendrit », ses jeunes disciples, comme Sleidan, J. Sorel, Cl. Feray, Castellion... Il n’a qu’un minimum de temps pour enflammer de son zèle les pasteurs novices qu’il forme à sa manière avant de les laisser partir pour le Dauphiné, la Savoie, Montbéliard. Il dirige tout de haut et de loin, avec la suffisante et distante supériorité d’un vieillard de trente ans : « Combien que je sois jeune, toutefois quand je vois ma débilité et indisposition de mon corps, j’ai soin de ceux qui seront après nous, comme si j’étais déjà vieil [542]. »
Tout à Strasbourg se colore de diplomatie. La pure doctrine elle-même est sujette à des adaptations : « Il n’y a guère d’Église, dira-t-il, qui ne retienne absolument aucune trace d’ignorance... Maintenant il nous faut donner une définition de l’Église qui convienne à notre argumentation actuelle ; je dis donc que l’Église se trouve là où l’on prêche la doctrine sur laquelle elle s’appuie comme sur un fondement. (C’est-à-dire là où l’on prend comme base les thèses fondamentales protestantes.) Même si la prédication est parsemée de taches, il me suffit pour établir le nom d’Église d’avoir la doctrine fondamentale intacte et sauve [543]. »
Strasbourg ménage à Calvin la possibilité de s’informer sur toutes les questions de la politique européenne. Dans les colloques de Haguenau, de Worms, de Francfort et de Ratisbonne, où on lui fait le grand honneur de l’appeler comme observateur ou comme porte-parole des réformés français, voire même de Strasbourg, un seul souci le domine : réaliser par tous les moyens un front commun des protestants, capable, le cas échéant, de soutenir une guerre victorieuse contre les catholiques. C’est là le grand idéal œcuménique, pour lequel, avec E. Doumergue et les calvinistes de son école, il faudrait encore s’enthousiasmer aujourd’hui.
Bien loin de chercher, avec Melanchthon, Bucer, Contarini, un terrain d’entente entre les chrétiens divisés, il ne néglige rien pour élargir le fossé entre catholiques et protestants, pour rendre la rupture définitive. Au point de vue de l’intransigeance, il pourrait même donner des leçons « au sophiste barbare » Eck et à ses émules. Autant on est obligé d’admirer la précocité et la vigueur de son génie politique, révélé par ses rapports à Farel, à la reine Marguerite, aux agents de François Ier et par toutes ses lettres ; autant il faut déplorer l’absence des sentiments chrétiens les plus élémentaires. Il ignore résolument le point de vue de l’adversaire. La bienveillance, la charité n’ont pour lui aucun sens en dehors des cadres du parti. Vertus « évangéliques » trop peu efficaces dans la politique qu’il préconise et finit par imposer au protestantisme.
Les délégués catholiques ne lui inspirent que haine et mépris ; non seulement Eck, « cette bête malheureuse dont la Providence ne veut pas nous délivrer », mais même des hommes comme le cardinal Contarini, dont Bucer apprécie la culture et l’intégrité, ne sont pour Calvin que des objets d’horreur [544]. Il évite leur contact impur, autant que pourrait le faire un bon pharisien, et leur prête généreusement ses propres intentions de « réprimer avec ou sans carnage » le parti adverse [545]. Le chancelier Granvelle lui inspire les mêmes sentiments de dévotion : il prie pour « que le Seigneur le supprime ou le corrige [546] ». Bucer est, à ses yeux, beaucoup trop conciliant ; Melanchthon le déçoit par son manque d’intransigeance. « Bucer a bien la meilleure conscience du monde... mais nous ne devons pas nous contenter de l’intégrité de la conscience, au point de ne pas tenir compte des frères » (de l’intérêt supérieur du parti, dirait-on, dans le style d’aujourd’hui). « Je le déplore auprès de toi, écrit-il à Farel ; prends garde que ces plaintes ne soient divulguées [547]. »
Les grands chefs du parti réformé manquent de fermeté. « Crois-moi, répète-t-il à Farel, qui est évidemment, comme lui, partisan de la manière forte, dans ces assemblées il faut des caractères énergiques qui confirment les autres », plutôt que des pacifiques du genre Bucer, « qui ne brûle que du seul désir de la concorde ». De la colère avant toute chose ! Il se voit personnellement assez bien doué pour cette politique extrémiste. Ses interventions diplomatiques aboutissent à un résultat extraordinaire. L’union de l’Empire échoue, mais en revanche, les princes protestants, attirés du côté de la France, servent la cause de François Ier, beaucoup plus que celle des réformés français auxquels Calvin se flattait de venir en aide. Trop politique, il se laisse prendre au jeu traditionnel des légistes et favorise une monarchie dont sa propre Réforme recevra les coups les plus durs.
Calvin croyait se situer « bien au-dessus de ces intrigues ; il n’aurait voulu abaisser son regard sur de telles affaires, s’il n’avait envisagé la possibilité d’aider les pieux fidèles. Je me fais donc violence pour m’insinuer dans les habitudes de ceux qui me paraissent capables de les aider [548] ». Douce violence, réjouissante pour le bon roi de France, qui lui mandait par la reine Marguerite qu’il était « merveilleusement satisfait des bons services... desquels il est bien averti [549] ». Mais tout en promettant « de faire tout ce qu’il lui serait possible, selon la puissance que Dieu lui donnerait », l’intermédiaire n’engageait pas la responsabilité du roi. Celui-ci n’avait, bien sûr, « aucune intention de s’entremettre de l’ordre et forme de vivre, des lois, constitutions et établissements des pays » de ses chers et grands amis de Suisse et d’Allemagne ; mais il ne fallait pas non plus qu’on se mêlât, sous quelque prétexte que ce fût, de sa propre politique religieuse intérieure [550]. Aussi fâcheuse qu’elle pouvait être pour l’ancienne unité de l’Europe chrétienne, la politique française de Calvin n’en fut pas moins favorable sur le plan étroit de la réforme suisse et genevoise. Justement, pour consoler le réformateur des réformateurs, la cité infidèle fait amende honorable et s’offre à lui avec une servilité accommodante. L’éloignement a exalté son prestige. Il s’est mesuré avec les meilleurs politiques et les esprits les plus célèbres du protestantisme. Il ne craint plus du tout, en publiant ses traités de la Cène, son commentaire de l’Épître aux Romains, d’être mis en parallèle avec Melanchthon, Bucer, Bullinger et autres savants interprètes des mêmes questions. Personne ne l’intimide plus.
À Genève, tout conspire à rappeler quelle perte la cité a subie en se privant du grand homme. Le parti minoritaire, les Guillermins, fidèles à Farel et à Calvin, restent en contact avec leurs chefs et agitent l’opinion. Le désarroi était grand dans la ville depuis leur départ. Les catholiques commençaient même à relever la tête. « L’on a entendu, disent les Registres du Conseil, que les évêques, tant le cardinal de Tournon, que l’évêque jadis de Genève, Lausanne et autres, font aucunes conjurations, par ensemble contre la ville et étaient assemblés à Lyon [551]. » Trompée par les apparences, la hiérarchie catholique responsable entreprit, une fois de plus, une de ces démarches maladroites qui contribuèrent si activement au triomphe du protestantisme. Un grand humaniste, le cardinal Sadolet, fut chargé de faire des avances aux Genevois en vue d’une réconciliation. Les conseillers décident de « faire réponse aimable » à la missive courtoise du célèbre lettré, et remettent à plus tard leur avis sur le livre qu’il leur avait envoyé [552].
Mais personne à Genève n’était de taille à se mesurer avec Sadolet. À Berne, non plus. Le pasteur Kuntz, une des nombreuses bêtes noires de Calvin, eut la merveilleuse idée de transmettre à ce dernier l’écrit du cardinal. La belle aubaine pour l’avocat de la cause ! « Je suis complètement occupé, annonce-t-il avec transport, ce sera un travail de six jours » (comme pour la Création), et sans doute surtout de six nuits fiévreuses. Ce plaidoyer pro domo déborde de science gratuite et d’indignation retenue, d’éloquence pathétique et d’attaques mordantes. Du fond de Wittenberg, Luther lui-même applaudit et le cœur de Calvin en fut gonflé de fierté. À Strasbourg, à Genève, les éditions de la célèbre réponse se multiplient. Ce n’était pas seulement un succès littéraire, mais la victoire politique du chef de parti. À distance, de la lointaine Alsace, le nom et la plume de Calvin se révélaient plus formidables, pour défendre la Réforme française contre les entreprises des papistes, que tous les efforts des Genevois et des Bernois conjugués. Walker dit avec raison : « Ce fut la plus brillante apologie qui eût paru jusqu’alors en faveur de la cause protestante et la Réforme n’en produisit plus tard aucune qui la surpassât [553]. »
C’est un chef qui a manifestement conscience de sa valeur et de sa mission exceptionnelle : « Au regard de ce qu’ils m’ont objecté que je me suis séparé de l’Église, en cela ne m’en sens rien coupable, si d’aventure celui ne doit être réputé pour traître, lequel voyant les soudars épars et écartés vagant ça et là et délaissant leurs rangs, élève l’enseigne du capitaine, et les rappelle et les remet en leur ordre. Car tous les tiens, Seigneur, étaient tellement égarés, que non seulement ils ne pouvaient entendre ce qu’on leur commandait, mais aussi il semblait qu’ils eussent mis en oubli et leur capitaine, et la bataille et le serment qu’ils avaient fait. Et moi, pour les tirer d’une telle erreur, n’ai point mis au vent une étrangère enseigne, mais celui tien noble étendard qu’il nous est nécessaire de suivre, si nous voulons être enrôlés au nombre de ton peuple. En cet endroit ceux qui devaient retenir les dits soudars en leur ordre et qui les avaient tirés en erreur, ont mis les mains sur moi, et pour ce que constamment je persistais, ils m’ont résisté avec grande violence. Et là ont commencé grièvement à se mutiner : tant que le combat s’est enflammé jusques à rompre l’union. Mais de quel côté soit la faute et la coulpe ? C’est maintenant à toi, Seigneur, de le dire et prononcer [554]. » Ce n’est donc pas lui qui a quitté l’Église, c’est le reste de la chrétienté qui a rompu l’union avec le capitaine et son lieutenant, porte-enseigne, Calvin. On a de la peine à prendre au sérieux les protestations de modestie et de timidité : « Vrai est que je ne parle pas volontiers de moi... » À voir manœuvrer son habileté d’avocat, sa souplesse politique, on songe qu’il y a mille manières directes et indirectes de se faire valoir. Tantôt il en appelle au Seigneur, tantôt au jugement de l’Église, d’une Église choisie pour les besoins de l’argumentation, tantôt le témoignage de sa seule conscience lui suffit.
Il ne craint plus les contradicteurs, « ces chiens qui aboient dans les coins », bien qu’il ait « confiance qu’ils ne resteront pas longtemps impunis ». Et de fait, les « soudars », les partisans de Calvin reprennent le dessus à Genève en nettoyant la ville des mal pensants. Des quatre syndics, sous lesquels le prophète avait été banni, le premier, Philippe, avait eu la tête tranchée, deux autres étaient condamnés à mort, et le quatrième ne s’était sauvé qu’en prenant la fuite. Cette belle victoire évangélique vient sceller les hommages unanimes du parti : « Le jugement de l’Église est porté. Je ne puis dire combien il est honorable pour nous. Je ne peux pas énumérer les témoignages que nous ont rendus ceux qui tiennent les premières places dans les Églises principales [555]. »
Les autres avis ne comptent pas. Il est de la race de ces « chefs qui ont toujours raison ». Mais cela ne va pas sans un dédoublement de la conscience. Il éprouve bien, comme tout le monde, qu’il est pécheur et sujet à l’universelle misère ; mais sur ces défaillances de sa conscience intime, il ne jette que des regards furtifs. Il s’appuie de préférence sur une sorte de conscience officielle, la conscience du légiste et de l’écrivain inspiré par la Bible, qui trouve toujours le moyen de se justifier, soit par le succès et la force, soit par les ressources que lui fournit un savant dosage de figures de rhétorique : allégories, apostrophes, prosopopées, comparaisons qui ne sont pas toujours raisons [556]. Parfois dans la même page, le moi social et le moi intérieur de Calvin se donnent ainsi la réplique : « Quant à nous, s’il est question de débattre notre cause contre tous les iniques et calomniateurs... je sais que non seulement notre conscience est pure pour répondre devant Dieu, mais nous avons suffisamment de quoi nous purger devant les hommes... Toutefois, quand il est question de comparaître devant Dieu, je ne fais pas de doute qu’il ne nous ait humilié en cette sorte, pour nous faire connaître notre ignorance, imprudence et les autres infirmités que, de ma part, j’ai bien senties en moi, et ne fais difficulté de les confesser devant l’Église du Seigneur [557]. »
Et voici Calvin confirmant, avant de reprendre en mains le sort de Genève et du protestantisme français, tous les doutes que son ami du Tillet formulait au sujet de sa mission, lors de son bannissement. C’est à Farel qu’il décrit son état d’âme, dans une lettre confidentielle : « Aussi longtemps que je suis resté lié (par le hasard des circonstances « providentielles »), j’ai préféré supporter le pire, plutôt que d’admettre dans mon esprit des idées de changer de lieu. Ces idées d’ailleurs m’assaillaient souvent. Or maintenant que je suis délivré par un bienfait de Dieu, qui refuserait de me pardonner de ne pas vouloir me précipiter spontanément dans ce gouffre que j’ai expérimenté fatal pour moi [558]. » Rentrer à Genève, c’est comme d’aller à la potence ; c’est revenir dans une chambre de torture ; « tout son cœur frémit d’horreur à la pensée des tourments dont son âme a été déchirée à Genève [559] ».
Mais à côté de ces doutes intérieurs, des considérations politiques arrêtent son attention : « Étant donné leur caractère, les Genevois me seront insupportables autant que je le serai pour eux. Une autre chose me trouble violemment : je ne ferai avancer les choses que si ceux-là me prêtent une main secourable, qui nous ont déjà fait sentir combien ils sont capables de nuire ». Si jamais il revient à Genève, il lui faudra un gouvernement docile... « Ajoute à cela que la lutte avec les collègues sera plus forte et plus difficile qu’avec les gens du dehors. Que peut l’activité d’un seul homme si elle est brisée par tant d’oppositions venues de tous côtés. Et pour dire la vérité, même si tout s’arrangeait bien, je ne sais comment je me suis déshabitué à gouverner, j’ai oublié l’art de conduire la multitude... Ici, je n’ai affaire qu’à peu de gens... Mais alors que je sens la difficulté d’être convenablement à la tête d’un petit nombre de fidèles bienveillants, comment réussirai-je à maîtriser une pareille multitude ? » Les savants éditeurs des Opera notent malicieusement : Ex ungue leonem : « la griffe du lion ». À Strasbourg, ce n’était que le pasteur d’un petit troupeau d’émigrés. Il ne pensait rentrer à Genève que comme le réformateur de l’État [560].
Ne sachant quel parti prendre, en bon nerveux, il attend avec impatience qu’on le pousse sur la pente de sa nature. Une fois cette impulsion reçue, rien ni personne ne l’arrêtera plus. « Le rappel à Genève me laisse tellement perplexe, ou plutôt dans une telle confusion d’esprit, que je n’ose imaginer ce qu’il faudrait faire. Si jamais je m’engage dans cette méditation, je ne vois plus d’issue. Aussi, pour peu que cette anxiété m’étreigne, je commence à douter de moi. En sorte que je m’en remets à d’autres pour me conduire. » Pour se dispenser d’examiner de trop près les inquiétudes de sa conscience, il fait état de l’approbation de ses amis : « Je me livre à la conduite de ceux par lesquels j’espère que Dieu me parlera ». Il se persuade d’être docile comme un enfant [561]...
En réalité, s’il aime beaucoup se faire prier, il ne laisse à personne le soin de le diriger. Ainsi, après avoir été « mené par force, bon gré, mal gré, aux assemblées impériales », il se retrouve tel qu’il était, « bien que toujours je continuasse à être semblable à moi-même [562] ». Au milieu de ces incertitudes, de ces calculs et de ces combinaisons, le tonnerre de Farel retentit de nouveau pour lui enjoindre, avec toutes les imprécations d’usage, de revenir à Genève : « Tu m’as violemment effrayé et consterné par ces foudres, ces foudres avec lesquelles, je ne sais pour quelle cause, tu tonnes de si étrange manière... Pourquoi donc m’attaquer avec une telle impétuosité que tu m’as presque dénoncé mon amitié... ». Farel apprend que sa lettre « l’a tout à fait décidé de prendre en mains cette province... Ta lettre l’a complètement confirmé dans notre point de vue : je croyais entendre en la lisant les tonnerres de Périclès [563] ». Encouragé par ces impressions, Farel s’en donne à cœur joie et multiplie ses éclairs au point que Calvin est obligé de le calmer : « Puisque tu le veux et que tu ne peux changer d’avis, je suis tout disposé à me mettre à ta dévotion. Que veux-tu de plus ? Que je fasse acte de soumission complète ? Ce ne sont pas des mots. Il me semble que j’ai assez manifesté dès le début que cette affaire n’est pas un jeu pour moi [564]... »
Calvin n’en attend pas moins une demi-année encore. Il a peur d’être ridicule en cédant trop vite et sans précautions : nisi vellemus nos prorsus ridiculos facere. Sa prudence excite la passion de Farel, dont les foudres émoussés se transforment en traits blessants : « Si tu avais été aussi lent à partir, lorsqu’on te donna l’ordre de sortir avec moi, que tu tardes à revenir, malgré tant de prières, les choses ne seraient pas actuellement dans l’état où elles se trouvent. » Le chef du parti voulait des garanties. Les Genevois ne s’étaient pas encore humiliés assez bas ; ils devaient multiplier encore ces promesses de docilité, ces hommages d’admiration, qui lui donnent la nausée (litteræ usque ad nauseam adulatoriæ) ; mais il aime ce genre de nausée [565]. « Je n’aurais jamais cru que j’aurais tant d’importance aux yeux de notre sénat. » Les démarches repentantes de celui-ci l’obligent « à se montrer sincère. Car je répandais plus de larmes que de paroles. Ces pleurs m’interrompirent à deux reprises, au point que je dus me retirer. Je n’en dirai pas plus long. Je t’assure seulement que je suis conscient de ma très grande sincérité [566] ». Comme au temps du romantisme (la Réforme fut une sorte de romantisme religieux), le degré de sincérité se mesure au niveau de l’émotion et de la passion. Malheureusement celle-ci varie, et bien fol est qui s’y fie. Et pendant tout l’automne et l’hiver 1540, pendant le printemps et l’été 1541, le cœur de Calvin oscille entre les deux extrêmes. Tantôt il répète à qui veut l’entendre : « Plutôt mourir cent fois que de retourner à Genève où il lui faudrait mourir mille fois par jour (ni plus ni moins). » Tantôt modifiant légèrement sa formule, il « offre son cœur immolé en sacrifice » : « Plutôt risquer cent fois la mort que d’abandonner l’Église de Genève [567]. »
En fin de compte, le romantisme se résoud en rationalisme, et la piété en politique. Un chef, même sensible comme une femme, au dire de Doumergue, se conduit par des raisons que le cœur ne connaît pas. Un argument impressionne Calvin plus que tout ce qu’on peut lui dire ou faire sentir. C’est que « Genève n’est pas une Église comme les autres. Il s’agit de prendre la charge, non d’une Église particulière, mais de l’Église universelle. Telle est la conviction qui se fortifie, telle est l’intuition qui se précise dans tous les esprits [568] ». Marcourt n’a pas besoin de lui dire que de Genève « on peut parler ad omnes Gallias », à toute la France, et que cette Église est d’une grande importance, que nul mortel ne peut la diriger avec autant de puissance, de prudence, d’habileté que lui... Nous sommes comme la porte de la France et de l’Italie, soulignent les Genevois, par où peut passer une édification admirable, ou bien la ruine [569]... Les Zurichois mettent aussi l’accent sur le point essentiel : « Tu sais que Genève est sur les confins de la France, de l’Italie et de l’Allemagne, de telle sorte que l’espérance est grande de voir l’Évangile se répandre de là dans les villes voisines et d’élargir les boulevards du royaume du Christ. Tu sais que l’Apôtre choisissait les métropoles pour y prêcher, afin que l’Évangile pût s’y répandre dans les villes voisines [570]. »
Un Calvin ne saurait résister à une pareille prédestination, marquée non par l’Esprit intérieur, comme on pourrait s’y attendre, mais par une conjoncture exceptionnellement favorable. Genève a besoin de Calvin pour devenir la métropole de la Réforme, et Calvin a besoin de Genève comme capitale de son royaume de Dieu. Tous les avis concordent sur ce point : celui de Bucer qui pense que Calvin n’a pas de « second qui pourrait lui être comparé... si vous regardez principalement le zèle, l’ardeur, l’industrie et l’esprit pour édifier l’Église, et la faculté et puissance qu’il a pour la orner et défendre par ses écrits, oui, l’universelle comme aussi la vôtre... ». Et les Zurichois confirment : « De Genève, cet homme doué par Dieu des dons les plus remarquables pourra être utile à bien des Églises de ces royaumes (France, Italie, Allemagne), et cela davantage que s’il enseignait en quelque autre lieu du monde que ce soit [571]. »
C’est avec cette vision géopolitique que Calvin reprend son expérience genevoise, déployant une activité infatigable qui, à sa manière, l’épuise et l’enchante. Demain il écrira à Melanchthon combien, somme toute, il a sujet d’être content de lui-même. « Je travaille ici et me fatigue d’une façon extraordinaire ; mes progrès sont moyens. Et cependant tous s’étonnent que je puisse réaliser de tels progrès, avec tant d’obstacles qui me viennent en grande partie des ministres eux-mêmes. Mais ce qui m’est un grand soulagement dans mes travaux, c’est de constater que, non seulement cette Église, mais tout le voisinage, sent quelque fruit de ma présence. Ajoute à cela le fait que (mon influence) déborde jusque sur la France et l’Italie [572]. » Revenu avec les honneurs d’une revanche inouïe, Calvin n’a plus à se gêner avec les Genevois. Sans explication, il reprend ses commentaires bibliques à l’endroit même où il les avait laissés, et ses Ordonnances aux articles pour lesquels il avait été expulsé. Rentré le 13 septembre, le légiste reprend immédiatement le code en main ; dans les Registres du Conseil, on lit en date du 13 :
« Maître Jean Calvin, notre évangélique... a prié mettre ordre sur l’Église et que celui fusse par écrit rédigé, et que l’on élise gens du Conseil pour avoir conférence avec eux. » Calvin rapporte que la rédaction de cet « ordre de l’Église » fut terminée en vingt jours [573]. Il n’en fallait pas plus à ce génie pressé et sûr de lui pour codifier la discipline ecclésiastique idéale, applicable sans doute d’abord aux conditions particulières de Genève, mais valable, dans l’esprit du législateur, pour l’Église universelle. La rédaction qu’il publie vingt ans plus tard offre un texte tout aussi hâtif et encore plus autoritaire. Ce n’est pas la sagesse pratique et harmonieuse d’une vie chrétienne profonde qui le préoccupe d’abord ; mais le souci d’obtenir la reconnaissance d’un principe idéologique. Il fallait à tout prix imposer à la politique genevoise la primauté de l’autorité ecclésiastique. Et ce chef-d’œuvre d’un État dominé par l’Église « devait servir de phare lumineux non seulement pour la Suisse, mais pour toutes les autres Églises [574] ».
À ce spectacle, Amédée Roget ne peut cacher son étonnement : « Le théologien de Noyon qui vient à peine de secouer la poussière des écoles se charge d’une mission redoutable et grosse d’orages... Voici donc clairement déterminé le pouvoir dont doivent être investis les pasteurs de l’Église. Il faut qu’ordonnés ministres et dispensateurs de la parole de Dieu, ils osent tout, qu’ils forcent toutes les grandeurs et les gloires de ce monde à s’incliner devant la Majesté de Dieu et à lui obéir ; qu’ils commandent à tous, depuis le plus élevé jusqu’au plus humble, qu’ils construisent la maison de Dieu, qu’ils renversent le règne de Satan, qu’ils épargnent les brebis, qu’ils exterminent les loups, qu’ils exhortent et instruisent les dociles, qu’ils accusent et confondent les rebelles et les opiniâtres, qu’ils lient et délient, qu’ils fulminent et foudroient, mais le tout selon la parole de Dieu [575]. » De là à faire de la Parole divine un instrument de domination politique, il n’y a qu’un pas. Car l’Ancien Testament, sur lequel Calvin s’appuie de préférence, offre assez d’exemples de dureté [576]. Et cependant, Roget voudrait prouver que l’action de Calvin dans les affaires politiques, fut très limitée. Les éditeurs des Opera lui donnent une réponse adéquate : « Ce chercheur infatigable ne niera certainement pas que l’avis et la main de Calvin exercèrent l’influence prépondérante dans la rédaction des lois et surtout dans les affaires ecclésiastiques ; à partir de 1541 tout dépendait de lui. Il fut vraiment le père et l’auteur de la discipline ecclésiastique et, aussi longtemps qu’il vécut, l’observateur le plus rigide et le vengeur impitoyable. Les protocoles du Consistoire en témoignent assez... La sévérité de ce tribunal et ses mesquineries furent telles qu’on disait communément qu’il serait préférable d’être en enfer avec Bèze qu’au ciel avec Calvin [577]. »
Théocratie, ou dictature biblique, l’autorité de Calvin à Genève tend au pouvoir absolu. Ingénument, Doumergue le compare au roi de France : « Le roi, vraiment roi, ce n’est pas François Ier, c’est Calvin. Sa préface (de l’Institution) est comme une solennelle annonce de son avènement. Il en fait part à la France et à l’Allemagne et au monde. Désormais c’est lui qui est le chef et le défenseur. Il prend possession de son sceptre spirituel qu’on ne lui ravira pas. Il met sur sa tête cette couronne splendide que les ténèbres de l’isolement... ne pourront plus cacher désormais au respect et à l’admiration de ses disciples. Ou plutôt Dieu lui-même, achevant son œuvre, dans le silence de la retraite a sacré son oint (le nouveau Christ !), celui qu’il avait choisi, élevé, dirigé, instruit, le jeune homme frêle et chétif, nouveau David contre ces nouveaux Goliath : le roi, le pape, l’empereur, celui qui va conduire la chrétienté protestante à ses destinées nouvelles... Farel va le forcer à monter sur le trône que la Providence lui a destiné et préparé : ce trône, c’est Genève [578]... »
Depuis, le monde a vu des royautés idéologiques et politiques plus impressionnantes que celle de Calvin. On voudrait, dans une étude du sentiment religieux, être dispensé de les rapprocher. L’Évangile serait peut-être moins compromis si Calvin jouait franchement son rôle dictatorial. Mais on ne sait jamais quand le chef de parti va se muer en prophète et abuser du nom de Dieu pour « contraindre et corriger [579] ». Il évoque trop volontiers le danger de mort, pour lui-même et les autres. Ce n’était pas rassurant pour les bons Genevois de savoir que leur évangélique se croyait « responsable de leur sang et de leur vie [580] ».
L’avènement définitif de Calvin à Genève confère au parti un accroissement de prestige et de puissance, mais il se solde chèrement sur le plan spirituel proprement dit, le seul qui devrait compter quand on parle de réforme. La grande idée libérale et humaniste de l’Évangélisme français, à ce tournant dangereux, se laisse entraîner sur la pente de la soumission et du renoncement à elle-même. En fait d’évangélisme, il n’y aura bientôt plus que la doctrine d’un homme, le calvinisme : renforcement, mais aussi rétrécissement indéniable : c’est le reflux du libre examen, de la piété indépendante, de la mystique huguenote. En se repliant sur la seule pensée de Calvin, la ferveur du spiritualisme français découvre un rivage solide mais dur, hérissé de récifs, de tempêtes et de guerres, la théocratie militante.
Hier, l’auteur de l’Institution et de la réponse à Sadolet apparaissait comme l’écho amplifié du renouveau chrétien, la voix émouvante d’une classe intellectuelle persécutée. Rien de plus large et de plus pur, semblait-il, que ce dynamisme vers la perfection de la doctrine, de la morale et de l’Église. Calvin se dressait, à la face du monde chrétien, comme un libérateur. Mais, Janus à deux visages, il annonce la liberté et la paix et apporte la guerre, l’oppression, non seulement des ennemis, mais de ses propres partisans, les Guillermins. Pour les lecteurs lointains de ses œuvres, pour les fidèles dociles et dévoués à ses consignes, le prophète présente une figure idéalisée, un peu tragique, mais attachante justement parce que les temps sont si tragiques et qu’il promet la fin du chaos.
Mais l’orthodoxie va servir au « parti français » d’instrument pour supplanter le « parti genevois » et l’évangile se confondra avec une mécanisation de la piété dont l’histoire offre peu d’exemples. Calvin poursuit évidemment des buts religieux très élevés. Prises isolément, ses formules sont souvent exaltantes et exaltées. Mais ses actes donnent à cette théorie un commentaire sans illusion. Il s’est chargé lui-même de lever toutes les incertitudes qu’on pouvait nourrir au sujet du caractère artificiel de son système. À voir cette réforme tourner à la dictature, un grand nombre de réformés de bonne foi eurent l’impression d’une sorte d’abus de pouvoir et de confiance. Ils ne s’attendaient certainement pas à tant d’animosité et d’amertume à l’intérieur même du mouvement de rénovation religieuse. Le renversement des rôles est complet : ce sont les laïcs qui se voient bientôt dans l’obligation de rappeler au calme et à la charité, mais sans succès, le nouveau clergé, les « messagers de la bonne nouvelle ».
Enlever au calvinisme son agressivité, ce serait, en quelque sorte, lui enlever son âme. Si la solidarité protestante consiste encore si souvent à mener en commun des campagnes « contre », cela n’a rien pour étonner de la part des disciples de Calvin. Comme tout chef victorieux, il aura aussi bien des amis. Mais ce sont essentiellement des partisans qu’unit la nécessité de la lutte. L’affection même qui existe entre Calvin et Farel, ou Viret, et celle qu’il voue à des hommes comme Bucer et Melanchthon, ressemble plus à une alliance offensive et défensive, à une foi élémentaire dans la cause réformée, qu’à cette harmonie profonde des cœurs et des esprits que seul peut créer l’amour.
L’amour : c’est la seule supériorité et suffisance que ne puisse revendiquer ce génie universel qui en remontrait si facilement à Sadolet et à tout le monde, « sûr de leur être supérieur, non seulement par la bonté et la justice de la cause, par la droiture de la conscience, par la sincérité du cœur, par la candeur de la parole, mais encore par la maîtrise de soi, la douceur et la modestie [581] ».
CHAPITRE II
Le chef de compagnons
_______
I
APPRENTISSAGE MISSIONNAIRE
Tandis que Calvin, avec sa Vénérable Compagnie des ministres, est occupé à installer son autorité sur la jeune république de Genève, et à organiser, de là, cette vaste révolution qui avait alors nom Réforme, Loyola ne songe guère à une action extérieure, encore moins à un bouleversement politique. En fondant la Compagnie de Jésus, le vieil étudiant basque et ses amis ne savent pas encore bien ce qu’ils veulent. Ils ont des idées très claires sur la lutte que chacun doit mener contre soi-même, mais ils ne prévoient pas les buts pratiques auxquels tendent leurs aspirations apostoliques. Quelques amis quittent Loyola pour entrer dans différents ordres religieux, parce que la liberté et l’incertitude, dans lesquelles il les laissé si longtemps, finissent par les impatienter. Quant à ceux qui s’attachent définitivement à lui, ce ne sont ni des partisans, ni des réformateurs zélotes, mais seulement des amis prêts à se consacrer ensemble « à n’importe quelle œuvre qui tendrait le plus à la plus grande gloire de Dieu [582] ».
La prétendue « milice fanatique » de Loyola se compose, à l’origine, d’un petit groupe de compagnons, liés par un même amour de la vie intérieure et de la pauvreté évangélique, et si peu préoccupés de combattre Luther ou Calvin, qu’ils aspirent à quitter l’Europe pour aller vivre dans le dénuement, au milieu des Turcs. En attendant que puisse se réaliser cette belle aventure, ils « s’exercent » d’après les principes que le Père ne cessera d’inculquer aux siens : « Ne point oublier sa conscience en s’occupant des autres ; ne point consentir à faire la faute la plus légère pour tout le gain apostolique du monde ; et ne pas même s’exposer au péril d’en commettre. » Car l’apôtre doit avoir en lui « la forme qu’il veut transmettre... pour mettre dans les autres la vertu d’humilité, de patience, de charité, etc. Dieu veut que l’agent immédiat soit humble, patient, charitable... La vertu n’est pas un moins apte instrument de votre apostolat que la doctrine ; en l’une et l’autre, vous devez être un instrument parfait du Seigneur... C’est une manière de vivre excellente, et qui est un exemple pour autrui, d’éviter non seulement le mal, mais l’apparence même du mal, et d’être des modèles de modestie, de charité et de toutes les vertus... Que leurs œuvres témoignent de la vérité de leur charité, et qu’ils méritent bien du plus grand nombre, en les aidant soit spirituellement, soit aux œuvres de charité corporelle... Qu’ils se rendent aimables, par l’humilité et par la charité qui les fera tout à tous.... Que personne ne les quitte avec des sentiments d’amertume... Qu’ils ne prennent parti pour aucune faction ; qu’ils restent dans le juste milieu, et montrent à tous de l’affection [583] ».
Le compagnonnage le plus fraternel a précédé la Compagnie. Avant de devenir un Ordre missionnaire, elle fut une sorte de cercle d’étudiants, une école essentiellement pratique de perfectionnement mutuel : « Comment expliquer, dira Pierre Favre, tout ce que le Seigneur nous a communiqué de moyens, de chemins, de vérités et de voies pour connaître le prochain, pour discerner ses bons et ses mauvais côtés dans le Christ, pour l’aimer, le supporter, le souffrir, pour compatir avec lui, pour rendre grâces pour lui, pour prier et demander pardon pour lui, pour l’excuser, pour parler en sa faveur et dire du bien de lui en présence de la divine Majesté et de ses Saints [584]. »
Longtemps ces amis ne sont unis que par l’affection et la communauté d’idéal : ils veulent devenir des « prêtres réformés », à la hauteur de la meilleure culture de leur temps, et réagir vigoureusement, par la pratique sincère des conseils évangéliques, contre le relâchement du clergé. À défaut de vie commune, ils poursuivent un programme commun de vie intérieure, entretenue par la méditation et le contrôle régulier de la conscience, par la fidélité aux sacrements et aux traditions de la piété chrétienne. Un jour, ils se décident à resserrer ces liens, à unifier leurs efforts par la perspective d’une aventure missionnaire à courir ensemble ; ce projet de croisade pacifique, si cher au vieux chevalier espagnol : aller à Jérusalem pour y convertir les Infidèles. C’est le vœu de Montmartre. L’idée de mettre cette « petite compagnie » à la disposition du pape n’est qu’une seconde intention de suppléance, pour le cas où les évènements rendraient impossible le voyage en Palestine.
Simon Rodriguez a gardé de ces premières années de compagnonnage un souvenir émerveillé. Il nous décrit la cérémonie du 15 août 1534, « dans la chapelle de saint Denis, au milieu de la montagne des martyrs, à deux milles de la ville, dans l’isolement, le silence, à l’abri de la foule ». Après la messe, célébrée par leur premier prêtre, Favre, « ils passent la journée dans l’enthousiasme et dans une immense joie fraternelle, près de la source de saint Denis, au pied de la montagne, de l’autre côté de la chapelle, s’entretenant les uns les autres du désir qui les enflammait de servir Dieu. Et, au coucher du soleil, ils rentrent chez eux louant et bénissant Dieu [585] ». Ce pèlerinage se renouvelle les années suivantes, même en l’absence de Loyola. Il s’impose tellement peu comme chef de ses compagnons que sa présence n’est pas nécessaire à la fidélité du groupe.
Quels sont ces hommes qui s’attachent au pèlerin et pourquoi lui restent-ils fidèles « jusqu’au bout du monde ? » Ce sont des étudiants remarquables par l’intelligence et surtout par le cœur, appartenant à des classes et à des nationalités bien différentes : nobles et pauvres, Espagnols, Français, Portugais. Des volontaires. Ils suivent Ignace de Loyola, un écolier de quarante ans, qui assimile avec peine les matières qu’ils dominent, eux, avec entrain. Ils sont gagnés par la force et l’égalité d’âme que dégage cette étrange personnalité. Car cet infirme a vite dissipé l’envie qu’on aurait de le railler ou de le plaindre, tant sa physionomie et tous ses gestes sont empreints de noblesse et de joie. Il impose le respect par une bonté à toute épreuve. Ce mendiant trouve le moyen d’aider de plus pauvres que lui, de soigner des malades dans les moments de loisir, de faire de la propagande pour ses Exercices. Les compagnons s’entraînent et s’entraident matériellement et spirituellement. Celui qui est plus doué, ou mieux formé pour une branche, donne des répétitions à ceux qui sont en retard [586].
Ils n’habitent pas en commun, mais ils prennent parfois des repas les uns chez les autres ; ou bien ils organisent de pieux pique-niques dans le voisinage de quelque sanctuaire de l’Île-de-France. Deux ont partagé la même chambre que Loyola à Ste-Barbe : le paysan savoyard Pierre Favre et le gentilhomme basque François Xavier. Après avoir apaisé ses scrupules par les Exercices, le jeune clerc savoyard, compatriote de Castellion, s’épanouira comme une fleur merveilleuse. Il possédera « l’art d’agir avec les gens et de se les attacher par son attitude aimable et cordiale, à un degré que je n’ai jamais vu chez un autre, nous assure son ami Simon Rodriguez... Il savait influencer peu à peu les esprits et par sa familiarité, par l’agrément et la douceur de sa conversation, il entraînait tous les cœurs à l’amour de Dieu [587] ».
Parmi les premiers compagnons de Loyola, c’est ce « Faber » candide et sans malice qui incarne le sourire de la Compagnie et de l’Église, qu’on appellera de préférence à tous les autres, dans quelques années, pour visiter les princes et les pays protestants. Désigné pour rencontrer Bucer et Melanchthon, il n’eut probablement guère l’occasion d’entrer en contact avec ces hommes qui n’auraient pu s’empêcher d’estimer sa modestie et sa loyale simplicité. « En premier lieu, ceux qui veulent rendre service aux hérétiques, dira cet ange de charité, doivent s’efforcer d’avoir une grande sympathie et un grand amour pour eux ; et les aimer en vérité, dans ce sens, qu’ils doivent éloigner de leur esprit toutes les considérations qui refroidissent habituellement l’estime. Deuxièmement il est nécessaire de gagner leur amour et leur estime : cela se produira en s’entretenant avec eux des choses que nous avons en commun, et en nous gardant des disputes dans lesquelles chacun désire seulement remporter la victoire sur l’adversaire [588]. »
L’autre compagnon de chambre, Xavier, était un gentilhomme basque dont la famille avait été ruinée pendant les guerres de Navarre. Brillamment doué, il ne rêvait que de se faire un nom et de racheter par une célébrité intellectuelle le malheur des siens. Au fils de famille ruiné, Ignace fait accepter gracieusement des secours matériels ; au professeur inconnu, il procure des élèves et s’assied lui-même aux pieds d’un maître quinze ans plus jeune que lui. Il tire peu à peu des préoccupations futiles cet idéaliste insatisfait que la fierté seule tenait à l’abri du désordre. Xavier écrira demain à son frère aîné, pour lui annoncer le passage d’Ignace au pays natal : « Que de fois, en mes difficultés, il m’a aidé de sa bourse et par ses amis ! Mais je lui dois encore plus : c’est grâce à lui que je me suis éloigné des mauvaises compagnies. Encore inexpérimenté, je n’en discernais pas le danger ; à l’heure actuelle, les sentiments hérétiques de ces hommes ne sont plus un mystère à Paris, et je voudrais, pour tout au monde, ne les avoir jamais fréquentés. Ce service, fût-il le seul, je ne sais quand j’en pourrai payer la dette au seigneur maître Inigo [589]. »
Ce sera en consacrant sa vie à rapprocher de l’Église, non les protestants, mais les peuples païens de l’Inde, de l’Océanie et du Japon, pour remplacer les pertes subies en Europe par le catholicisme. Le plus doué des disciples d’Ignace, le seul qui ait une vague connaissance des novateurs, n’aura jamais l’occasion de se mesurer avec eux. L’incroyable activité missionnaire que ses initiatives imposent à la Compagnie naissante réfuterait à elle seule l’absurde accusation, sans cesse reprise, « que la Compagnie de Jésus a été fondée pour extirper l’hérésie [590] ». En s’élançant jusqu’aux extrémités de la terre, pour étendre le Règne du Christ, comme pénitent hindou et lettré japonais, il reste ce prince charmant dont le protestant Böhmer, lui-même, subit le prestige : « Son noble et sympathique visage, son allure ferme et élégante, son éloquence enflammée, sa franchise impétueuse, qui ne dégénérait jamais (comme chez tant de réformateurs) en une suffisance blessante, sa vivacité juvénile, et surtout l’enthousiasme débordant, pur de toute préoccupation personnelle qui animait tout son être, (produisaient) une impression ineffaçable. On l’admirait, on l’aimait malgré soi, on s’éprenait de lui, on était édifié par sa seule présence... Son œuvre était tout pour lui, sa personne, rien ; la jalousie, la passion de dominer, le souci mesquin de son autorité, de sa santé, de ses convenances personnelles, tout cela lui était tout à fait étranger. Il n’exagérait rien quand il disait qu’il lui était doux de porter la croix du Christ ; et il ne faisait point de phrase quand il déclarait : Je crains Dieu et rien d’autre dans le monde [591]. »
Dans l’intimité de la chambre commune et plus tard dans toute la suite de ce compagnonnage apostolique, Loyola communique à ses amis un enthousiasme à base de charité, où il est impossible de trouver la moindre trace de fanatisme confessionnel.
À la primauté de la foi qui joue un si grand rôle dans toutes les disputes de cette époque, l’influence de Loyola oppose la primauté de l’amour du prochain, qui se dépense pour les plus déshérités sur le plan matériel (les malades, les pauvres) comme sur le plan spirituel (les infidèles, les païens). Même s’il lui arrive de parler, dans le vocabulaire du temps, « de la redoutable infection de l’hérésie », l’apostolat qu’il envisage est à base de charité et de prière. « L’ordre de la charité, par laquelle nous devons aimer tout le corps de l’Église, en son chef Jésus-Christ, exige que nous apportions de préférence le remède là où la maladie est plus grave et plus dangereuse. » Il prescrit donc à tous les membres de la Compagnie d’offrir des prières et des messes pour la conversion des peuples les plus menacés d’Allemagne, d’Angleterre et du Nord, et songe à leur « porter secours avec une particulière affection... Nous voulons que ces prières durent tant que les besoins de ces pays nécessiteront pareil secours. Et nous voulons qu’aucune province, même celles qui sont aux extrémités des Indes, ne soit exemptée d’exercer ainsi la charité [592] ».
Aux Indes, il faut que les compagnons prient pour la conversion des pays d’Europe et de Paris, de Louvain ou de Cologne ; on prie pour les âmes qui attendent aux confins du monde. Xavier était peut-être encore à l’Université quand mûrit dans son esprit la vision apostolique illimitée, qui lui fait dire un jour : « Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse ? Envoie-moi où tu voudras, si tu le juges à propos même jusqu’aux Indes [593]. » Il ne sera pas seulement le génial conquistador das animas, l’organisateur d’une prédication unifiée de la foi dans toutes les terres nouvellement découvertes, mais surtout un précurseur de l’apostolat missionnaire le plus moderne. En l’espace de dix ans, il trouve le moyen d’explorer les rivages les plus éloignés, de stimuler la formation d’un clergé et de cadres catéchistes indigènes ; d’enraciner le christianisme dans la mentalité des peuples païens, par l’assimilation des langues, des usages, des traditions culturelles. Ce n’est pas lui qui confondrait évangélisation avec entreprise de domination ou de colonisation.
Il mobilise pour son œuvre l’élite intellectuelle et morale des universités européennes et fait prévaloir une méthode respectueuse des valeurs de l’Orient : seuls les esprits les meilleurs, pense-t-il, seront capables de baptiser les civilisations de la Chine et du Japon et d’en épanouir toutes les virtualités. La charité désintéressée le sépare de la race des maîtres et l’incorpore aux populations qu’il évangélise. Aussi pourra-t-il, sans exagération, affirmer au roi de Portugal « que dans ces royaumes des Indes jamais un Portugais n’a été aimé comme lui [594] ». Cet ascète « avait toujours la bouche pleine de rire ».
Le regard de ces Basques mystiques, Loyola et Xavier, embrasse efficacement tout l’horizon de l’univers. Si une seconde dizaine d’années lui avait été accordée, Xavier aurait sans doute tenté de réaliser son projet de revenir en Europe à travers la Chine et le Nord de l’Asie, pour y retourner ensuite avec de nouvelles équipes de missionnaires. D’autres compagnons de Loyola sont envoyés au Brésil, au Congo, en Éthiopie. Cela au moment où Calvin, l’illustre disciple des Budé, Érasme, Valla, Danès, Vatable, rétrécit à sa mesure la vision du monde chrétien, enseignant, avec des efforts dignes d’un meilleur emploi, la réprobation inévitable de la plus grande partie de l’humanité. Un demi-siècle environ avant que le second maître de Genève, Bèze, ne déclare solennellement que « les païens sont tous coupables, que Dieu se réserve de les punir et qu’il faut les abandonner à sa justice... laissant ces longs voyages en terre païenne à ces sauterelles vomies récemment de l’enfer », aux jésuites [595]. Quand Xavier meurt, Loyola songe à lui confier le gouvernement de la Compagnie.
*
* *
Au printemps de 1535, Loyola quitte la France, sur les instances de ses compagnons, soucieux de l’envoyer dans son pays pour rétablir sa santé ébranlée et régler, en pèlerin de l’amitié, les affaires de famille de tout le groupe. Ils comptent se revoir, à Venise, dans trois ans, pour le grand départ en Palestine, fixé au printemps de 1538.
En attendant ce rendez-vous lointain, les amis parisiens, et ceux qui dans la suite s’attachent à leur manière de vivre, Claude Lejay, Paschase Broet, Jean Codure, maintiennent les liens du compagnonnage évangélique que Laynez nous décrit en ces termes : « Nous avions fait à Dieu la promesse solennelle de nous vouer entièrement à son service en toute pauvreté. Ce serment, nous le renouvelions chaque année. Nous passions alors toute la journée en plein air et dans un esprit d’étroite amitié, nous prenions un repas en commun. Nous en faisions autant dans le courant de l’année ; nous nous rendions à la demeure de l’un des nôtres, en changeant chaque fois, et nous apportions notre frugal repas. Ces visites maintenaient en nous l’ardeur spirituelle et nous unissaient par une cordiale affection. Nous nous aidions les uns les autres matériellement. Le Seigneur nous faisait alors avancer également dans nos études, vouées entièrement à la Majesté divine et à l’amour du prochain. Il régnait entre nous une amitié exquise. Nous nous efforcions de nous soutenir de toute manière dans les choses spirituelles. Cette façon de vivre nous était recommandée par maître Ignace, et lorsqu’il dut s’en aller en Espagne, sa patrie, il remit la direction à l’excellent maître Favre, comme au meilleur d’entre nous [596]. »
Dans la crainte de se voir empêchés de remplir leur promesse par la guerre engagée entre François Ier et Charles-Quint, les amis parisiens décident de devancer l’heure de la réunion à Venise. L’un de ces compagnons, Simon Rodriguez, nous a décrit certains aspects de ce voyage à travers la Lorraine et la Suisse, qui leur offrit quelques aperçus singuliers de la Réforme. Ils s’en allaient, vêtus d’une soutane d’écolier, la tête protégée par le chapeau parisien à larges bords. Dans un sac attaché sur le dos, chacun emportait la Bible, un bréviaire et des manuscrits. Leurs bagages se réduisaient au strict minimum : avant le départ, ils avaient distribué leurs biens aux pauvres. Du col pendait un chapelet, en évidence. Les gens les regardaient passer avec une curiosité soupçonneuse et chuchotaient sur leur passage : « Ils vont sans doute réformer quelque pays. » Ils voyageaient en groupes, Espagnols et Français soigneusement mélangés, joyeux et chantant des psaumes. Leur marche était si légère que, dans leur entrain, ils avaient l’impression de ne pas toucher terre [597].
Le long des routes, on raillait leur chapelet, des ministres protestants leur reprochaient leur « idolâtrie ». Ils défendaient imperturbablement leur foi. Traversant le pays de Bâle, ils déplorent la destruction des statues et des autels. Dans une auberge ils trouvent une bruyante assemblée, occupée à fêter le mariage d’un curé, qui, le sabre au côté, faisait le bouffon, brandissant son arme et poussant de grands éclats de rire. Aux abords de Constance, un curé, père d’une nombreuse famille, provoque les voyageurs dans une dispute où il n’en mène pas large contre les « maîtres » parisiens. « Comment pouvez-vous suivre des opinions que vous êtes incapable de défendre ? lui demandent les pèlerins. – Demain je vous ferai emprisonner et vous verrez si je sais défendre mon parti. » Mais le lendemain, ils étaient déjà loin de Constance.
La première chose, en arrivant dans une auberge pour l’étape, consistait « à faire un peu d’oraison, pour rendre grâces à Dieu Notre Seigneur des bienfaits reçus, puis à prendre un frugal repas, plutôt moins que plus », dit Laynez [598]. En route, ils récitent l’office, prient en petits groupes, chantent des psaumes, s’entretiennent de sujets édifiants, car leur dévotion grandit encore quand ils ne trouvent rien à manger pendant de longues journées de marche. Dans une bourgade, au seuil d’un hôpital, ils virent une pauvre femme venir à eux, baiser leurs chapelets en pleurant, tandis qu’elle expliquait en allemand la consolation de son âme. Comme les voyageurs, ignorant l’allemand, ne répondaient que par gestes, elle courut chez elle et revint les mains pleines de débris de croix et de statues mises en pièces par les hérétiques. Touchés à leur tour jusqu’aux larmes, les compagnons, à genoux dans la neige, baisèrent avec respect les pieux symboles de leur foi, que la pauvre femme remporta dans sa maison comme un trésor [599]. Le sentiment religieux de ces hommes qui déplorent la fureur des iconoclastes sera régulièrement taxé de fanatisme par les écrivains protestants. Tant il est vrai qu’on ne peut résister à la révolution sans devenir réactionnaire.
Loyola, seul dans son pays natal, ou avec ses compagnons retrouvés dans le Nord de l’Italie, exerce toutes les activités apostoliques qui sont la raison d’être primordiale de la Compagnie. À Azpeitia, en quelques mois, sans autre violence que celle de la mortification qu’il s’impose à lui-même, il réussit à supprimer les abus de la discipline ecclésiastique et les désordres moraux de ses proches et de ses compatriotes [600]. Son bref passage dans sa patrie est signalé par la cessation de procès, par la réconciliation d’adversaires acharnés, par des restitutions et des arrangements à l’amiable dont les testaments et les contrats font foi. Les pauvres, surtout les pauvres honteux, eurent spécialement à se féliciter de ses réformes. On lui doit le premier essai, en Espagne, pour remédier officiellement à la mendicité [601].
Voici le souvenir que le registre de l’hôpital de Saint-Martin a gardé de Loyola : « En l’année 1535, arriva ici... le seigneur maître Inigo de Loyola... Ce saint homme, au temps de son séjour dans la présente ville d’Azpeitia, sa patrie, fut vivement affligé des nécessités spirituelles du peuple. Préoccupé de porter remède à tous les maux... il se donna beaucoup de peine pour la conversion des pécheurs... Ce saint homme qui médite continuellement la Sainte Écriture, procura tant qu’il put que les vrais pauvres de sa patrie, qui souffraient de la faim et d’autres nombreuses nécessités, fussent efficacement secourus. Il traita de cette affaire avec le Conseil de la ville et avec les principaux habitants, et il fit les règlements et les ordonnances qu’on verra plus loin [602]... » Cette organisation méticuleuse de l’assistance sociale présente un côté paradoxal : à se soumettre à ces règlements rigides, Loyola lui-même aurait difficilement pu mener la vie aventureuse de pèlerin qu’il suivit tant d’années, et qu’il admet pour ses compagnons, volontaires de la pauvreté.
Quand les différents groupes se rejoignent à Venise, la saison est si mauvaise qu’il faut remettre le départ en Terre Sainte à des temps meilleurs. Les amis se répartissent alors dans les différents hôpitaux de la ville. Et ces docteurs, ces théologiens, ces maîtres ès arts, formaient de bonnes équipes d’infirmiers. « Avec allégresse, ils balayent la maison, dressent les lits, font la toilette des malades, leur portent les potions et la nourriture, se tiennent à leurs ordres la nuit comme le jour. Si quelque décès se présente, ils vont au cimetière, creusent la fosse, organisent les funérailles et transportent la dépouille sur leurs épaules jusqu’au champ des morts. Les malheureux dans les hôpitaux en étaient dans l’admiration. La générosité joyeuse de ces pèlerins devint, dans la ville, un objet de curiosité qu’il fallait avoir vu. Nobles, riches, marchands, notables se rendaient aux Incurables et à Saint-Jean pour contempler cette merveille [603]. » Il y avait entre eux une émulation étrange pour choisir les besognes les plus dures et les plus répugnantes. Loyola n’apprend la discreta caritas, la discrétion dans l’amour du prochain, que lentement et pas à pas, comme il fait toute chose. Autant que la pauvreté, l’héroïsme contre nature comporte des limites. En attendant cette clairvoyance dans l’exercice de la charité, on exagère, celui-ci partage la couche des lépreux, celui-là baise des plaies purulentes.
Mais combien ces folies ascétiques sont moins choquantes pour le sens chrétien que la panique des ministres genevois et de Calvin lui-même devant la peste ! À Genève, ce sont les magistrats laïcs qui doivent tancer vertement leurs pasteurs, Calvin en tête, parce que « nul d’eux n’ont la constance d’aller à l’hôpital pestilentiel, combien que leur office porte de servir Dieu et à son Église aussi bien en prospérité que en nécessité jusqu’à la mort [604] ». En dehors de la Vénérable Compagnie, il y aurait bien l’un ou l’autre volontaire, tel Castellion, qui fut peut-être écarté parce que Calvin ne tenait pas, en lui confiant cette charge redoutable, à en faire un pasteur et ensuite un rival héroïque. Bèze a trouvé une manière élégante de rétablir le prestige de son maître : en célébrant son courage et en salissant la mémoire de Castellion, qui, à l’en croire « se serait impudemment désisté [605] ». Ignace de Loyola et ses compagnons, non seulement réalisent le minimum de la charité qui exige d’aider le prochain dans l’extrême nécessité, mais affrontent spontanément et, en quelque sorte, inutilement les pires dangers de contagion. Combien de ses disciples succomberont, comme le jeune prince Louis de Gonzague, ce « martyr de la charité », au service des pestiférés.
La politique turque et vénitienne rendant impossible le voyage en Terre Sainte, il ne restait qu’à essayer sur place le compagnonnage qu’on voulait pratiquer au milieu des infidèles, en Orient. Ils parcourent donc les différentes villes de l’Italie, par groupe de deux ou trois, chacun exerçant, à tour de rôle, les fonctions de supérieur. Comme le dit la première esquisse officielle, le premier statut de la Compagnie, la formula Instituti de 1540, ils veulent se consacrer à l’enseignement du catéchisme aux enfants, à l’instruction des simples, aux œuvres de charité spirituelle et matérielle. Ce n’est que sur la demande instante du chef de l’Église et des évêques qu’ils se chargent de missions plus considérables, en qualité de professeurs, de visiteurs apostoliques, de conseillers ecclésiastiques.
Avant de posséder la langue italienne, ils commencent à prêcher, « pour se mortifier », sur les places où les gens s’attroupent et observent avec curiosité ce mélange de mots étrangers italianisés et d’improvisations ferventes [606]. Les auditeurs se laissent toucher par l’ardeur communicative de Xavier, par la sérénité paisible de Pierre Favre, par la délicatesse de Lejay et la fougue de Bobadilla. Ces prêcheurs campent dans des abris de fortune et dans des masures en ruines. Ainsi, par exemple, tandis que Laynez et Favre se dépensent à mendier et à enseigner le peuple, « Ignace faisait l’office de cuisinier, pour autant qu’il y avait quelque chose à cuire [607] ». Loyola montrait même beaucoup de goût et de savoir-faire dans la préparation de ces pique-niques [608]. Il fallait parfois dormir sur de misérables paillasses, à deux sous la même couverture, le frileux rivalisant de générosité pour supporter le froid aussi bien que le fiévreux endurant le chaud [609]. Quand ils sont à bout de forces, ils se reposent en des vacances d’un nouveau genre, comme à Vicence, où ils vaquent à l’oraison pendant quarante jours pour se refaire la santé.
Tout en stimulant ses amis à l’héroïsme, Loyola ne se départait jamais d’une affection chaleureuse et délicate. Pour courir au secours de son ami Rodriguez, malade à Bassano, Ignace, malade lui-même, fait trente milles à pied, avec une forte fièvre, si pressé que Favre, bien portant, parvenait difficilement à le suivre [610]. Malgré un souci aristocratique et espagnol de la distinction et de la tenue, il avait un don remarquable pour mettre tout le monde à l’aise, les malades pour lesquels jamais rien n’était trop coûteux, les jeunes compagnons intimidés ou étourdis, qu’il gâtait de prévenances [611].
Cette bonté virile et clairvoyante ne rayonne pas seulement au sein de la Compagnie. En temps de disette, des milliers de pauvres seront intelligemment secourus ; les filles de joie, les pauvres femmes que la misère oblige presque à tomber dans le désordre, trouvent dans l’œuvre imaginée par Ignace, de Sainte-Marthe, la « Compagnie de la grâce », une occasion de se réhabiliter. Bien loin d’hypnotiser Loyola, les luttes confessionnelles semblent, pendant longtemps, étrangères à sa pensée. Il n’a de regard que pour des initiatives constructives : enseignement du peuple et de la jeunesse, apostolat auprès des Maures et des Juifs romains, création d’orphelinat, de refuge, d’œuvres de bienfaisance et surtout les Exercices, pour lesquels il est dénoncé une septième et huitième fois à l’Inquisition [612].
« Je me donne tout entier à communiquer à d’autres les Exercices spirituels aussi bien dans Rome qu’au dehors. Je le fais pour avoir quelques hommes instruits dans notre parti, je veux dire dans le parti de l’honneur et de la gloire de Dieu Notre-Seigneur ; car, après tout, nous n’avons pas d’autre but que la louange et le service de sa divine Majesté, et nous souhaitons de ne pas être autant contredits par le monde afin d’avoir plus de liberté pour prêcher la parole de Dieu [613]. »
Le succès de la retraite ignacienne est surprenant aussi bien pour transformer profondément l’esprit d’une élite capable d’y consacrer trente jours de solitude, que pour remuer les foules inertes et indifférentes. Les Exercices ne sont pas encore imprimés, mais les copies se multiplient et circulent par l’Italie. Demain, ce sera le roi de Portugal qui demandera, par l’entremise de Xavier, d’en obtenir un exemplaire [614]. Des hommes éminents, après avoir accepté le risque de suivre les Exercices, peut-être par simple curiosité, en sortent changés et enthousiastes : tels le cardinal Contarini, ou l’agent de Charles-Quint, Pierre Ortiz, ou l’ami de Vittoria Colonna, le représentant de Sienne, Lazare Tolomei, et bien d’autres [615]. Un vaste mouvement de missions et de retraites populaires se déclenche, sous l’influence de Laynez et de Favre à Parme, de Broet et de Rodriguez à Sienne. Partout où ils passent, nous dit H. Bernard, les compagnons suscitent une curiosité pareille à celle qui, naguère, accompagnait les montreurs de mystères [616].
En attendant l’arrivée de ses amis à Venise, Loyola écrivait : « Je pense rester encore une année ici. Ce que Notre-Seigneur veut faire de moi après, je l’ignore [617]. » Exact pour contrôler les résultats de ses expériences et pour en tirer profit, il aborde les situations nouvelles sans parti pris, comme s’il allait à l’aventure. Il regarde agir ses compagnons et n’apprend pas moins qu’en consultant ses propres souvenirs. Ils délibèrent souvent ensemble, fraternellement ; ils mettent tout en commun et s’éclairent mutuellement. À la différence de Calvin qui a tendance à tout juger et décider par lui-même, Loyola écoute volontiers et ne fait valoir son point de vue que s’il est sûr de représenter l’idéal de tous et la volonté de Dieu.
II
RÉALISATIONS APOSTOLIQUES
Épanoui par l’amour, le penseur le plus simple élargit ses premières vues étriquées. L’action charitable développe en lui le sens de l’universel, qui s’atrophie au contraire chez un génie « mal aimé ». Aux buts limités du voyage en Palestine et des tournées de pèlerinage, succèdent les perspectives sans bornes ; Loyola et ses amis veulent aider tout le monde, « aussi bien les Turcs que les Maures, les juifs et les chrétiens, les païens, les savants et les ignorants, les petits et les puissants, les riches et les pauvres [618] ».
Après les expériences de l’apostolat social et populaire, ce sont les milieux intellectuels et le clergé qui révèlent à Laynez, à Favre, à Lejay et à Salmeron, leur besoin urgent de réforme et de culture chrétienne. Bientôt l’influence de ces hommes gagne les régions éloignées, les classes dirigeantes des provinces frontières déjà entamées par le protestantisme. Sans l’avoir cherché, les compagnons sont amenés à se mesurer avec les hérétiques. Comme ils ne s’en tirent pas mal, on les emploie volontiers dans ce travail de défense. Avec bien d’autres missionnaires contemporains, comme les capucins, ils sont entraînés, malgré eux, dans les remous de la Contre-Réforme. Ce qui ne signifie nullement que cette intervention soit la raison d’être de leur existence. Le mot de « Contre »-Réforme conviendrait bien mieux pour désigner l’opposition protestante que pour caractériser l’effort positif et homogène de la réforme catholique.
Les compagnons de Loyola vont être mêlés toujours plus activement aux mouvements d’idées, aux évènements d’importance européenne. Ils maintiennent tout naturellement la forme de vie que l’on avait toujours reconnue jusque là comme légitime : l’ancien équilibre de la cité chrétienne, les traditions religieuses, les valeurs culturelles et sociales et leur encadrement politique. À une époque où tous les domaines se compénètrent, le renouveau spirituel s’appuie spontanément sur l’autorité et la puissance des gouvernements établis. Loyola apprécie la valeur de l’exemple qui vient de haut et les services que les princes et les chefs d’État peuvent rendre à la cause religieuse. Il adopte même, dans un chapitre des Constitutions, le principe d’Aristote et de Thomas d’Aquin que « plus le bien est universel, plus il est divin », pour persuader les siens de se concilier l’appui des influences les plus larges et les plus décisives en faveur de la réforme [619]. C’est d’ailleurs la méthode d’apostolat que les réformateurs protestants utilisent systématiquement. Mais on chercherait vainement, dans la vie et dans l’œuvre de Loyola, une politique, un programme de gouvernement aussi personnel que celui qui apparaît dans les Ordonnances et l’Institution de Calvin, et qui s’exprime encore plus clairement dans les épreuves de force de l’histoire genevoise.
Ni pour fonder sa Compagnie, ni pour étendre son œuvre, Loyola n’eut besoin de recourir à l’agitation et à la violence. Le mendiant, habitué à la vie de samaritain volontaire et de catéchiste occasionnel, n’a plus qu’un goût absolument désintéressé pour les affaires. De même qu’il a quitté librement l’armée et la scène publique de son pays, il veut que sa Compagnie, « pour être libre de s’adonner aux choses spirituelles, se tienne à distance des affaires du siècle [620] ». Il défend aux siens de se laisser impliquer dans les procès et les intrigues politiques. « Dans la Compagnie, il ne faut pas que l’on incline de préférence vers l’un ou l’autre parti qui pourrait exister entre les princes chrétiens. Mais que par la charité, on embrasse plutôt, dans le Seigneur, tous les partis, même s’ils devaient s’opposer [621]. » Cette neutralité sympathique, compréhensive, ne sera pas du goût des régimes fanatiques : la Compagnie sera donc suspectée et tiraillée tour à tour par les partis au-dessus desquels sa liberté d’esprit ose se maintenir. On lui attribuera les tendances diamétralement opposées : la nouveauté dévastatrice, l’aveuglement sinistre, bref tous « les noirs desseins de la réaction ».
Cependant les compagnons doivent « veiller à ne pas admettre des sentiments ou des paroles défavorables pour la nationalité les uns des autres... ils éviteront de mettre la conversation sur les disputes et les guerres entre les nations ». Le général insistera pour que les Espagnols et les Portugais soient encadrés dans leurs études par des compagnons de différentes nationalités. Il y voit un grand avantage pour le rapprochement des peuples et une chance d’enrichissement mutuel par l’échange de valeurs complémentaires [622]. Il ne viendrait jamais à l’idée de Loyola d’asseoir son autorité sur un parti de compatriotes, choisis exclusivement, comme les ministres de Calvin, en raison de leurs sympathies et de leurs affinités nationales. Les compagnons devront s’assimiler le langage, les traditions, les usages des pays qu’ils habitent. Ils parleront français en France, allemand en Allemagne, italien en Italie [623]. Ils ne seront pas exposés à la tentation du particularisme qui donne si souvent aux communautés calvinistes de Strasbourg, de Ferrare, de Francfort et surtout de Genève, l’aspect de colonies françaises, de centres d’agitation étrangère. Au contraire, les principaux ennuis que connut Loyola lui vinrent de sa résistance au nationalisme des compatriotes espagnols. Il n’y eut cependant ni sang versé, ni emprisonnement, ni violence.
Les pires attaques venant du dehors ou même du dedans ne réussissent pas à communiquer à cette âme la moindre amertume. Bronzé contre les humiliations et le mépris, Loyola ne s’occupe plus de lui-même, ni de sa dignité personnelle. L’animosité n’influe en rien sur les gestes de sa clémence ou de sa sévérité. Il est objectif et serein : « Jamais il n’a injurié quelqu’un ou ne s’est servi d’une parole méprisante [624]. » Au siècle des vociférations, ce n’est pas un mince-mérite. Le chef des compagnons reste un féodal. Le féodal a des adversaires. Mais pour lutter, il n’a pas besoin de dénigrer son antagoniste. Après l’échec de Pampelune, Loyola est plein d’estime pour les chevaliers français et ceux-ci le traitent avec les plus grands égards. Devenu chevalier évangélique et besognant pour le Roi Éternel, il aura encore davantage envie de gagner le cœur de ses adversaires. Nul désir de confondre les pécheurs ou les hérétiques, avec ce besoin rageur de les humilier qui anime régulièrement Calvin. Croisé convertisseur, Loyola est plein d’une compassion virile même pour les « infidèles ». Il n’ambitionne que de les vaincre dans le bien, en leur donnant sa foi joyeuse. Au lieu d’accabler, il réveille les énergies : le salut est offert à tout le monde. S’il faut lutter et se défendre contre le seul ennemi, le démon, « l’ennemi de la nature humaine », c’est encore, pourrait-on dire, à armes égales, sans orgueil dédaigneux. Parmi les compagnons, on semble ne reconnaître à Loyola qu’un seul parti pris. On l’appelait l’interpretatio patris : l’interprétation du Père consistait à regarder toujours le bon côté des gens et des choses, et à ne tolérer sur le prochain que des appréciations bienveillantes. Laynez admire la grande simplicité qu’il montre « en ne jugeant personne, en interprétant tout en bien [625] ».
Il ne pouvait cependant pas s’empêcher de voir l’évidence : que la Réforme avait mis en branle une révolution totale, non seulement des idées, mais des institutions. Sa violence atteignait tous les domaines, politique, social, militaire. En conseillant des princes catholiques, Loyola ne leur demande pas d’assister impassibles au bouleversement de l’équilibre de la société chrétienne. Il pense, comme tout le monde alors, que l’emploi de la force se justifie par la nécessité de maintenir les droits et l’ordre établis. On accusera demain les jésuites d’avoir attisé les luttes politiques et religieuses. On les rendrait même volontiers responsables de tout le sang versé dans les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles. Mais on oublie que la révolution battait son plein en Allemagne, en Suisse et en France, avant même que l’Ordre de Loyola n’ait pris naissance. Les bûchers, les pillages, le vandalisme des iconoclastes, le massacre des paysans allemands, les conquêtes sanglantes de Berne, etc., se situent à une époque où il ne saurait être question de jésuites.
Au mois de mai 1525, alors qu’Inigo de Loyola, revenu de Jérusalem, s’évertuait à apprendre les rudiments du latin à Barcelone, Luther lançait aux princes ce message évangélique pour réprimer la révolte des paysans : « Ayez pitié de ce pauvre peuple, poignardez, châtiez, tuez tous ceux que vous pourrez. Un homme qu’on peut convaincre de rébellion est au ban de Dieu et de l’empereur, et tout chrétien peut et doit l’égorger [626]. » On chercherait vainement pareilles envolées dans la morale « laxiste », ou dans l’ascèse « rigoriste » de Loyola. Mais parce qu’il est impossible de prouver qu’il ait fait du tort à personne, parce qu’il eut la sagesse de se tenir à distance de l’Inquisition, on le chargerait bien volontiers, lui et ses compagnons, de la responsabilité entière des guerres de religion. Pauvres jésuites : « Comment l’auraient-ils fait puisqu’ils n’étaient pas nés ? »
Ce qu’on a tant de peine à leur pardonner, c’est d’avoir enlevé aux protestants le monopole de ce mot magique de Réforme, et d’avoir, ici et là, travaillé peut-être d’une façon plus moderne et plus efficace. L’activité de ces nouveaux venus, leur compagnonnage religieux, le désintéressement et la valeur personnelle de ces preti riformati étaient le signe d’un nouvel élan dans l’apostolat catholique. Ce dynamisme représentait une force insoupçonnée avec laquelle on n’avait pas du tout compté. Le papisme, l’Antéchrist, Babylone étaient condamnés, leur fin était certaine : et voici que tout à coup, de cette Église prétendue écrasée, des missionnaires repartaient dans toutes les directions du monde, non seulement les compagnons d’Ignace, mais avec eux des ouvriers remarquables de tous les anciens Ordres et des Congrégations nouvelles. Les compagnons de Loyola étaient les éclaireurs, les routiers de ce grand mouvement de reconquête. Crime impardonnable !
À Rome, la Compagnie est mise sous la protection de Notre-Dame de la Route, della Strada. Le protestant Böhmer ne sait s’il doit admirer ou plaindre ces voyageurs infatigables : « Ils semblaient être possédés, comme les bohémiens, d’un perpétuel besoin de locomotion. Car Ignace les tenait toujours en haleine et ne leur permettait pas de se fixer pour longtemps en n’importe quel lieu. (Pourquoi alors prenait-il tant de soin de « fonder » les résidences et les collèges ?) C’est ainsi qu’il réussit à maintenir sa Compagnie toujours sous les armes et à être prêt à mobiliser toutes les forces nécessaires au premier signe du pape [627]. » Mais pour être exact, il faut noter qu’il ne s’agit pas de soldats, pas même « de l’armée du Salut », pas même de « gardes pontificaux », mais de missionnaires, dont « c’est la vocation de parcourir différents pays et de vivre sur n’importe quel rivage du monde, où l’on peut espérer le plus grand service de Dieu et le plus grand secours des âmes [628] ».
Pour des missions aussi variées, et souvent aussi délicates, que celles de pionniers, de légats et de... réformateurs, Loyola recherche une élite morale et même physique et sociale [629]. De ses routiers, il requiert un ensemble de qualités harmonieuses : en ce siècle de l’humanisme et de la Renaissance, l’équilibre de la personnalité du messager garantira tout particulièrement le succès de la Bonne Nouvelle. Un des points essentiels pour la Compagnie, c’est le choix des collaborateurs : ne conviendront comme compagnons que les sujets doués aussi bien du côté intellectuel que du côté caractère, ou du côté santé et vigueur corporelle [630]. Malgré sa généreuse bonne volonté et le prestige de son nom, le délégué de Charles-Quint auprès du Saint-Siège, Ortiz, manque des qualités sportives requises chez un compagnon : il est jugé trop corpulent pour partager les travaux de la Compagnie [631]. Choisis avec le plus grand soin, entraînés plus soigneusement encore, dans toutes sortes d’« expériments », d’aventures et d’exercices spirituels, les compagnons de la première génération de jésuites furent vraiment des êtres exceptionnels, des géants, si l’on veut en croire H. Bremond, qui ne saurait être suspect de trop les aimer.
La légende a beaucoup exagéré « le mystère et la puissance des jésuites ». On les a attribués à l’organisation, à la discipline de fer, au fanatisme, à l’absence de scrupules dans l’emploi des moyens, à des influences machiavéliques secrètes : opinions de polémistes superficiels, contents de résoudre les problèmes les plus complexes avec des formules passe-partout. Il est cependant difficile d’attribuer à la seule duperie et au charlatanisme, le renouveau moral et religieux déterminé par les Compagnons. Les pécheurs innombrables qui, sur le passage de ces hommes, se sentaient soulevés au-dessus du désordre, reconnaissaient du premier coup d’œil leur sincérité et leur idéalisme. La force et l’efficacité de la Compagnie sont dues à l’optimisme religieux qu’Ignace sut communiquer à ses amis.
Le chef lui-même réalise le type qu’il s’est fixé dans les Constitutions comme modèle du général : c’est un homme de Dieu, uni au Seigneur par une vie de prière intense, surnaturel dans toute son activité, exemplaire dans la pratique de toutes les vertus qui rendent aimable devant Dieu et devant les hommes, et surtout rayonnant par « la splendeur de sa charité » envers le prochain ; sincèrement humble, sage, maître de lui, prudent, alliant la fermeté, la droiture et la mansuétude, aussi bienveillant et désintéressé qu’il est énergique, clairvoyant, magnanime, décidé et persévérant [632]... Ignace est l’objet d’une vénération pleine de tendresse. Un témoin de tous les jours, un enquêteur méticuleux, Gonzalès de Camara, exprime l’opinion commune en disant : « Notre Père Ignace est si universellement aimé, qu’il n’y a sans doute personne dans toute la Compagnie qui n’ait pour lui la plus grande affection et qui ne soit persuadé que le Père l’aime d’un amour pareil [633]. » Xavier portait sur son cœur, jour et nuit, une signature de son Père bien-aimé et pleurait de joie en recevant de sa part, au bout du monde, quelque marque d’amitié : « Je pense en vérité que la Compagnie de Jésus n’est pas autre chose qu’une compagnie d’amour et d’union, de laquelle toute amertume et toute crainte servile doivent être tenues à l’écart [634]. »
Tout en lui prêche la joie : son visage, ses yeux rient toujours. Il n’a pas à se forcer pour être enjoué, mais bien pour ne pas laisser déborder sa gaîté intérieure à la vue de ses compagnons et du prochain qui lui donnent trop de consolation [635]. Il ne dédaigne pas l’humour. Il apprend qu’un prédicateur de renom invite quelque vieille femme à ne pas manquer son propre sermon. Loyola encourage cette candeur, et assure l’orateur que, s’il est content de lui, il lui cherchera quelque petite vieille pour aller l’entendre [636]. Le jeune Ribadeneira jette l’émoi dans la communauté par ses farces incessantes : Ignace obtient qu’il limite son esprit inventif à l’une ou l’autre trouvaille par jour. Informé des obstacles que l’archevêque de Tolède opposait sans cesse à l’activité de ses compagnons, Ignace modère leur nervosité et leur zèle trop pressé : « L’archevêque est vieux, la compagnie est jeune... », disait-il calmement.
Péguy suggère dans sa Tapisserie de sainte Geneviève, « comme Dieu ne fait rien que par compagnonnage... ». Même quand le vieux soldat, pour copier les modèles de la Légende Dorée, ou des Pères du désert, sévit avec une sévérité qui nous étonne, et prescrit une discipline méticuleuse, il n’oublie jamais le point de départ, « la loi intérieure d’amour et de charité ». Les formules de l’obéissance la plus rigoureuse sont empruntées aux habitudes monacales du moyen âge, entre autres à saint François d’Assise [637]. En les adoptant, la Compagnie de Jésus reste une compagnie de l’amitié : « societas Jesu, societas amoris », dans laquelle tout dépend, non de la crainte et de la contrainte, mais du bon vouloir libre. En théologie, comme en pédagogie et en spiritualité, les jésuites sont les défenseurs de la liberté. Ils insistent pour que tout, dans l’ordre moral et religieux, réponde à un engagement personnel et volontaire. L’« hommage de fidélité » que Dieu attend de nous est une question de grâce, et donc de complaisance amicale, irréductible aux seules notions juridiques. Aux yeux d’Ignace, le compagnonnage vécu par Notre-Seigneur et ses disciples n’est pas un côté négligeable, comme on pourrait le croire à lire Calvin : « Nous sommes indignes d’approcher familièrement de Dieu ; ce que nous confessons être très vrai [638]... » Au contraire, chez Loyola, les échanges humains et surnaturels qui caractérisaient l’amitié de Jésus pour les siens, se prolongent jusqu’à nous. « Idolâtrie » que Calvin ne saurait ni comprendre, ni admettre : « C’est ce qu’on a fait par ci-devant des Saints trépassés, car on les a exaltés jusqu’à les faire compagnons de Dieu, en les invoquant comme lui [639]. » Cependant, au nom de Jésus, Xavier et Ignace continuent à guérir des âmes et des corps malades, comme Pierre et Paul le faisaient, ou plutôt le font encore.
« Notre réformateur, dira le pasteur Max Dominicé, n’a prêté aucune attention à l’amitié de Jésus pour ces hommes (Pierre, Jacques et Jean). Ce qu’il en dit est maigre et glacial... La méfiance de Calvin à l’égard des liens de l’amitié... il ne voue aucune attention au sentiment d’amitié que Jésus porta un jour à l’homme Lazare... Il craint de diviniser les sentiments humains [640]. » Nous approchons ici du cœur du problème. Le Sauveur de Loyola est vraiment Dieu et vraiment homme : il nous sauve dans la mesure où il s’incarne en nous. L’idée centrale du système de Calvin est peut-être la divinité de Jésus-Christ, mais cet idéal désincarné est une construction sur laquelle son auteur garde tous les droits. Ainsi, rien d’étonnant que le premier pas de Calvin à Genève tende à imposer à tout le monde ses idées, sa discipline, sa police ecclésiastique, alors que la dernière étape à laquelle Loyola se résigne, c’est d’accepter l’autorité que ses compagnons lui confient. Un des disciples les plus indépendants d’Ignace, Simon Rodriguez, a libellé ainsi le vote par lequel fut choisi le général : « Il m’a semblé qu’Ignace devait être élu comme notre Supérieur et recteur. Et j’affirme que je n’ai été persuadé dans ce sens, ni directement, ni indirectement, par aucun homme, mais librement et spontanément, ainsi que vous le ferez aussi, je pense. Jusqu’ici, il n’y a pas eu entre nous la moindre ambition [641]. » Tous étaient bien de cet avis, à ceci près que Loyola aurait volontiers laissé à un autre le soin de commander.
Cependant, une fois convaincu de la mission que la volonté de Dieu lui dicte par le vote répété de ses compagnons et par d’autres signes manifestes, il commande en chef, sans tergiverser, mais paternellement et avec amour. Ce mobile exclusif lui donne le droit d’exiger beaucoup de ceux qui font profession d’aimer Dieu et le prochain de toutes leurs forces : « Celui-là n’aime pas Dieu de tout son cœur, dira-t-il, qui aime quelque chose pour soi et non pour Dieu [642]. » Il rappellera donc, en toutes circonstances, la nécessité de « sortir de soi », de s’oublier en s’adonnant aux œuvres de charité « les plus basses, les plus contraires à la nature... comme de servir les pauvres, les infirmes ». Obéir, ce n’est pas subir, ni simplement se soumettre à une discipline, mais vouloir ensemble, en mettant en commun toutes les initiatives et tous les efforts. « Pour ceux qui veulent, dira-t-il, rien n’est difficile, surtout dans les choses que l’on entreprend pour l’amour de Notre-Seigneur [643]. » C’est cet amour de base qui seul justifie l’organisation de la Compagnie et sa transformation en Ordre régulier qui « ne maintiendra son unité et sa cohésion que par le lien du seul amour de Jésus-Christ ».
Tel est le centre de la personnalité ignacienne, la garantie de l’esprit de corps et de l’amicale obéissance : « Bienheureux ceux qui ne sont pas divisés, bienheureux ceux qui regardent vers le ciel avec leurs deux yeux [644] ! » La simplicité de cette attitude libère une capacité d’action, un esprit inventif qu’expriment naïvement ces vers du mystique jésuite J.-J. Surin :
« Je veux aller courir parmy le monde...
J’ai pris l’humeur d’une âme vagabonde
Après avoir tout mon bien dépendu...
De tous les maux je ne fais plus que rire,
Je suis exempt de crainte et de désir ;
S’il faut avoir le meilleur ou le pire,
Je m’en remets à qui voudra choisir...
Allons, amour, au plus fort de l’orage...
Je veux parler à la face des rois,
Je veux paraître en ce monde un sauvage
Et mépriser ses plus sévères lois.
Je ne veux plus qu’imiter la folie
De ce Jésus qui, sur la Croix un jour,
Pour son plaisir, perdit honneur et vie,
Délaissant tout pour sauver son amour [645]. »
Les vagabonds de cette mystique très ancienne et toujours nouvelle emportèrent du premier coup les suffrages de la chrétienté traditionnelle. La Compagnie existe à peine comme Ordre religieux, elle n’a encore que des promesses de développement et d’approbation officielle, et déjà, de toutes parts, on réclame son intervention. Les prêtres « réformés » étaient, semble-t-il, assez rares à cette époque pour apparaître comme une curiosité. Ce fut un véritable engouement. Les compagnons faisaient grande impression et le sillage de leur influence ne mit que peu de temps à s’élargir. Le délégué de Charles-Quint suggère de les employer pour les pays du Nouveau Monde. Jean III de Portugal, mis en éveil par Diego de Gouvea, l’ancien principal de Sainte-Barbe, insiste, par son ambassadeur au Vatican, pour se réserver les missionnaires de Loyola. L’ambassadeur Mascarenhas demandait six compagnons : « Nous ne sommes que dix, répondait Loyola, si vous m’enlevez six compagnons que me restera-t-il pour le reste du monde [646] ? » Il lui en accorda deux, mais tout de suite les renforts s’annoncent abondants.
Car les Exercices donnés à Rome, à Parme, à Lisbonne, font de véritables pêches miraculeuses. Des novices de valeur se présentent dans tous les pays que sillonnent les routiers d’Inigo : beaucoup d’Italiens, d’Espagnols, de Portugais, mais aussi des Français, des Belges, des Allemands. En parcourant l’Europe, en visitant les villes impériales, comme délégué du pape ou de l’empereur, Favre, Lejay, Bobadilla attirent des jeunes gens idéalistes, dont les plus extraordinaires, sans doute, seront le second apôtre de l’Allemagne, Canisius, et le vice-roi de Catalogne, François de Borgia. Les étudiants de l’Ordre qui vont se former à Paris, à Louvain, à Rome ou à Cologne, gagnent les sympathies de jeunes intellectuels et même de savants, comme Postel, qui se rallient à la Compagnie. Partout des amis influents, des rois, des princes, des hommes d’Église et même de grandes dames, exagèrent encore le mouvement de faveur qui porte les cœurs vers la formule ignacienne. Les remous produits par des oppositions mesquines, comme celle du pape Caraffa, de l’archevêque de Tolède Siliceo, du dominicain Melchior Cano, au lieu de l’arrêter, favorisent encore la marée montante des vocations [647].
Il ne fallait pas moins que cette expansion rapide pour répondre à toutes les missions qu’on veut leur confier. Les papes et les évêques demandent des théologiens, des conseillers, soucieux de reprendre la formation du clergé et des élites : Laynez, Salmeron, Lejay, Canisius seront ces réformateurs, et leurs avis seront entendus jusqu’aux sessions du concile de Trente. Dans tous les pays d’Europe, et jusqu’aux Indes, les collèges surgissent à une cadence accélérée : Coimbre, 1542 ; Alcala, 1543 ; Valence, 1544 ; Valladolid, Candie et Barcelone, 1545 ; ensuite Tivoli, Burgos, Gubbio, Messine, Pérouse, Bologne, Ferrare, Evora et Goa... À travers l’empire, les compagnons réorganisent les hautes écoles d’Ingolstadt, de Dillingen, de Vienne, de Prague [648].
Tous ces efforts sont constructifs, même les travaux d’approche du monde protestant. Pierre Favre s’était déjà formé, en 1540, sur l’Allemagne, le jugement suivant : les disputes et les controverses sont vaines. Il faut reconstituer les cadres d’un clergé digne de confiance. Ignace et Canisius l’approuvent entièrement. La création du Collège Germanique, à Rome, répond à ce vœu et à cette nécessité : donner aux peuples catholiques d’Allemagne des prêtres instruits et zélés. Le Collège romain, l’actuelle Université Grégorienne (1551), fut le modèle d’autres séminaires. Les résultats remarquables du collège germanique et hongrois inspirent les collèges anglais, irlandais, nordique. Tous ces établissements suivent plus ou moins le modus parisiensis, la pédagogie des collèges parisiens, adaptée aux circonstances.
Au moment où les anciennes écoles refusent de renouveler leurs méthodes, les princes et la bourgeoisie trouvent un intérêt multiple à encourager les nouveaux, éducateurs, modernes et parfaitement organisés. Le succès des écoles confessionnelles, à cette époque, est général. Mais bien différent est l’esprit de Sturm ou de Melanchthon en Allemagne, celui de Loyola et de ses compagnons dispersés par le vaste monde et celui de Calvin à Genève. Bèze lui-même ne pourra maintenir les étroitesses de Calvin [649]. Dans les collèges des jésuites, les écoliers affluaient « à grandes hardes », voire, au grand scandale des synodes, maints fils de réformés. Le collège de Paris atteignit bientôt 1300 élèves, celui de Dijon 700, de Dôle 800, de Billom 1500. Les collèges s’imposaient pour deux avantages qui ne pouvaient laisser insensibles les bourgeois réalistes : la gratuité – les jésuites sont en effet les inventeurs de l’« école unique » – et la qualité de leur enseignement [650].
À peine née, la Compagnie s’occupe des écoles, comme si l’enseignement était sa seule raison d’être. D’autre part, elle pousse le travail missionnaire en Mauritanie, au Congo, aux Indes, au Japon, au Brésil, en Éthiopie et dans toutes les parties de l’empire portugais et espagnol, comme si l’évangélisation lointaine était sa tâche principale. Elle consacre enfin des forces si importantes au ministère de la prédication, de l’apostolat intérieur, des publications apologétiques, que les protestants contenus par elle, ou refoulés, la considèrent comme le soutien le plus redoutable de la Contre-Réforme et lui vouent une affection tout évangélique...
La carrière de Loyola est bien paradoxale. Les incertitudes et la lenteur des débuts éveillent l’impression qu’il ne sait pas où il va. Il lui faut une quinzaine d’années pour devenir le chef d’un groupe de compagnons. Il lui faut encore une autre douzaine d’années pour établir la législation de son Ordre et tracer nettement les lignes de son œuvre. L’approbation pontificale se fait désirer longtemps et reste l’objet de discussions, de reprises et de surprises. La docilité du Saint-Esprit n’est pas, pour Loyola, une brillante théorie, mais un laborieux apprentissage. « Jamais il n’a compris le gouvernement comme une improvisation ou un despotisme aveugle. Avant de décider, il prend son temps pour prier. Et si absolue que soit sa confiance dans le secours d’en haut, il prend aussi le temps de réfléchir et de consulter. Dans les avis qu’il sollicite, il cherche une lumière, non le reflet de sa propre pensée ; il croit à l’utilité d’une opinion librement exprimée et il laisse aux gens qu’il interroge le loisir de la réflexion ; il penserait manquer de sens et tenter Dieu, s’il demandait d’émettre à l’improviste un avis sur quoi que ce soit... Si l’idée d’autrui apparaît meilleure que la sienne, il s’y range de bonne grâce. Il avoue l’emprunt sans crainte de se diminuer. Par qui sait-on, par exemple, sinon par lui, que l’idée des collèges est due à Laynez ? Rien n’égale la loyauté, la sagesse, l’esprit de foi avec lesquels il traite les affaires [651]. »
CHAPITRE III
Maître Calvin et sa Vénérable Compagnie
_______
I
LES INSTRUMENTS DU POUVOIR
Calvin est un météore prodigieux. Le point de départ est éblouissant, mais la suite fumeuse. Presque tout le monde, à cette époque, réclamait une réforme du christianisme, et c’était un idéal bien compréhensible que celui de vouloir ramener la chrétienté à la pureté de la foi, à la dignité et au sérieux des mœurs, à la simplicité première. Mais l’action de Calvin est beaucoup plus décevante, après coup, quand il s’efforce, envers et contre tous, de conduire à sa guise l’évolution de l’Église qui le reçoit et de toute la cité chrétienne. Le rythme qu’il imprime à l’histoire trahit désormais une volonté de puissance qu’on souhaiterait plus authentiquement religieuse.
Le nouveau Maître est « un Picard maigre, au visage long, aux traits fatigués ; son œil est bleu, son regard vif, sa barbe châtain clair, saillant sous le menton... Quand il parle, il lève l’index de la main droite [652]. » Il dicte, il définit, il donne des ordres qu’il est inutile de discuter. Sans transition, à l’anarchie et à la liberté, succèdent la discipline, le contrôle de toute la vie, l’édification uniforme obligatoire. Subitement tout a changé. Tout, d’ailleurs, s’est décidé subitement : subite et forcée la vocation, comme la conversion ; subite et forcée la mission de revenir à Genève ; rapide et forcée la codification du système, la réponse à Sadolet, la rédaction des Ordonnances. Tout semble se produire par à-coups, par éclairs de génie, par décisions inattendues. Mais une fois le fait accompli, quand le réformateur se croit installé dans le définitif, ses beaux résultats précipités sont remis en cause. Et ce ne sont pas seulement les adversaires du dehors qui doutent de la perfection de son système, mais bien les fidèles eux-mêmes, avides de saisir la première occasion venue de réexaminer une adhésion arrachée par la contrainte ou la surprise. Une peur théocratique renforcée réussit, seule, à apaiser, par asphyxie, les convulsions de cette société subjuguée.
Que le clerc ulcéré de Noyon n’ait plus éprouvé que de la colère contre l’Église qui l’a chassé, qu’il déteste des prélats et des théologiens dont l’exercice de l’autorité tient lieu de vertu et de compétence, qu’il jette au rebut les dévotions superflues, les rites et les observances de surcharge, les usages ecclésiastiques décriés par tant d’humanistes, cela ne constitue pas encore une énigme psychologique bien rare. Un révolutionnaire aurait de la peine à ne pas brûler ce qu’il a adoré. Justement, ce mépris global et ces condamnations sommaires s’imposent plus facilement aux masses que les demi-mesures et les formules nuancées. Les redresseurs de torts, les « entrepreneurs de démolition » ont la partie belle. Calvin qui est leur héritier, le successeur des tribuns et des iconoclastes, le contempteur des Anabaptistes anarchiques, sent vivement la nécessité de remonter le courant. Après avoir fait table rase, le puritain est pressé de reconstruire. Faute de mieux, dans sa hâte, il relève, presque tels quels, des piliers renversés, des fragments entiers de l’ancien édifice, repris avec plus ou moins de discernement et de goût, dans l’architecture rigide de la nouvelle bâtisse.
Mais on ne reconstruit pas sans scandale la contrepartie de ce qu’on vient à peine de détruire. Le réformateur doit déclarer la guerre aux Genevois qui viennent de mettre leur ville à son entière discrétion. Ce n’est pas la première fois que la révolution dévore ses propres enfants. Les révolutions religieuses ne montrent pas moins d’appétit que les autres. Les paysans allemands avaient déjà été abandonnés au massacre par Luther qu’ils prenaient pour leur libérateur. Quant aux Genevois, à peine émancipés de l’autorité d’un évêque bonhomme, ils goûtent immédiatement les bienfaits d’un ordre nouveau. Le 13 septembre 1541, Calvin reprend « la réforme de la vie publique par l’exercice de la discipline ecclésiastique, dont il faisait le premier mot de son programme et la condition sine qua non de sa rentrée [653] ».
Théoriquement, le 20 novembre 1541, la Cité de Dieu est achevée : les Ordonnances sont adoptées. Calvin a dressé son Église avec quatre « offices » établis par Dieu : les pasteurs, les docteurs, les anciens et les diacres. Un consistoire, conseil des pasteurs et des anciens, est chargé de la surveillance et de la censure. Tout cet appareil « évangélique » : la vénérable Compagnie des pasteurs, le corps des professeurs, le consistoire, tout est dans la main de Calvin. L’épuration qu’il projette ne peut se réaliser d’un coup. L’expérience alsacienne lui a appris que certains ménagements politiques sont encore plus efficaces que la contrainte brutale. Il procédera donc par étapes. Il lui faut une compagnie de ministres à sa dévotion, et un peuple homogène de sujets dévoués. Ce n’est qu’après avoir éliminé du corps électoral tous les éléments indépendants qu’il pourra songer à modifier la composition même de la population, en obligeant les anciens Genevois à céder la place aux étrangers, et spécialement aux Français.
Calvin est surpris lui-même de la douceur dont il est capable et voudrait que ses amis admirent la patience dont il fait preuve en ne prenant pas trop brusquement sa revanche. À son retour, il n’aurait eu qu’un geste à esquisser pour supprimer les pasteurs, plus fidèles au peuple qui les avait reçus qu’aux idées du jeune chef intransigeant. Il attend son heure. « Je n’avais pas encore en mains une constitution ecclésiastique qui me permît de les attaquer... je me résolus à supporter ce que je ne pouvais supprimer [654]. » Le légiste a besoin de se couvrir d’un texte de loi pour réaliser ses plans. Mais on peut être sûr qu’en rédigeant les Ordonnances, il n’a pas oublié ce point de vue éclairant : créer un instrument pour réduire toutes les oppositions.
Les pasteurs gênants seront, peu à peu, relégués dans des paroisses rurales, ou éloignés de manière à ne plus porter ombrage. « Les pasteurs qualifiés étaient rares, ceux qui étaient animés d’un zèle aussi ardent que le sien l’étaient encore davantage... » Calvin les change souvent et se forme péniblement une garde de compatriotes choisis peut-être moins pour leur mérite religieux ou leurs capacités que pour leur docilité au maître. Les exemples de Castellion, de Fabri et de bien d’autres, montrent assez que le souci de la valeur personnelle passait après les autres considérations. Imperméable à l’ironie des choses, Calvin attribue le calme initial de la ville à un effet de sa bonté. Ses adversaires « n’osaient espérer une telle modération » ; ils doivent bon gré mal gré proclamer son indulgence... « Combien d’autres n’auraient pas eu une maîtrise pareille [655]... » Les Genevois pensaient tout simplement que cela n’était pas naturel, et « ils regardaient, nous dit Walker, ces ministres étrangers, qui apparaissaient et disparaissaient si rapidement, comme un élément factice introduit du dehors dans leur existence [656]. » Leur vocation dépend « principalement » de l’examen : « Si celui qui doit être ordonné a bonne et sainte (ou saine) doctrine. » Inutile de dire que l’influence de Calvin est déterminante pour fixer ce point et pour exercer « bonne police à entretenir les pasteurs en leur devoir [657] ».
Rien de bien mystique dans la tâche dévolue par les Ordonnances aux pasteurs et à leurs auxiliaires dans le « gouvernement de l’Église ». Gardiens de l’ordre et d’une police rigoureuse des mœurs et de la foi, leur rôle est d’abord extérieur : « Annoncer la parole de Dieu pour endoctriner, admonester, exhorter et reprendre, tant en public comme en particulier, administrer les sacrements et faire les corrections fraternelles avec les anciens et les commis. » Le règne de l’artificiel commence dans cette ville qui avait été la spontanéité même. Calvin avait « abordé sa tâche avec la promptitude d’un homme d’affaires et avec une vision très nette de ce qu’elle comportait [658] ». Mais un homme d’affaires ne change pas les âmes. Il bouleverse les habitudes, il communique autour de lui la fièvre partisane, l’« affairement ». Ce zèle factice qui bat tous les records pour le nombre des prédications, des catéchismes, des conférences et des publications, donne à Genève l’allure d’une usine confessionnelle.
Doumergue nous assure que « dès 1546, le clergé de la ville commence à être digne et uni ». Cent pages plus loin, obligé de faire face à Galiffe, il accorde de mauvaise grâce : « Plusieurs des collègues de Calvin eurent des histoires très scandaleuses, dont les détails ne peuvent entrer dans un ouvrage destiné aux deux sexes. Je pourrais en publier une en latin pour l’édification des tartuffes [659]. » Peu à peu, les plus graves désordres disparaîtront de la surface, mais avec eux les derniers restes de la liberté. En pleine Renaissance, Calvin supprime tout ce qui pourrait ressembler à de la licence, c’est-à-dire en fait, toute liberté d’opinion, de parole, de presse et d’action.
Les rouages qui assurent l’unité de la foi sont aussi efficaces que peu compliqués. Le Saint-Office n’est pas encore organisé à Rome (12 juillet 1542) que déjà un prototype perfectionné fonctionne à Genève, sauf que son champ d’action est plus étendu et son besoin d’ingérence plus aigu : le Consistoire. C’est un organisme destiné, en quelque sorte, à remplacer la conscience personnelle par une super-conscience publique, comme Oecolompade et Standonck osaient à peine le rêver. Dans un régime de parti unique, tout repose sur la doctrine du parti. Pour la contrôler, la censure du clan des pasteurs émigrés s’étendra non seulement à l’église et à l’école, mais aux conversations et aux divertissements, à la conduite de tous et de chacun, partout où un regard indiscret peut pénétrer.
Les pasteurs sont aussi surveillés et n’ont qu’à bien se tenir : « Premièrement faut noter, disent les Ordonnances, qu’il y a des crimes qui sont du tout intolérables en un ministre... les premiers sont hérésie, schisme, rébellion contre l’ordre ecclésiastique [660]. » Or la pensée d’un seul est sûre. Calvin est persuadé que ses vues, et les siennes seulement, sont toujours fidèles à la Bible. C’est la Cause de Dieu qu’il défend : il ne saurait tolérer le moindre relâchement. Même quand il s’égare, quand il blesse visiblement la charité ou la vérité, c’est par excès de zèle. Mais qui oserait le lui dire ? Il prend non seulement au sérieux, mais au tragique sa fonction « épiscopale ». Rien n’est négligé pour assurer la plus grande pureté dans la doctrine et la plus grande correction dans les mœurs. Une volonté aussi tenace de supprimer d’un coup toutes les erreurs et tous les abus ne s’était peut-être jamais vue. Malheureusement cette immense bonne volonté fait fi de l’expérience vécue et trop peu d’amour l’anime.
Suivant un idéal abstrait, il faut rendre les fidèles parfaits, coûte que coûte, dans le minimum de temps possible. Il faut vite s’assurer les moyens de contrôle et d’influence, installer les hommes de son choix aux leviers de commande, forger un instrument de gouvernement d’abord religieux et ensuite civil, qui permette d’opérer les transformations radicales. La police ecclésiastique est l’objectif principal. Calvin ne serait pas revenu à Genève si on ne la lui avait pas garantie préalablement. C’est par ce canal que la réforme est supposée pénétrer dans les cœurs. La formation de la conscience individuelle vient après [661].
Si le crime d’hérésie, si facile à commettre, est déjà l’épouvantail des ministres et des docteurs censés capables d’avoir quelques idées personnelles, combien plus effrayera-t-il les gens du commun. Il suffit de si peu pour contracter l’impureté des anciennes superstitions. « Le nombre des personnes punies et des cas entraînant punition augmenta sans doute considérablement grâce à l’influence » du réformateur. Et le zèle délateur était vite stimulé à l’époque des sorciers et des « libertins ». « Calvin et Bernard requièrent légitime inquisition contre les hériges (hérétiques ? sorciers ?) afin d’extirper telle race [662]. » Les espions sont récompensés. Les parents eux-mêmes peuvent être dénoncés par leurs enfants. « On ne peut rien dire, écrire ou imprimer, qui aurait pu ressembler à une attaque contre le régime. » « S’il y a aucun qui fasse sédition ou assemblée pour faire soutenir querelles, il sera puni de peines plus rigoureuses selon qu’il le méritera [663]. »
Il avait bien été réservé que le Consistoire ne devait avoir « aucune juridiction civile et n’user que du glaive spirituel ». Il n’en dominera pas moins la politique genevoise. Les Genevois n’ont pas encore l’habitude de se gouverner eux-mêmes. Pour comble de faiblesse, ils n’ont plus un seul homme d’État digne de ce nom, depuis l’exécution des « Artichauts » et la mort de quelques anciens magistrats. On accepte par crainte du pire cette nouvelle autorité mystérieuse qui ramène sur la ville à peine libérée une ombre plus lourde que celle de la souveraineté savoyarde ou épiscopale. On regimbe cependant, en cachette, contre le régime de cet étranger toujours plus décidé à « contrerôler ceux de la ville et ceux du Conseil aussi [664] ».
La lutte pour le pouvoir est connue. On sait par quelles alternatives Genève et son réformateur passèrent. Maintes fois Calvin s’attend à être expulsé à nouveau. Il gémit alors : « Il y eut un temps où personne n’osait bouder les ministres. Maintenant rien ne plaît tant que de les critiquer, et Satan suscite toujours de nouvelles occasions [665]. » Calvin a pour lui un sens politique toujours à l’affût des moindres chances qui peuvent s’offrir à son parti, et une rapidité d’action qui déconcerte et subjugue, malgré eux, les Perrin, Ameaux, Berthelier, et autres adversaires maladroits. Le maître observe tout et n’oublie rien : « Chaque jour s’offrent de nouvelles occasions de le dompter (Perrin). »
Sans cesse, en effet, de nouvelles possibilités juridiques sont créées par son esprit fertile en ressources. Il intente, par exemple, un procès politique à Perrin. L’enquête se retourne contre l’homme de paille du réformateur : Maigret se trouve compromis. Calvin alors s’ingénie à ramener l’affaire sur le plan de la discipline ecclésiastique. Moyennant de « belles remontrances », par un discours acéré de pointes, il compte reprendre l’avantage en soumettant Perrin à un véritable examen de conscience, dont on chercherait difficilement l’équivalent dans l’usage monacal de la « coulpe » la plus sévère. « Quels sont les sentiments de Perrin à l’égard de Calvin ? de Poupin ? A-t-il encore de la rancune contre le lieutenant de justice Corne ? » – Perrin, croyant ne plus être un enfant, répond fièrement : « Que ce qui est dehors, Messieurs en peuvent juger, mais ce qui est dans le cœur demeure au jugement de Dieu et ne croit les avoir offensés en sorte du monde. » Belle réponse dont Calvin cherche à tirer parti pour le compromettre [666]. Car il ne tolère même pas la cinquième liberté, celle de se taire et de ne rien dire. Perrin devrait avouer tout ce qu’il a sur le cœur contre l’irréprochable Calvin. Mais il ne viendrait pas à l’idée de ce dernier d’examiner ses propres sentiments de rancune et de malveillance contre celui qu’il continue de traiter de César ridicule. Pour céder aux efforts de réconciliation de Viret, Calvin fait semblant d’oublier les torts de ses adversaires, mais en rappelant charitablement que ce sont des insensés et des perfides [667].
Aux moments critiques, quand tout semble compromis, Calvin fait donner la garde. Le « trépied d’élite » (Farel, Viret, Calvin) est prêt à affronter toutes les batailles. Le réformateur appelle ses amis, les plaideurs magnifiques, qui ne demandent qu’une occasion d’exercer leur talent, d’assouvir leur zèle pour les saintes disputes. Alors qu’il est lui-même en faute, il joue le rôle de persécuté avec un accent qui devait émouvoir Farel : « Si tu cèdes à mon conseil, tu viendras bientôt nous voir. Si cela te paraît bon, prends Viret pour compagnon de voyage. Ne fuis pas des malheureux [668]. » Les avocats de ce malheureux sont magnifiquement reçus et leurs dépens couverts aux frais de la république. Leur avis est formel : les livres de Calvin ne sauraient être soumis à la règle commune de la censure ; il est naturel que sa correspondance interceptée exprime un peu du mépris qu’il nourrit contre les autorités genevoises. Soulevé par le « trépied d’élite », Calvin se redresse comme « l’homme le plus excellent en science et en savoir, qui a remontré à beaucoup de gens, comme à Luther et Melanchthon et autres, leurs fautes [669] ».
C’est donc lui qui parlera bientôt seul au nom de l’Église. Quelle hérésie téméraire osera encore prétendre, comme le fit un jour Jean Morelli, « que le Consistoire ne pouvait rien définir ni quant à la doctrine, ni quant aux mœurs, mais seulement rapporter au peuple, auquel seul il appartenait de juger [670] ! ». Avancer une opinion aussi démocratique, c’était s’exposer aux peines les plus sévères. Pour avoir la paix, le Conseil de Genève prit l’habitude de s’adresser à lui pour tout et pour rien, comme s’il incarnait la Ville et l’Église. En 1560, cette confusion et cette servilité apparurent enfin, excessives à Viret et à Calvin lui-même qui, désormais sûrs de leur autorité, rapportent que « plusieurs gens de bien désireraient que la police ecclésiastique touchant le Consistoire soit mieux séparée de la juridiction temporelle, comme au temps de l’ancienne Église il en était ; même que autrefois, au commencement de la réformation on ne l’entendait pas ainsi... Au reste il y a une chose contenue aux Édits qui ne s’observe pas : c’est qu’on doive appeler et communiquer avec les ministres et toutefois au lieu de cela, on l’appelle lui tout seul, comme s’il était les ministres [671] ». Cette mise au point ne changera rien à la situation de fait. Calvin continue à vouloir décider de la politique intérieure et extérieure de la Cité et même à l’engager efficacement dans la tourmente des guerres de religion qui se préparent en France.
Condé et Coligny ont besoin de 6.000 écus pour payer les mercenaires allemands. Calvin ne voudrait pas refuser de les aider, mais il cherche un biais pour rendre la chose acceptable aux Genevois sans ressources. Il leur conseille une finasserie en guise de réponse ; mais cette échappatoire pourrait bien contenir un piège, dans lequel les Genevois ne sont pas encore assez puritains pour se laisser prendre : « Il serait d’avis qu’on fasse réponse que si ceux de Bâle veulent fiancer, Messieurs se constitueront rière fiances, s’assurant que ceux de Bâle ne le voudront pas faire et que par ce moyen on les pourra renvoyer honnêtement. Ce qu’étant entendu de tous a causé grande fâcherie, tant pour ce qu’il est impossible de fournir à telle somme, en cas qu’il fallût amender et que ce serait cause de la ruine de la ville, que aussi on désire de leur pouvoir assister en tout et par tout... a été résolu qu’on n’exposera pas la ville en danger outre nos facultés [672]. » Les conseillers étaient trop ingénus pour goûter le charme d’une diplomatie à ce point sinueuse.
En politique, passe encore. Mais en matière ecclésiastique, la naïveté des Genevois aura toujours de la peine à s’habituer aux manœuvres par lesquelles leur Évangéliste arrive à ses fins. C’est entendu : « Il n’avait pas de prédilection pour les ecclésiastiques indigènes [673]. » Cette litote de Roget recouvre un singulier principe : Calvin s’arrange pour évincer les hommes qui, appuyés par les sympathies du peuple, auraient pu devenir des rivaux et maintenir le parti genevois qu’il voulait abattre. Ainsi Troillet et Castellion sont écartés pour des raisons prétendues très graves que Calvin se refuse à faire connaître, préférant l’insinuation la plus lourde, dans son mystère, à une explication embarrassée. La faveur dont le candidat genevois est l’objet est comparée par Calvin à l’amour dont les guenons chérissent leurs petits... « Si le Conseil persiste dans sa résolution... il saura ce qu’il doit faire... » Insinuation vague, menace vague : combien de fois, à court de moyens, ne fait-il pas appel aux prestiges des magnétiseurs des foules [674] ! Plus encore que les Genevois leurs petits, Calvin chérit ses créatures, les réfugiés français, dont certains se révèlent de véritables imposteurs, tel ce Jacques Paul Spifame, seigneur de Passy, qui, après avoir longtemps flatté le maître en copiant ses sermons, devait mourir en 1566 sur l’échafaud, parce que faussaire, intrigant, adultère [675].
Le choix des ministres, des professeurs ou même des magistrats, relève d’une politique partisane. Que de procès de tendance, ourdis sous des prétextes religieux, pour des mobiles d’ordre personnel ou particulier ! La question d’impartialité ne se pose même pas... Il s’agit d’obtenir gain de cause, fût-ce même par des voies inqualifiables. « Il ne dédaignait pas d’employer des moyens mesquins indignes de son grand caractère, voire même des manœuvres basses, pour arriver à son but [676]. » Ameaux avait touché Calvin à la prunelle de l’œil, en mettant en garde ses compatriotes contre « les ministres français qui voulaient se rendre maîtres de la ville » : ce qui d’ailleurs devait se vérifier à la lettre. On sait à quelle peine infamante ce conseiller clairvoyant fut condamné. « Certes, il est permis de trouver, avec Roget, qu’un procès de trois mois était démesurément long, et le châtiment infligé bien disproportionné, pour des propos de table que celui qui les avait tenus n’avait fait aucune difficulté de rétracter [677]. » Ce n’était qu’un de ces nombreux « libertins genevois qui, avant travaillé, peiné, risqué leur vie pour l’indépendance de Genève, ne voulaient pas se voir dérober le fruit de leurs efforts par un étranger qui venait leur imposer une nouvelle manière de vivre. Ils ne voulaient pas du régime disciplinaire, c’est-à-dire de l’inspection incessante des mœurs et de la conduite par le Consistoire... à l’égard des fournées de nouveaux bourgeois pris dans les rangs des réfugiés pour grossir le nombre des amis de Calvin, leur mot d’ordre était : « Genève aux Genevois [678]. »
Du fait de la fraternité calviniste, les franchises des bourgeois, les habitudes et les relations entre concitoyens libres et entre voisins du même pays, subissent des transformations profondes. Des classes de nouveaux venus se constituent, tissant un réseau d’intrigues entre les villes hospitalières, se créant des privilèges et des facilités de parvenus. Qu’on songe au bouleversement des traditions familiales provoqué par le nouveau droit matrimonial, et les encouragements distribués par les réformateurs à ceux qui « quittaient tout » pour la cause de la foi, avantageuse aussi aux coureurs d’aventures. Le sens pratique de Calvin est toujours en éveil. En apprenant le scandale de sa belle-sœur, il songe immédiatement au parti que son frère Antoine pourra en tirer : « Comme cette louve habitait chez moi, nous la surprîmes en compagnie de Pierre, le Bossu. Toutefois nous nous consolons de ce chagrin par l’espoir qu’enfin le divorce rendra la liberté à mon frère [679]. »
Cependant, malgré une atmosphère assez lourde, l’esprit de corps le plus fraternel régnait dans la Vénérable Compagnie et dans la compagnie des fidèles dociles aux ordres de Calvin. Aussi longtemps qu’on évite de le contredire, on peut compter sur les signes d’une faveur très efficace. Certains prennent le parti de le flatter. De ses créatures, Calvin se fait délivrer des brevets d’orthodoxie et de bonté. Les ministres ne sont pas à une déclaration près. Ils proclameront, chaque fois que l’intérêt de la « fraternité » l’exigera, qu’ils « n’ont trouvé en lui sinon que toute charité, menant une vraie vie de chrétien, annonçant fidèlement et purement la parole de Dieu [680] ». Il obtiendra d’eux tous les mémoires qu’il voudra ; il leur fera signer des ouvrages composés par lui, contenant les plus grands éloges sur sa propre personne [681].
Il déploie en revanche un véritable génie de l’accusation. Contre ses victimes, il sait mobiliser toutes les influences et créer des courants d’opinion factices, contraires aux faits les mieux établis. Tout cède devant cette inlassable agitation. Un différent surgit entre Calvin et le Conseil. Celui-ci hésite à sévir contre de prétendus hérétiques. Excédé par les sollicitations tapageuses des prêcheurs, il cherche une diversion en consultant d’autres villes. Aussitôt, les correspondants du réformateur sont alertés et mis en campagne : « Il faudrait que votre Conseil réponde que la forme que nous avons suivie jusqu’ici (pour l’excommunication) est conforme à la parole de Dieu et qu’ensuite il désapprouve une innovation. » Réponse dictée : il est bien question d’une enquête sereine ! Le clergé qui met en branle les procès remue ciel et terre pour leur donner la plus grande publicité. Il frappe les esprits avec les exemples les plus terribles. Il dénonce, vitupère et réclame. Les laïcs en sont excédés. Mais prétendre que « les prêcheurs devraient nous laisser en paix... prêcher miséricorde et ne pas tant solliciter », c’est risquer les foudres de la Compagnie. Le Spectable Maître Calvin et les Vénérables considèrent comme leur devoir essentiel de sonner l’alarme [682].
Aussi aura-t-on rarement vu un régime plus essentiellement clérical. « Les conférences de la Vénérable Compagnie eurent souvent plus d’importance pour Genève que les réunions des conseils civils [683]. » Ce n’est pas seulement à Gaspard Favre, c’est à toute la ville que Calvin après Farel pouvait crier : « Nous sommes ici par-dessus vous. » Mais pourquoi se mettre en fureur en entendant la réplique qu’il a en quelque sorte provoquée : « Je le sais bien, par sus tous [684]. » Ce cléricalisme concentré offrait des avantages substantiels pour les ministres, forts de leur juridiction sans appel et de leurs privilèges sociaux et économiques. Du simple point de vue matériel, Castellion aurait volontiers échangé le sort de professeur contre celui de pasteur. Malgré la misère des temps, le ministre de la parole goûtait une aisance enviable [685].
Un embourgeoisement de ce clergé était inévitable. Les superlatifs et les déclarations moralisantes à l’excès contrastent avec la pratique concrète. Encore après la mort de Calvin, la peste révélera le pauvre courage des pasteurs. Étrange rigorisme, qui accable de vexations les braves laïcs et tolère, sans doute sans les voir, la médiocrité et la lâcheté des collaborateurs immédiats. Calvin a beau tout « surveiller de près » et se défier de tous : la formation morale de ses proches aboutit à un insuccès notoire. Paradoxe plus grand peut-être : des parasites hypocrites peuvent capter sa confiance et l’abuser, alors qu’il semble imperméable aux moindres reproches de la franchise [686]. Kampschulte pose brutalement la question : « À quoi bon le catéchisme et le Consistoire, à quoi bon tant de prédications et d’heures de prières, si les serviteurs de la parole, dans les moments d’épreuve faisaient défaut, spécialement quand les fidèles ont le plus besoin de consolation et de religion. » L’organisation ecclésiastique de Genève est une machine puissante, mais il semble bien que l’huile a été négligée.
L’objection se place dans une fausse perspective. Il ne s’agit pas tant, pour la mission de Calvin, de guérir des pécheurs incurables par définition que de sauver la Cause de Dieu, la Réforme. C’est là seulement que le prophète donne toute sa mesure. Il était bien question de travailler à une minutieuse formation intérieure du clergé ! Le temps des ascètes et des spirituels confits en dévotion est révolu. Plus de recherche illusoire de la perfection. Des vertus communes. La même loi pour tous : la confiance absolue, la révélation libératrice que Luther abandonnait à une société pleine de confusion. C’est toute cette société qu’il importe de refondre sur le modèle de la Bible.
II
LA RÉVOLUTION CALVINISTE
Calvin a sauvé la Réforme. Il apparaît, sous plus d’un rapport, comme le plus génial des réformateurs et un des hommes les plus influents de l’histoire du christianisme. Au moment où ce jeune réformateur entre en scène, les grands protagonistes sont ou bien disparus, ou bien arrêtés dans leur élan. À partir de 1541, aucun homme dans le protestantisme ne saurait plus se mesurer avec lui. Alors que la révolution religieuse semblait vouloir s’apaiser lentement ou s’affaisser sur elle-même, il change le désarroi général en certitude de triomphe. Plus que tout autre, ce réformateur est soulevé par des visions à la fois précises et universelles, par la confiance dans une mission providentielle, par « le souci de toutes les églises ». Son prophétisme se double d’un sens politique extraordinaire, d’un don de la propagande et de l’organisation sans pareil à cette époque, si l’on met à part le pendant catholique, Ignace de Loyola.
Calvin est le seul réformateur qui poursuive, avec un esprit de suite qui ne se dément jamais, une politique internationale protestante dont les objectifs n’ont pas dévié. Sa netteté, la sûreté de son regard et plus encore la contagion de sa certitude tiennent du prodige. Les autres ne font que tâtonner ; lui seul n’hésite jamais, ne revient jamais en arrière, n’éprouve jamais le besoin de se reprendre, encore moins de se dédire. Au milieu des remous d’opinions, du flottement des tendances, il reste ferme comme un rocher. Les grands coryphées du mouvement, Farel, Bucer, Melanchthon et Luther lui-même, ne sauront jamais aussi sûrement que lui ce qu’ils veulent et les décisions immédiates qu’exige la situation religieuse du moment.
L’autorité presque incompréhensible de sa parole et de ses écrits, l’énergie inflexible de ses résolutions ramènent la confiance dans le camp réformé, ébranlé par les divisions intérieures encore plus que par les assauts venus du dehors. Le jeune maître possède le double avantage d’une culture plus moderne et d’un esprit religieux et politique plus classique. Il sait la valeur des cadres, des garanties institutionnelles. Il connaît, mieux que personne, la nécessité d’un Credo, d’une dogmatique, de principes sévères. La doctrine réformée, qu’il définit et condense, illusionne les meilleurs, qui n’y décèlent aucune nouveauté, mais seulement la quintessence des essais évangéliques antérieurs. Après tant de déceptions et d’incohérences, la lassitude réveillait, un peu partout, la nostalgie de l’ancienne unité. À cette inquiétude générale, Calvin offre l’image d’une orthodoxie plus exigeante, une doctrine plus simple, mieux codifiée, rédigée dans une langue admirable qui, avec des traductions multiples, atteindra la plus large diffusion [687].
Sa morale puritaine était plus fière et apparemment plus idéaliste que tout ce qu’on voyait réalisé au concret dans l’histoire de la chrétienté. L’exemple de Strasbourg et de Genève, surtout admiré à distance, semblait prouver qu’une organisation très efficace de l’Église et un apostolat conquérant, un clergé solidaire, pouvaient se concevoir en dehors d’une hiérarchie traditionnelle. La cité modèle, par sa discipline rigoureuse, renchérissait sur toutes les organisations ecclésiastiques connues. La Réforme n’était donc pas vouée fatalement à l’anarchie, comme on pouvait le craindre. Elle était viable, dans la formule de Calvin, et administrait une preuve éclatante de sa vitalité. Calvin qui pense à tout, intéresse à son œuvre les rois, les chefs d’États et d’Églises. Il intervient de mille manières pour aider les persécutés, les pauvres fidèles, lointains partisans de sa révolution, en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Hongrie, en Pologne, en Suède. Il est au courant de tout. On dirait qu’il a tout prévu et préparé.
Et ce dynamisme dispose d’une arme redoutable, un esprit combatif, une passion contagieuse. Calvin incarne un plan d’action commune contre le papisme. Un feu dévorant s’attache à ses messages et soude les volontés incertaines. La crainte collective et une sainte impatience vont cimenter le protestantisme que les opinions désagrégeaient. Pour rallier les réformés, Calvin cultive l’agressivité aussi systématiquement que l’orthodoxie. Au moment où, par son dogmatisme conservateur, le calvinisme se rapproche du catholicisme, il s’en éloigne toujours plus par ses tendances affectives. Aucune réforme ne présente une telle fixité doctrinale, animée d’un tel esprit d’opposition systématique. Jamais la rupture n’avait été aussi profonde et aussi définitive. L’intervention de Calvin rend illusoires les tentatives de réconciliation, les compromis, les Interim.
Plus de colloques désormais. La polémique va encore se simplifier et raidir, c’est-à-dire fausser, les positions respectives. Il n’y a plus qu’à choisir entre « le royaume de Dieu et celui de Satan, du pape ». À un chef de révolution, en pleine mêlée, ne demandons pas des sentiments raffinés de charité. Conformément aux déclarations de guerre que lancent ses exposés doctrinaux eux-mêmes, il lui paraît tout naturel de maintenir Genève en état de siège. Genève n’est, à ses veux, qu’un camp retranché, une citadelle, une base de départ. Ce n’est pas la cité sainte du roi très pacifique, c’est le point d’appui de la contre-offensive réformée. Dans cette forteresse, toutes les énergies seront durement mobilisées en vue d’une croisade évangélique d’un nouveau genre. Tout est subordonné aux nécessités de la grande lutte engagée « contre l’Antéchrist ». Aucune opposition, aucune distraction des esprits, aucun amusement, c’est-à-dire aucun gaspillage des forces, ne sera toléré. James Paris a raison : « L’œuvre de ces glorieux ouvriers et champions de la Réforme a été une véritable révolution... Elle s’est opposée avec violence au système ecclésiastique [688]. »
Violente à l’origine, la Réforme ne manifeste aucune tendance à l’apaisement depuis que Calvin en a pris la tête. Sa violence, pour être plus réfléchie, mieux calculée, ne nous semble pas devenir plus humaine. Dans l’évolution intérieure des mystiques, l’unité se fait toujours plus grande entre la doctrine et l’homme, entre la pensée et la vie. Tel n’est pas le cas du réformateur. Il y a comme deux êtres en lui qui ne s’accordent guère : le prophète et le fils de Cauvin. La majesté souveraine du « théocrate » de Genève, qui impressionnait si fort Bèze et les partisans (sans parler des profiteurs du régime), ne put jamais cacher suffisamment un autre personnage gênant dont il faut nous occuper avec soin. Car le psychologue parie que le vrai Calvin ce n’est pas le théologien illustre qui remplit la scène du monde, mais plutôt l’homme de tous les jours. D’autant plus que son système semble fort bien pouvoir se séparer de lui, et même gagner beaucoup à cet éloignement. Car la réforme calviniste prospère et s’épanouit bien mieux au loin que dans le voisinage immédiat du réformateur, où la force seule triomphe des dernières répugnances.
Comment Calvin évolue-t-il sous les yeux tout dévoués des rédacteurs des registres genevois ? Comment se voit-il lui-même dans le miroir de sa correspondance ? Les faits quotidiens parlent un langage plus clair que les prestigieuses déclarations de principes et les nobles professions de foi. Il convient d’observer de très près les instruments de réforme mis en œuvre au centre même du calvinisme réel.
Les lettres que nous connaissons de l’évangéliste Calvin ne le flattent pas et jettent un jour étrange sur son « gouvernement », sur les méthodes de cette domination. Et encore, nous ne possédons que la correspondance expurgée et jugée par lui édifiante. Car, à la suite de certains démêlés dus à des confidences rendues publiques, le réformateur proposa à ses amis de se renvoyer mutuellement leur correspondance, afin d’examiner ce qu’on pouvait risquer de laisser voir et ce qu’il vaudrait mieux tenir secret [689]. Il réservera désormais la crème de ses colères pour les entretiens de vive voix. Il en reste cependant toujours plus qu’on en souhaiterait dans une âme touchée par la grâce de l’Évangile.
Le contraste éclatait parfois avec violence entre les exemples des prêcheurs et celui de saint Paul, qu’ils citaient infatigablement. « Il n’y a plus de saint Paul..., criait la femme de Perrin. Lorsqu’on lui faisait quelque mal, saint Paul l’endurait, tandis que si je dis quelque chose qui déplaît aux ministres, on me jette en prison [690]. » Ce n’était que trop vrai même aux yeux des simples. Au nom d’une élite intellectuelle et morale, à la Congrégation, devant une soixantaine de personnes, Castellion développait ce même parallèle que Calvin jugeait « d’une noirceur extrême ». – « Paul fut serviteur du Christ, les pasteurs se servent eux-mêmes ; il fut toute patience, eux l’impatience incarnée ; il fut maltraité dans des émeutes, les pasteurs provoquent ces tumultes ; il fut emprisonné, eux font jeter en prison quiconque les blesse d’un mot ; lui s’appuyait sur la promesse de Dieu, eux sur une force étrangère ; lui souffrait ce que d’autres lui faisaient subir, les pasteurs persécutent des innocents. » C’était sans doute réaliste. Et il n’était pas besoin d’inventer des scandales pour opposer la chasteté de saint Paul, sa tempérance, ses veilles apostoliques, aux désordres et au manque d’esprit surnaturel des ministres en fonction.
Même Calvin aurait pu s’instruire aux remarques d’un Castellion. La Congrégation n’était-elle pas d’ailleurs destinée à cela ? Non, Calvin trouve seulement ce discours « sanguinaire » et sans attendre, comme quelqu’un qui ne peut ou ne veut pas comprendre, il court immédiatement au gendarme, en l’occurrence aux syndics, comme s’il avait fallu prévenir une effusion de sang [691]... La correction fraternelle ne devait-elle jouer que dans un sens ? Les prétendues « calomnies absolument fausses » dont le réformateur se plaint n’étaient que des critiques « absolument » justifiées dans une réunion de ce genre. Curieux spectacle d’une Église où les pasteurs, prompts aux reproches violents, ne supportent rien et où les appels à la modération doivent venir régulièrement des laïcs.
On a de la peine à croire que des ministres par ailleurs très bourgeois et même peu édifiants aient pu recourir si souvent à une sévérité mesquine pour maintenir leur cléricalisme autoritaire. On est banni après avoir reçu le fouet pour s’être dérangé pendant le sermon d’un ministre. Un certain Mermet est jeté en prison parce que « oyant braire un âne, il a dit qu’il chantait un beau psaume ». Il est condamné à faire une réparation publique et banni sous peine du fouet s’il revient [692]. Le cauchemar de Calvin, c’est un peuple qui rit. Non seulement Rabelais, mais des plaisantins de cabaret, ou des commères qui se gaussent du monde au marché, au lavoir, ou dans les vignes, sont des impies et « des chiens enragés qui dégorgent leurs ordures à l’encontre de la Majesté de Dieu [693] ».
L’outrecuidance des ministres les pousse à des injustices criantes au cours de procès dans lesquels la passion rendait tout le monde aveugle. Un renversement des valeurs se produit. Alors que le moindre esprit frondeur contre l’autorité cléricale est réprimé avec la dernière rigueur, des brutalités criminelles contre le prochain ne semblent pas tirer à conséquence. C’est Roget qui en fait la remarque. « Blesser, estropier son semblable, s’il ne s’agissait pas d’un personnage haut placé, c’est à quoi on ne regardait pas de très près. » Battre sa femme était un sport fréquent, moins dangereux pour la religion calviniste que le tir à l’arc. Georges Ogier est remis devant le Conseil « pour ce qu’il est cruel à châtier une fille qu’il tient chez lui, l’ayant fouettée six jours durant, il la voulait fouetter davantage, avec ce qu’il a battu sa femme ; arrêté qu’on lui fasse bonnes remontrances [694] ». Il était temps, par un sermon édifiant, d’accorder un repos dominical à ce batteur infatigable. Une certaine Jeanne Pontoux est « condamnée à trois jours de prison au pain et l’eau, pour avoir incité les jeunes femmes à crier haut à leur fenêtre, quand leurs maris les battaient ». Cette indulgence à l’égard de pareilles brutes contraste avec la dureté réservée à des bagatelles intéressant le seul amour-propre des ministres.
Les panégyristes de Calvin célèbrent volontiers la pédagogie de Calvin et dénigrent Montaigu. On serait tenté parfois de penser que le grand fouetteur Tempeste a trouvé un émule à Genève. Ainsi quand nous lisons l’histoire de la fille de Jean Barois : les parents viennent se plaindre que « leur fille, âgée de treize ans, s’en va coucher par les rues, se veut précipiter à retraits... et veut s’en retourner à la papauté... Des voisins déposent que la fille est traitée trop durement, qu’elle est enfermée, qu’on l’a trouvée saignante. Avis de leur dire qu’ils se mêlent de leurs affaires, sans entreprendre de corriger les parents de la dite fille quand ils la reprennent... Cependant Messieurs sont priés de la mander quérir, sans faire semblant de rien, puis la mander à l’hôpital, pour être très bien fessée de verges comme elle le mérite [695] ». Le Conseil de la Ville est mobilisé par Calvin pour mettre ordre à des enfantillages : « A été proposé par M. Calvin que les enfants du Sr Lambert, avec un Allemand, sont pleins d’insolences... arrêté qu’on les appelle après dîner, pour les faire battre de verges à l’école [696]. » Le souci d’un enseignement moderne, d’un ordre plus rationnel des classes, le renouvellement des méthodes, sont des mérites, non seulement du collège de Genève, conduit par Cordier et Castellion, mais de bien des écoles inspirées de l’humanisme. La marque propre du réformateur, il serait plus juste de la chercher dans l’empreinte violente imposée aux cerveaux qui lui sont soumis. Doumergue ose louer cela, et dans ces termes : « Ils étaient bien tous coulés dans le même moule. Quel moule et quel fondeur [697] ! » Il s’agit des apprentis messagers de la bonne nouvelle sortis de la formation de Calvin ; mais la remarque s’applique à tous les degrés de cette éducation sans nuance.
Le moule était, cela va sans dire, chauffé à blanc, au feu de la colère, de la fierté et de la peur. Le dévouement aveugle à la cause que Calvin obtiendra de ses disciples ne saurait faire oublier les sacrifices au prix desquels ce résultat fut acquis. La dureté du maître manifeste une incompréhension de l’enfance et de la jeunesse qui ébahit. Le traitement recommandé par Calvin dans l’affaire des jeunes garçons sodomites en est une preuve patente. Il n’est pas sûr que Calvin ait jamais émis le vœu « de faire pendre environ 700 à 800 jeunes gens » ; mais il fit régler leur compte à un nombre suffisant de Genevois pour avoir été capables d’une aménité de ce genre [698]. La sévérité avec laquelle sont punies les légèretés des jeunes gens, et surtout des jeunes filles « conduites devant Saint-Pierre le mercredi à la sortie du sermon et mises au collier », trouve une compensation inattendue dans l’indulgence dont fut l’objet le ministre débauché Jean Fabri. Roget note : « On aurait pu croire qu’à la suite d’une aventure aussi scandaleuse, Fabri fût déchu pour toujours. » Non, après avoir été démis à Genève, il sera, sur recommandation de Calvin, chargé d’un ministère dans le Piémont [699].
Peu à peu tout le monde apprit à ne penser que par lui, à ne dire que ce qu’il permettait, à partager ses sentiments religieux, ses passions évangéliques. Une veuve ne devait pas pleurer en criant : « Jésus, Marie » ; elle ne devait pas dire « requiescat in pace » sur la tombe d’un mari, sous peine de poursuites ; il était dangereux d’opiner que le pape après tout pourrait bien être un brave homme [700]. La mode, le théâtre, les jeux, les arts sont réfrénés par un réformateur qui voit du mal partout. La garde-robe, la cuisine et la table sont surveillées de près. Incapable de supprimer les caves, le réformateur tente de transformer les cabarets en « abbayes », dans lesquelles la Bible enlèverait le goût du vin et la mouchardise le goût de la critique [701]. Ce révolutionnaire qui n’admet de directive de personne, qui bouleverse sans égard l’Église et la Cité, a un besoin de fixité tenace à l’ordre imaginé par lui comme idéal, jusque dans les relations économiques et sociales, consacrant par des règlements somptuaires les avantages des « beati possidentes », des gens de condition. « À ses yeux l’inégalité des fortunes est dans l’ordre, comme l’inégalité des conditions », et cet ordre ne devrait pas être compromis par un dangereux esprit démocratique [702].
À cet ordre géométrique Calvin sacrifie de grandes valeurs religieuses : la piété personnelle et le bon esprit. Les Genevois apprendront à ne prier que par la bouche des pasteurs, obligés qu’ils sont, dimanches et jours de semaine, d’observer ponctuellement les horaires du culte, qui n’est qu’une prédication unifiée. Les églises deviennent des lieux de réunion. Personne ne pouvait venir prier à l’église en particulier, si ce n’est avec le pasteur en répétant ses paraphrases. En dehors du prêche les églises devaient être fermées et il était même interdit de stationner aux abords du temple, toute dévotion personnelle pouvant conduire à la superstition [703]. Autant Calvin méconnaît les lois du sentiment religieux, autant il s’ingénie à forcer les consciences par des contraintes extérieures : serments, « marteaux », « grabeau », qui rivalisent avec tout ce que l’Église a jamais inventé de plus compliqué [704]. Avant d’être admis à la Cène, les fidèles devaient se procurer des jetons (des marteaux) de plomb attestant qu’ils sont instruits dans la foi calviniste, « et ceux qui n’en ont pas ne seront pas admis ». Le Conseil fit valoir que cela ne pressait pas encore, prétextant qu’on manquait de... plomb pour faire des marreaux.
Le « grabeau », ou « l’ordre pour remontrer ou soi censurer entre les Seigneurs du petit Conseil », eut apparemment plus de succès, quoique rien ne justifie l’enthousiasme ronflant de Doumergue [705]. Car cette institution calviniste, comme tant d’autres merveilles puritaines, devait vite se transformer en école de formalisme : « Nous pensons, dit Roget, que les anciens membres du Conseil devaient trouver, dans une semblable coutume, une arme puissante pour intimider les nouveaux conseillers et les détourner d’avoir trop des idées à eux. Puis, quel encouragement aux passions malveillantes que cette obligation d’une semonce mutuelle à époque fixe ! Aussi, si le grabeau ne paraît pas avoir suscité d’orages à l’intérieur du gouvernement genevois (d’ailleurs tenu au secret), c’est parce que les membres du Conseil prirent de bonne heure le sage parti de se décerner régulièrement, tous les quatre mois, un certificat mutuel de complète satisfaction [706]. »
« Ils m’ont toujours plus craint qu’aimé, et je veux bien qu’ils sachent que je suis mort en cette opinion d’eux qu’ils m’ont plus craint qu’aimé, et encore me craignent plus qu’ils m’aiment [707]. » Ce testament du réformateur exprime parfaitement l’atmosphère de confiance qui régnait, non seulement entre Berne et Genève, mais aussi entre le maître et la Vénérable Compagnie, entre le consistoire, les conseils et les fidèles. Le très bienveillant biographe Walker observe : « Si aujourd’hui, le système de Calvin nous laisse l’impression irrépressible d’une tyrannie spirituelle insupportable, il y eut des milliers de ses contemporains... auxquels il apparut comme la plus parfaite école du Christ [708]. » Sur la perfection de l’école du Christ, les élus de Calvin, quoique portés à se croire meilleurs que le reste du monde, ne devaient pas être complètement aveugles. La plupart se soumettaient, bon gré mal gré, comme on le fait en période de dictature, à un chef qui, après une révolution, renverse toutes les résistances pour établir une apparence d’ordre.
Calvin avait réussi à se rendre absolument indispensable. Tant d’intérêts se confondaient d’ailleurs avec la Réforme. L’indépendance politique entre la Savoie, Berne et la France ; la prospérité matérielle favorisée par l’établissement de riches réfugiés ; la production, c’est-à-dire la diffusion, de la littérature réformée, le renom et la fierté nationale. Dans une Genève qui avait « mal digéré son émancipation », les hommes habiles en affaires étaient rares. Calvin et certains de ses collaborateurs, comme Bèze, avaient justement ce génie de l’action politique et commerciale. Les Genevois n’avaient pas perdu l’habitude de recourir pour tout et pour rien à l’autorité. Le prince-évêque disparu, ils finirent par accepter que Calvin se substituât à leur suzerain. Il n’avait peut-être pas toutes les qualités requises pour faire un bon pontife (il s’y essaya néanmoins), mais en revanche, tout ce qu’il fallait pour jouer le rôle d’un chef d’État, camouflé sous la toge du légiste religieux.
De guerre lasse, les Genevois s’habituèrent à l’entendre dire son mot dans toutes leurs affaires. Avec le don d’intimidation qu’il possédait à un degré merveilleux, il sut si bien imposer ses avis, qu’on recourut à lui pour le choix des ministres, des professeurs et des médecins ; pour l’examen des fourneaux, pour les problèmes d’urbanisme et d’architecture, pour le nettoyage des rues et pour la construction des remparts, pour toutes les négociations diplomatiques de caractère international, pour la police du marché, pour l’ordre du guet, pour la vente du bois, du charbon, des légumes, des vins et du poisson. C’était un être exceptionnel, sans commune mesure, avec ce qu’on était habitué de voir dans les cadres d’une petite cité sans histoire, un prodige d’activité qu’on n’aimait guère, mais dont il était impossible de ne pas admirer l’adresse et la puissance [709].
Sur cette école évangélique, on ne saurait porter un jugement plus sévère que ne le fit Calvin lui-même, le jour où, sans se douter qu’il se regardait dans un miroir, il écrivait : « Ç’a été donc un acte trop téméraire et désordonné, qu’un seul homme attirant à soi la puissance commune, a premièrement ouvert la porte à une tyrannie débordée [710]. » Pour excuser ce gouvernement clérical arbitraire, qu’aucune tradition, ni aucune évolution normale ne justifiaient, il ne suffit pas de se donner à soi-même des satisfecit et d’affirmer avec suffisance la supériorité du système : « Chez nous, des édits publics et une certaine discipline répriment les désordres que tolère l’autorité pontificale [711]. » « Le fait est que l’État calviniste a voulu être un État moral [712]. » Oui, mais au prix de la conscience morale elle-même, c’est-à-dire de la liberté. Si l’on se contente de résultats faciles, on ne peut assez admirer le succès de Calvin. Les moyens employés pour rétablir l’ordre dans le peuple chrétien offrent le spectacle d’une efficacité presque totale. Mais il n’y a pas que l’efficacité visible et immédiate qui compte.
III
LA DOMINATION DE LA CITÉ
Aux heures du culte, à Genève, les églises sont pleines, les sermons plus assidûment fréquentés que nulle part ailleurs. Mais cette affluence est forcée. Aucune spontanéité dans cette ferveur craintive de bonnes volontés que la monotonie d’une liturgie austère et sombre découragerait plutôt, s’il était permis de se décourager, si le moindre laisser-aller était toléré. Les autorités religieuses et civiles sont respectées, mais les marques de déférence et de soumission sont exigées manu militari. La conduite de la jeunesse paraît édifiante, sinon irréprochable. Mais les verges et le collier d’infamie, les simulacres de bûchers étaient peut-être plus efficaces que l’enseignement de la prédestination pour assurer cette tenue et cette façade à peu près exemplaires.
Ce n’est pas à dire que les principes et les mobiles d’action proposés par Calvin aient manqué d’élévation ou de pureté. Sa méprise est plus obvie. C’est pour viser trop haut qu’il s’expose à manquer le but. C’est par angélisme qu’il devient inhumain.
Il proclame hautement la nécessité de servir Dieu seul, et purement, sans crainte, sans considération d’intérêt, en faisant abstraction même du salut personnel [713]. Mais combien de Genevois serviraient Dieu sans peur et sans reproche, si Calvin ne mobilisait contre eux son formidable appareil de contrainte ? Il en appelle régulièrement aux sentiments de confiance, à l’abandon total, à la foi inconfusible dans la Providence. Il magnifie l’idéal de la vocation chrétienne, il exalte la fierté, le sens des responsabilités, la droiture de la conscience. Des âmes très généreuses, les pionniers du puritanisme, ont vécu de ces grandes certitudes. Idées fort anciennes que la prédication courante avait sans doute le tort de croire archiconnues, qu’elle ne rappelait que pour mémoire, en les noyant dans le flot des formules toutes faites. Le verbe infaillible de Calvin les a dégagées. En les dépouillant des réminiscences routinières, du diluage dévotieux, il leur donna un relief étonnant, une puissance de choc insoupçonnée. Mais la simplification oratoire est plus facile que la simplicité intérieure. Les antithèses sublimes ne brillent souvent qu’aux dépens de la profondeur et de la plénitude.
L’insistance du réformateur sur les aspects d’une théodicée cruelle, l’écho persistant des menaces de vengeance divine, arrêtent les plus belles envolées. La bise est familière, à Genève. Mais, avec Calvin, le temps se maintient à l’orage fixe.
*
* *
Religion de parti, le cléricalisme calviniste ne pouvait fleurir qu’en s’appuyant sur la fidélité de partisans intéressés au succès de sa cause. Il faudrait appeler ce parti par son nom : le parti français. Les pensées de Calvin se tournent de préférence vers la France. Il dépend dans son idéologie, dans sa conception du droit et de la justice, de la tradition légiste française. Il commence à enseigner à Genève comme un Français et ne manifeste aucun empressement à devenir citoyen de Genève [714]. Tous ses collaborateurs dans le ministère sont des compatriotes, de même que les réfugiés, les « témoins de la foi » qu’il aide de préférence à se refaire une situation. Si l’influence du réformateur s’exerce jusque sur le développement de l’industrie et du commerce genevois, les métiers des émigrants français y trouvèrent aussi leur avantagé. Ce sont les accointances des réformateurs avec la France qui contribuent à les faire chasser une première fois [715]. Ce sont les menées de ses compatriotes émigrés qui occasionnent une grande partie des troubles aboutissant à l’extermination ou à l’expulsion des libérateurs genevois. Les Français introduits « par fournées » (« en moins d’un mois (avril-mai 1555) soixante admissions de nouveaux bourgeois, tous Français, furent prononcées, c’est-à-dire dix fois plus qu’on n’en avait fait jusque là en toute une année »), c’étaient pour Calvin des hommes « sûrs » [716]. Il peut compter sur eux et se sert volontiers de leurs rapports et de leurs délations : les principaux agents et espions de la police consistoriale se recrutent parmi les Français, permettant au maître de sévir contre les mécontents marchands genevois, qui loin de l’inquisition calviniste, à Lyon, à Bordeaux ou à Strasbourg, se laissent aller à des confidences trop libres [717]. En retour, ce qui pourrait porter atteinte à l’un de ses Français, Calvin le ressent « comme si c’était dirigé contre lui » ; et ce qui l’offense personnellement blesse la Majesté divine [718].
Ce nationalisme susceptible et envahissant fut ressenti par les Suisses comme un malaise et un danger. Dès les premiers contacts avec les chicaneurs évangéliques venus de France, Megander écrit à Bullinger : « Vois quel embarras vont nous créer ces Français superstitieux, pour ne pas dire séditieux. » Pierre Kuntz, pasteur de Berne, pensait de même que « ces têtes chaudes ne se calmeraient jamais ». Bullinger redoutait l’influence excitante que Farel et Calvin avaient l’un sur l’autre et il intervint pour séparer ces deux... chauvins [719]. Calvin et ses protégés appartiennent à cette catégorie d’émigrés qu’on voit dans toutes les révolutions ; incapables de s’assimiler à la population qui les accueille par charité, ils n’ont de repos qu’ils n’aient bouleversé les institutions locales et créé un ordre nouveau conforme au sentiment qu’ils ont de leur supériorité. Pour ce qui est de la valeur du message délivré, moyennant certaines circonstances favorables, l’idéologie d’un Ochino, ou d’un Gentilis aurait également pu faire fortune à Genève. Mais les Français occupaient déjà la place et leur chef savait exploiter systématiquement toutes les possibilités de la politique locale et internationale. « Les méchants (Genevois) pourront bien se démener tant qu’ils voudront, nous aurons la moitié des sièges. ». Le menuisier de Morges, qui disait que « Calvin joue le pape et maître Abel le cardinal », caractérisait assez bien la situation, telle que la voyaient les contemporains qui osaient encore penser et parler. Ce n’était peut-être pas un rapport littéral qui attribuait au pasteur Trepperaux ce passage de sermon : « Vous n’êtes tous que diables. Pensez-vous que ce pays soit vôtre ? – Il est à moi et à mes compagnons, et serez gouvernés par nous qui sommes étrangers, dussiez-vous grincer des dents [720]. » Le fait est que les vieux Genevois grincèrent vainement des dents en assistant, impuissants, à la conquête de Genève par la Vénérable Compagnie des pasteurs français. En attendant, « les réfugiés remplissaient les maisons qu’avaient vidées les banissements et les exils volontaires à la suite des longues querelles de partis [721]. »
Les réfugiés sont les bienvenus, comme partout où la charité est politique, dans la mesure où leur nom et leur fortune constituent une réclame pour le parti. Tous ne conviennent pas si bien pour les rôles serviles que le maître leur destine : les indépendants préfèrent encore la police bernoise. Ainsi beaucoup d’Italiens. Après le premier enthousiasme causé par l’arrivée du prestigieux orateur qu’était l’ancien général des Capucins, Ochino, Calvin sera vite gêné par son éloquence « mieux faite pour les Italiens que pour le goût des Français [722] ». Sans oser encore mettre en cause la vertu et le talent du personnage qui honore Genève, le Picard avoue aussi ingénument que peut le faire un Picard : « Je n’ai pas beaucoup de confiance dans l’esprit de la plupart des Italiens. » C’est d’ailleurs la même chose pour quiconque n’entre pas dans ses vues. S’il est question d’étendre la confession d’Augsbourg à la Réforme française, Calvin protestera : « Comment les Allemands vont-ils nous imposer la loi ? Vont-ils nous dicter comme à des enfants ce qu’il faut croire ? » C’est lui qui légifère pourtant, depuis qu’il écrit l’Institution « pour servir à nos Français », jusqu’au moment où, après avoir évincé le Vaudois Viret, il passera la main à un autre Français, au second maître de Genève, Théodore de Bèze [723].
Faut-il s’étonner dès lors que les Genevois surveillés, dénoncés par leurs hôtes, n’aient pas réussi à cacher une nervosité qui allait jusqu’à la haine : les Registres du Consistoire qui n’ont pas disparu ont retenu de nombreux échos de ces plaintes contre ceux qui « parlaient mal des Français [724] ». Les femmes surtout avaient de la peine à ne pas penser tout haut : « Ces Français sont déjà beaucoup de gens. L’Évangile est aussi en leur pays qu’en celui-ci. » Les hommes aussi maladroits que furieux ne se dominaient pas assez : « Ces Français, ces mâtins sont cause que nous sommes esclaves, disait François Favre, et ce Calvin a trouvé le moyen qu’il lui faut aller dire ses péchés... » Et Philibert Berthelier explosait en sortant du sermon où il fallait aller par force : « Calvin ne veut pas que nous toussions, mais nous p.... nous r... Je me suis battu l’épée à la main, à Lyon, pour soutenir Calvin. Maintenant je ne me couperai pas un ongle pour lui. » Pauvre manière de se donner de l’air, en face d’une équipe d’orateurs et d’intrigants très habiles, en face d’un parti solidement appuyé par la Vénérable Compagnie et le Consistoire, et surtout en face d’un chef génial, aux ressources manœuvrières inépuisables. Jusqu’à l’apaisement définitif, obtenu par l’écrasement de toute opposition, la ville respire dans l’atmosphère étouffante d’une sorte d’état de siège, soigneusement entretenue.
*
* *
La foi et la fidélité à la discipline ecclésiastique sont toutes tendues par le puissant ressort de la crainte. Calvin et ses amis recourent aux gendarmes chaque fois qu’on leur tient tête. À les en croire, la patrie est toujours en danger. Avant toute décision à prendre, avant les élections, Calvin et ses acolytes donnent l’alarme : danger, menaces extérieures, troubles et révolution, complots, tramés par les méchants sont grossis jusqu’à donner l’épouvante [725]. En particulier Calvin s’impose par la méthode toute moderne de l’exploitation des scandales et des procès, sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir. « Il semble avis aux jeunes gens que je les presse trop. Mais si la bride ne leur était tenue raide, ce serait pitié. Ainsi il faut procurer leur bien, malgré qu’ils en aient... La punition capitale qu’on a fait d’un de leurs compagnons leur a bien abattu les cornes [726]. » Il savoure son succès. Au retour de Perrin, sur l’absence duquel Calvin se permet les soupçons les plus injustes, « il faudra que lui et sa diablesse de femme filent doux [727]... ». Peu d’hommes avaient autant fait pour la Réforme à Genève qu’Ami Perrin, mais du jour où il osa soupirer contre la domination de la Compagnie de Calvin, il fut classé comme suspect et dangereux pour la république [728].
Tremblant sans cesse pour la fragilité de l’édifice qu’il avait construit hâtivement sur la base de sa seule dialectique, il veut qu’on partage ce même frisson sacré. On se mit donc à vivre dangereusement. C’est Eugène Choisy qui en fait la remarque : au temps de Calvin « si vous croyiez, comme plusieurs bons chrétiens, que le baptême des enfants n’est pas commandé par la Bible, si vous trouviez que les ministres sont des « ménestriers », qu’ils ne prêchent que les promesses et ne disent qu’« une note », si vous estimiez que l’Église est une assemblée de gens qui « vivent bien », hâtez-vous de fuir l’État chrétien de Genève, vous couriez peut-être le danger d’être pendu ou étranglé pour avoir tenu ces propos méchants [729] ». La terreur extérieure a suffisamment été décrite par les Galiffe, les Kampschulte, les Goyau. À l’école de Farel, Calvin est devenu un maître : « Terrifions les âmes des impies. » C’est un mot d’ordre que le disciple appliquera, sinon avec plus d’éclat, du moins avec plus de froide méthode. « Par ses paroles et mieux encore par ses actes, le réformateur laisse voir qu’il regarde le châtiment immérité d’un innocent comme un moindre mal que la négligence à châtier un coupable [730]. » Rien de plus efficace que ce système de gouvernement qui semble dériver d’un parti pris doctrinal : « Ce n’est pas merveille si foi et frayeur peuvent être ensemble dans l’âme du fidèle, vu qu’à l’opposite on voit bien ès iniques nonchalance et sollicitude tout ensemble [731]. » La crainte devient le principal levier du régime, le grand mobile d’action, une sorte de critère pour l’orthodoxie et la prédestination.
Une peur qu’il exploite avec prédilection, c’est celle du diable. Les réformateurs ont rempli le monde de démons à un degré inconnu du naïf moyen âge lui-même. Calvin, lui, en est obsédé. Il le voit à l’œuvre dans toutes les entreprises des adversaires de la révolution religieuse en cours. Il faut le vaincre en prêchant une sorte de terreur politique contre le démon, en supprimant en masse les boute-peste et les sorcières, en « extirpant l’hérésie », en menant une guerre sans relâche contre les moindres vestiges du « papisme ». À ses yeux, il n’y a que deux camps : celui des élus qui acceptent l’« Institution chrétienne » et celui de Satan, dont le parti est bien délimité par des frontières territoriales précises. Le démon règne sur la France, sur l’Espagne et l’Italie [732]. Rome et l’Église catholique évidemment fourmillent de démons, puisque le démon est le père des papistes et que tous les signes de l’Antéchrist sont visibles chez le pape. Celui-ci est tantôt le vicaire du diable, tantôt Satan en personne. La papauté est l’abomination de l’abîme, sa doctrine est tirée de la sentine de Satan, ses fidèles des esclaves de Satan, pareils aux Juifs et aux Turcs, pire que les Turcs. Le culte catholique est diabolique, la croix un signe de malédiction. Pour ne pas être « abandonné avec les papistes à la perdition », il faut bien se tenir sur ses gardes.
Le culte de la peur n’est que l’aspect négatif de celui de la haine, d’une haine sacrée qui trouve son expression parfaite dans les leçons si bien apprises par des âmes d’élite, telles que la duchesse Renée de Ferrare : « Quand je saurais que le roi mon père, et la reine ma mère, et feu mon mari, et tous mes enfants sont réprouvés de Dieu, je voudrais les haïr de haine mortelle et leur désirer l’enfer [733]. » En apprenant la mort de ses ennemis personnels, Calvin exulte à la manière d’un juif de l’Ancien Testament. Son assurance alors dépasse les limites de l’odieux. La femme d’Ochino se tue dans un escalier : « C’était un jugement de Dieu qui frappait dans sa maison ce vieillard impie, avant même que son crime eût éclaté au dehors [734]. » Et après l’exécution des frères Comparet : « J’ai acquis la certitude que ce n’est pas sans un jugement particulier de Dieu que les deux ont dû, contrairement à la sentence des juges, subir un long tourment sous la main du bourreau », qui, lui, était sans doute trop ému pour les décapiter correctement [735]...
La terreur théologique aboutit normalement, même chez ce très grand esprit, à la superstition. Toucher à Calvin, c’est un parricide. Berthelier et ses amis meurent, sans pouvoir se défendre, sous l’inculpation de... lèse-majesté [736]. Le prophète invoque si souvent les jugements de Dieu et interprète en fonction de cette idée des évènements si bizarres, que les Genevois ne peuvent s’empêcher de rire sous cape. Un pestiféré, buveur et vaurien, délire et va se jeter dans le Rhône : c’est un miracle satanique. Calvin le raconte longuement à son ami Viret, pour se consoler. Car ses auditeurs ne veulent pas se persuader que le diable a emporté sa proie sans laisser de traces [737]. Un homme descend à la cave pendant le sermon et se perce en tombant sur son épée : Dieu, par là, démontre et confirme la réforme calviniste. Un amant, pris de vin, tombe de la fenêtre d’une courtisane et « se casse les os en beaucoup d’endroits » ; c’est le doigt de Dieu en faveur de la Cène. Il y avait encore à Genève des esprits assez enténébrés par les restes de l’idolâtrie papiste pour ne pas se frapper des évocations infernales de maître Calvin : « Je conclus le sermon, dit-il, jusqu’à ce que les enfers vous engloutissent avec toutes vos maisons, vous n’aurez pas la foi en Dieu qui vous tend la main... ». Et après avoir tancé la sottise des fidèles qui osent sourire : « Qu’y a-t-il de plus glorieux pour nous que cette vengeance si éclatante de Dieu contre les contempteurs de notre doctrine ! Comme je le disais, cet endroit est digne entre tous d’être signalé par des exemples spéciaux du jugement de Dieu... »
On pourrait croire que la crainte est non seulement le commencement, mais la perfection de cette sagesse. C’est bien l’antithèse de l’esprit de Loyola qui disait : « Il faut veiller d’agir en esprit d’amour et non avec le trouble de la crainte [738]. » Le trouble de la peur crédule est à ce point intimement associé au sentiment religieux calviniste qu’on a pu dire : « L’esprit de crainte domine tout. » Certains racontars impressionnants, par exemple le récit de la vision d’un lac de sang qui aurait été observé en Pologne, l’émeuvent bien plus profondément qu’un Viret. Il semble à l’affût de signes providentiels. À défaut de vrais miracles, il exploite avidement les pauvres prodiges que le ciel lui envoie. Ainsi, la foudre vient-elle à tomber sur la flèche de Saint-Pierre, ce sera le signal divin pour lancer une croisade contre les croix des églises et des édifices publics, tant à la ville qu’à la campagne. « C’était honte que telle croix comme marque et enseigne de la diablerie papale fût laissée [739]. » Cette hantise du diable déchaînait des fous rires, qui attiraient de nouveaux châtiments de Dieu, c’est-à-dire de la police stimulée par les mouchards du consistoire, et ces répressions à leur tour excitaient des imprécations. Car les Genevois ne voyaient pas pourquoi ils ne pourraient pas aussi parler du diable à tout propos et hors de propos, à l’exemple des prêcheurs : Vincent Rollin est banni perpétuellement pour avoir dit que « Calvin avait le diable au corps. » Dadaz et ses amis vont en prison parce qu’ils ont poussé l’insolence jusqu’à rire au sermon ensemble « et même Dadaz a mis la cape devant la face pour rire tant mieux [740] ». Pétavel est dénoncé pour avoir exprimé cette opinion sacrilège : qu’il n’y avait que deux diables en enfer, « dont ledit Calvin en est un [741]... ».
Violenta non durant ? Le réformateur faisait un tel abus de serments, de protestations solennelles, d’appels au jugement de Dieu, d’apostrophes menaçantes : (plutôt mourir cent et mille fois !) que les déclarations les plus sérieuses, comme le serment des pasteurs, font l’effet de phrases formalistes, en regard des actes quotidiens : « Je promets et je jure... que je n’abuserai point de la doctrine pour servir à mes affections charnelles... sans donner lieu ni à haine, ni à faveur, ni à vengeance, ni à autre cupidité charnelle [742]... » Kampschulte exagère-t-il en affirmant que le système de Calvin risquait de pousser les consciences soit dans le rigorisme fanatique, soit dans l’hypocrisie servile ? Les soutiens de Calvin, Froment, Curtet, Amblard, Corne, Jean Lambert, P.J. Jesse, Bonivard étaient loin d’être irréprochables sur le chapitre des mœurs [743]. « Il n’y a, par exemple, rien de plus répugnant que la vie privée de Bonivard, qui ne se fatiguait pas de célébrer par la plume, en prose et en vers, l’œuvre de Calvin et la nouvelle Genève, mais dont les mœurs étaient une insulte directe au système calviniste. » La peur et la contrainte ne suffisent pas à soulever l’homme au-dessus de lui-même ; mais conjuguées avec un mépris et une haine sacrée des ennemis (de Dieu), elles le soulèveront au-dessus des autres.
C’est un des secrets de l’influence explosive de l’esprit puritain : Dieu demande la haine. Il faut savoir haïr saintement (d’après le ch. XIII du Deutéronome) : « Quand ton frère, ou ton fils, ou ta femme ou ton prochain dira : allons et servons d’autres dieux... que ton œil ne lui pardonne point, et ne lui fais miséricorde, et ne le cache point, mais tu le tueras, ta main sera sur lui la première pour le mettre à mort, et après la main de tout le peuple et le lapidera jusqu’à ce qu’il meure... C’est Dieu qui parle, nous assure Calvin, et voit-on clairement ce qu’il veut qu’on garde en son Église jusqu’à la fin du monde. Ce n’est point sans cause qu’il abat toutes les affections humaines dont les cœurs sont accoutumés d’être amollis. Ce n’est point sans cause qu’il chasse l’amour du père envers ses enfants et tout ce qu’il y a d’amitié entre frères et prochains... bref qu’il dépouille quasi les hommes de leur nature... pour qu’on mette en oubli toute humanité quand il est question de combattre pour sa gloire. » « L’oubli de toute humanité »... Le fanatisme chrétien, juif ou musulman, se demande F. Buisson, a-t-il jamais trouvé mieux sa formule ? En lisant cette page, en songeant qu’elle sera lue, commentée en chaire longtemps après Calvin, aux heures sinistres des guerres de religion, on pressent la redoutable influence que le commerce familier de l’Ancien Testament (lu avec les lunettes de Calvin) pourra un jour exercer sur les imaginations exaltées ; on devine tout ce qui se commettra d’inhumain pour la gloire de Dieu [744]. »
Telle était l’application concrète de cette merveilleuse « institution chrétienne », qui devait rendre à l’Évangile sa pureté originelle. Le gouvernement de Genève par la Vénérable Compagnie, l’ordre maintenu par la police du Consistoire devaient devenir, aux yeux de Calvin, « comme un luminaire auquel toutes les Églises adressées en la réformation chrétienne puissent prendre exemple [745] ».
Le peuple élu avance, subjugué, vers une Terre Promise qu’il faut chercher dans le pays de sainte Utopie plutôt que du côté de la céleste Jérusalem. Aucune erreur, aucune faiblesse, aucun abus ne sera toléré. Rien que l’Esprit et la volonté de Dieu. Rien que sa Parole et sa Justice. Tout est parfait en théorie. En pratique, n’ayant pas assez pris lui-même la « forme du Christ », Calvin imprime à tous les détails de sa Réforme la marque de sa personnalité puissante et tourmentée. Être réformé, ce sera finalement se conformer à la mentalité de Calvin. Sans vouloir se poser en modèle, Calvin risque de trouver, dans son mouvement, plus d’imitateurs de ses complexes que de ses grandes visions théologiques. Il ne recherche ni le sang ni la guerre, mais la soumission radicale à l’Éternel de toutes les réalités temporelles. Dommage qu’on l’ait trop souvent comprise comme le sacrifice « des autres ».
CHAPITRE IV
Le Général de la Compagnie de Jésus
_______
I
LA LIBRE OBÉISSANCE
L’adhésion des Genevois à la discipline de Calvin équivaut à une acceptation passive et forcée. On s’incline parce qu’il n’y a pas moyen de changer ce gouvernement autoritaire et d’échapper à la volonté de puissance de Calvin. Avant de mourir, ce grand révolutionnaire dira : « Je vous prie ne changer rien, ni innover, non pas que je désire pour moi par ambition que le mien demeure et qu’on le retienne sans vouloir mieux, mais parce que tous changements sont dangereux et quelquefois nuisent... tout ce que j’ai fait n’a rien valu. – Les méchants prendront bien ce mot : mais je dis encore que tout ce que j’ai fait n’a rien valu, et que je suis une misérable créature [746]. » Mon œuvre n’a aucune valeur, mais il ne faut rien changer : toute la prudence du réformateur s’exprime dans ce désespoir orgueilleux et dans ce pessimisme opportuniste.
Les compagnons de Loyola font la découverte de l’autorité et des avantages apostoliques de l’obéissance. Ils échangent leurs courses aventureuses, leurs improvisations contre une vie régulière ; ils échangent la faiblesse des efforts dispersés, contre la force d’un organisme cohérent, d’un « ordre » religieux dont l’action sera d’autant plus efficace que les membres seront plus solidaires, plus fraternellement unis. Mais cette coordination des énergies ne leur apparaît pas comme une non-valeur, et encore moins comme une nécessité fatale, mais comme le choix libre d’un bien meilleur, comme le moyen de développer l’amour de Dieu et des hommes.

LE « PÈRE » IGNACE
Portrait unique, exécuté le jour de sa mort (31 juillet 1556) par l’artiste florentin Jacopino del Conte, ami et pénitent de Loyola. Physionomie détendue suggérant une sérénité et une bienveillance chèrement acquises. Une endurance et une puissance d’acceptation à l’abri des surprises : un Sage.
Les Ordres religieux étaient tombés dans le discrédit. L’opinion publique, travaillée par le scepticisme des humanistes et la rancœur des transfuges, n’entendait plus que des moqueries sur les moines. La vie religieuse ne présentait aucun attrait, en ce moment, pour l’ardeur des compagnons de Loyola. Ils n’étaient qu’une poignée d’hommes, mais leur liberté d’allure leur permettait d’intervenir très efficacement, au gré des circonstances. Ils étaient beaucoup demandés. Mais les œuvres de bienfaisance, les catéchismes populaires, les conversions individuelles, les missions lointaines, l’apostolat aux frontières des régions protestantes, bref, tous ces élans d’action rapide, ne seraient-ils pas gênés par des cadres démodés ? La solution des Oratoriens ne semblait-elle pas mieux convenir à la Compagnie ? S’adonner à l’apostolat au hasard des rencontres et des besoins du moment. Laisser à l’initiative individuelle toute sa richesse, se contenter de la seule loi de la charité : Philippe de Néri ne devait-il pas réaliser de grandes choses avec cette formule ?
Pendant tout le printemps de 1539, les compagnons présents à Rome en discutèrent [747]. Ils se réunissaient chaque soir après leurs travaux et passaient en revue les inconvénients et les avantages de la vie commune. La règle n’avait que peu de chances pour elle. La mentalité de la Renaissance était orientée dans un sens diamétralement opposé. La décadence, présumée ou réelle, des instituts monastiques donnait beaucoup à réfléchir. Les hésitations furent de longue durée. Rien ne pressait pour Loyola. Son insistance ne portait que sur un point : l’examen de la question et les débats devaient être désintéressés. Il ne souhaitait rien d’autre que de découvrir, à la lumière de Dieu, si vraiment la fondation d’un nouvel Ordre religieux était bien contraire ou conforme à Sa sainte volonté. Les compagnons auraient désiré consacrer à l’étude de ce problème un mois de retraite, à la manière des premiers « Exercices ». Mais ils ne pouvaient décemment interrompre leurs prédications, leurs conférences et leurs cours de théologie.
Chacun fit du moins de son mieux pour réduire au minimum les distractions, pour se maintenir dans une attitude de recueillement et d’« indifférence », afin de réfléchir objectivement, seul, sans se laisser influencer par les autres, sans vouloir, non plus, leur imposer des réflexions partisanes. Après des semaines de méditations sur le même sujet, le problème parut à tous suffisamment analysé. Une soirée fut consacrée à l’examen des raisons opposées à l’obéissance et une autre à l’exposé des motifs favorables à ce vœu tant discuté [748]. Rien n’éclaire mieux l’esprit d’Ignace que ces longues délibérations fraternelles, durant près de trois mois, aboutissant à une décision libre, parfaitement unanime. Rien de pareil aux interventions violentes et brusquées marquant les différentes étapes de la prise du pouvoir par Calvin et son équipe à Genève. Le choix de l’obéissance est le fruit d’un élan mystique, collectif, et d’autant plus personnel qu’il exigera de plus grands sacrifices. Le secrétaire du groupe enregistre la décision de la manière suivante : « Enfin Dieu nous ayant accordé son secours, nous sommes arrivés à cette conclusion, obtenue non seulement à la majorité des voix, mais sans opposition aucune : il nous paraît plus utile et plus nécessaire d’accorder l’obéissance à quelqu’un d’entre nous, afin de réaliser mieux et plus exactement notre premier désir d’accomplir en toutes choses la volonté de Dieu, et pour que la Compagnie soit conservée plus sûrement, et enfin pour qu’on puisse pourvoir convenablement aux affaires particulières, spirituelles et temporelles, qui se présenteront [749]. » Toutes ces délibérations s’achèvent doucement, dans la joie et la concorde, par une communion fraternelle qui devait attester leur résolution « spontanée et mûrement délibérée » de renforcer leur compagnonnage par les liens de l’organisation religieuse. Les lignes fondamentales du nouvel institut furent rédigées et soumises à l’approbation du Saint-Siège, dont la réponse se fit attendre jusqu’au 27 septembre 1540. La bulle « Regimini militantis Ecclesiæ » donnait aux compagnons les premiers encouragements et la permission d’élaborer entre eux des Constitutions, sous la conduite d’un Supérieur qu’il leur fallait encore désigner. Ce n’est que le 9 avril 1541 que cette élection eut lieu. Loyola fut choisi à l’unanimité.
L’appellation plus tard courante de « Général de la Compagnie » est souvent interprétée dans un sens impropre. Il s’agit d’une vieille expression syncopée, commune pour désigner bien d’autres « supérieurs généraux ». Le terme de « général » est adjectif et non substantif. Il est synonyme d’universel et n’a aucune nuance militaire. Les publicistes qui s’en prévalent pour décrire Loyola comme un « dictateur des âmes », commettent un contre-sens et tracent une caricature d’après un faux modèle. Sous la plume de Loyola, le nom du Supérieur a une résonance toute monastique : « Prælatus, præpositus generalis » [750]. La neuvième partie des Constitutions, qui traite du gouvernement de la Compagnie avec une clarté qui ne laisse rien à désirer, montre immédiatement que Loyola a bien oublié les schèmes militaires et qu’il ne songe pas un instant à un « capitaine », mais seulement à un Père, pour diriger son Ordre. Dans le nombre des qualités requises, certaines sont plus ou moins indispensables et plus ou moins faciles à réunir sur la même tête. Mais un titre de perfection au moins ne saurait lui faire défaut : « L’amour et la bonté du Supérieur général devront, en tout cas, dépasser la commune mesure » (a lo menos no falte bondad mucha y amor) [751].
Dans la mesure où l’organisation est plus précise et plus centralisée, les contacts entre les Supérieurs et les inférieurs requièrent une confiance mutuelle croissante. Ce n’est pas un paradoxe. Un grand écrivain de l’Ordre et un fin psychologue décrit ainsi la situation de droit et de fait sur laquelle repose la « formidable organisation » des jésuites : « Le Supérieur ne peut jamais regarder le subordonné comme un numéro, ou comme un instrument inerte, mais comme une personnalité vivante, comme un confrère qu’il faut traiter avec respect et indulgence. Et l’inférieur ne regarde pas le Supérieur comme un potentat, mais comme un ami paternel, dont le pénible devoir est de porter la charge de tous les autres dans son cœur, de diriger leur avenir et de favoriser leurs travaux avec une sollicitude large et clairvoyante. Le Supérieur, le Recteur sera toujours pour le jésuite celui auquel il se confiera le plus volontiers, devant lequel il développera ses plans et ses projets, livrera ses désirs, en présence duquel il laissera ses soucis et ses chagrins se donner libre cours... Le Supérieur est dans une maison le confrère qui doit écouter chacun, sans que sa patience ou son amour puissent jamais se trouver épuisés [752]. »
La capacité d’adaptation aux circonstances, la souplesse des jésuites pour se conformer aux mentalités les plus diverses, aux hommes et aux évènements des époques et des pays les plus variés, est aussi proverbiale et décriée que leur « discipline militaire de fer [753] ». Pour réaliser tous les défauts qu’on leur prête, il faudrait qu’ils soient, en même temps, des automates et des supervivants. En fait, les compagnons d’Ignace sont simplement des religieux, soigneusement choisis, soigneusement formés et suivis, et surtout parternellement soutenus, plutôt qu’asservis par l’autorité. « Il ne vous est nullement défendu de mettre le Supérieur au courant, si vous êtes d’un avis différent du sien, et si après avoir consulté Dieu dans la prière, il vous paraît opportun de le dire [754]. » La « discipline militaire de fer » n’aurait aucune chance de durée. L’obéissance, en revanche, tient sans peine aussi longtemps qu’elle est soulevée par un grand amour : « Le lien principal qui unira d’une part les membres entre eux, et de l’autre avec la tête, c’est l’amour de Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Si les Supérieurs et les inférieurs sont bien unis à Lui, ils seront facilement unis les uns aux autres [755]. » Si la contrainte intervient, ce n’est pas pour attirer ou retenir les compagnons dans l’Institut, mais peut-être pour les obliger à le quitter.
Tout est engagement volontaire : aussi bien l’obéissance que l’ascèse. La seule chose qui est prise à contrecœur, et qui doit être imposée, c’est l’autorité, ce sont les charges et les dignités dont vraiment personne n’a envie d’être accablé. Le simple religieux se sent habituellement plus libre, en tout cas bien moins lié que le Supérieur. Et il est heureux de son sort, comme tout chrétien sincère, dans la mesure où il consent les sacrifices demandés par sa vocation. Comme le note encore Lippert, l’Ordre des jésuites, encore moins qu’un autre, ne saurait que faire de caractères mécaniques, de natures sans décision„ sans initiative, incapables de porter allègrement leurs responsabilités. En prévision de la multiplicité et de la délicatesse des tâches qui se présentent à ses compagnons, Loyola a décidé qu’« il serait utile de ne pas admettre à la profession une grande foule et des gens quelconques, mais des hommes choisis ; et cela vaut aussi pour le degré de coadjuteurs formés (prêtres des trois vœux), et celui de scolastiques (étudiants) [756] ». Le niveau de cette élite spirituelle, pense-t-il, rendra plus facile l’union et l’entente fraternelle. Loyola a le bon sens de penser que pour être pratiquement d’accord, ou même pour partager les mêmes convictions, il n’est pas nécessaire de s’entourer d’esprits étroits et fanatiques. Assez peu intellectuel pour douter de la raison raisonnante et ne pas trop se fier à son jugement, il apprécie d’autant plus les échanges de vue fraternels, et surtout les inspirations communes puisées non dans la discussion dialectique, mais dans la prière et le recueillement.
Loyola reconnaît en même temps, dans le document capital sur cette question, la « Lettre sur l’obéissance », et la nécessité de la logique, et la relativité de nos points de vue [757]. De sa nature l’intelligence se porte vers ce qui lui paraît évident. Et dans ce cas, nous n’avons pas d’autre choix que de nous soumettre à ce que nous voyons. La volonté ne peut rien contre une évidence. Mais dans combien de cas pratiques, nos intuitions ne sont ni totales, ni parfaites. Et ce sera alors de la bonne prudence, de ne pas trop se fier à sa seule prudence, et d’admettre, au moins comme plausible, comme hypothèse de travail et d’action, que les autres, en particulier le Supérieur, qui voit les choses de plus haut, pourraient bien avoir raison autant que nous, ou contre nous... Au contraire, Calvin, de l’aveu de son biographe très respectueux, J.D. Benoît, « n’était jamais effleuré par le moindre doute sur la rectitude absolue de sa pensée et de son jugement [758] ». L’attitude de Loyola nous semble beaucoup moins dangereuse : il faut savoir suffisamment douter de soi-même pour essayer de comprendre les raisons du Supérieur, à moins que, par impossible, il ne commande une chose contraire à la conscience. Dans ce cas, un religieux aurait des motifs encore plus pressants que n’importe qui pour désobéir [759].
Les compagnons de Loyola étaient habitués à de grands sacrifices : mais ils étaient sincèrement convaincus que ces sacrifices avaient un sens et un but honnête. Loin de sacrifier leur conscience, comme on l’imagine, avec une certaine perversion sadique, ils espéraient fermement la purifier, l’éclairer, la fortifier contre les illusions même les plus subtiles. Böhmer en convient loyalement : « Il est trop simple et même absolument faux de continuer à représenter tout bonnement Loyola et ses disciples, comme des réactionnaires, des gens rétrogrades, des obscurantistes. Tous étaient à la hauteur de la culture de leur temps et incarnaient un idéal de progrès bien moderne. La cure d’âme qu’ils recommandaient avait quelque chose de tout à fait nouveau. » Et il renchérit, mais en glissant toujours vers la surface externe des choses : « En ce qui concerne le recrutement, il n’y a peut-être pas une seule congrégation qui se soit montrée aussi prudente et aussi difficile, dans la réception de nouveaux membres, que la Compagnie de Jésus. Ignace ne considère comme absolument qualifiées que des personnes saines, dans la force de l’âge, d’un extérieur attrayant, d’un bon entendement, d’un caractère calme et énergique [760]. »
Considérations exactes, mais unilatérales. Parce que Loyola, conformément à l’usage ecclésiastique, n’admet pas comme ouvriers apostoliques des candidats qui seraient sans cesse gênés et gênants, parce qu’ils ont un nez vraiment trop crochu, parce qu’ils sont bossus ou difformes, il ne s’ensuit pas du tout que l’extérieur et les dons naturels aient été pour lui l’essentiel. Bien au contraire. Les qualités religieuses d’oubli de soi (d’indifférence), de dévouement, d’esprit de foi priment tout le reste ; avant même d’examiner un candidat, l’Ordre lui soumet le texte de l’« Examen Général » qui déclare avec une netteté sans ambages les exigences de l’Institut et les obligations de la vie régulière. « Le but de cette Compagnie, y est-il affirmé avant tout, c’est de s’appliquer, avec la grâce divine, au salut et à la perfection de son âme propre, et avec elle de se dépenser sans réserve au salut et à la perfection du prochain [761]. »
Les observateurs superficiels de la Compagnie sont trop habitués à la seule obéissance servile dont se contentent les services publics et militaires ; ils ne connaissent plus, sous le nom d’obéissance, que des obligations négatives, incarnées par le percepteur d’impôts et l’instructeur de l’école de recrues. Évidemment « cette obéissance-là scandalise l’homme [762] ». Et Loyola, qui avait payé assez cher sa connaissance de la psychologie militaire, avait une sainte horreur de l’obéissance mécanique, qui se bornerait à la seule exécution matérielle des ordres donnés. À force de constater qu’à Genève les plus beaux succès des Ordonnances et de toute la discipline ecclésiastique sont le résultat d’une véritable police des mœurs et de la foi, efficace dans la mesure même où elle savait se faire craindre, les historiens calvinistes imaginent difficilement la possibilité d’une obéissance libre. On les comprend si bien ! Mais Loyola s’inspirait d’autres modèles ; et tout d’abord de la fidélité féodale. Il n’aurait voulu, pour rien au monde, que ses compagnons le suivissent par crainte. La soumission même exacte et ponctuelle, accordée à contrecœur, en murmurant et sans conviction, n’avait à ses yeux aucune valeur [763]. C’est un engagement volontaire qui doit rester généreux et pur d’alliage ; car, l’inférieur comme le Supérieur, ne poursuivent pas des objectifs profanes ; ils servent librement « le Roi universel des siècles ».
Cette obéissance n’est pas d’invention ignacienne. Comme tous les religieux fidèles aux « conseils évangéliques », Loyola s’inspire de l’exemple du Christ « obéissant jusqu’à la mort ». Lui et ses compagnons savent instinctivement qu’en écoutant l’Église, ils risquent moins de s’égarer qu’en suivant le chemin de leur amour-propre. Pour dénoncer les abus de l’obéissance ignacienne, il faudrait d’abord établir par des faits précis que les jésuites ont failli gravement en exécutant des ordres formels donnés « au nom de la sainte obéissance ». Les Monod, Choisy, Doumergue, Stickelberg et tant d’autres se contentent d’incriminer cette « soumission aveugle », sans administrer la preuve des ravages qu’elle aurait exercés.
Loyola ne découvre aucune application inédite de l’obéissance. Il souligne seulement d’un trait vigoureux sa signification apostolique. Là réside son originalité : l’action commune est de nature à faciliter l’extension du royaume de Dieu, conformément au plan de salut universel, dans l’Église et par l’Église. Elle favorise l’esprit objectif et surnaturel. À travers tous les intermédiaires de l’autorité, le religieux est censé n’obéir qu’au Seigneur [764]. Les formes les plus anciennes de la vie religieuse de Basile, d’Augustin et de Benoît expriment déjà ces exigences de l’obéissance chrétienne. Quant aux symboles, Loyola puise largement dans la tradition riche en images. Les Pères du désert connaissent déjà l’exemple de la docilité spirituelle qu’on reproche à Ignace d’avoir répété : « Il faut se laisser conduire et porter comme le bâton dans la main d’un vieillard. » C’est sans doute par le canal du doux François d’Assise que Loyola apprit à expliquer « la perfection la plus haute » par l’obéissance du cadavre. Ainsi les inférieurs, à en croire le Poverello, doivent se laisser faire par les Supérieurs : qu’on les élève ou qu’on les abaisse, qu’on les déplace, qu’on les malmène, ou qu’on les honore, ils demeurent, comme des cadavres, imperturbables dans leur humilité [765]. »
Les anciens maîtres tels que Jean Climaque, Bernard, Bernardin de Sienne, Bonaventure avaient souvent commenté les mérites de l’obéissance qui, pour être dépouillée de toute malice, devrait supposer un engagement personnel. Ignace, au cours de ses lectures, s’est imprégné des leçons familières de la spiritualité médiévale depuis Cassien et Grégoire jusqu’à Thomas a Kempis. Il n’aura même pas besoin d’inventer ce raffinement qu’est « l’obéissance aveugle », puisque François d’Assise avait déjà parfaitement décrit comment l’inférieur doit accomplir non seulement ce qui est commandé expressément, mais encore ce qui n’est que pensé par le Supérieur ; et non seulement ce qui est ordonné, mais encore ce qui n’est même que souhaité. Au moindre signe de l’autorité, le Frère doit exécuter ce qu’il devine être son intention [766]. Ces idées étaient assez répandues à la veille de la Réforme pour que Nicolas de Flue ait pu les prêcher aux Bernois : « L’obéissance est la plus grande vertu qu’il y a au ciel et sur la terre [767]. »
Les historiens protestants qui abordent le vocabulaire de la spiritualité chrétienne médiévale sont tentés de se méprendre sur ses formules symboliques. Le nettoyage des iconoclastes du XVIe siècle a affaibli leur sens du mystère et notamment celui du langage figuratif. Ainsi Choisy, Doumergue et Monod ne semblent pas avoir beaucoup approfondi les signes pour déplorer, comme ils le font, dans l’obéissance des jésuites, « cette abdication totale de la volonté et de l’intelligence, qui aboutit à énerver l’initiative et l’énergie humaine... à tarir au cœur de l’homme les sources mêmes de la piété... Loyola a fondé toute sa doctrine sur un seul principe, une seule vertu, l’obéissance... » Monod sait pourtant fort bien que ce n’est pas vrai, puisqu’il ajoute, une trentaine de pages plus loin : « C’est par la charité et par l’amour mutuel que la subordination entre tous se maintiendra [768]. » Le terme franciscain « obéissance de cadavre » est-il plus dur que l’injonction du Seigneur demandant à ses disciples d’être « morts à eux-mêmes » et de « perdre leur vie pour la sauver ».
Loyola a beaucoup évolué. Il a découvert successivement les différents aspects de son idéal religieux. On ne peut, sans parti pris, ramener tout cet idéal ignacien à l’obéissance.
Loyola n’a pas moins insisté sur la pratique de la pauvreté ; celle-ci occupe sans contredit une place beaucoup plus centrale que l’obéissance dans les Exercices. Le pivot de la « réforme de vie », c’est l’humilité obtenue par la pauvreté volontaire. De l’obéissance, c’est à peine si les Exercices parlent occasionnellement. Cette mystique continue d’inspirer les Constitutions. Ainsi, outre le vœu spécial d’obéissance au pape, pour ce qui concerne les missions, – vœu qui n’ajoute rien d’essentiel à la profession, mais qui ouvre la porte à bien des commentaires plus ou moins bienveillants –, les profès prononcent un vœu supplémentaire pour accentuer encore les obligations ordinaires de la pauvreté religieuse. Ils promettent de ne rien entreprendre pour changer la législation de l’Ordre en matière de pauvreté, sauf pour la rendre, si possible, plus sévère encore [769]. Et il suffit de parcourir les fragments qui nous sont parvenus du journal spirituel d’Ignace, pour se convaincre de la tendresse qu’il éprouvait à l’égard de Dame Pauvreté. Même à côté de l’enthousiasme du Poverello, on peut encore trouver presque excessif l’amour, le jaillissement de larmes et de joie intérieure, dont s’accompagnent les méditations de Loyola sur la pauvreté [770].
Cependant, ce n’est pas un exalté qui consigne au jour le jour, pendant des mois, les mouvements de son âme souvent extatique. Le texte paisible et ordonné des Constitutions, qui dérive de ces visions et de ces grâces mystiques, ne vibre que d’une lumière sereine, n’avance qu’au rythme d’une sagesse parfaitement clairvoyante et équilibrée.
*
* *
En vingt jours, Calvin avait fini de rédiger les Ordonnances de l’Église, de la cité idéale de Dieu parmi les hommes. Loyola n’aura pas assez d’un temps cent fois plus long, de cent fois plus de réflexion et de prière, pour mettre au point la simple ébauche d’un petit institut religieux nouveau. « Dans la détermination du code de la Compagnie de Jésus, Ignace procède comme il a fait pour rédiger les Exercices, et comme il veut que le retraitant, formé par lui, fasse pour le règlement de sa vie personnelle : noter les lumières d’en haut et les leçons des faits, à mesure qu’elles se présentent. Là est la sagesse chrétienne. Un livre éclairé comme un ciel d’été, ferme comme le granit des montagnes sortira de cette lente élaboration... Codure, Xavier, Frusius, Nadal, Ribadeneira, Domenech, Ferron servent tour à tour de secrétaires... Comme tous les grands chefs, Ignace n’aimait résoudre que sur des renseignements exacts. Polanco lui servait pour ces indispensables recherches dans la législation des Ordres religieux antérieurs et pour l’adaptation du code de la Compagnie au droit canon en vigueur... Les papiers qui nous restent prouvent combien cette étude fut minutieuse à travers les constitutions des franciscains, des bénédictins, des augustins [771]... »
Mais cette perfection condensée n’est peut-être qu’un rêve impossible ? Elle ne deviendra réalité qu’après la mise au point et la contre-épreuve de l’expérience commune. Après dix ans d’efforts collectifs, quand les Constitutions eurent été rédigées, les compagnons se réunirent de nouveau à Rome, pour en prendre connaissance, pour en discuter et pour suggérer des modifications. Avec quelques amendements, le texte fut approuvé à l’unanimité. Il n’en était pas définitivement établi pour autant. Ignace se garda bien de le proclamer aussitôt comme ayant force de loi immuable. Aucune hâte, aucune fièvre dans cette entreprise. Il importe avant tout de se rendre compte si l’œuvre est viable.
Des hommes de confiance iront d’abord expliquer le code aux différentes maisons de la Compagnie déjà répandue dans de nombreux pays d’Europe. Ils s’informeront des réactions des membres qui n’ont pas pu être consultés ou qui n’avaient pas voix au chapitre. Chacun sera d’abord entendu, afin que ces Constitutions, mises à l’essai, répondent bien aux vœux personnels de tous [772]. Le sage Nadal fut spécialement chargé de cette tournée d’inspection et s’en acquitta à la satisfaction générale. Il rapporta de divers côtés les réflexions, les objections entendues, par exemple celles de Canisius sur la fondation des collèges. Et jusqu’à la fin, avec l’application d’un élève docile et d’un maître vigilant ouvert à toutes les suggestions, Ignace retouche les détails de ce chef-d’œuvre de mesure et de lucidité dont le protestant Böhmer dira : « Son auteur est sans doute un des plus grands génies organisateurs qui aient jamais existé [773]. »
Oui, la Compagnie est un organisme puissant. Mais ce ne sont ni les cadres, ni la discipline servile qui soutiennent sa force. Les compagnons formés par les Exercices et les Constitutions ne sont ni des soldats, ni des politiques, ni des machines, mais tout bonnement des religieux missionnaires. L’étrange réussite de Loyola, ce n’est pas seulement d’avoir doté son Ordre d’un appareil gouvernemental solidement articulé. Mais bien plus, d’avoir insufflé la vie, une vie spirituelle très personnelle aux membres saisis par cette organisation. À la différence d’une construction savante, dont la raideur blesse, la Compagnie est un corps souple et résistant, capable de s’adapter aux besoins légitimes, « suivant la variété des personnes, des circonstances de temps et de lieux », ainsi que le fondateur le remarque si fréquemment. Les tempêtes renaissantes n’ont pas entamé l’esprit, ni la structure de cet Ordre tenace entre tous. Attirant sur lui beaucoup d’assauts dont l’Église est l’objet, il consacre ses meilleures énergies à maintenir et à développer la Tradition. Il semble se confondre avec elle, tellement il en épouse toutes les formes, toutes les tendances même opposées : la dévotion sensible et populaire et la piété raisonnable des élites ; le renouveau biblique et patristique et la spiritualité méthodique ; l’indulgence pastorale et l’ascèse rigoureuse. À la fois défenseur de la religion personnelle et de l’orthodoxie collective, Loyola puise simplement dans la plénitude de la vie de l’Église. Il en accepte, comme un bien universel, la théologie et la philosophie, la morale et la liturgie, l’ascèse et la mystique. Son esprit ne se pique nullement d’originalité. Son imagination n’est ni curieuse, ni particulièrement inventive, mais d’autant plus féconde et créatrice pour réaliser l’ensemble des valeurs chrétiennes. Le sens de la continuité et une largeur de vue incomparable compensent une certaine pauvreté littéraire ou spéculative. Son action, mûrement réfléchie et décidée, exerça une influence profonde, non seulement par ses œuvres propres, mais à travers un grand nombre d’instituts religieux, anciens ou modernes, qui se sont inspirés de son dynamisme, voire même directement de ses Constitutions.
Attribuer tout cela au laxisme et au machiavélisme, c’est parler pour ne rien dire [774].
Les préventions que l’on nourrit contre la Compagnie se ramènent la plupart du temps aux griefs du protestantisme contre le catholicisme. L’autorité et l’unité de la foi, la discipline et l’organisation religieuse sont regardées comme des non-valeurs, ou comme des valeurs incompatibles avec la liberté de l’esprit. Beaucoup de malentendus et bien des contre-sens aident encore à exciter les animosités. Une juste appréciation, par exemple, de l’obéissance de jugement est inaccessible à qui n’en saisit que le sens littéral « d’aveuglement volontaire ». Or, elle signifie presque juste le contraire. L’obéissance aveugle suppose une clairvoyance supérieure. Loin d’appauvrir elle, doit élargir l’esprit. C’est le regard de la charité qui soumet l’intelligence particulière trop subjective et égoïste au jugement plus objectif, plus large et plus universel de celui qui est responsable de l’ensemble. L’activité de la connaissance n’est pas faussée, ni paralysée, mais au contraire stimulée à dépasser le point de vue unilatéral, à corriger des manières de voir trop peu désintéressées. C’est l’effort loyal, dans tout acte de soumission, pour aller au fond des choses et embrasser, avec les raisons du supérieur, le plus grand nombre d’aspects possibles, afin « de se conformer à la seule règle de toute bonne volonté et de tout bon jugement, la Bonté et la Sagesse éternelle [775] ».
L’accord entre le chef et les subordonnés ne peut avoir qu’un but : le bien commun à procurer par l’union des esprits et des cœurs. Un supérieur perdrait sa supériorité, s’il cessait de commander en vue du bien commun. À plus forte raison, s’il utilisait son autorité pour commettre ou faire commettre le péché. C’est dire que malgré le préjugé favorable dont jouit l’autorité, les compagnons gardent l’œil bien ouvert. La Compagnie juge, mais avec un regard bienveillant, les chefs qu’elle s’est donnés. Malgré une terminologie austère, l’obéissance, telle que la conçoit Loyola, est encore une des formes les plus humaines et les plus vivantes. Elle s’adapte si bien aux nécessités du réel que les adversaires des jésuites leur reprochent indistinctement leur discipline excessive et leur trop grande souplesse, leur liberté d’allure et leur rigidité ; ce qui n’est pas très logique.
En réalité l’obéissance ignacienne crée un climat favorable à l’épanouissement de la mystique et de l’initiative personnelle. François Xavier, que Loyola aurait volontiers désigné comme son successeur, pratique l’obéissance et exige de ses subordonnés une soumission exemplaire. Cependant le fait d’être un brillant organisateur ne l’empêche pas d’apprécier la spontanéité et l’esprit inventif des autres. Si centralisée qu’elle fût, la Compagnie lui apparaissait comme une « société d’union et d’amour » et cet amour libérait de toute crainte. Sa prière préférée exprime adéquatement l’état d’âme que le fondateur de l’Ordre cultivait avec prédilection chez les siens :
O Deus, ego amo Te... « Ô mon Dieu, je vous aime,
Je ne vous aime pas pour que vous me sauviez,
Ou bien parce que, ceux qui ne vous aiment pas,
Vous les punissez du feu éternel.
Vous, mon Jésus, tout entier
Vous m’avez embrassé sur la croix,
Vous avez supporté les clous, la lance,
Et une immense ignominie,
D’innombrables douleurs, sueurs et angoisses,
Et la mort... et cela pour moi
Et pour moi pécheur !
Comment donc ne vous aimerais-je pas,
Ô Jésus très aimant ?
Non pas pour que vous me sauviez dans le ciel,
Ou de peur que vous me damniez éternellement,
Et sans aucun espoir de récompense.
De même que vous m’avez aimé,
Ainsi je vous aime et je vous aimerai
Seulement parce que vous êtes mon roi,
Et seulement parce que vous êtes mon Dieu.
Pour apprécier la différence de climat qui existe entre la mentalité ignacienne et celle de Calvin, il peut être suggestif d’entendre comment ce dernier s’explique sur le même thème O Deus, ego amo Te... « Il est vrai que celui qui répute quel Père nous est Dieu, il a suffisante raison, voire encore qu’il n’y eut nul enfer, d’avoir plus grande horreur de l’offenser que de mourir ; mais aussi d’autre part, selon que notre chair est encline à se lâcher bride à mal faire, il est nécessaire pour la restreindre d’avoir cette cogitation en l’esprit, que le Seigneur, sous la puissance duquel nous sommes, a toute iniquité en abomination ; duquel ceux qui auront provoqué l’ire en vivant méchamment, n’éviteront point cette vengeance [776]. » Sous l’influence probable de son enfance, le grand avocat de la Réforme dit : « Le pur amour semble désirable, mais pratiquement la malédiction du péché ne saurait être conjurée que par la peur de la vengeance divine. » Le mystique dit : « Mon Dieu, je vous aime, seulement parce que c’est Vous, et je ne veux rien savoir de ce qui pourrait m’arriver. » Là, une vision angoissée des rapports entre Dieu et l’âme. Ici, l’expérience vivante que la grâce est une amitié, que la foi implique une réponse libre et un échange cordial [777].
Dans cette perspective, il est assez clair qu’il faut toujours obéir à Dieu seul. Un supérieur est encore plus tenu à l’obéissance qu’un subordonné. Rien de plus suggestif à cet égard, qu’une page personnelle servant au fondateur de la Compagnie de « memento », de programme spirituel.
Voici comment le Général entendait l’obéissance pour son propre compte :
« 1. Ne contredis personne, ni avec raison, ni sans raison, ni le supérieur, ni l’égal, ni l’inférieur. Regarde toujours comme préférable ce qui semble bon à autrui. Ne t’excuse pas, même si tu pouvais le faire à bon droit.
» 2. Pratique en toutes choses l’obéissance aveugle envers les grands et les petits, les supérieurs, les égaux et les inférieurs. Rappelle-toi que tu l’as promis au Christ.
» 3. Ne fixe jamais les fautes du prochain. Sois toujours prêt à les excuser. Et au contraire sois toujours prompt à t’accuser toi-même. Que ton désir soit d’être pénétré par le regard des autres tel que tu es intérieurement.
» 4. Ne parle pas, ne réponds pas, ne contemple pas, ne va pas en promenade, en un mot ne fais rien, sans avoir pesé si cela est agréable à Dieu, si cela peut servir à l’utilité ou à l’édification du prochain.
» 5. Conserve en toutes choses la liberté d’esprit. Ne te préoccupe pas de l’opinion des hommes, mais conserve ton esprit si libre, que, s’il le fallait, tu pourrais tout aussi bien faire le contraire. Qu’aucun obstacle ne t’empêche de la garder. Ne renonce jamais à cette liberté [778]. »
Calvin n’aurait rien perdu à pratiquer ce programme d’hygiène spirituelle, au lieu d’étouffer son génie en supprimant jusqu’à la notion de liberté. Le pasteur Benoît n’est pas le seul à le regretter et à lui préférer l’attitude d’un Vinet : « Dieu se glorifie par notre liberté... Entre la créature privée de la liberté et la créature libre, il y a un espace que ni l’œil, ni la pensée ne peuvent mesurer : elles n’ont rien de commun, si ce n’est d’avoir été créées... Dieu en créant la créature libre a atteint le sommet des créatures [779]. »
Chez Loyola la liberté et l’obéissance ne sont que deux aspects du même amour de Dieu et du prochain. Cet idéal lui tient tant à cœur qu’il porte le texte sur lui. Bien mieux, les témoins de sa vie s’accordent pour retrouver ces principes d’action inscrits dans toute sa manière d’être. C’est un principe de base ; l’humilité, la pauvreté, l’obéissance correspondent à l’amicale condescendance de Dieu, « la suave disposition de la divine Providence exigeant la coopération de ses créatures ». L’engagement volontaire occupe le centre de cette réforme, où le détachement de soi-même coïncide avec l’attachement absolu au bon vouloir de Dieu. « Je ne dois absolument plus m’appartenir, mais au Créateur et à celui qui tient sa place [780]. »
Or l’amour de Dieu multiplie ses invitations, ses appels à la docilité, à la libre obéissance. Il commande librement, comme il veut, par l’intermédiaire du cuisinier, du portier, du jardinier, du sacristain ou de l’infirmier, qui, dans leur rôle, sont aussi compétents que le pape ou l’empereur le sont dans leur vocation. À Genève, il semble souvent qu’une seule personne représente la Parole et la Volonté divine. Dans l’esprit d’Ignace le nombre des représentants de Dieu est aussi grand que celui des êtres avec lesquels la Providence lui ménage des contacts. Chacun, suivant ses fonctions, peut être appelé à lui donner des ordres au nom de Dieu. Mais il faut un cœur aimant et libre pour recevoir ces messages. Le compagnon de Jésus s’efforcera d’y répondre libéralement, dans toutes les situations de sa vie. Ici Loyola retrouve, à un niveau supérieur, tout l’élan de la piété féodale, la mentalité du chevalier chrétien dont Péguy a traduit la véritable inspiration :
Quand on a connu d’être aimé par des hommes libres,
Les prosternements d’esclaves ne vous disent plus rien...
Toutes les soumissions et les accablements du monde
Ne valent pas une belle prière, bien droite agenouillée,
De ces hommes-là [781]...
C’est ce goût de la liberté chrétienne, comprise comme une tendance à la libéralité, qui donne à Loyola et à ses compagnons leur élan et leur estime des hommes et des choses. Elle explique encore leur sens de l’adaptation et leur robuste obéissance.
II
LE GOUVERNEMENT PATERNEL
À prendre au pied de la lettre certaines formules du « Testament » de Loyola, qui ont depuis passé dans le texte des règles de l’Ordre, on pourrait penser que la passivité, l’automatisme, la soumission impersonnelle sont l’idéal rêvé par lui. On oublie le centre de visée que tous les détails désignent et rappellent : « Je dois me remettre en tout et pour tout, en todo y por todo, entre les mains de Dieu notre Seigneur... Je dois me former à l’abnégation de mon jugement et de mon esprit propres. » Dans le doute, « je dois m’en référer au jugement d’une, de deux ou de trois personnes... je ne dois pas être à moi, mais à Celui qui m’a créé et à celui qui tient sa place [782] ». Indifférence, abandon, abnégation, tout tend à la perfection, mais librement ; tout suppose l’absence d’égoïsme.
Le souci de ne pas forcer les consciences tempère l’amour d’Ignace pour la discipline. Dans le premier règlement qu’il ait établi, lors de son passage à Azpeitia, il ajoutait la restriction suivante à l’engagement des membres de la Confrérie : « Voluntariamente y non obligandose a peccato alguno : volontairement et sans s’obliger sous peine de péché quelconque [783]. » Il complète la sixième partie des Constitutions par un chapitre d’une netteté pareille. La Compagnie, nous dit-il, souhaite vivement que toutes les Constitutions soient observées exactement. Mais elle désire aussi rassurer les consciences : que personne ne se borne à obéir par peur de commettre des péchés. Aussi les Constitutions et les questions de discipline, dans lesquelles les obligations des vœux ne sont pas strictement impliquées, n’imposent pas une responsabilité sous peine de péché mortel ou véniel. Car, il faut qu’« à la peur de l’offense succède l’amour et le désir positif de toute perfection [784] ».
On ne saurait trop insister sur cette idée dominante de la liberté ignacienne, qui demain inspirera la théologie de l’Ordre dans la trop célèbre querelle « de Auxiliis ». Comme toute sagesse acquise par l’expérience, la vision du monde de Loyola a parcouru bien des étapes. Il y eut une certaine phase de don quichottisme spirituel ; ensuite une période parisienne d’idéalisme impressionniste, pourrait-on dire. Ces improvisations ne cessent pas sous l’influence du curialisme romain. Elles se plient cependant au goût latin de la forme classique qui met son empreinte sur toute l’organisation de l’œuvre. Durant cette longue préparation, tandis qu’il rassemble les matériaux épars, Loyola semblait trop céder à la fantaisie : « Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté. » Il ne savait qu’offrir, avec ses amis, les fruits du hasard et de l’aventure. Mais le moment de construire venu, il se révèle un architecte méticuleux, aussi attentif aux détails qu’aux vastes perspectives.
Mais quel fut donc le « gouvernement » de ce Général ?
C’est entendu que Loyola est un chef, mais un chef exclusivement religieux. Toutes ses intentions et les moyens employés s’efforcent d’échapper aux emprises profanes. La règle commune des jésuites leur prescrit : « Les membres de la Compagnie ne doivent pas se mêler des affaires séculières, si pieuses qu’elles puissent être par ailleurs ; cela vaut encore beaucoup plus du Général [785]. » Que rien ne le détourne de sa tâche surnaturelle : « Procurer la perfection et le secours du prochain à la gloire de Dieu. » Il n’a reçu d’autorité que pour cela. L’étendue du pouvoir est donc limitée, (est-il besoin de le dire ?) par sa nature même. Sa seule raison d’être est d’édifier, ad aedificationem : le bien des âmes et de l’Église, le bien spirituel de la Compagnie dans son ensemble et dans chacun de ses membres [786]. L’Ordre doit exercer un contrôle sur son chef et même le déposer ou le punir, s’il s’est rendu coupable dans sa doctrine ou dans sa conduite. Loyola a une très haute idée du commandement ; à tous les échelons de l’autorité, il prévoit une sélection sévère pour le choix des supérieurs, recteurs, provinciaux [787].
En fixant l’idéal du chef religieux, Loyola n’éprouve que le sentiment de son indignité. Il a bien perdu ce goût du pouvoir personnel qui séduit et parfois aveugle le maître de Genève. Loyola ne demande qu’à se décharger de ses responsabilités trop lourdes. On ne saurait douter de la sincérité avec laquelle il repousse le choix répété de ses compagnons et de son directeur spirituel, et insiste dix ans après sa nomination définitive pour qu’on veuille bien accepter sa démission [788]. Mais il faut qu’il soit épuisé par la maladie pour qu’il obtienne un soulagement dans la personne de son auxiliaire préféré Nadal (1554). Convaincu que « le bien et le mal rejaillissent de la tête sur les membres et que les inférieurs seront habituellement tels que les supérieurs », Loyola s’entoure de toutes les précautions humaines possibles. « Les supérieurs auront tout pouvoir pour faire le bien, mais ils seront retenus s’ils venaient à mal agir [789]. »
Il faut lui rendre cette justice. Il a dirigé sa Compagnie avec une conscience scrupuleuse, avec un soin et une ferveur exemplaires. Il lui arrivera d’exercer la soumission et la patience de ses subordonnés, en leur donnant des ordres insignifiants, des consignes presque futiles, des sortes de tests de bonne volonté : épreuves de pédagogie monacale apprise chez les Pères du désert, exercices d’assouplissement du caractère auxquels il tenait beaucoup, peut-être un peu trop [790]. Mais on ne l’accusera pas d’avoir cédé à l’arbitraire, ni d’aimer commander pour le plaisir de commander, ni d’organiser pour le seul amour de l’ordre et de la discipline chère à l’ancien officier de Pampelune. Ce qui le hante c’est la régularité surnaturelle du religieux. Il la poursuit pour lui-même et pour les autres, sinon sans raideur, du moins sans dureté, sans colère ni mesquinerie, avec un amour serein et une joie communicative. Car Loyola peut exiger des siens beaucoup plus que Calvin ne saurait demander de ses ministres bourgeois. C’est un chef paternel qui a le don de faire aimer l’idéal qu’il préconise et de susciter l’héroïsme volontaire. Les siens le connaissent et partagent ses vues apostoliques ; ils lui font confiance. Au centre de la chrétienté, cet homme de si grand jugement et de longue expérience mesure adéquatement les besoins universels de l’apostolat moderne. Avec lui, ils sont sûrs, même en se sacrifiant, de servir l’Église.
Nul mieux que Loyola, à cette époque, n’admire le rôle joué par les anciens Ordres religieux. Loin de vouloir les supplanter, il se contente de les imiter et de les suivre de loin. « Voyons sans peine, remarque-t-il au début de la lettre sur l’obéissance, les autres Ordres religieux nous être supérieurs dans la pratique du jeûne, des veilles et de toutes les autres austérités. » Il appelle de ses vœux un renouveau de toutes les formes de la vie religieuse. Mais les obligations monastiques des anciens Ordres, leur vœu de stabilité, leur éloignement de la société laïque, laissent la place libre pour des méthodes d’apostolat plus direct. Avec tous ses compagnons, Ignace est d’avis de ne retenir des habitudes monacales que l’essentiel de l’esprit religieux : le renoncement, les conseils évangéliques, la vie intérieure. Son Ordre reçoit une orientation apostolique si marquée qu’on a pu parler d’une transformation radicale du monachisme.
« Auparavant tous les religieux... ont un habit particulier, la psalmodie du chœur, des jeûnes et des pénitences statutaires ; tous fournissent des évêques ; tous nomment aux charges et décident les affaires par voie de suffrage... Le fondateur de la Compagnie modifie ou supprime ces dispositions traditionnelles... il supprime l’habit, le chœur, l’accès aux dignités ecclésiastiques, les austérités de règle, le système électif ; le généralat est à vie ; et l’activité s’étend à toutes les formes de l’apostolat [791]. » Du décor habituel du monachisme, il enlève tout ce qui peut gêner la mobilité, la rapidité de la pénétration dans les milieux profanes les plus divers.
Mais, cette simplification obtenue, il fallait obvier au subjectivisme, prévenir la dispersion des forces, coordonner les générosités individuelles sollicitées par mille tâches extérieures et menacées au dedans par la séduction des saintes fantaisies (locuras sanctas [792]). La Compagnie, pendant six ans, ne connut aucun vœu d’obéissance. Le génie de Loyola réussit à communiquer à ses compagnons une vision objective de la situation religieuse. Pour remédier à la grande crise individualiste que traversait la chrétienté de la Renaissance, il ne suffisait plus de consentir des sacrifices admirables, mais dispersés : efforts sans lendemain, sans esprit de suite, sans retentissement durable. Le doute, l’anarchie, rongeaient dangereusement la vitalité de l’Église souvent mal gouvernée, au moment même où, pour la première fois, elle commençait à s’étendre sur toute la surface de la terre. Loyola voulut que son institut au moins, dans le désarroi général, possédât la puissance de choc la plus concentrée, en même temps que la mobilité la plus souple. Il mit tout en œuvre pour que son Ordre représentât une force et pût être efficacement présent partout où l’Église le demanderait [793].
Dans son admiration pour le génie organisateur de Loyola, le protestant Böhmer perd un peu le sens des proportions : « Tous les fils du gouvernement de l’Ordre, dit-il, convergent vers un seul lieu : le cabinet du Général de l’Ordre à Rome. Ce cabinet est déjà alors semblable au cabinet d’un prince. Il est en relation avec presque toutes les cours catholiques, il reçoit des lettres, des consultations, des communications secrètes de toutes les parties du monde catholique. De plus, on lui adresse régulièrement, au moins tous les trois mois, des relations détaillées de toutes les résidences de l’Ordre établies en Europe et plus fréquemment encore des rapports confidentiels de ses divers disciples. Son cabinet est ainsi une chancellerie ecclésiastique et politique, et en même temps un office de renseignements d’un genre supérieur. C’est là, mieux que partout ailleurs, qu’on peut connaître le but et le succès de l’activité de l’Ordre [794]. » Au service du trésorier de Castille Juan Velazquez, Loyola avait été à bonne école. La correspondance lui servit merveilleusement à entretenir l’esprit de corps, l’unité d’action entre tous les compagnons, et à renforcer leur apostolat par une propagande judicieusement dirigée.
Les échanges épistolaires constituent le journalisme de l’époque. La correspondance entre les partisans de la Réforme, et surtout celle qui avait sa centrale à Genève, n’était pas mal organisée non plus. Et le fait d’avoir un service œcuménique de presse ne permet pas encore de préjuger a priori sur l’orientation « politique » d’un organisme de ce genre. La seule comparaison instructive, ce n’est pas celle qui porte sur la fréquence ou la régularité des communications, mais celle qui aborderait le contenu détaillé de cette immense masse de documents réformés et jésuites, non pour y voir à qui revient la palme du savoir-faire, mais quelles préoccupations s’y révèlent, quels mobiles et quels sentiments prédominent.
La correspondance du réformateur genevois est un fleuve énorme, où malheureusement tout se mêle, l’éloquence majestueuse, la prédication édifiante, l’animosité et des passions regrettables. Dans ce limon, la charité devient solidarité partisane, la foi mène à « l’absolutisme, à l’intransigeance, à l’intolérance », le zèle le plus fervent pour l’Évangile se confond avec « une obstination têtue et revêche, un fanatisme, une âpreté et une violence avec lesquels il a souvent poursuivi ses ennemis [795] ». Dans le genre épistolaire, Calvin apparaît peut-être encore plus grand écrivain que dans ses traités savants. Il manie le latin et le français avec une facilité, une élégance, une clarté supérieures. Mais si le style est absolument sûr de lui, si les mémoires et les avis, qu’il délivre avec l’aplomb d’un prophète, offrent des exposés lumineux, des aperçus magnifiques, l’homme et le système se consument dans une ardeur trop souvent égocentrique.
Les 6742 lettres qui remplissent les douze gros volumes de la correspondance de Loyola ne brûlent pas de cette flamme sourde. Il ne se départ jamais d’un calme souverain. La langue quelque peu embarrassée explique partiellement cette forme solennelle et comme abstraite. Beaucoup de ces messages ne sont que des rapports apparemment techniques et presque impersonnels, mais soulevés par un amour du bien et un souffle de confiance qui réchauffent les formules les plus générales. Ces lettres sont chrétiennes dans leur inspiration comme dans leur forme.
Les schémas, ou minutes, très nombreux qui nous sont parvenus suggèrent comment il s’y prenait. Après avoir mûrement réfléchi et prié sur une question, il note sobrement les faits et les raisons objectives qui feront l’objet de la lettre : il énumère parfois une véritable litanie d’arguments classés d’après leur importance, comme pour la démonstration d’un théorème. Le correspondant en pèsera la valeur particulière et collective, sans être abusé par des plaidoyers passionnés, ou des effets de polémique tendancieuse. Un secrétaire, Polanco ou un autre, est souvent chargé de mettre en bon latin ces avis ou réponses du Père. Avec quel soin scrupuleux il rédige lui-même les lettres personnelles, on s’en rend compte par les conseils qu’il donne à Favre et à Bobadilla sur la manière de concevoir une correspondance utile et bienfaisante. Il doit lui-même, en ce moment, contenter deux cent cinquante correspondants. « Je vais expédier cette nuit trente lettres qu’il me faudra réexaminer... S’il s’agit de lettres à des personnages importants, je les récris jusqu’à trois fois [796]. »
« Déjà de son temps, les relations par écrit, au sein de l’Ordre, sont mieux organisées que dans aucun des États européens. Il y a un véritable gouvernement de cabinet [797]. » N’exagérons rien. Ce n’est pas plus exact que « la discipline militaire de fer » à laquelle l’historien allemand s’attache comme à un talisman. Toute organisation n’est pas nécessairement militaire. Et toute discipline collective n’est pas, non plus, obligatoirement fondée sur la force et la contrainte. Rien de plus clair que ces messages ignaciens qui volent sans cesse à travers l’Europe et jusque sur les océans lointains. Parfois cet épistolier improvisé relève ses mots d’ordre de quelques discrètes pointes d’humour. Mais la malice, même inoffensive, n’y trouve point de place. Aucune trace d’emportement ou d’amertume, pas un jugement malveillant, pas un mot blessant : c’est vraiment l’« édification », la bonté érigée en système.
Médiéval et moderne, il voit encore la chrétienté comme un tout et ne conçoit pas la division comme une réalité durable. Il ne connaît pas la Réforme, qui n’est sans doute à ses yeux qu’un épisode transitoire, et ne s’en occupera que sur l’invitation des autorités ecclésiastiques, secondairement. Toute son activité est positive. Sans faux internationalisme, il apprécie l’enrichissement spirituel dû à la confrontation des mentalités différentes. Il veut que ses compagnons voyagent et rencontrent d’autres gens et d’autres mœurs, qu’ils apprennent des langues étrangères et qu’ils se communiquent les uns aux autres leurs expériences, leurs difficultés, leurs points de vues. Il mesure la force et la clarté que procurent ces échanges d’idées et de méthodes, cette mise en commun des joies et des épreuves. Les nouvelles intéressantes sont recueillies à Rome et retransmises partout, pour être lues à table, dans les maisons, pour encourager les isolés, pour soutenir la confiance et l’union des cœurs [798].
Envoyés en mission, les disciples de Loyola sont sérieusement avertis de ne pas se mêler de politique, mais de s’appliquer exclusivement au seul but de leur vocation : le service des âmes [799]. S’il avait entendu dire que son gouvernement évoquait le cabinet d’un prince, le général de la Compagnie aurait sans doute recommandé à ce professeur trop sérieux ce qu’il aimait à trouver chez ses novices : « Te volo ridere, fili mi... » J’aime à vous voir rire...
La Compagnie est au service de l’yglesia militante [800]. Mais ce service « militaire » diffère absolument de ce qu’on imagine sous ce terme. « Il n’est pas question d’Église militante, note judicieusement Przywara, au sens d’un combat déterminé, ou d’une attitude agressive, mais seulement de l’état où l’Église se trouve : dans le service de la discipline et de l’obéissance. Aussi les Règles ne parlent nulle part d’un combat déterminé, ou d’une attitude combative contre des adversaires, mais uniquement de l’attitude des membres de l’Église par rapport à l’autorité de l’Église [801]. » Le compagnon est en état de service commandé, mais d’abord contre son propre cœur, contre les ennemis intérieurs, qu’il s’agit de réduire « sous la bannière de la croix [802] ».
Avant de songer à une croisade quelconque pour le royaume de Dieu, avant la stratégie et la mêlée de la conquête apostolique, le compagnon est soumis à une préparation tactique contrariante. En période de formation – c’est déjà le service des âmes –, la vie commune impose un entraînement intensif qui semblerait forcé, s’il n’était précisément à base de seule générosité volontaire. Ignace éprouve le désintéressement des siens. Ils doivent avoir la conviction, quoi qu’ils fassent, de servir « comme des serviteurs inutiles ». Ils seront cependant toujours prêts à se donner tout entiers [803]. Une fois cette humilité du service de l’Église assurée, les initiatives pourront se donner libre cours sans danger de recherche ni de suffisance personnelle.
Il est indéniable que les trouvailles de Loyola pour « exercer » les compagnons posent des problèmes et appellent des réserves. On peut comprendre et apprécier à leur juste valeur les « expériments », les épreuves de service à la cuisine, dans les hôpitaux, les voyages de mendicité connus sous le nom de « pèlerinages », le découpage systématique du temps, la ponctualité, le soin minutieux de la propreté, de l’hygiène, de l’ordre domestique. Cet absolu dans la perfection visible et tangible n’a rien pour nuire à des jeunes gens enthousiastes, tout disposés à accepter les exigences les plus impérieuses au service d’un grand idéal. Même dans le sport spirituel, l’exactitude présente beaucoup d’avantages, à condition que la perspective ne soit pas déformante. Chacun est d’ailleurs convaincu de la signification plutôt symbolique de ces exercices de virtuosité.
Mais, en tout, l’excès de zèle est un défaut. Il paraît certain qu’autour de Loyola on fut parfois tenté d’ériger en principe universel des attitudes compassées, artificiellement étudiées. Le souci d’une édification trop calculée, trop extérieure menace de détourner l’attention du principal sur l’accessoire. Les recommandations de Loyola concernant le maintien, le contrôle des moindres gestes et attitudes, l’attention démesurée prêtée à l’étiquette religieuse rappellent l’aristocrate espagnol, qui, dans le voisinage de la curie romaine, laisse plus ou moins consciemment renaître en lui un certain sens de la dignité, mais aussi un certain formalisme, appris à la cour des Rois Catholiques. Come noble caballero de Christo, en noble chevalier chrétien, il adresse à l’élite de son temps l’invitation à se distinguer au service du Seigneur, sans aucune concession à la lâcheté naturelle, ni à la vulgarité [804].
On pourrait souhaiter parfois une plus grande simplicité. Nous aimerions mieux, pour notre part, qu’à l’exemple de son ami Philippe de Néri, il eût moins forcé sa nature, et qu’il ait ri davantage, au besoin jusqu’aux éclats, plutôt que de se donner la discipline pour réprimer la trop grande envie de rire que lui inspirait la vue de ses frères [805]. La mesure de la pénitence : un coup de fouet pour un accès de rire, est de bon augure. Loyola devait avoir un penchant à l’hilarité qui est rassurant. Le sens des vraies valeurs humaines ne fut jamais étouffé chez lui : son idée merveilleuse de n’admettre autour de lui que des mines réjouies et des soumissions enthousiastes le montre assez [806]. Malheureusement la joie elle-même est au prix d’efforts un peu tendus. Et pour ce qui est des esprits récalcitrants et trop critiques, Loyola n’hésitait pas à leur faire la vie dure. D’une générosité parfois incompréhensible à l’égard des faibles, des infirmes, des malades, il pouvait devenir terrible – mais terrible sur commande – en face de caractères négatifs, qui dans sa Compagnie représentaient plus qu’un poids mort, une menace d’affadissement. Ribadeneira, Lancicius, Gonzalez, Olivier Manare, ont recueilli des gerbes d’anecdotes qui justifient la boutade de Zapata : « J’aimerais mieux obéir à cinquante supérieurs qu’au seul Ignace [807]. »
Même à cette époque encore dépendante des habitudes ascétiques du moyen âge, les sanctions imposées par Loyola à ses compagnons pour des manquements sans importance nous frappent par leur sévérité disproportionnée... Passe encore pour les pénitences conventuelles infligées aux compagnons qui négligent la tenue dans la visite des églises de Rome, ou jouent à la pomme d’or sans permission, ou encore écoutent avec une complaisance trop visible des malices contre le prochain. Mais il est impossible de ne pas s’étonner de la raideur expéditive avec laquelle Loyola décidait de certains renvois [808]. Le fondateur se contentait-il parfois de prétextes anodins pour se débarrasser de compagnons dont il voulait cacher des délits secrets ? Ribadeneira et Lancicius n’en soupçonnent évidemment pas l’existence. Sinon, comment expliquer que cet homme qui ne se fâche jamais sérieusement, qui apparaît comme un modèle de charité aux yeux des plus clairvoyants ; celui que Xavier appelait vuestra santa caridad, qui veillait avec tendresse sur les malades, sur les faibles, sur les frères accablés de travail, comment pouvait-il se résoudre si facilement à briser l’avenir de certains religieux, pour des manquements qui n’étaient même pas des fautes ? Le frère Silvestre faillit être renvoyé pour désobéissance au médecin. Tel autre infirmier, pour avoir manqué à la modestie en soignant la jambe d’un malade. Le Père Zapata est renvoyé pendant la nuit, sans viatique, pour avoir osé critiquer la prédication de Nadal, le bras droit d’Ignace [809].
Ce qui étonne dans ces « exécutions », ce sont les résultats obtenus. Les hommes les plus durement traités, comme Zapata, ou Rodriguez, loin de s’aigrir ou d’en concevoir de la rancune, gardent à Loyola une estime extraordinaire. Zapata devient Franciscain et ce religieux édifiant demeure un grand ami de la Compagnie [810]. Simon Rodriguez, prodigue difficile à contenter, âme inquiète, caractère instable, après être revenu à son père, ne ressent à son égard que de la reconnaissance et de l’affection [811]. Les compagnons fautifs constatent que les sanctions de leur chef ne sont dictées par aucun sentiment d’amour-propre, de colère ou de partialité. Sa justice ne se contente-t-elle pas souvent de laisser les délinquants choisir eux-mêmes leur pénitence ? Ils se l’infligent d’ailleurs avec une sévérité que le Père est obligé de modérer. Pour les questions litigieuses plus délicates et plus importantes, il s’en remet à la sentence d’un jury, dans lequel les fidèles du genre Polanco et Nadal se distinguent en faisant du zèle espagnol, allant jusqu’à lui conseiller un emploi abusif de la confession. Devant cette surenchère de la stricte observance, le Général défend la juste mesure et adoucit les peines prévues par les arbitres [812].
On comprend que des hommes comme Rodriguez, délicatement corrigé et pardonné, admirent l’étonnante bonté de Loyola et déclarent « n’aimer personne autant que lui ». Il vaudrait la peine de citer la correspondance de ces adversaires fraternels, toute dominée par la charité, et de la mettre en parallèle avec les documents échangés par Calvin sur le compte de ses nobles contradicteurs, tels que Falais et Castellion [813]. Loyola aime les siens d’une tendresse virile. Il craint seulement de trop s’abandonner à cette joie d’aimer et d’être aimé par les siens, dont certains trouvent qu’« il paraissait tout entier être un amour [814] ». Les intimes auxquels il accorde toute sa confiance et qu’il reprend à l’occasion avec une rudesse digne des Pères du désert, subissent le charme de cette affection exigeante. Laynez, Polanco, Nadal, Gonzalez, Ribadeneira, tous apprécient la sollicitude du Père qui veut savoir exactement si ses compagnons sont bien soignés, s’ils dorment et s’habillent convenablement, si la cuisine et l’infirmerie ne sont pas négligées. Il ne reçoit jamais assez de nouvelles de ses amis, et cela s’entend surtout des bonnes nouvelles, qu’il prenait un intense plaisir à propager « pour l’édification du prochain ». Cela peut sembler incroyable, mais c’est ainsi : il réussissait à ne parler d’autrui qu’en bonne part.
Tel fut le gouvernement de Loyola dans ce qu’on voudrait appeler (si l’on ne craignait de ressusciter des symboles tendancieux) le ministère de l’intérieur, la vie domestique. Un sage mélange de régularité ascétique et de charité vigilante. Loyola est d’une intransigeance minutieuse quand il s’agit d’ordres formatifs, qui ne tirent pas à conséquence, qui visent essentiellement à éprouver et à confirmer la bonne volonté des débutants. L’instruction d’une école de recrues a des exigences qui tombent en période de service actif. La conduite du « ministère des affaires étrangères », la direction lointaine des compagnons lancés en pleine mêlée, se caractérise par des vues très larges, par une réelle magnanimité. Quand il avait chargé quelqu’un d’une mission de confiance, Loyola voulait pouvoir compter sans réserve sur son esprit de décision et d’initiative. Il n’aime pas que les Supérieurs de maisons ou de provinces se déchargent sur lui de leurs responsabilités et lui demandent trop de conseils. « Je vous ai nommé pour gouverner, gouvernez... »
« Il suivait volontiers, au dire de Manare, l’inclination de ses inférieurs, quand c’était possible, et se réjouissait quand elle était conforme à son choix, disant que c’était la meilleure manière de gouverner les personnes et la plus suave de toutes [815]. » À plus forte raison désirait-il que Xavier dans les îles du Pacifique, ou Canisius en Allemagne, fissent preuve de clairvoyance et d’énergie personnelle [816]. Dans les importantes missions apostoliques ou diplomatiques confiées aux siens, Ignace les soutenait et les encourageait au moyen d’instructions dont on ne sait ce qu’il faut le plus admirer, l’élévation de la pensée, le sens du réel, la sérénité absolument libre de toute passion partisane. Le grandiose plan d’action terrestre et maritime contre les Turcs pirates, adressé à Charles V, nous donne un aperçu de la sagesse qui pouvait, à l’occasion, inspirer ce mystique jusque sur le plan des affaires temporelles [817].
Mais ce qui perce encore à travers les directives concrètes les plus précises, c’est la nécessité pour les chargés de mission de s’adapter, de se faire tout à tous, de discerner personnellement les indications du bon esprit. La turbulente indépendance du fougueux Bobadilla, la délicatesse de Lejay, sont traitées avec des égards pleins de confiance [818]. Avant de se faire rappeler de son fief du Portugal, il faut que Rodriguez abuse vraiment de son autorité pour que Loyola songe à « employer le bistouri », c’est-à-dire à le démettre de ses fonctions de provincial et à l’éloigner. Mais sitôt revenu à résipiscence, le compagnon retrouvera, à l’intérieur de l’Ordre, assez de latitude pour suivre, à son gré, ses fantaisies de pèlerin, d’ermite et de missionnaire [819].
Loyola se borne souvent à suggérer un esprit, des attitudes, qui dirigeront les subordonnés « suivant les nécessités des personnes, des temps et des lieux ». Le gouvernement de ce « prince à la discipline de fer » est assoupli continuellement par ces mesures de la prudence, par ces correctifs de la modération : « D’après les circonstances, autant que faire se peut, comme le Supérieur le jugera bon, selon l’usage de la Compagnie, selon qu’il sera opportun ou nécessaire... » Le style d’Ignace est émaillé de ces restrictions.
Dans la pratique de la vie commune, quand il n’est question que de sacrifier le sens propre au bon ordre de la maison, ou aux exigences d’activités collectives, Ignace demande une soumission exacte et ponctuelle. Dans les questions plus complexes, et souvent combien plus importantes, que le bon sens et le savoir-faire du Supérieur ne peuvent résoudre, il approuve sans peine un jugement et des décisions opposés aux siens, pourvu qu’ils soient motivés par des raisons sérieuses et désintéressées. Manare l’expérimente un jour : « Il m’arriva une fois d’agir contrairement à un ordre que j’avais reçu de lui par lettre. J’expliquai ma conduite en lui disant que je m’étais représenté Ignace présent et qu’il m’avait paru l’entendre dire : “Fais comme tu le penses en ton esprit : car si j’étais présent, je t’ordonnerais d’agir ainsi.” Il partagea cette interprétation en m’écrivant que j’avais agi d’après sa volonté. C’est l’homme, dit-il, qui donne une tâche, mais c’est Dieu qui donne le discernement (discretio). Je veux que pour le reste vous agissiez sans scrupule, comme vous jugeriez devoir le faire, dans les circonstances, nonobstant les règles et les ordres donnés [820]. »
Il faut donc, non pas renoncer à son jugement, mais faire usage d’un bon jugement pour pratiquer « l’obéissance du jugement ». Il faut un bel équilibre et une sérénité d’esprit peu banale pour savoir, comme inférieur ou supérieur, se mettre à la place d’autrui et rester uni en esprit, alors même qu’il est nécessaire peut-être de désobéir à des ordres formels. Loyola avait reçu un solide bon sens. Il a pu lui donner congé, pour un temps, lorsqu’il poursuivait l’idéal romanesque des Amadis ou de la Légende Dorée. Mais le climat romain lui rend le goût des proportions qu’il cultive dans tous les actes de son gouvernement. Tout le monde voit qu’il ne commande que pour s’acquitter d’une charge, sans volonté de puissance, sans démangeaison de vaine gloire. Il est toujours prêt à céder sa place à un autre, fût-ce même à cet original de Bobadilla, si les compagnons se déclarent d’accord. Ce dernier se prévaudra un jour de cette réflexion pour revendiquer la succession d’Ignace défunt.
Profond connaisseur des hommes, le Général sait doser ce qui convient à chacun. Il ne suit jamais des schèmes tout faits, mais traite chaque personnalité, chaque caractère d’une façon spéciale. C’est une des difficultés dans l’étude de la psychologie du fondateur de la Compagnie. La variété des aspects de cette physionomie déroute. Le peintre ne réussit pas à saisir l’expression tout à fait ressemblante de son portrait. C’est un chef énergique d’une fermeté exceptionnelle. C’est un compagnon plein de bonhomie et d’humour. C’est un ascète dur pour lui-même et pour les autres. Un gentilhomme d’une courtoisie et d’une distinction charmantes. Un sage dont les lentes réflexions éclairent d’un coup les situations embrouillées. Un Père d’une délicatesse que Ribadeneira déclare supérieure à celle de la plus tendre des mères à l’égard des faibles et des malades.
À côté des actes d’autorité s’alignent les témoignages d’une bienveillance extrême. Ignace doit détourner Ribadeneira de la littérature qui le passionne trop. Mais en l’appliquant à la philosophie, il lui laisse le choix entre les écoles de Valence, de Gandie, de Sicile, de Bologne ou de Padoue. Le P. Adriaenssens est invité à venir du Nord à Rome, s’il le souhaite [821]. Le P. Viola, fatigué, est envoyé renouveler ses forces dans l’air du pays natal, avec comme unique obligation de donner parfois des nouvelles de son état de santé. « Nous vous envoyons donc, très cher frère, dans votre patrie. Vous y resterez, ou vous irez ailleurs suivant que vous le jugerez préférable pour votre rétablissement. Ne vous regardez pas comme séparé du giron de la Compagnie, mais uni autant que possible à elle... Il vous est également permis de vous rendre, quand vous voudrez, dans toute maison ou collège de la Compagnie, à votre choix. » Qu’il ne craigne pas d’utiliser tous les moyens propres à soulager sa santé, sans se soucier des frais [822]. Ignace savait à merveille l’art « de tailler les habits d’après l’étoffe dont on dispose », comme il le recommandait à Olivier Manare : « Faites comme vous le jugerez bon et comme l’onction du Saint Esprit vous enseignera. Adaptez les règles à votre poste, comme vous le pourrez [823]. » Les cadres juridiques, dans la mentalité ignacienne, restent des cadres ; leur rôle est subsidiaire. Ils soutiennent et encouragent l’effort personnel sans asservir la personne elle-même. Ils appliquent une énergie donnée. Les cadres sont exactement à la mesure du bon vouloir libre.
On pouvait reprocher aux compagnons d’Ignace de se forcer pour paraître édifiants, pour vaincre jusqu’aux premiers mouvements de leur nature. Le personnage qu’on se composait pour manifester dans les détails du maintien, la dévotion qu’on ne pouvait afficher par un uniforme religieux, n’était et ne sera jamais du goût de tout le monde. Mais à qui parlait de façade, de feinte et d’hypocrisie, Loyola répondait en riant qu’il souhaitait que le plus grand nombre fasse au moins semblant d’être modeste et recueilli. Et montrant deux types de candeur et de simplicité, Salmeron et Bobadilla, il disait : « Voilà les deux seuls hypocrites que je connaisse parmi nous ; car, on n’aperçoit vraiment pas sur eux toute la vertu qui se cache sous leur écorce [824]. » Et qui sait si les Genevois, eux-mêmes, n’auraient pas plus volontiers supporté des ministres qui, au lieu de sévir violemment contre leurs ouailles, se seraient un peu appliqués à se dominer eux-mêmes et à paraître toujours de bonne humeur... L’égalité d’âme à laquelle Loyola et les siens s’exerçaient sans cesse ne nuisait certainement pas à l’ambiance familiale de la maison généralice. Dans l’Ordre tout entier, elle facilitait les rapports cordiaux entre le Père et ses fils.
À l’heure actuelle encore, le gouvernement de la Compagnie repose sur cette règle essentielle, que nul chapitre général n’a le pouvoir de modifier : « La manière de gouverner dans la Compagnie doit être paternelle et s’inspirer de la mansuétude, de la bénignité, de la charité du Christ [825]. » Et telle fut bien l’autorité de ce meneur d’hommes, de cet éveilleur de caractères. D’une force d’âme que rien n’entame, et cependant d’une délicatesse virile, de plus en plus sensible aux véritables qualités humaines. Il aime la courtoisie, la distinction et la maîtrise de soi, mais tout autant la simplicité, la jovialité, la musique, toutes les formes du savoir et de l’art. Doué d’un agréable sens de l’humour, il comprend qu’on le plaisante ou le critique. Bien mieux, vient-on à se moquer de lui, il se réjouit de servir ainsi « à consoler un frère ». Gouverner, pour lui, c’est connaître à fond chaque cas personnel et « donner à chacun ce qui lui convient ». Il jouit d’une telle confiance qu’il peut demander de durs renoncements, tout en se fiant lui-même à la liberté d’esprit des siens : « Je vous prie de vous servir des moyens que le Seigneur vous enseignera être plus convenables et je vous le dis, en toute liberté, afin que vous fassiez ce qui vous paraît le meilleur [826]. »
Au retour de chaque mission, il tient à savoir si le responsable est content de son travail et s’en est acquitté « avec liberté ». Car il ne faut obéir qu’avec liberté et de bon cœur.
_______
QUATRIÈME PARTIE
TRIOMPHE ET TRAGÉDIE
_______
CHAPITRE PREMIER
Les martyrs du calvinisme
Parmi les Évangéliques français qui donnent leur vie pour la cause de la Réforme, bon nombre ne méritent personnellement que de la sympathie et de l’estime. Ces idéalistes appartenaient parfois à une élite spirituelle et ils mouraient courageusement pour ce qu’ils regardaient comme la vraie foi [827]. Mais bien des révolutionnaires aussi se posent en martyrs, alors qu’ils succombent simplement sous les coups d’une réaction qu’ils ont provoquée.
L’expérience des bouleversements politiques introduits par la Réforme dans maints pays de Suisse et d’Allemagne n’avait rien de rassurant pour le pouvoir établi, en France, et suffisait amplement à ouvrir les yeux des observateurs les moins avertis. Permettre aux réformés d’agir au grand jour, d’insulter ouvertement la foi traditionnelle, c’était tolérer des attentats et des troubles, c’était faciliter au parti réformé la conquête des positions influentes dans l’État et se résigner, à plus ou moins brève échéance, à subir un changement de régime au profit des audacieux et des novateurs. Car, une fois instaurée, la Réforme ne manquerait pas d’organiser la Cité à sa façon et de déclencher, en sens inverse, une répression énergique contre les partisans de la Tradition, pareille à celle que Calvin recommande au duc de Somerset [828].
La plupart du temps, les mesures de défense prises par le roi et les Parlements s’appesantirent sur de « pôvres fidèles », qui n’en pouvaient mais, ou dont les intentions étaient pieuses. Mais les chefs de file qui, de loin, sans se risquer dans la mêlée, lançaient leurs directives, ne visaient à rien moins qu’au triomphe d’une révolution qui serait totale ou ne serait pas. Ce n’était pas seulement la hiérarchie, le système des bénéfices, les traditions cultuelles et culturelles, mais toute la structure sociale et politique qui était attaquée, avec des moyens de propagande d’autant plus redoutables qu’ils paraissaient plus religieux. À distance, la théocratie calviniste devait inquiéter un François Ier, ses légistes et ses politiciens, encore davantage qu’elle ne gênait les bourgeois de Genève. Jamais une réforme évangélique n’aurait pu se présenter avec un visage plus menaçant. L’activité de Farel, de Calvin et de leurs amis en Suisse romande, intensifia la publicité de la Réforme en France, mais envenima aussi, au plus haut degré, les rapports entre le gouvernement et les Évangéliques, leur enlevant presque toutes les chances d’une pénétration pacifique [829]. Ils récoltèrent les fruits de la colère abondamment semée par Marcourt et par les légistes gapençais et picard. Il y eut nombre d’exécutions, des représailles et des massacres atroces, comme ceux des Vaudois de Mérindol et Cabrière.
En règle générale, les légistes exerçaient cette répression défensive, sans pitié comme sans haine, avec une fidélité à la loi, dont Calvin aurait pu mieux s’inspirer [830]. Cette manière de défendre en bloc la foi, l’Église et les institutions politiques, ne pouvait étonner les esprits de ce temps, les juristes français qui réformaient Genève et la Suisse romande moins que personne. Mais on est surpris de retrouver des influences de cette mentalité politique sous la plume de Loyola. Ses projets de croisade uniquement spirituelle pour la conversion des Turcs nous plaisent davantage que les conseils qu’il soumettait à Canisius, en réponse à la demande du roi Ferdinand préoccupé de trouver les meilleurs moyens pour la réforme catholique de ses États [831]. À côté de suggestions positives fort sages concernant la réforme du clergé et de l’enseignement, les méthodes de police religieuse empruntées aux exemples du Parlement français impressionnent péniblement un lecteur moderne. Et combien plus étrange encore l’attitude de cet homme qui risquait sa vie, comme en se jouant, avec ses compagnons au chevet des contagieux et qui, une fois conquis par l’ambiance curialiste romaine, pousse le conformisme jusqu’à céder à des raisonnements barbares sur le bien commun, appuyant de considérations spirituelles l’impossible décrétale d’Innocent III « Cum infirmitas » : on peut refuser les soins et les médicaments à un malade, dût la mort s’ensuivre, s’il ne consent pas à recevoir les sacrements [832].
Ces aberrations (nous ne connaissons pas chez Ignace d’écarts plus importants) semblent bien être restées sur le plan théorique : elles n’ont guère influencé le cours des évènements, ni terni son idéal philanthropique. Dans sa conduite, le réformateur n’oublie jamais que le véritable apostolat chrétien ne saurait progresser que dans le sens de la charité. Sans s’opposer à l’Inquisition, il sait par expérience, pour avoir été dénoncé une douzaine de fois, quelle justice boiteuse elle représente. Böhmer constate loyalement le peu d’empressement que les jésuites montrent à collaborer avec les Inquisiteurs : « Ils résistent aussi énergiquement que possible contre cette obligation qu’on leur impose, et ils obtiennent au moins de ne pas s’occuper de procès criminels [833]. » Quand on leur offre des charges de consulteurs de l’Inquisition, les compagnons de Loyola sont très perplexes. Si parfois ils l’acceptent à contrecœur, c’est en définitive pour être mieux à même de se défendre contre les accusations dont la Compagnie était si souvent l’objet [834].
Au contraire, avec quel empressement Calvin s’érige en Grand Inquisiteur ! Il ne s’est pas contenté de préconiser, avec la plupart de ses contemporains, la légitimité de l’emploi de la force dans la solution des problèmes religieux ; il est intervenu, lui-même personnellement, à tout propos pour obliger les pouvoirs civils à tirer le glaive, pour accentuer la cruauté du bras séculier, souvent désireux de modération. C’est lui qui dénonce, qui accuse, qui préjuge de la sentence ou la dicte, alors que les querelles ne sont que des questions personnelles mises en relation forcée avec la religion. C’est le peuple, hier encore catholique, ce sont les magistrats et les conseils qui freinent le clergé.
Depuis qu’il est venu à Genève, que de crises se sont dénouées d’une façon brutale ! C’est l’exécution de Jean Philippe et de ses partisans qui ouvre le chemin du retour à Calvin. C’est l’exécution de Gruet qui consacre sa première victoire sur le parti des Ameaux-Perrin.
C’est le bannissement de Bolsec qui sauve le Picard d’une crise toujours menaçante. Cet étranger, dont rien ne légitime l’autorité, se sent toujours en équilibre instable. C’est toute une opposition politique qui est frappée dans la personne de Servet, de Comparet, de Claude Genève, de François-Daniel Berthelier et de tant d’autres. Les victimes sont des adversaires personnels de Calvin. Elles ne deviennent dangereuses pour la religion et la cité qu’après avoir été ainsi représentées et défigurées par le réformateur avocat. Le sort de la Réforme réclamait moins ces sacrifices que le pouvoir personnel du Maître.
Calvin avait le choix entre un idéalisme évangélique pur de sang et de violence, mais peut-être inefficace, et un triomphe politico-religieux. Oubliant la substance la plus précieuse de l’Évangile, la charité, il opta pour la puissance. Plus qu’à la Bible, semble-t-il, il croit à la loi du plus fort. La sagesse humaine de son premier livre catholique, sur la Clémence de Sénèque, n’excluait pas a priori la possibilité d’un esprit plus conciliant et plus compréhensif. Mais le réformateur est prisonnier de son dogmatisme nouveau et de sa formation légiste. Un peu d’indulgence suffirait à renverser une œuvre mal assise sur le fondement de l’arbitraire et de l’agitation révolutionnaire.
Ce qui étonne dans l’histoire de Genève, à cette époque, ce n’est pas tant l’abondance des tumultes et des procès criminels, mais bien la part personnelle, directe, que « l’homme de Dieu » y prend toujours davantage. Si Calvin avait seulement voulu ne pas s’en occuper, la plupart des procès genevois n’auraient pas eu lieu, ou auraient pris une tournure toute différente. Mais excités et entretenus par le clergé, les ressentiments se donnent carrière sous le couvert du zèle [835]. Calvin ne reconnaît aucune tradition et n’est certes retenu par aucun scrupule de fidélité aux usages ecclésiastiques. En poursuivant les « hérétiques » et les libertins, il ambitionne de faire autrement et mieux que l’Église catholique. On l’aurait beaucoup étonné avec les excuses des apologistes affirmant qu’il suit et copie la hiérarchie. Il ne dépend que de lui-même et de Dieu. Il ne pourrait renier les idées qu’il expose dans sa « Defensio contra Servetum » sur le châtiment des hérétiques, sans se renier lui-même et toute sa réforme. Thèse cardinale, pivot sur lequel tourne l’histoire de Genève et toute la théocratie du grand Picard.
Dans sa longue série des procès genevois, Calvin est le seul qui sache exactement ce qu’il veut et qui se livre tout entier, esprit, cœur et volonté à ces tristes besognes. Les autres, les ministres, les syndics, les magistrats sont des acteurs plus ou moins volontaires, des instruments plutôt passifs, de toute façon poussés par des influences qu’ils ne sauraient contrecarrer. Calvin seul prévoit tout et poursuit son but de justice vindicative avec une présence d’esprit parfaitement lucide. Rien n’échappe à ce regard qui enregistre même les détails des supplices intéressants pour un réquisitoire d’outre-tombe.
Calvin tire parti de tout avec un réalisme qui déconcerte. L’exploitation des victimes surprend encore plus que les crimes judiciaires eux-mêmes. Ainsi après l’écrasement de Bolsec : « À quelque chose malheur est bon, répétera le Maître. L’impiété perverse de ce moine trcheur a donné occasion à l’éclaircissement de la matière tant nécessaire et tant salutaire de la prédestination [836]. » C’est comme si la religion calviniste avait besoin de ces chocs en retour pour s’affirmer et découvrir ses dogmes fondamentaux. Gruet, Bolsec, Servet, les Comparet, les libertins et les anabaptistes sont des êtres providentiels. Ils permettent au prophète de mieux se reconnaître, de formuler plus nettement son message, d’exprimer ses préférences métaphysiques et ses penchants instinctifs en termes universels, obligatoires pour tous.
Les martyrs ont joué un rôle de premier plan dans cette réforme. Ils ont bien mérité de la cause, non seulement en facilitant son avènement, mais surtout en révélant le vrai visage du calvinisme. Ces sacrifices ont éprouvé la consistance et la solidité de l’Institution chrétienne. Ont été ainsi démontrées et illustrées par des procès sanglants, non seulement la thèse gratuite de la prédestination, mais encore les théories spéciales de Calvin sur le péché originel, sur la déchéance de la nature et de la liberté humaines, sur la mission rédemptrice du Christ, sur la Trinité, sur la cène, sur la discipline ecclésiastique, bref les principales pièces de cette théologie. Le Dieu justicier de Calvin réclame ces témoins négatifs, et ces répressions, en retour, consacrent la révélation du système théocratique [837].
Voilà pourquoi le procès de Servet demeure comme le type de ces démonstrations dogmatiques. « Si Servet était acquitté, note le pasteur J.D. Benoît, c’était Calvin qui se trouvait moralement condamné et son œuvre détruite ; de là l’acharnement de la lutte. Calvin triompha et, avec lui, la Réforme à Genève [838]. » Un biographe visionnaire n’a donc pas tort de représenter Servet comme le sauveur de la Réforme calviniste. Il n’y a aucun parti pris à mettre ce cas hors série. Il n’a pas besoin d’être exploité, il parle de lui-même. Comme le prouvent les interminables discussions et justifications ultérieures, si jamais une question fut capitale dans l’histoire du calvinisme ce fut bien celle-là. Doumergue et les fidèles intégristes sont mal inspirés de « condamner cette erreur », comme ils l’ont tenté avec le monument de Servet, puisque c’est justement ici qu’il leur convient de se montrer « fils respectueux et reconnaissants de Calvin ». L’exécution de Servet assura le triomphe auquel ils doivent probablement d’être calvinistes.
Comment attribuer « à une erreur des temps » le geste le plus logique et le mieux réfléchi, le plus personnel et le plus volontaire qui soit ? Ce fut l’instrument le plus efficace de son apostolat, un moyen regrettable, mais « justifié par la fin », l’établissement de la réforme genevoise, impossible sans cette condition sine qua non. La religion nouvelle s’est tellement identifiée avec une certaine politique qu’il n’est plus possible de les imaginer séparées. La répression des adversaires du système n’est pas une question accessoire. C’est une tendance essentielle de cette doctrine : on ne peut la concevoir autrement que comme une guerre déclarée à toutes les formes de pensée différentes de celle de l’Institution chrétienne. Tant que les autres doctrines n’auront pas été extirpées, Calvin regardera la réforme positive comme inexistante [839].
Pour le réformateur comme pour les contemporains qui ne s’y sont point trompés, Servet demeure le « manifeste » calviniste par excellence. Calvin avait cherché souvent une confrontation avec cet aventurier espagnol qui, malgré un tempérament opposé, intellectuellement lui ressemblait comme un frère : même audace, même assurance inconfusible, même obstination. À l’« Institutio christiana » de Calvin, Servet avait fini par opposer une « Christianismi restitutio », qui, dans le titre déjà, lançait un véritable défi et se présentait comme une réforme définitive de tous les essais de réforme antérieurs.
Servet, c’est le sosie, le double du prophète élu : un prédestiné de malédiction, parce que, avec les mêmes principes et presque les mêmes méthodes d’investigation religieuse, il va jusqu’au bout du libre examen et ne craint pas de l’employer pour critiquer, non seulement l’Église catholique et les idées théologiques courantes, mais même le biblicisme calviniste. H. Bauke remarque fort justement : « Dans Servet, Calvin voyait la conséquence ultime et extrême de ses propres pensées ; on pourrait même dire sa propre caricature [840]. » C’est un peu contre soi-même que le réformateur décharge son ressentiment de révolté. Mais en même temps qu’une autopunition, l’exécution de Servet apporte une libération du prophétisme calviniste. Cette mort, recherchée et préméditée, met un sceau définitif sur son esprit. À ce tournant décisif de sa destinée, Calvin cesse d’être un persécuteur occasionnel ou traditionnel des hérétiques pour devenir chef de file. La victoire apaise ses dernières inquiétudes et lui confère une mission spéciale dans cette épuration du monde. C’est le professionnel du châtiment dès hérétiques.
À l’heure où la légitimité des répressions sanglantes était combattue par un vaste courant d’opinion, alors que la mentalité publique semblait vouloir s’adoucir, le génie de Calvin se croit appelé par Dieu pour barrer la voie à la tolérance et pour ramener en arrière le mouvement de la pensée chrétienne. En autorisant de son nom, de son exemple et de sa doctrine, une théorie chancelante, Calvin justifie les pires violences de l’Église et se condamne lui-même. Car il n’y avait pas de raison valable pour que, dans cette sinistre journée d’octobre 1553, sur le plateau de Champel, ce fût Servet, son alter ego, le libre penseur, plutôt que lui-même, qui donnât sa vie pour la cause de la Réforme. Celle-ci, toute prête à pencher, se redresse et se trouve désormais établie sur le roc... par le bûcher de Servet. Calvin se vante presque de cette investiture reçue de son ennemi ; car, avant de mourir, le martyr demanda pardon à Calvin qui se considère comme la vraie victime. Calvin est conscient de soutenir désormais « des assauts pour maintenir toute la chrétienté [841] ». Il n’est pas l’agresseur, il défend, presque seul contre tous, l’ensemble du christianisme. Bien mieux, ce rôle exige de sa part une sorte de courage héroïque, celui du bon pasteur qui expose sa vie pour ses brebis : « Je fus prêt, à Paris, à risquer ma vie pour le gagner à Notre-Seigneur, s’il eût été possible. »
Il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il a bien mérité de l’Évangile : l’illusion ne saurait aller plus loin. La bonne foi est sauve, la bonne foi maniaque qui a toujours raison.
Le retentissement de ce meurtre judiciaire, soigneusement préparé, soigneusement orchestré et exploité, fut aussi profitable sur le plan politique qu’il était désastreux sur le plan spirituel. Désormais le parti était assez fort, assez redoutable, non seulement pour braver, mais pour écraser toute opposition. Les bons bourgeois partisans d’un ordre nouveau, les réfugiés et les citoyens de fraîche date, saluèrent avec respect et servilité l’avènement d’un régime à la fois austère et confortable, capable de réprimer les troubles, d’assurer la paix des consciences et les nouveaux droits de propriété.
Calvin l’emporte de haute lutte contre l’esprit de son temps qui faisait dire à l’auteur du plus ancien récit de la mort de Servet : « Cet évènement troubla un grand nombre d’hommes pieux et engendra un scandale inouï, qui semble ne plus jamais devoir s’effacer. » Car c’était trop clair, à la lumière de ce bûcher, que « la réforme ne se contentait pas de protester contre les abus anciens ; elle en provoqua de nouveaux, qui ne valaient pas mieux » ; qui étaient même pires, comme toutes les rechutes, au seuil de la guérison [842].
La dialectique de Doumergue, Stückelberger et de tant d’autres panégyristes de Calvin est ingénieuse. Mais les faits ont été établis avec tant d’évidence par les actes, par la correspondance du réformateur, par toute la polémique de cette époque, et mis en lumière par J.B.G. Galiffe, Kampschulte, Roget, Buisson, Choisy et encore dernièrement par le professeur protestant Oskar Pfister [843]. L’intervention de Calvin équivaut à une réaction contre l’esprit du temps, beaucoup moins sévère que le sien, nommément dans la Genève épiscopale. Pour présenter Calvin comme un défenseur de la tolérance et, par exemple, Castellion ou Zurkinden comme des représentants de l’intolérance, ainsi que le fait Doumergue et après lui, Stückelberger, il faut pousser bien loin l’amour du paradoxe [844].
Les humanistes en général désapprouvaient la répression. Et même le clergé français « représentait la classe la plus cultivée de la nation... la plus tolérante en religion [845] ». Si la Sorbonne et le Parlement étaient partisans de la dureté, pouvait-on, sans les approuver, renchérir sur leur intolérance ? Calvin proclame lui-même sa supériorité et, en quelque sorte, son originalité en s’opposant au courant de la tradition : « Il s’en faut de beaucoup que cette doctrine (de l’extirpation des hérétiques) soit aujourd’hui reçue... » Il y a en effet toute une large influence humaniste contre lui, « des monstres... qui souffriront que tout cela demeure impuni [846] ». Il faudrait qu’on extermine même les rieurs du genre de Rabelais. Calvin s’indigne de voir les Cardinaux trop tolérants. Et dans les milieux protestants de la tendance de Castellion ou de Melanchthon, on ne pouvait que se distancer des « fureurs de Zénon et de sa fatalité stoïcienne [847] ».
Le scandale, à Genève, ce n’était pas tant la facilité avec laquelle les exécutions capitales se prononçaient par les autorités civiles ou le parti au pouvoir, que l’insistance du clergé in corpore pour obtenir, avec force chantage, ces abus de justice et ensuite pour en assumer, de gaîté de cœur, l’entière responsabilité. Encore une fois, ce sont des laïcs, des magistrats et l’opinion populaire qui se manifestent ici bien plus chrétiens que la rage des théologiens, la « rabies theologorum ». Zurkinden le dit sans ambages à Calvin : « Si une justification de cette condamnation devait être donnée, c’était au Conseil et non à toi de le faire. » « Je ne vois pas que vous puissiez obtenir aucune faveur auprès des hommes d’esprit rassis, en entreprenant, le premier de tous, de défendre ex professo cette thèse odieuse à presque tous, autant que je puis le reconnaître par les premiers jugements que je recueille [848]. » Nulle part sans doute l’immense génie de Calvin ne s’est ainsi révélé un mauvais génie, comme dans cette vengeance posthume contre Servet, la « Defensio orthodoxae fidei... contra prodigiosos errores... Serveti... haereticos jure gladii coercendos esse [849] ». Toute sa souplesse, toutes les échappatoires de sa dialectique d’avocat n’empêcheront pas cette insulte à la mémoire de son ennemi terrassé d’être une mauvaise action. Si l’aveuglement est une excuse, on peut toutefois constater qu’il est complet.
Les gens rassis et responsables redoutaient avec Zurkinden et Musculus que cette folie risquât d’« entraîner la mort de beaucoup d’hommes qu’on aurait pu épargner... ». « Grâce à Dieu, nous aimons mieux sauver les âmes rachetées du sang du Christ que de les livrer au licteur [850]. » Falais, Gribaldi, Zébédée, Toussaint, pensent qu’on n’a pas le droit d’intenter une poursuite criminelle pour cause de religion. C’était d’ailleurs le point de vue de Servet, fort de l’exemple du Seigneur et des Apôtres. Il n’était pas besoin d’être clerc pour l’imaginer. Des femmes du peuple, des artisans, des marchands, des ouvriers trouvaient fort étrange de « faire mourir en cette cité gens pour religion [851] ». Haller constate que Calvin est blâmé de ceux qui avaient toujours été ses approbateurs, qu’on trouverait à peine un homme sur cent qui parlât bien de Calvin ; et Hotman écrit de Bâle qu’on n’y parle pas mieux de Calvin qu’à Paris [852]. À Zurich, nombre de gens, même des étrangers victimes de la « papauté », Allemands, Français et Italiens, blâment Calvin. Tous tremblent pour le présent et pour l’avenir ; tous redoutent de voir les nouveaux pontifes « surexciter encore l’animosité forcenée de leurs fidèles... pour se défaire des hommes qui s’étaient opposés jusqu’ici à l’exécution de ses plans politico-religieux ». La vie à l’intérieur des Églises réformées menace de devenir « désolante » et le retentissement extérieur sur les guerres de religion est incalculable [853].
Un prophète mineur, réduit à la misère par la grâce de Calvin, Castelllion, élève la voix avec une force toute particulière contre « le forcement des consciences ». Mais son « Conseil à la France désolée », de même que la protestation de ses amis : « De haereticis an sint persequendi », n’aura pas plus de succès immédiat que les efforts d’Étienne Pasquier, de l’Hospital et de beaucoup d’hommes de bonne volonté. « À vingt reprises, opine F. Buisson, il y eut non seulement des possibilités, mais même des probabilités pour le triomphe d’une politique de paix. Malheureusement le fanatisme avait alors ses apôtres et ses agents provocateurs ; et des intérêts, des appétits, des conflits politiques infiniment complexes se faisaient un masque de la question religieuse [854]. »
Étant donné l’influence de Calvin et le rayonnement incroyable de ses écrits, on ne saurait surestimer le rôle qu’il a joué dans la préparation psychologique de cette explosion de haine religieuse qui va ensanglanter l’Europe, et surtout la France. Ce n’est pas impunément qu’un peuple en fermentation est éduqué dans le mépris des scènes paisibles et naïves de la piété médiévale pour s’exalter au spectacle des batailles de l’Ancien Testament. Le parti réformé, de plus en plus calviniste d’inspiration, va non seulement se défendre, mais attaquer avec une mentalité plus dangereuse. Le génial malade aggrave la contagion en exacerbant la psychose de guerre déjà trop répandue.
Les durs qualificatifs utilisés par le psychologue Oskar Pfister sont difficiles à éviter : Calvin ne serait-il pas un théologien sadique [855] ? Il en donne bien des signes, non seulement par le choix unilatéral de ses thèmes bibliques, mais encore par les motifs qui inspirent les actes les plus décisifs de son ministère. Au moment des procès, quand ses victimes s’épuisent dans les tortures ou dans l’angoisse d’un avenir incertain, le réformateur vante ce qu’il croit être de la fermeté et qui n’est que de l’inconscience : « Les syndics traînent (plus indulgents que lui...). Je déploie ma sévérité dans la répression des vices publics et surtout les excès de la jeunesse [856]. » Avec son collaborateur des Gallars, Calvin se mêle directement à la conduite du procès de Gruet. Ailleurs, il se contente d’admirer, et avec quelle complaisance, l’action vengeresse de Dieu contre ses ennemis dont l’un a « eu la tête tranchée de dessus les épaules, le corps attaché au gibet, et la tête clouée en icelui... ». La vie ne comptait pas cher à ses yeux : « Vrai est que Satan a ici assez d’allumettes, mais la flamme s’en va comme celle des étoupes. La punition capitale qu’on a fait de l’un de leurs compagnons leur a bien rabattu les cornes [857]. »
Ce n’est pas Calvin qui brandit le glaive contre les hérétiques, mais c’est tout comme, puisque c’est lui qui définit l’hérésie et signale les suspects. Un simple adversaire d’occasion un peu trop railleur, le médecin Bolsec, que personne ne voudrait inculper, critique la prédestination. Crime impardonnable : « Jérôme (Bolsec) qui se vautre dans les choses sacrées comme un porc immonde fouillant le sol de son groin impur... Que Dieu de sa puissante main frappe ce perturbateur impie... Une aussi odieuse impiété ne peut être tolérée d’aucune façon. Fasse Dieu que nos magistrats s’acquittent, comme ils doivent, de l’office qui leur incombe de faire disparaître les scandales qui troublent l’Église [858]. » Voici encore sans doute ce même Bolsec que Calvin poursuit dans ce protégé de Madame de Cany : « Sachant en partie quel homme c’était, j’eusse voulu qu’il fût pourri en quelque fosse, si ce eût été à mon souhait. Et sa venue me réjouit autant comme qui m’eût navré le cœur d’un poignard. Mais jamais je l’eusse cuidé un monstre si exécrable en toute impiété et mépris de Dieu, comme il s’est ici déclaré. Et vous assure, Madame, s’il ne se fut si tôt échappé, que, pour m’acquitter de mon devoir, il n’eût pas tenu à moi qu’il ne fût passé par le feu [859]. »
Ces vaincus sur lesquels le maître de Genève s’acharne ont sur lui un double avantage. Ils ont au moins autant raison que lui et leur attitude est saine et normale. Tout l’orchestre de la propagande calviniste ne suffit pas à étouffer la petite voix de Bolsec qui s’amusait à chanter dans sa prison :
Ami Calvin, réponds, est-il licite
Dire que Dieu veut, induit, nécessite
L’homme à pécher ? Comment se peut-il faire
Vu que le péché lui est si fort contraire ?
Chrétiens sont-ils devenus tyranniques ?
Chrétiens ont-ils zèle pharisaïque ?...
Brebis du Christ sont-elles si cruelles [860] ?
Loin de toucher Calvin, ces questions l’exaspèrent. Comme si lui seul avait le droit de soumettre les autres à la... question. Il semble sans pitié et souvent sans scrupule contre quiconque ne partage pas ses idées. Il profite de la détresse de Castellion pour le calomnier et le traiter de voleur, avec des périphrases accablantes. Comme il en avait le droit, l’apôtre de la tolérance avait été retirer du bois tombé dans le fleuve, sur les rives du Rhin. Sous la plume du réformateur ce geste devient... un crime : « Le sachant, et le voulant tu te fais au détriment d’autrui un gain honteux et criminel. » La victime de cette diffamation largement répandue par le grand écrivain lui répondit très dignement : « Que toi (Calvin) qui me connais, tu pusses accueillir des bruits pareils, je ne le pensais pas... que dans un livre destiné au public, tu viendrais à les répandre dans le monde entier et jusque devant la postérité, non j’en prends Dieu à témoin, quoique je te connaisse, je ne l’aurais pas cru [861]. »
Dans sa haine et son mépris des adversaires, il ne peut que leur prêter les intentions les plus basses. À l’en croire, Bolsec, Castellion, et même Roussel doivent être les pires des hommes. Il les voit « crever d’ambition et de cupidité, ou de rage », sans s’interroger une seule fois sur ses propres sentiments. Il affirme qu’il a tout fait pour sauver Servet, alors que sept ans auparavant il est déjà décidé à le tuer : « S’il vient ici (à Genève) et que mon autorité ait quelque valeur, je ne souffrirai jamais qu’il en sorte vivant [862]. » Une fois sa victime dénoncée et emprisonnée par ses soins, il n’a qu’une idée fixe : « J’espère que le jugement comportera la peine de mort ». Le peuple est horrifié par la manière barbare dont furent exécutés les Comparet. Il fallut même exiler le bourreau pour calmer l’opinion. On dirait que Calvin a savouré le spectacle : « J’ai acquis la certitude que ce n’est pas sans un jugement particulier de Dieu que les deux ont dû, contrairement à la sentence des juges, subir un long tourment sous la main du bourreau [863]. » Et voici le justicier de Claude Genève et de Berthelier dans un rôle qui va mal avec le titre d’« homme de Dieu » : « Nous verrons avant deux jours, comme je l’espère, ce que la torture leur arrachera. »
Non seulement les chefs du parti genevois sont frappés de mort ou d’exil, mais quiconque s’est plus ou moins compromis avec eux est exposé au même sort, comme G. Bonnet, Nicod Duchesne, Pierre Savoye. Les femmes des condamnés sont obligées de vider la ville sous peine de fouet. La femme de Ph. Berthelier est chassée de sa maison, bien qu’elle fût sur le point d’accoucher [864]. Cette justice expéditive, abusant de son triomphe, se charge de trente-six exécutions capitales entre février 1557 et février 1558. Après Balzac, Stefan Zweig essaie de mesurer le retentissement probable de la mentalité angoissante de Calvin : « Sur un théâtre plus vaste que Genève, Calvin eût fait couler plus de sang que Robespierre [865]. » Quoi qu’il en soit, la déesse Raison ne pouvait guère se montrer plus exigeante que ce Dieu qui commande à ses fidèles de se laver les mains dans le sang des pervers. Les modèles que Calvin se choisit dans l’Ancien Testament « par leur cruauté... sanctifient leurs mains, lesquelles ils eussent souillées en pardonnant [866] ».
Il assume la pleine responsabilité de ses actes et avoue spontanément que cette épuration se fait sous son influence et sur ses instances : « Meo impulsu... meo hortatu [867]. » Il n’a pas conscience de commettre le moindre mal. Il étale une innocence pathologique : « Je ne puis plus supporter le caractère de ce peuple, même s’il supporte le mien. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi on m’accuse de dureté. » Il joue à la victime ; il s’étonne qu’on ne l’aime pas, il gémit qu’on le déteste sans raison. Il est le juste persécuté. Non seulement Perrin est « un fauve échappé de la cage par la faute de ses gardiens », mais les réformés eux-mêmes de Zurich et d’ailleurs, qui n’épousent pas toutes ses querelles, sont des bêtes féroces à ses yeux. « Si tu savais seulement par quels atroces pervers je suis déchiré, avec ton cœur humain, tu gémirais des misères auxquelles je suis endurci. » Qu’il rencontre « dans son troupeau plus de haine que de la part des ennemis déclarés au sein de la papauté », c’est un mystère insoluble. Roget témoigne d’un bon vouloir méritoire en essayant d’excuser le réformateur : « C’est la férocité politique, qui, bien plus que la haine vigoureuse que leur avait vouée Calvin, fit tomber la tête des amis de Perrin [868]. » Cependant le réformateur n’avait qu’un geste à faire pour apaiser les esprits. Il les a au contraire surexcités au plus haut degré.
À Genève, il aggrave les méthodes judiciaires et au loin, à travers toute l’Europe, il fouette les passions morbides. C’est une véritable hystérie que dénonce Renée de Ferrare elle-même, peu suspecte de modération : « Je suis marrie, lui écrit-elle, que vous ne savez pas comme la moitié du monde se gouverne en ce royaume, et les adulations et envies qui y règnent, et jusques à exhorter les simples femmelettes dire que, de leurs mains, elle voudraient tuer et étrangler ; ce n’est point la règle de Jésus-Christ [869]. » Elle y arrivera cependant elle-même, si elle veut bien se persuader de la doctrine du Deutéronome prescrivant de tuer, de lapider, de sa propre main, le frère, le fils, la femme ou l’ami, qui passe à l’idolâtrie. « Ici, fait Calvin, notre Seigneur nous constitue tous ses procureurs ! » Il faut haïr, c’est Dieu qui parle et commande. Le réformateur a plus vite appliqué cette doctrine que celle des béatitudes [870].
Doumergue se pâme d’admiration en examinant la correspondance de Calvin avec les dames, propagandistes par excellence du parti réformé, auxquelles il réserve le meilleur de sa prédication épistolaire. « Que de temps ! Que de forces ! Que d’intelligence ! quel tact ! quelle mesure ! quelle noblesse ! et quelle pieuse affection !... Princesses et grandes dames sont des femmes, nous avertit solennellement Doumergue, et les femmes ont joué un très grand rôle au moment de la Réforme... le fait reste, il y avait beaucoup de femmes et des femmes nobles [871]. » Parmi les marques de cette « délicatesse », faut-il placer la rigueur avec laquelle le Maître de Genève intime, à distance, à des créatures passionnées et angoissées, l’ordre de briser des foyers, de partir pour l’exil, de se réjouir de la mort d’un frère ou d’un mari, qui débarrasse le terrain pour la Réforme, tel un Monsieur de Guise : « J’ai souvent désiré que Dieu mît la main sur lui pour délivrer son Église, s’il ne voulait se convertir [872]. » Tels sont les beaux sentiments que Renée de Ferrare devrait relever dans les psaumes commentés par le Réformateur ; effectivement, après cette lecture, elle se rend. « David a haï les ennemis de Dieu de haine mortelle, je n’entends point contrevenir, ni déroger à cela... » Et elle se met à souhaiter conditionnellement l’enfer à tous ceux qu’elle aime, « s’ils sont réprouvés de Dieu ». Madame de Pons reçoit à la mort de son mari des consolations qu’on pourrait résumer ainsi : votre fléau de mari est mort, Dieu soit loué [873]. Ce Dieu ne tolère aucune neutralité, aucune indulgence. Et Calvin lui ressemble volontiers. Quelqu’un n’accepte pas la « parole du Seigneur », c’est-à-dire sa parole, aussitôt intervient la haine absolue : « Je ne pourrais nullement lui pardonner et fût-il cent fois mon propre père [874]. »
On doit faire la part très grande à l’emphase et à la rhétorique qui se délectait de grosses injures à l’adresse des adversaires de la Réforme : « Sacrilèges, impies, idolâtres, bélîtres, ordes bêtes, couchons, truies, chiens, vipères, etc. » Mais à la longue, ces violences de pensée et de parole entraînent la dureté des actes et la sauvagerie des mœurs. Une psychose de terreur menace de pénétrer plus à fond et de durer plus longtemps quand le fanatisme religieux s’en mêle. Avant l’intervention de Calvin, la répression des hérétiques était une malheureuse question de fait qui laissait subsister bien des doutes quant à sa légitimité. Pour Calvin elle devient une question de foi et de droit, une doctrine essentielle dont il fait si hautement profession qu’il en devient le professeur attitré : « Certains m’accusent durement de m’ériger en maître de cruauté et d’atrocité [875]. » La tragédie de l’évangélisme persécuté fut de se transformer en calvinisme persécuteur, et persécuteur fervent, depuis que le prophète rend Dieu directement responsable de ces massacres. Les hommes de ce temps, déjà irrésistiblement tentés par le goût de la brutalité, voient leurs instincts en quelque sorte divinisés.
Car la joie de la colère devient un service divin : « Nous ne devons point souffrir que quelqu’un s’élève pour troubler l’Église et pour faire une révolte, que telle peste soit bientôt exterminée [876]. » Les humanistes, ces rieurs tolérants, qui veulent empêcher la suppression des hérétiques, sont encore pire qu’eux : « Si un homme qui veut nous attirer après des dieux étrangers mérite la mort, que sera-ce de ces chiens qui ne demandent qu’à pervertir et abrutir tout le monde, tellement qu’on ne sache plus ce que c’est que la religion... gens profanes qui ne font que se gaudir et se moquer de tout ce qu’on dira de Dieu ». La tolérance et l’humanisme sont les plus funestes des hérésies et les plus dignes d’être châtiées. Pas de quartier ! « Que le premier qui aura connu le mal, que celui-là le découvre, et qu’un chacun fasse en son devoir, en sorte que telles pestes ne soient point nourries au milieu de nous... Il faut couper les mauvaises herbes bien tôt, comme dit l’Apôtre, en l’Épître aux Hébreux. Qu’un chacun s’incite et se pique... Si quelqu’un tâche à me débaucher (du calvinisme), voilà Dieu qui me commande de me lever contre lui, quand il serait mon frère germain, que ce serait mon fils ou ma femme, il est dit que je ne dois rien épargner [877]. »
L’épouvantable croisade des guerres de religion a trouvé son fondement dogmatique : « Nous devons user d’une telle rigueur, non seulement envers une seule personne, mais envers toute une ville... Ceux qui ont l’autorité du glaive ne doivent être nonchalants. » Et les fidèles doivent stimuler leur sainte ardeur. Les attentats utiles à la cause reçoivent leur justification théologique. « Voici que le Seigneur en a suscité un qui a percé notre tyran [878]. » Il n’y a pas de limite à ce zèle frénétique. Dieu lui-même est menacé dans son honneur par le moindre retard à « faire justice » : « Quand on a retiré un homme du gibet, il voudrait avoir vu pendre ceux qui l’ont délivré. »
Il n’est même pas requis d’attendre des preuves et des actes. Des présomptions suffisent à cette justice préventive. Punir d’avance offre de précieux avantages : « Quand nous voyons des gens qui ne demandent qu’à tout pervertir, il les faut réprimer avant le coup, et ne point attendre à l’extrémité ; car c’est une maudite patience... Si Dieu ne nous donne pas le moyen de purger le mal sitôt que nous voudrions, il nous faut gémir... nous sommes trop froids en cet endroit, nous sommes admonestés de nous piquer. » Et donc, sus au pervers : « Quelle miséricorde est-ce d’en vouloir épargner deux ou trois pour faire couper la gorge à tout un peuple. » Telle est la mystérieuse efficacité de cette réforme : réprimer sans pitié les « malpensants », nettoyer la cité par le glaive, et l’ordre fleurira : « Voilà tous les crimes en un monceau... voilà tout un peuple purgé, voilà la guérison commune [879]. »
Ce venin de la colère empoisonne non seulement l’âme du réformateur mais celle de tous ses disciples. Atteints par cette contagion, Viret, Bèze, Knox, Farel, propageront un esprit agressif qui gagnera de proche en proche les adversaires eux-mêmes. Tout le monde s’habituera peu à peu à un genre imprécatoire et vociférateur qui ne laissera plus aucune chance à une vue objective de la situation, à une compréhension tolérante des opinions [880]. Doumergue évidemment a une excuse toute prête : « Les temps étaient affreux... Rome qui avait l’Inquisition venait de se donner les jésuites (sic). Dans une pareille extrémité que faire ? Les justes milieux, les atermoiements étaient mortels. Il fallait des héros à l’âme de feu, au bras de fer. Il fallait des héros conscients de leur mission divine, incapables de douter de la victoire [881]. » Les temps affreux justifient une théologie affreuse, la prédestination. L’apparition des jésuites, dont on ne sait rien à Genève au temps de Calvin, exige le reniement de l’équité et de la charité évangélique, toutes valeurs « mortelles » en période critique. Le fanatisme était-il le seul moyen de sauver la Réforme ? Nous admettons volontiers la bonne foi de Doumergue et de ses pareils, mais avec Oskar Pfister nous pensons que cette mentalité religieuse pourrait encore aujourd’hui déchaîner une dangereuse psychose.
Les nécessités du pouvoir n’ont pas épanoui la bonté de Calvin. Il n’aimera plus que ses fidèles, et encore dans la mesure de leur docilité et de leur attachement à sa cause. Il se dépense avec un zèle admirable pour venir en aide aux réfugiés qui cherchent asile à Genève. Mais malheur à ceux-ci aussitôt qu’ils manifesteront la moindre indépendance. Les Ochino, les Gentilis, les Bolsec, les Castellion et tant d’exilés, apprirent à leurs dépens l’étroitesse des liens qui devaient unir les seuls partisans, à l’exclusion de tous les autres. Pour démontrer que Calvin fut « un législateur singulièrement humain » Doumergue cite des textes recommandant la « douceur envers les tout petits et même toutes les bêtes [882]. » Sa doctrine n’est pas si tendre et ses actes moins encore. « Le traité sur la punition des hérétiques est de 1554. Que l’on compare ces doctrines avec celles d’Érasme sur la tolérance religieuse... on mesure la régression qui s’est accomplie depuis moins d’un siècle [883]. » Viénot reconnaît que l’erreur de Calvin n’était pas simplement « l’erreur de son siècle ». Mais on pourrait croire, à le lire, que la tolérance est un fruit de la Réforme, alors qu’elle est le fait d’un humanisme antérieur à la révolution religieuse. Calvin a commencé sa carrière comme humaniste catholique (on a bien de la peine à l’imaginer) en écrivant un traité de la tolérance (1532). Vingt-deux ans plus tard, il consacre son triomphe sanglant à Genève par la proclamation du droit de glaive contre les hérétiques.
Aucune hyperbole ne saurait dire combien l’intolérance lui tient à cœur. « Il vaudrait mieux que le monde pérît un million de fois que la gloire de Dieu fût obscurcie » par la pensée d’un homme libre [884]. On ne peut prier à la manière orthodoxe sans s’imprégner de cette violence, en prenant de préférence « à la bouche même de Dieu » les menaces les plus terribles des prophètes et du psalmiste.
Sans doute les Parlements, les rois, l’Inquisition ont provoqué un grand nombre de condamnations capitales. Une vraie réforme aurait au moins pu se dispenser de rivaliser avec des institutions qu’elle dénonçait à cor et à cri. Dans cette importante question de la liberté des consciences et de la discipline religieuse, Calvin représente un recul, non seulement dans les méthodes, mais plus encore dans l’esprit qui les anime.
CHAPITRE II
Loyola, les hérétiques et l’Inquisition
Aux moments où il était le plus menacé, le calvinisme fut sauvé et rétabli à Genève par le sacrifice de nombreuses victimes, dont Servet est le nom le plus connu. Mais la victoire de la Compagnie de Jésus ne repose-t-elle pas sur des procès du même genre ? Question capitale : se serait-elle maintenue sans la condamnation d’adversaires tels que Landivar, Pierre de Castillo et Mainardi ?
Le pénitent qui, pendant une vingtaine d’années, prenait plaisir à se faire bafouer, subitement se montre intraitable contre des dénonciateurs inquiets de son orthodoxie. Ce revirement dans l’attitude d’Ignace intrigua ses compagnons eux-mêmes. Lui, naguère si patient au cours d’une douzaine d’enquêtes subies avec le sourire, s’active maintenant à poursuivre des adversaires qui, pris de peur, sont disposés à s’excuser et à rétracter leurs accusations [885]. Contre l’avis de tous les autres Pères, qui reflétaient certainement la pensée habituelle du fondateur, Loyola mène ce procès jusqu’à sa conclusion définitive et ne désarme qu’après avoir obtenu une sentence en bonne et due forme. Refoulé si longtemps, le fanatisme espagnol aurait-il trouvé le moyen de sourdre à nouveau ?
Cependant, l’attitude du chef de la Compagnie ne trahit aucune animosité, aucune malveillance. Il a mûrement réfléchi et pesé devant Dieu le pour et le contre de sa détermination. Il voit ses efforts apostoliques sans cesse compromis par des discussions fastidieuses sur l’authenticité de son catholicisme. Aussi longtemps que sa seule personne était en jeu, sa patience n’eut pas de bornes. Mais une œuvre collective s’ébauchait, dans laquelle ses compagnons présents et futurs étaient tous solidaires. Pouvait-il indéfiniment les exposer à des soupçons, à des tracasseries paralysantes ? La passivité naïve et complice avait assez duré. L’heure de l’action, et même de la réaction a sonné, pour le capitaine de Pampelune. Plutôt que de laisser ternir, sans rime ni raison, le bon renom de ses amis et défigurer leur zèle pour l’Église, Loyola décide de requérir désormais, en des circonstances pareilles, une contre‑épreuve juridique et officielle des approbations déjà obtenues des autorités ecclésiastiques.
Ignace s’engage sur une voie critique où le désir d’efficacité pourrait être séduit par la volonté de puissance. Le « pur » Évangile doit tenir compte des contingences et descendre dans des réalités décevantes que comporte la lutte. Les contradicteurs de Loyola ne sont nullement scrupuleux dans le choix des moyens. Leurs attaques, déjà tenaces à Paris et à Venise, vont prendre une forme sournoise et d’autant plus dangereuse. L’un de ces adversaires, Miguel Landivar, avait même failli tuer Inigo à Paris, tant la conversion de Xavier l’avait mis hors de lui. En Italie et à Rome même, l’influence des compagnons est combattue par des rumeurs confuses. Le passé de Loyola et de ses disciples était l’objet de commentaires malveillants. Ils s’étaient permis de critiquer trop franchement les idées hardies des prédicateurs en vogue tels que Mainardi. Dans leur zèle enthousiaste, les partisans des novateurs ne trouvent rien de mieux que de dénoncer Loyola et ses compagnons. Inspiration originale : des hérétiques accusent les premiers jésuites devant le tribunal suprême de la foi catholique [886]. Mal leur en prit. Une fois cette affaire engagée par la partie adverse, Loyola n’était pas homme à se dérober. Et que l’accusation se retire à son tour, le doute n’en continuerait pas moins à planer sur la Compagnie naissante. Aucune équivoque ne devait subsister sur son premier départ.
La défiance semée avec soin autour des compagnons rendait leur activité de plus en plus stérile. On n’osait plus leur témoigner ouvertement de l’amitié, les auditeurs ne venaient plus au sermon, on craignait de leur confier des enfants pour le catéchisme. Suivant le principe d’action qu’il observait habituellement dans ses propres démêlés avec les juges ecclésiastiques, Loyola insista pour qu’une sentence catégorique fût prononcée ; ou bien ils étaient coupables et devaient être condamnés ; ou bien ils étaient acquittés et leur apostolat serait garanti contre de nouvelles contradictions.
Ce n’était plus seulement une question d’abnégation personnelle ; un exercice d’humiliation, comme tant d’autres auxquels le pèlerin s’était joyeusement soumis. Il y allait de l’honneur et de l’existence même de l’Ordre, de l’édification ou du scandale d’un grand nombre. Si jamais ces « prêtres réformés » voulaient exercer une influence apostolique, il fallait qu’un jugement solennel leur rendît la confiance publique et empêchât les dénonciations de se renouveler toujours. Que les accusateurs se soient désistés, cela ne changeait nullement l’état de l’opinion, tant que l’autorité n’aurait pas tranché le débat. Naguère Loyola, appelé à se défendre seul, dédaignait même l’appui qu’on lui offrait d’un avocat ou d’un procureur, nous dit Ribadeneira, tant il s’abandonnait en celui pour lequel il souffrait. Mais après avoir réuni des compagnons, s’il était en butte à des attaques sérieuses, il mettait tout en branle pour assurer aux siens le bouclier d’une décision juridique [887].
Les adversaires disposaient de grandes ressources et de crédit. L’éloquence et le charme de Mainardi avaient beaucoup de partisans. Le doyen du Sacré Collège lui-même, le cardinal de Cupis, soupçonnait le pire chez les compagnons de Loyola, redoutant davantage « les loups qui se présentent sous les dehors de brebis, que les vrais loups » dont on s’écarte spontanément. L’affaire traîna pendant huit mois, les vrais loups jugeant préférable de ne pas insister, trop contents de se faire oublier. Ce n’était pas du goût d’Ignace, dont l’amour des situations claires primait toutes les considérations de convenances. Il fit tant que le procès continua et que l’enquête fut poussée à fond, sur les « Exercices », sur la doctrine et la vie des compagnons, sur les idées et menées de leurs adversaires.
Il n’y eut ni torture, ni effusion de sang, ni pamphlet, ni concours d’éloquence judiciaire, mais une convergence impressionnante de dépositions et de témoignages. Pour aider les recherches, la Providence permit que les hommes les mieux informés sur l’ensemble de la question se rencontrassent, en ce moment, à Rome, c’est-à-dire les juges de l’Inquisition qui avaient examiné Loyola en Espagne, à Paris et en Italie. Les déclarations concordantes et simultanées de l’inquisiteur Figueroa d’Alcala, du docteur Gaspard des Doctis de Venise, de l’inquisiteur de Paris, Mathieu Ori, faisaient la lumière sur des faits qu’ils avaient passés au crible le plus serré. Pour les activités présentes du jeune Institut, de nombreux personnages civils et ecclésiastiques se portaient garants. Le jugement fut d’autant plus élogieux pour les Compagnons inculpés, qu’il devait être sévère pour les accusateurs obligés de prendre la fuite, ou de subir le feu... en effigie [888].
Loyola n’a jamais eu l’occasion d’écrire un traité sur la clémence, comme le jeune humaniste noyonnais au temps de sa jeunesse catholique. En bon Espagnol, il estime que l’abandon de la foi équivaut à une trahison et à un délit public. Au pays de la reconquista, il est tout naturel de regarder les adversaires de la religion comme des ennemis de l’ordre établi. Loyola n’a jamais songé à innover : il reconnaît, sans se poser de problème, le droit et même le devoir du souverain de défendre la vraie foi par le glaive. Avec le peu d’humanisme qu’il réussit à assimiler, l’idée de tolérance ne lui fut pas enseignée. La charité, en revanche, cultivée avec prédilection, sauva, dans la pratique, un sens de la modération et une indulgence rarement surprise.
Voici, cependant, l’intransigeance du médiéval. Quelques mois après l’ouvrage, le plus malheureux sans doute qui soit sorti de la plume de Calvin, démontrant dans sa Defensio fidei « qu’il est licite de punir les hérétiques et qu’à bon droit ce méchant (Servet) a été exécuté », à cette date lourde de toutes les guerres civiles, Loyola est amené à son tour à rédiger, sur le même sujet de la répression des hérétiques, un mémoire qui est aussi bien regrettable. Embarrassé par une question du roi Ferdinand sur le choix des moyens les meilleurs pour réformer ses États, Canisius, dans son incertitude, s’était adressé au Général. Celui-ci consulte ses théologiens, Laynez, Salmeron, Olave, Frusius, Polanco et finit par transmettre à l’apôtre de l’Allemagne des avis inspirés visiblement des méthodes du Parlement français. Ces conseils ne semblent pas satisfaire entièrement l’esprit de Loyola. Les formules qu’il emploie sont plus hésitantes que d’habitude. Canisius ne reçoit aucun ordre formel, mais seulement des suggestions qui devront être examinées avec le recteur de Vienne, le P. de Lannoy. Ils soumettront ce mémoire au souverain, ou le laisseront de côté, suivant qu’ils le jugeront opportun. Il est heureux que ces consignes d’inspiration trop espagnole et française soient restées effectivement lettre morte [889].
Comment favoriser la réforme catholique à l’exception de toute autre ? Loyola s’étend longuement sur les moyens positifs et développe son plan habituel de pédagogie et d’apostolat. Mais il vaut la peine de citer les « moyens préventifs », où nous trouvons les passages probablement les plus durs que Loyola ait laissés. « Le premier de ces moyens préventifs serait que Sa Majesté non seulement se montrât catholique, mais encore ennemie énergique et résolue des hérétiques. Ce serait sans doute le plus grand et le plus approprié des moyens humains. » Le rapport conseille ensuite d’écarter des conseils royaux, de la magistrature et de l’administration, de toutes les dignités et fonctions importantes, les personnes suspectes d’hérésie. « Le remède serait encore plus efficace si l’on faisait quelques exemples, en frappant les hérétiques dans leur vie, dans leurs biens, ou en les condamnant à l’exil, pour montrer le sérieux avec lequel on traite les affaires de la religion. » À ce « sérieux » médiéval, Favre et Canisius, par bonheur, préfèrent les armes spirituelles qu’un François de Sales préconisera après eux : « J’ai toujours dit que qui prêche avec amour, prêche assez contre les hérétiques, quoiqu’il ne dise un seul mot de dispute contre eux [890]. »
Après avoir détaillé les zones d’influence auxquelles devait s’étendre l’épuration (enseignement, universités, collèges, presse, librairies, clergé, fonctionnaires, etc.), le mémoire atteint son point culminant : « Les prédicateurs d’hérésies, les hérésiarques et enfin quiconque serait surpris en train de communiquer cette peste à d’autres, devraient, semble-t-il, être punis de supplices sévères – gravibus suppliciis –. Il faudrait déclarer publiquement que ceux qui se repentiraient dans l’espace d’un mois, à partir du jour de la publication, pourraient obtenir une absolution bienveillante dans le for interne et externe. Après ce temps, que ceux qui seraient surpris dans l’hérésie deviennent infâmes et inaptes à tous les honneurs. Et s’il apparaissait possible de les frapper de l’exil, de la prison, ou quelquefois de la mort, ce serait peut-être encore plus à propos – consultius – : Mais je ne parle pas du dernier supplice (le feu ?), ni d’établir l’Inquisition, car cela semble dépasser la compréhension de l’Allemagne telle qu’elle est actuellement disposée. »
Canisius et le roi jugèrent les conseils positifs plus acceptables que les projets de répression. Ce mémoire servit beaucoup plus à stimuler la formation des élites ecclésiastiques et laïques, à lancer les écoles et la presse catholiques, qu’à allumer les bûchers. Assurément, Loyola « retarde » au point de vue de la tolérance : il compte encore trop sur la police pour sauver l’orthodoxie. Il est de son temps. Mais nous continuons à croire que son esprit pèche moins que celui de Calvin contre la charité évangélique. Son avis n’a rien de personnel ; il fait écho aux usages courants en France. C’est une thèse commune énoncée timidement. Il est plus que probable d’ailleurs que ce mémoire confidentiel n’a pas été transmis à son destinataire royal. Loyola était d’accord de se laisser corriger par ses disciples de Vienne. S’il ignore la théorie de la tolérance, il en tolère la pratique.
Au contraire, la diatribe de Calvin sur la punition des hérétiques détermine une réaction décisive. Immédiatement publiée dans les deux langues et souvent rééditée, elle ne vise à rien moins qu’à changer la mentalité européenne. L’intolérance gagne en profondeur. Ce n’est plus seulement une précaution politique, c’est un dogme nouveau, une nécessité théologique. La répression n’est plus facultative, applicable suivant l’opportunité ; elle est exigée en bloc contre tous les mal pensants. À en croire Calvin, ceux qui n’admettent pas la peine de mort contre les blasphémateurs blasphèment eux-mêmes et, coupables du même crime, sont passibles de la même peine [891].
Il semble bien que personne ne soit jamais mort par la faute de Loyola et il n’a sûrement jamais poursuivi personnellement un adversaire avec l’intention de le faire exécuter par le bras séculier. Ses interventions pour adoucir les peines des adversaires prouvent assez chez lui une absence totale de colère ou de rancune [892]. Avec la plupart des fidèles à cette époque, il admet, sans examen critique, les institutions existantes, parmi lesquelles l’Inquisition. À la demande du pape, il se résigne, malgré sa répugnance innée pour les procès, à donner des avis ou à laisser tel ou tel de ses compagnons recevoir une charge de consulteur du Saint-Office.
Cependant la jeune Compagnie eut suffisamment d’attaques à subir de la part de l’Inquisition et du Parlement français pour mériter de ne pas être confondue avec ces instruments de la répression catholique. Une des luttes les plus acharnées que soutint le nouvel Ordre en Espagne, par exemple, avait justement comme enjeu le privilège pontifical des jésuites de pouvoir absoudre les hérétiques, en secret, au confessionnal, sans recourir aux tribunaux de la foi. Ils déployèrent des efforts généreux pour adoucir les méthodes inquisitoriales et pour soustraire cette institution à l’arbitraire de l’État. L’Inquisition choisit parfois ses victimes parmi les membres de l’Ordre. Le cas du jésuite missionnaire G. Malagrida reste célèbre : ne fut-il pas condamné au bûcher par l’Inquisition portugaise au service de Pombal [893] ? Des jésuites tels que Tanner, Laymann et surtout le poète Fr. Spee, dont Leibniz admirait la « Cautio criminalis », jouèrent un rôle décisif dans la lutte contre les stupides procès de sorcières [894]. Au contraire, le prestige de Calvin contribua sérieusement à la propagation de cette psychose des « hériges », des sorciers, des boute-peste [895].
Les relations de Loyola avec les hérétiques furent presque toujours indirectes, par l’intermédiaire de ses compagnons. À ceux-ci, il dicte de loin des mots d’ordre d’une sagesse et d’une modération peu communes. À Laynez, Salmeron, Lejay, en 1546, à Trente, il envoie, par exemple, une instruction prescrivant entre autres : « Dans les sermons, il ne faut toucher aucun point sur lequel les protestants ne seraient pas d’accord avec les catholiques. Il faut simplement encourager la pratique des usages et des dévotions de l’Église, en poussant les âmes à une entière connaissance de soi et à une meilleure connaissance et amour de leur Créateur et Seigneur [896]. » Toute la prédication, comme toute l’apologétique des compagnons, doit être positive et surtout s’appuyer sur l’exemple, s’inspirer de l’oraison et amener les fidèles à faire oraison. Cette recommandation revient six fois dans la seule instruction que nous venons de citer. Elle occupe encore la première place dans l’« Instruction del modo de proceder » adressée à Broet et Pelletier et aux compagnons de Ferrare, où le duc Hercule II d’Este leur est tout favorable, où les ménagements par conséquent sont dictés, encore plus qu’en d’autres circonstances, par des motifs de seule charité. Si les jésuites sont invités à étudier les questions controversées et à s’armer, contre les hérésies, d’une doctrine capable « de découvrir les plaies et de les guérir », ce n’est pas pour « exterminer » les conseillers calvinistes qui rôdent autour de Renée de Ferrare et de sa cour, mais pour « essayer de les gagner avec amour » [897].
L’historien allemand B. Duhr définit bien l’esprit avec lequel les compagnons de Loyola abordèrent le problème de la conversion des protestants. « La caractéristique de l’activité des premiers jésuites a été l’esprit de douceur et de charité dans lequel elle se déploya. Chez Favre vit et agit non pas l’esprit d’un zélote qui voit partout des hérétiques et désire les brûler, mais l’esprit de la charité compatissante, qui dans le frère, à ses yeux égaré, voit d’abord le frère, et ensuite seulement l’erreur. Ainsi jamais un mot cruel ne lui échappe : il excuse, il cherche à persuader et, par-dessus tout, il prie. Et comme preuve qu’il n’y a pas l’ombre de dissimulation, ni d’hypocrisie, il suffit de remarquer que les plus beaux traits de sa sympathie (à l’égard des protestants) se trouvent dans son journal, qui n’était pas destiné à la publication, et resta inédit pendant des siècles, ainsi que dans des lettres confidentielles, dans lesquelles il ouvre son cœur à des amis [898] ». Nous connaissons les sentiments affichés publiquement par Calvin à l’égard de ses adversaires et des « hérétiques ». Nous n’osons imaginer ce qu’auraient été ses effusions intimes s’il en avait tenu un journal fidèle. En revanche, quel témoignage de charité rendent les notes exclusivement personnelles du fragment de journal de Loyola ou du Mémorial de son premier disciple Pierre Favre !
Le journal d’Ignace que nous possédons pour une période de plus de trois mois, n’offre pas une ombre d’amertume, pas même quand, incommodé par des doutes, il commande tranquillement au diable : « á tu posta », à ta place ! Les réflexions suivantes découvrent la racine de sa bonté : « Il me semblait que l’humilité, le respect et la vénération ne devaient pas être animés par la crainte, mais par l’amour. Cette certitude s’imposa si fort à mon esprit que je disais continuellement : « Donnez-moi une humilité pleine d’amour, et de même une vénération et un respect aimants »... Plus tard, consolé, il éprouve le besoin de répandre cette tendresse sur la création entière : « Il me sembla que je ne pouvais en rester là, mais que je devais avoir à l’égard de toutes les créatures la même attitude d’humilité pleine d’amour, à moins que parfois cela ne s’accorde pas avec la gloire de Dieu, comme dit l’Évangile : je serais semblable à vous, un menteur [899]... » Favre pense que la chose la plus indispensable pour travailler au milieu des protestants, c’est de les aimer vraiment, « d’avoir une grande sympathie et un grand amour pour eux, et de gagner leur amour et leur estime [900] ». Et de fait, les compagnons gagnaient le cœur des personnages protestants qui ne dédaignaient pas de causer avec eux, comme les conseillers secrets luthériens de la diète d’Augsbourg de 1551 [901]. Canisius peut dire de Lejay : « Personne n’a davantage travaillé et souffert auprès des protestants. Il a peiné partout de telle manière que tous désiraient le garder près d’eux. Dans ses leçons, il parlait avec une telle douceur qu’il aurait été difficile de se sentir blessé. Et cependant, il était toujours exact et concis, développant avec facilité les questions les plus difficiles [902]. »
Favre et Canisius représentent bien la mentalité de Loyola à l’égard des protestants. Leurs regards sont fixés sur les maux et les remèdes spirituels. C’est la décadence de l’élite et du clergé qui les inquiète. « Il est étonnant, disait Favre, qu’il n’y ait pas deux ou trois fois plus d’hérétiques, pour le simple motif qu’une vie scandaleuse conduit à l’incrédulité. Ce n’est pas l’abus de l’Écriture dans la prédication, ni les raisons spécieuses des luthériens dans les disputes qui ont pu amener tout un peuple à se détacher de l’Église... La faute principale revient à la vie scandaleuse des clercs [903]... » À la vue de tant de faiblesses et de l’inanité des disputes et de la polémique, Canisius se propose « de dépasser la plupart des autres auteurs par son amour et sa modération. Ceux-ci, dans leurs violences, dans leur passion trop humaine, emploient des remèdes trop forts qui, au lieu de guérir, ne font qu’irriter les Allemands ». Il est décidé à « maintenir la paix et la charité à travers ses écrits, malgré les attaques les plus violentes et les plus injurieuses à son égard [904] ». Il écrit à un professeur de Dillingen qui abusait de l’ironie : « Avec des médecines aussi amères, loin de guérir les malades, nous les rendons incurables. Il faut défendre la vérité avec force et sobriété, afin que notre modestie soit connue de tous et que nous récoltions un bon témoignage auprès de ceux qui se trouvent en dehors (de l’Église). Les gens, chez nous, en Allemagne, sont dégoûtés des disputes passées. Les bien-pensants eux-mêmes répugnent à voir défendre leur foi avec amertume. Ce que tous désirent et louent, c’est la modération, unie à la dignité, et à une démonstration solide. L’esprit de douceur nous commande d’avertir ceux qui se trompent plutôt que les aigrir [905]. » L’apôtre intervient souvent à Rome pour suggérer l’indulgence dans la manière de traiter les Allemands : « Nous demandons instamment toutes les permissions requises (Index, censures, jeûne), pour traiter nos Allemands avec plus de douceur, afin de ne pas éteindre la mèche encore fumante [906]. »
Les compagnons, si conciliants pour la population protestante, ne faisaient que mettre en pratique les recommandations du fondateur de la Compagnie, rappelant à ses subordonnés de Cologne et d’Ingolstadt que « les attaques directes aigrissent et endurcissent, alors que la clarté et la splendeur de la vérité gagnent les cœurs [907] ». Il insiste pour que les leçons de théologie, aussi bien que la prédication, s’abstiennent de toute injure à l’égard des hérétiques. Les dogmes doivent être exposés d’une manière sereine et positive. L’erreur des doctrines opposées se déduira d’elle-même. L’Espagnol Nadal, cependant plus excusable d’être prévenu contre les protestants, exprime la pensée d’Ignace en prescrivant aux compagnons « qu’on n’entende jamais de la part d’un jésuite un mot qui puisse être interprété comme une offense ou une injure. Il faut se contenter de présenter les vérités de la foi avec zèle et constance [908] ». Et pour se prémunir contre le démon de la colère, les amis de Loyola avaient des méthodes naïves qui nous semblent plus aptes à traduire la véritable mentalité chrétienne que des volumes de controverse. Laynez recommandait, par exemple, « quand une pensée contre quelqu’un vous obsède, mettez-vous Na genoux et priez pour lui jusqu’à ce que votre esprit en soit délivré [909] ». Laynez disait encore à Canisius : « On ne doit pas dire facilement qu’une opinion est hérétique. Dans les discussions, il faut absolument éviter d’appeler quelqu’un hérétique. » Et le terme que Canisius employait dans une lettre datée du concile de Trente, pour désigner les protestants, « nos frères séparés », illustre son attitude comme celle de son maître en face des hérétiques [910].
Incapable de suivre les agissements de tous les compagnons d’Ignace en contact avec les protestants, nous nous contenterons de citer le jugement d’un historien digne de toute confiance : « On ne peut fournir la preuve, affirme Bernhard Duhr, que sur l’instigation des jésuites, un seul protestant ait été exécuté en Allemagne à cause de sa foi [911]. » Il n’y a pas de raison pour qu’ils se soient montrés là plus féroces ailleurs. Les exceptions et les extravagances ne sont jamais, nulle part, tout à fait exclues : le nom de Bobadilla seul suffirait à le prouver. Mais le peu de crédit dont jouissait cet homme fantasque indique assez de quel côté il faut chercher le véritable esprit d’Ignace. Et ce qu’il importe de ne pas perdre de vue, c’est que « l’activité des jésuites contre les protestants, en Allemagne même, n’occupe pas un dixième des forces qu’ils y ont engagées [912] ». Donc, un apostolat défensif secondaire en regard des activités essentielles de l’Ordre.
Il faut attendre la mort de Loyola et de Calvin pour voir apparaître dans la correspondance des jésuites les premiers signes de la lutte qui allait s’engager entre les deux mouvements caractéristiques de la Réforme et de la Contre-Réforme. Alors, peu à peu, Calvin commence à faire figure de premier adversaire de l’Église romaine.
En 1560, Laynez eut à Rome une longue discussion avec un calviniste qui essayait de répandre sa doctrine. Le Genevois, prisonnier de l’Inquisition, ne présenta, au cours des débats, qu’une seule défense : « J’en appelle à Calvin [913]. » Et le 6 avril 1563, Polanco écrit de Trente au P. Araoz, en Espagne : « En Allemagne, la doctrine de Calvin gagne du terrain. L’Électeur de Saxe veut abandonner le luthéranisme et passer à Calvin... ce changement continuel est un signe que ces formations de sectes n’ont jamais longue durée [914]. » Que Polanco et même Canisius mentionnent en passant la mort de Calvin et évoquent, à cette occasion, la fin misérable d’Hérode, cela n’a rien de surprenant, si l’on connaît les bruits que colportaient à plaisir, en ce moment, les diplomates et spécialement les luthériens [915]. Le document dans lequel Calvin a décrit ses multiples misères mettait à une rude épreuve les habitudes médisantes d’une époque qui avait, du respect et des convenances, une autre notion que nous [916].
Dans la lutte défensive qu’ils soutiennent pour sauver l’Église traditionnelle, les vrais compagnons de Loyola manifestent, en même temps qu’un sens du réel très aigu, un souci particulier de la dignité et de la charité chrétiennes. Canisius exprime vigoureusement, le 10 octobre 1578, cette vigilance et cette sereine confiance : « L’Allemagne endormie et refroidie se porterait mieux si, en beaucoup d’endroits, nombre de luthériens ne devenaient calvinistes, et si les catholiques ne ronflaient pas tout haut en pleine tempête [917]. »
Pour Calvin, quiconque refuse d’entrer dans le mouvement de la réforme et, surtout, quiconque abandonne le parti est digne de toutes les malédictions. Tout est nettement tranché et les positions entre les deux camps sont presque aussi irréductibles que l’état d’élu et de réprouvé sur le plan de la prédestination divine. Loyola, malgré la raideur de certaines de ses formules, n’a rien de cette géométrie. Il sait, par expérience personnelle et par l’expérience d’un grand nombre d’âmes aidées intimement par lui, que les acheminements de la grâce et de la miséricorde sont infiniment variés. Il ne juge de rien, ni de personne, avec hauteur et suffisance. Il ne désespère d’aucune faiblesse : sa confiance dans l’amour de Dieu pour les pécheurs et les égarés dégage une impression d’optimisme [918].
S’il y eut jamais un hérétique capable d’exciter l’indignation des milieux romains, ce fut bien le Général des Capucins, Bernardin Ochino, qui, en 1542, passe à la Réforme avec une femme, laissant son jeune Ordre et tout le monde catholique dans la plus profonde stupeur. Il vaudrait la peine de citer in extenso la lettre admirable adressée par Loyola à son ami Claude Lejay, trois ans après l’évènement, pour lui demander d’essayer d’atteindre le Frère Bernardino, à son retour d’Allemagne, et de l’engager, avec le plus d’amitié possible, à se réconcilier avec l’Église. L’esprit de charité qui motive cette démarche est affirmé à trois reprises avec une telle insistance qu’on se demande par quelle antiphrase les admirateurs de Calvin ont pu se risquer à dire que Loyola était insensible et n’avait pas d’amis [919]. Ochino ne doit pas craindre de revenir : Il faut lui « promettre la Compagnie et que je suis là (pour le protéger) et maître Laynez et maître Salmeron. Et quant à sa personne et à ses affaires, qu’il se persuade de pouvoir avec certitude disposer de nous comme de son âme même [920] ». Il est vraiment décidé « à l’aider de toutes ses forces en toute charité, pourvu qu’il veuille aussi s’aider lui-même, toutes les circonstances étant favorables ».
L’intolérance de Calvin s’appesantissait aussi bien sur les hérétiques du dehors que sur les contradicteurs de l’Église genevoise elle-même. La bonté de Loyola s’épanouissait sur « tout le monde », sur les Turcs et sur les Juifs [921], sur les pécheurs et les courtisanes, sur les hérétiques, mais bien plus encore sur les accusateurs, les zélotes du dedans, souvent les plus difficiles à supporter. Dès son apparition, le jeune Ordre actif suscita bien des discussions et des remous plus ou moins charitables. C’était le Cardinal papable Caraffa et ses Théatins qui prenaient ombrage de sa vitalité et de son indépendance [922]. C’étaient les anciens Ordres, spécialement en Espagne, qui se scandalisaient à la vue des méthodes nouvelles d’apostolat conquérant utilisées par des compagnons trop enthousiastes. Alors que le Général des dominicains, le P.F. Romey, et des théologiens de marque comme J. de la Peña, Dominique de Soto, Louis de Grenade et bien d’autres, accordaient généreusement leur appui à l’œuvre de réforme de Loyola, des intégristes irréductibles du type de Siliceo et de Melchior Cano voyaient dans les jésuites les avant-coureurs de l’Antéchrist et le proclamaient bruyamment à la face de l’Espagne et du monde [923].
À l’égard des fanatiques, Loyola ne perd jamais son sens de la mesure, sa bonne humeur et son humour. Les assauts des adversaires lui servent d’un joyeux purgatoire ; alors que, dans la mentalité de Calvin, on pourrait presque dire : « L’enfer, c’est les autres. » Loyola, qui n’attaque jamais, se défend chaque fois qu’il le faut, en faisant tranquillement face.
La première réponse de Loyola aux attaques forcenées dont il est parfois l’objet consiste à prier et à faire prier beaucoup [924]. Ensuite, il s’efforce de causer avec ses accusateurs, de leur fournir amicalement, par des intermédiaires sympathiques, les explications propres à les calmer. Ainsi la fureur de Melchior Cano s’apaisera-t-elle peut-être à la vue de témoignages de hautes personnalités ecclésiastiques, de membres du Sacré Collège, exprimant leur avis par écrit sur la Compagnie. Si cela ne suffisait pas, on pourrait lui soumettre un document élogieux de son propre Supérieur Général, favorable aux jésuites et si toutes ces attentions de la charité ne parvenaient pas à désarmer son courroux, l’amour du prochain obligerait les accusés à recourir à une sentence « fulminante » du pape [925]. En recommandant à ses compagnons de confier à Dieu leurs ennemis, dans la prière, Loyola veut que ce soit avec amitié et pour toucher leur cœur, « non par peur des contradictions, ou par crainte des difficultés qu’ils pourraient causer [926] ». Il ne demande pas d’être à l’abri des contradictions, mais de supporter joyeusement ces épreuves bienfaisantes, sans lesquelles il n’y aurait pas moyen de manifester son amour [927].
À un religieux zélote qui menaçait de lancer l’Inquisition contre les jésuites et qui, effectivement, croyait sauver l’Église en dénonçant à Rome le nouvel Ordre, Ignace de Loyola fit parvenir, par un ami commun, la savoureuse réponse que voici : « Dites au Père frai Barbaran : de même qu’il dit que tous les nôtres qui se trouvent entre Perpignan et Séville devraient être tous brûlés ; de même, je dis et désire que lui et tous ses amis et connaissances, non seulement ceux qui se trouvent entre Perpignan et Séville, mais tous ceux qui se trouvent dans le monde entier, soient incendiés et embrasés de l’Esprit-Saint, afin qu’ils parviennent tous à une grande perfection et s’élèvent un jour très haut dans la gloire de la divine Majesté. Veuillez lui dire aussi que, par devant leurs Seigneuries, le gouverneur et le vicaire de Sa Sainteté, se traite actuellement toute notre affaire, et qu’ils sont sur le point de prononcer la sentence. Si donc le Père Barbaran a quelque charge contre nous, je l’invite à venir déposer et prouver son accusation devant les Seigneurs juges mentionnés plus haut. Car, je me réjouirais davantage, s’il faut payer quelque chose, de le faire moi-même ; que je sois le seul à l’expier, plutôt que tous ceux qui se trouvent entre Perpignan et Séville soient exposés à être brûlés. À Rome, de Sainte Marie de la Route, le 10 août 1546. Inigo [928]. » C’était la fête de saint Laurent. Le gril et l’humour du martyr semblent avoir inspiré le Général des jésuites.
Notre parallèle entre la mentalité des deux réformateurs ne serait pas complet sans quelques comparaisons de documents typiques. Voici Calvin jugeant un adversaire plus sympathique que lui, Castellion : « Crois-moi, Castellion est une bête, non moins venimeuse qu’obstinée. Il simule la charité, de même que la modestie, alors qu’on ne peut rien imaginer de plus arrogant. » Puis, après lui avoir attribué, sans preuve aucune, un pamphlet contre l’intolérance, Calvin se rengorge : « Non seulement, il me fut facile de dissiper ces nuées de calomnies, mais même de tourner à ma louange tout ce qu’on m’objectait odieusement [929]. » Même sentiment de supériorité infinie à l’égard d’un ami de Castellion, qui ose le critiquer : « Ce pauvre homme tâche à se faire valoir en nous accusant... homme transporté d’une folle ambition... homme outrecuidé jusqu’à se rendre ridicule... Il dit qu’il faut que tout le monde me baise ici la pantoufle... Je suis bien assuré que s’il pouvait tenir ma place, il ferait bien autres morgues. Car s’il est si enflé n’étant rien, il faudrait bien qu’un degré acquis le fît crever du tout. Mais il montre bien quelle bête venimeuse il est, étant si marri de voir tout ici en bon accord. Car voilà ce qu’il appelle baiser ma pantoufle, qu’on ne s’élève point contre moi et la doctrine que je porte pour dépiter Dieu en ma personne et la quasi fouler aux pieds [930]... » Le dépit de Calvin, c’est la colère de Dieu.
Voici, en regard, comment Loyola, le « général à la discipline de fer », traitait un de ses subordonnés les plus originaux et les plus difficiles, le pittoresque Bobadilla, qui signifiait avec insolence à son chef qu’il ne savait que faire de ses lettres et de ses directives : « Avec le superflu, disait-il, de ce que vous écrivez, on pourrait composer deux nouvelles lettres. » Le Père Ignace ne prend rien au tragique : « Quant à ce que vous dites que vous ne daignez pas lire mes lettres, et que le temps vous manque, je puis vous assurer que, pour mon compte, j’ai assez de temps et de plaisir pour lire et relire les vôtres. Et afin que vous lisiez les miennes, je tâcherai, de mon côté, en omettant tout ce qui vous paraîtra superflu, de m’adapter autant que je pourrai à votre point de vue... En conséquence, je vous prie par l’amour de et le respect de Notre-Seigneur, de me dire la manière que je dois observer, en vous écrivant, ou en vous faisant écrire par d’autres afin que je puisse vous donner entière satisfaction. » Et poussant jusqu’au bout l’« humilité pleine d’amour », il se jette aux pieds de son enfant terrible et lui propose de prendre le commandement à sa place. « Si la Compagnie est d’accord, ou seulement la moitié de celle-ci, je vous donne ma voix, pour autant que celle-ci vaut quelque chose, et je vous offre, de très bon cœur et avec une grande joie spirituelle, la charge que j’occupe. Et non seulement je vous élis, comme je viens de le dire, mais si une autre solution vous paraît préférable, je m’offre, pour élire n’importe qui que vous nommeriez, ou que quelqu’un d’autre nommera, avec la certitude que cette disposition réaliserait certainement le plus grand service, la louange de Notre-Seigneur et la plus grande consolation de mon âme, en la divine Majesté... » Puis reprenant sa proposition sur un ton encore plus solennel : « Il est bien vrai qu’absolument parlant, je désire demeurer inférieur et me décharger de ce fardeau... En conséquence, en tout et pour tout, déposant entièrement mon pauvre jugement, je tiens toujours et espère tenir toujours pour meilleur ce que la Compagnie, ou la moitié de celle-ci, comme il a été déclaré, le décidera. Ainsi résolu, après l’avoir écrit de ma main, je l’approuve et le confirme [931]. »
Qu’il eût été facile de s’entendre avec un Castellion ! Et quel enrichissement spirituel la réforme calviniste aurait gagné si elle avait été capable d’assimiler la pensée de cet humaniste chrétien ! Au lieu de cela, « la vieille rancune de Calvin contre Castellion, qui ne lui a jamais fait de mal, nous disent les savants éditeurs des Opera, n’est pas le moins du monde apaisée au moment de sa mort [932] ». On mesure encore mieux le recul de l’esprit chrétien si l’on se reporte aux débuts de l’Évangélisme, à la sereine volonté de réforme qui animait le Cénacle de Meaux, « ces entêtés de l’espérance qui ne savent point haïr [933] ». La capacité de haine à laquelle Calvin est parvenu dépasse tous les enseignements qu’il a pu même recevoir d’un fanatique tribun comme Farel. Calvin s’indigne que Farel, dans sa bonhomie partisane, puisse donner le nom de « Frères » aux luthériens de la nuance Westphal : « Tu dis que ce sont des frères, eux qui non seulement repousseront, mais détesteront une appellation fraternelle que nous pourrions leur adresser. Et comme nous serions ridicules de nous prévaloir du nom de frères auprès de ceux pour qui nous sommes les pires des hérétiques [934]. » On aura beau mettre sur le compte de la « dureté des temps » cet acharnement inouï : les pires attaques et les persécutions dispensent-elles un messager de l’Évangile du devoir le plus urgent imposé par la « bonne nouvelle » : celui de la charité ? Et les vrais témoins de la foi mériteraient-ils le nom de martyrs s’ils reniaient la charité [935] ?
Tout l’apostolat d’Ignace, parmi les infidèles, ou parmi les fidèles, auprès des Juifs, des Turcs, des païens, ou des « frères séparés », s’efforce toujours loyalement d’observer la « discreta caritas » : une charité clairvoyante [936]. Et le Dieu qu’annoncent ses missionnaires, avec plus ou moins de talent et de savoir-faire, ce n’est pas un Dieu justicier et vengeur, mais la « Bonté Infinie, l’amour divin [937] ».
Mais quand l’offre des indulgences dépasse la demande, on assiste à une dévaluation du vrai pardon. De même, à force de vouloir réconcilier tous les extrêmes, à force de multiplier les excuses, les sourires, les bénédictions et les encouragements, l’apostolat des compagnons menace de s’enliser dans la banalité. Ils marchent avec leur temps qui les mène parfois où ils ne voulaient pas aller. Ils s’habituent à des complaisances naïves pour les mœurs et l’esprit de leur époque. L’accumulation des pratiques religieuses et des inventions apostoliques relève bien d’un certain « style jésuite » où le sérieux de la foi ne trouve pas toujours son compte.
À l’exemple de Loyola, ils se sont efforcés d’estimer toutes les créatures. Ils ont loué et exalté tout ce qui de près ou de loin touchait à l’honneur de l’Église ou de la Tradition. Mais ils ont aimé et approuvé trop de choses qui n’auraient pas été du goût du mendiant Loyola : ils ont même profité de la mégalomanie de princes temporels et ecclésiastiques, grands bâtisseurs d’églises, de collèges, d’universités. Pour gagner les âmes, ils se servent de tous les moyens d’approche de l’humanisme, des voyages, des sciences, du théâtre, des usages populaires discutables, comme les rites malabars ou chinois. La richesse du baroque engendre la confusion au point que les détails submergent tout. La « captation de bienveillance » à grand renfort de propagande, de festivals tout proches de l’opera ou du mélodrame, finit par excéder. L’Imago primi sæculi (1640), énorme dithyrambe illustré, qui étale dans un style ampoulé les gloires de la Compagnie durant le premier siècle de son existence, reste le symbole de cet esprit frivole, de cette dévotion tapageuse et superficielle. Entre l’enthousiasme béat qui affadit les caractères et la rigidité qui les dessèche, la balance n’est pas facile à tenir. Des conflits, comme ceux qui opposent si douloureusement Loyola à son ancienne bienfaitrice et Philothée, Élisabeth Roser, découvrent un idéal de vertu passablement roide et compliqué [938].
CHAPITRE III
Calvin intime, le malade, le surhomme.
Calvin a réalisé une œuvre grandiose ; elle porte malheureusement les traces de ses maladies. « Il est vain de discuter avec Carlyle, pense Aldous Huxley, parce que ce serait discuter avec la digestion de Carlyle. » Nous ne manquerons pas de respect à la mémoire de Calvin, en souscrivant à un jugement analogue de son plus grand panégyriste, E. Doumergue : « Calvin fut parfois acerbe, violent, nerveux, énervé, cassant, colérique. – Certes ! Ce qu’on peut se demander, c’est par quel prodige impossible il ne l’eût pas été. Quand un adversaire plus ou moins fâcheux l’attaquait, quand cette attaque tombait juste à un moment (et il y avait toutes les chances pour que ce fût toujours ainsi), où Calvin avait mal à l’estomac, était en proie à la migraine, souffrait de la gravelle, était épuisé par des crachements de sang, est-il étonnant que sa langue ait été vive, que sa plume ait été mordante [939] ? » – Non, c’est tout naturel, si l’on se place à ce point de vue que la colère est une fatalité théologique et qu’un prophète ne saurait jamais en avoir assez. Mais Loyola et des milliers de chrétiens ont suffisamment prouvé que, moyennant un minimum de vie intérieure, il n’est pas impossible, même pour un malade, de dominer ses instincts. La joie rayonnante avec laquelle le fondateur de la Compagnie, infirme et malade, passait à travers les difficultés et les épreuves faisait même dire à ses intimes : « Les mauvaises nouvelles rendent la santé à Ignace [940]. » Un malade réagit tout différemment suivant qu’il s’inspire de la « Bonne Nouvelle » ou de l’« Évangile de la mauvaise humeur [941] ».
À qui veut s’édifier, nous recommandons le livre second du troisième volume de Doumergue nous décrivant Calvin chez lui, « à l’auberge de l’amitié, dans son bureau de poste, ou bureau de placement, dans son agence matrimoniale », car sa maison était digne, paraît-il, d’afficher toutes ces enseignes séduisantes. C’est bien le moment de parler de la séduction de Calvin. Doumergue en est littéralement ébloui. Pour nous communiquer son enchantement, l’intarissable orateur méridional arrange les faits, entasse les textes, esquive les difficultés, argumente avec une éloquence dont lui seul ne se lasse jamais. « Comment la prodigieuse influence personnelle de Calvin a-t-elle été possible ? Où est l’explication ? – Sans doute le génie, le travail, l’activité, la doctrine, l’éloquence, expliquent beaucoup de choses. Mais tout ? Non... Eh bien, nous constatons cette chose simple, naturelle, nécessaire, à savoir que Calvin a eu le caractère exigé par sa situation exceptionnelle. » Nous voici en plein déterminisme calviniste. « Certes, pas plus ici qu’ailleurs, nous ne contestons les défauts de Calvin, ni ce côté, cette face de son caractère, qui est l’austérité, la sévérité. Même nous reconnaissons qu’il était nerveux, irritable, très irritable, et que cette irritabilité naturelle était sans cesse augmentée par l’énervement de la maladie, et par l’énervement plus agaçant encore d’une opposition souvent méchante. Nous ne contestons pas davantage qu’un homme de cette énergie, de cette volonté, de cette clarté de conception, de cette confiance en la vérité telle qu’il la concevait, n’ait eu un penchant très naturel à exercer la domination dont il était capable, qui lui était offerte par les circonstances, et qui était indispensable au succès de sa mission et de son œuvre. – Mais toutes ces restrictions faites, il n’en reste pas moins que ce qui est incontestable dans le caractère de Calvin, c’est la séduction, c’est l’attrait [942]. »
Les milliers de pages de ce monument littéraire sont de la même force. Doumergue a épousé toutes les antipathies et les rancunes du maître, sa dialectique amplificative ; c’est un prédicateur huguenot du XVIe siècle égaré dans l’histoire moderne. Comment ne serions-nous pas séduits lorsqu’il nous engage si gracieusement à « ausculter le cœur » de son héros : « Notons donc les battements du cœur de Calvin et datons-les, année, mois, jour. »
Calvin ne demandait qu’à s’entourer d’âmes sœurs, indulgentes à ses défauts, pleines d’admiration pour son génie et l’œuvre qu’il incarne. Son cœur a besoin de l’affection la plus tendre. Son amitié, même quand elle multiplie les prévenances, ne ressemble qu’imparfaitement au don de soi, à l’oblation de la charité. C’est une ardeur jalouse de mettre son emprise sur autrui. Un amour de possession et de domination, qui ne réussit pas à se mettre à la place des autres, mais souhaite d’autant plus conquérir la sympathie et l’approbation. Une certaine entente fraternelle a régné entre les principaux pionniers de la Réforme, Melanchthon, Bucer, Capiton, Farel, Viret, Bullinger et Calvin. Des hommes supérieurs par la situation, l’intelligence et la culture, ont été attirés par le maître de Genève, tels les Cop, les Budé, les Étienne, les Normandie, les Falais, et tant d’autres personnages de premier plan. Mais combien de ces liens fragiles finissent par se relâcher, telle l’amitié de Melanchthon et de Viret, obligés de prendre leurs distances, comme pour se dégager d’une étreinte trop exigeante. Le réformateur s’exprime tout entier dans cette joyeuse fierté à propos de ses amis. Leur attachement, dit-il, soutient la comparaison avec n’importe quelle affection humaine.
Bien sûr, Calvin avait le cœur sensible et il eut des amis dévoués, Viret, Farel, Bèze : « Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un couple d’amis qui ait vécu ensemble en si grande amitié... que nous avons fait en notre ministère [943]... » La « sainte amitié » dont il est question dans ce beau passage se révèle tout de suite plus proche de l’esprit de corps, qui lie les partisans de toutes les révolutions que de la charité évangélique. Calvin l’avoue aussitôt en souhaitant voir « mis en déroute les ennemis, non seulement ceux de l’extérieur qui nous combattent ouvertement ; mais ces voisins et ces familiers qui nous mettent à l’épreuve ». Il veut absolument compter parmi les biens de cette amitié, le fait qu’elle est « impénétrable aux chiens impurs qui aboient dehors ».
Doumergue a dédié au « cœur de Calvin » ses immenses volumes, magnifiquement édités et illustrés. Et cependant Calvin, non seulement ne devient pas populaire, mais se refuse à séduire les cœurs de ceux qui lui doivent leur religion. Le pasteur Benoît l’exprime discrètement : « Il faut le reconnaître, Calvin n’est pas pleinement sympathique... Il est difficile d’éprouver pour lui cet enthousiasme, cette ferveur que l’on éprouve pour saint François d’Assise, par exemple, et même à certains égards pour Luther [944]. » Et Doumergue avec éloquence : « Il ne reste rien des maisons qu’il a habitées dans ses divers voyages ou séjours, comme il ne reste rien de sa maison dernière, sa tombe. C’est caractéristique. Il y a là une différence importante entre le réformateur français et les réformateurs suisse, allemand et écossais... Ils sont réels, humains, vivant d’une vie ordinaire. Pour Calvin, rien. Tout de suite l’homme a disparu, il n’est resté que son idée. Et les peuples ont dit : c’est une abstraction [945]. »
Mais essayons aussi d’expliquer pourquoi « une auscultation » est nécessaire, si l’on veut percevoir les battements du cœur de Calvin. Son cœur n’était-il pas le cœur faible d’un malade ? « Pour bien comprendre certains traits de son caractère, il faut se rappeler que Calvin fut toute sa vie malade [946]. » Et cependant, il y a des malades rayonnants, des « infirmes aux mains de lumière » qui, loin de s’aigrir, s’adoucissent au contact de la « bonne souffrance ». Il est bien évident, par contre, que la maladie n’a rien valu pour le caractère et le cœur de Calvin.
Autant que lui, Loyola fut accablé de maux physiques. Une étrange parenté les rapproche encore jusque dans leurs maladies. Depuis son pèlerinage à Jérusalem (1523), jusqu’à sa mort (1556), Loyola ne cessa guère de souffrir de maux d’estomac, de crises biliaires, de fièvres, sans compter sa jambe malade et tous les raffinements d’une pénitence ingénieuse à s’imposer le maximum de mortification... Le savant anatomiste qui a fait l’autopsie de Loyola relate comment « il a extrait de ses mains d’innombrables pierres trouvées dans les reins, les poumons, le foie et dans la veine porte ». Le médecin actuel qui analyse le rapport de Realdus Colombo évoque les douleurs atroces que Loyola dut endurer et s’étonne qu’il l’ait fait avec une telle sérénité [947]. Car c’est avec un visage rayonnant qu’il supportait toutes ses infirmités et bien d’autres tribulations. En dehors des circonstances où la violence du mal le forçait à s’aliter, personne ne soupçonnait qu’il fût malade et rien n’enrayait son activité énorme et paisible. Comme toutes les autres créatures, messagères de Dieu, la souffrance était aimée et ne réussissait qu’à le rendre plus aimable. La croix l’a grandi et confirmé d’une sorte de consécration.
Nous connaissons bien mieux encore, jusque dans leurs détails les plus répugnants, les maladies qui ont frappé Calvin et le visage qu’il leur opposa. La crainte de vouloir ridiculiser le réformateur nous retient de publier in extenso une de ses lettres à un groupe de médecins de la faculté de Montpellier. Il nous faut, cependant, examiner l’attitude de Calvin devant sa croix. L’art de souffrir lui est encore plus difficile que l’art de bien vivre.
I
MENS SANA IN CORPORE SANO
L’ÂME DE CALVIN
Pfister a-t-il raison de penser qu’il y a autre chose, une maladie apparemment légère pour les admirateurs de Calvin, mais générale et profonde : une maladie du tempérament, une maladie nerveuse et psychique ?
« Nous reconnaissons qu’il était nerveux », admet Doumergue, lui-même. Sous cet euphémisme, il faut entendre une nervosité tout à fait anormale, qui lui donna bien plus de fièvres que toutes les autres maladies ensemble. C’est d’elle que proviennent les accès de timidité et de sauvagerie que Calvin signale personnellement comme un des traits de sa nature ; ses douloureuses tergiversations et ses entêtements au sujet de sa prétendue vocation ; ses brusques changements d’attitude et jusqu’au rythme de sa théologie, continuellement en oscillation dialectique entre le pessimisme le plus méprisant et l’exaltation du prédestiné.
L’intelligence est exceptionnelle, mais il lui faut toujours la surexcitation de la lutte à outrance. La vivacité de son esprit ne s’allume artificiellement qu’au choc de la contradiction. Dans le calme, il peut dire sincèrement que « son esprit incline à la paresse ; je te l’affirme, je n’ai pas lu, sans honte, cette partie de ta lettre qui loue mon activité, car je suis bien conscient de ma paresse et de ma lenteur [948] ».
Peu d’hommes, cependant, auront possédé une pareille capacité de travail intellectuel. La concentration inouïe à laquelle il s’était forcé jusqu’à se rendre malade, pendant ses études, produisait ses fruits. Il pouvait avec une rapidité invraisemblable composer des sermons et des remontrances publiques, préparer des leçons d’exégèse, écrire ou dicter des cours, des livres, de longues lettres, des rapports exhaustifs, dont la clarté oratoire et la perfection formelle étonnent. En un clin d’œil, son esprit a tout saisi, examiné, analysé : et simultanément tout s’organise, dans sa tête, en programmes d’action, de controverse et de propagande. Mais cette manipulation hâtive des idées et des réalités les plus complexes, suivant des schèmes uniformes et rigides, dégage une impression de gêne et de monotonie croissante.
Trop pressé, Calvin violente ce qu’il touche et refoule sa propre faculté créatrice. Aucune découverte originale, aucun véritable approfondissement n’est survenu depuis l’Institution chrétienne. Toute la souplesse de son esprit mobile et « nerveux » s’use à défendre des thèses toutes faites, des attitudes étroites de plaideur acharné à mobiliser sans cesse, pour gagner le même procès, la plus grande masse d’arguments, de témoignages, à constituer le dossier le plus volumineux. Son invention se perd en distinctions, outrances, habiletés, ruses, faux-fuyants, indignes non seulement d’un si grand esprit, mais surtout de la cause spirituelle qu’il prétend défendre [949]. Un ensemble impressionnant de doctrines et d’institutions converge autour de quelques idées forces qui ont bien des apparences d’idées fixes [950].
Monoidéiste, Calvin ne voit que son point de vue, ne sent qu’une chose intensément : que sa cause est en danger et qu’il faut qu’elle triomphe à tout prix. Calvin prêtait généreusement à Luther, qu’il ne connaissait pas, ce vilain défaut de son propre caractère : la maladie d’avoir toujours raison : « Il n’y aura rien de sain, tant que cette rage d’avoir le dessus nous agitera [951]. » N’a-t-il pas prononcé contre lui-même le jugement qu’il porte sur Luther : « Il souffre de grands vices. Plaise au ciel qu’il puisse mieux refréner ce caractère excessif qui entre partout en ébullition. S’il pouvait tourner toujours contre les ennemis de la vérité cette véhémence qui lui est innée, au lieu de la lancer contre les serviteurs de Dieu. Plût au ciel qu’il eût mis plus de soin à reconnaître ses défauts ! La plupart du temps, des flatteurs lui firent du tort, alors qu’il était déjà, par nature, trop enclin à être indulgent pour lui-même... C’est ce que dénonce saint Paul : que nous nous consumons les uns les autres en nous mordant et nous lacérant [952]. » Calvin souhaite l’emploi de la véhémence contre les ennemis de sa vérité et il a cultivé consciencieusement cette méthode de soulagement théologique.
Est-il question de connaissance, quand la passion aveugle s’empare, comme d’une proie, de l’objet des recherches ? Rien ne le démontre plus clairement que son attitude dans la grande querelle sacramentaire, un débat interne, où il n’est pas question d’une polémique avec les « ennemis » des protestants, mais d’un conflit entre la première et la seconde génération de la « Réforme ». Calvin pense écrire contre les luthériens au nom de Genève, de Zurich, de la Suisse : au nom de l’Église universelle. Ses encycliques contre Westphal ne plaisent ni à Zurich, ni à Genève, ni même à Farel. Calvin avait entrepris cette nouvelle affaire avec des protestations de modestie et de docilité à l’égard des Églises suisses [953]. Engagé dans ses publications, il manifeste une fois de plus, pour employer les litotes des Éditeurs des Opera, « combien rarement il fait sien l’avis de ses collègues et combien peu volontiers il prête l’oreille à leurs conseils... il pense que pour défendre la cause commune... il s’est acquitté de sa tâche, de manière qu’on n’a plus besoin de rien entreprendre en particulier. Il montre ainsi suffisamment qu’il ne changera plus rien [954] ».
Farel a la mauvaise idée de lui conseiller de se soumettre à la censure, comme il faut bien que les autres s’y résignent. « Je présenterais aux groins de ces porcs, pour être insulté, déchiré honteusement, un ouvrage que j’ai poli avec le plus grand soin ! » C’est une douleur au-dessus de ses forces : il ne peut s’exposer au ridicule. « Penses-tu que j’ai un caractère assez servile pour offrir spontanément un jeu plaisant à leur insolence. Vois ce que tu obtiens. Je préférerais être moi-même privé de la vie que de voir l’Église du Christ privée de ce fruit de mon travail. Mais si l’une ou l’autre solution est inévitable, je préférerais plutôt jeter au feu, de mes propres mains, ce travail qui m’a coûté tant de peine, plutôt que faire ce que tu m’ordonnes [955]. » Et une autre fois : « Je m’enflammai tellement (à la demande du Conseil de soumettre son ouvrage aux censeurs) que je jurai, devant les syndics, que même si je devais vivre mille ans, je n’éditerais plus rien dans cette ville. Je m’étais déjà endurci auparavant à leurs insultes. Mais ceci était trop indigne [956]... »
L’orgueil de l’esprit qui s’affirme dans cet « accès de bile vomie de son cœur blessé », comme il s’explique lui-même, est suggestif au plus haut point. Des observateurs peu scrupuleux, des gens habitués aux disputes et aux procès, des laïcs du parti de Calvin éprouvent de la stupeur à voir l’abus que le grand réformateur fait des noms de chiens, de vauriens, pour traiter ses adversaires [957]. Des amis lui conseillent de se laisser censurer et corriger. Lui, s’indigne là-contre, comme s’il se trouvait atteint dans une de ses prérogatives essentielles. Il préfère mourir, ou vivre mille ans, plutôt que de renoncer à ce droit, qu’il considère comme sacré, d’insulter ses frères de Genève ou de Hambourg.
Les facultés géniales de ce surhomme sont incontestables. Mais nul n’a plus que lui conscience de sa supériorité. Parfois, celle-ci n’ose s’affirmer directement, joue la timidité et doute d’elle-même ; puis, subitement, elle s’exprime dans un mépris cruel qui n’épargne ni collaborateurs, ni amis. « La mort d’Abel (Poupin), bien que soudaine, à dire vrai, ne nous a pas causé un deuil trop grand, car son caractère était à peine supportable. Il est parti fort à propos [958]. » Le bon sens des braves Genevois qui tiennent parfois à se gouverner eux-mêmes n’est que de la folie : « Ici nos hommes déraisonnent étrangement... Ils font exprès de s’opposer aux sages conseils (de leur prophète). Je dévore tellement de ces détails qui paraissent petits que j’en suis presque étranglé. Car, crois-moi, il y a de ces sottises... tragiques [959]... »
Il se compare avantageusement aux plus grands génies et trouve qu’il lui manque encore un peu d’assurance : « Tu sais quels sentiments de respect j’ai pour Augustin. Mais je ne cacherai pas que ses longueurs me déplaisent. En revanche, ma brièveté est peut-être trop concise. Mais je ne veux pas disputer maintenant pour savoir ce qui vaut le mieux. Car, j’ai si peu confiance en moi (!) que je préfère, suivant mon naturel, qu’on me pardonne plutôt que de désapprouver les autres [960]. » Le jeune Calvin savait que, dans la Réforme, Luther n’était pas « le seul ». La conviction d’avoir, à côté de lui, une place égale, ou supérieure même à celle des pionniers du protestantisme, ne cessa de se développer dans son esprit hautain. Ainsi, avec quelle irritation accueille-t-il les vers du pasteur d’Orbe, André Zébédée, proclamant ingénument que Zwingli était le « nec plus ultra » de la Réforme. « Bien loin de l’approuver, je puis dire que je vois déjà maintenant beaucoup de plus grands hommes (que Zwingli), et j’en attends beaucoup d’autres, et je souhaite que tous le dépassent [961]. » Il hésite à souffler à l’oreille de Farel le sentiment de dédain qu’il éprouve à l’égard des admirateurs de Zwingli et de Luther. Mais il n’en pense pas moins : « Quos ego... »
Sa mémoire prodigieuse est tournée de préférence vers les aspects effrayants, hyperboliques de la révélation comme de l’histoire humaine. Il enregistre d’instinct tous les détails capables de servir d’arguments négatifs contre les hommes, comme s’ils n’étaient tous que des adversaires éventuels.
La facilité de cette mémoire étrange est une force et une faiblesse. C’est la mémoire d’un nerveux prisonnier de ses schèmes, enchaîné à ses habitudes de pensée. Depuis ses veilles studieuses d’Orléans, il entretient délibérément ses insomnies en ruminant un certain nombre de questions controversées auxquelles, invariablement, il ramène toutes les discussions. Il remâche, avec obstination, les mêmes préventions intellectuelles et affectives, incapable de rien oublier, mais aussi incapable de rien pardonner, ou de rien corriger dans ses manières de voir ou de faire. Il pense avec sa mémoire indélébile, comme il pense avec les impressions ineffaçables de ses sympathies et de ses antipathies. Son esprit enchaîne les connaissances sans les creuser. On pourrait dire que plus il touche aux mêmes problèmes, moins il les approfondit, plus il en fait des thèmes à développements dialectiques, des prétextes à réaffirmer ses positions personnelles.
Sa vision du monde est si peu susceptible de se rafraîchir que son imagination doit se mettre en état d’agressivité pour créer. C’est ce qui donne à son style ce reflet uniforme de mauvaise humeur. Pour le colorer, il doit solliciter sa pensée à des inventions polémiques. C’est le flux de paroles pressées du nerveux qui se soulage : soliloques assez vite dépourvus d’agrément. Même avec ses amis, il discourt, il parle seul, il dicte ses définitions, ses rapports, avec la musique patiente d’un charmeur, avec une influence hypnotique que ses auditeurs subissaient sans défense. Le génie souffreteux faisait oublier le pauvre homme difficile qu’on n’avait pas le cœur de contrarier. Il est compréhensible que Bossuet, qui était la santé même, ait trouvé le style de Calvin « plus triste que celui de Luther ». Pour Doumergue, cela veut dire... qu’il était gai, joyeux, et même que son langage était noble, bien qu’il « ne recule pas devant des mots scabreux, grossiers, non obscènes, mais orduriers », que son panégyriste infatigable n’a cependant pas la force de citer [962]. Les enfants sont de petites ordures, les hommes des crapeaux, des vaches, des pourceaux... Ce n’est pas la Babylone papiste, c’est la fraternité évangélique qu’évoquent ces épithètes bucoliques.
Les humanistes avaient habitué les lecteurs de la Renaissance à l’abus des fleurs de rhétorique et des formules violentes ou recherchées. Ce cabotinage littéraire a fortement contaminé la sensibilité et le goût de Calvin, non sans préjudice pour la vérité et la loyauté. À force de cultiver le paroxysme verbal, il ne sait plus exactement lui-même la portée des phrases qu’il déclame, et les grandes protestations puritaines donnent une idée fausse sur bien des choses qui se passent à Genève et dans l’âme de Calvin. Ainsi quelle est la valeur de sentiments exprimés en termes excessifs : il est haï, lui tout seul (bien qu’innocent) alors que pour racheter la paix, il offrirait volontiers cent fois la gorge au bourreau... Peut-être qu’il devra s’exiler, si jamais le territoire de Berne lui est ouvert. « Mais il serait préférable d’être écarté de leur territoire et de m’en aller tout droit au carnage [963]. » Il y a « cent fois » trop de pathos et autant de fois trop peu de vraisemblance de la part de l’homme occupé, en cette année 1555, à piétiner les derniers restes du parti genevois.
La capacité d’illusion de ce nerveux atteint les limites de l’inconscience. La même phrase exprime la plus grande amertume et la conviction étrange de la sérénité : « Si tu savais seulement la dixième partie des affreuses insultes dont je suis déchiré, avec ton humanité tu gémirais des misères auxquelles je me suis endurci [964]. » Qu’après avoir semé le vent, dans le procès et le livre contre Servet, il récolte la tempête, c’est une injustice abominable. Protée insaisissable, d’une impressionnabilité morbide, il se fuit et se méconnaît, alors même qu’il ne fait que parler de lui : « Que dirais-tu, si tu entendais dire que dans ces troubles (1552), je n’étais pas moins calme que ceux qui, par nature, sont lents et froids [965]. » Là-dessus, pour prouver le contraire par des faits, il s’emporte immédiatement contre Falais qu’il calomnie au point que les Éditeurs des Opera eux-mêmes en sont scandalisés. « Voilà comment il est déjà calmé et froid : il affirme que Troillet et Bolsec ont été lancés contre lui par un complot de Falais, de ce même homme qu’il avait autrefois entouré de tant d’égards, qu’il avait reconnu comme très honorable et même proclamé martyr de la bonne cause [966]. »
Le même jour, Calvin écrit à Viret : « Parmi les conseillers, il en est peu de courageux », peu de « cordati » assez magnanimes pour digérer le meurtre de Gruet » ; – ensuite, avec dévotion aux fidèles de France : « Le Seigneur a daigné nous faire une grâce signalée en nous donnant des magistrats très bien disposés, pour porter remède au mal qui nous travaille [967]. » « Ce n’est pas la seule occasion, note A. Roget, que nous surprenions des contradictions de cette nature... la fermeté énergique s’alliait à un tempérament très mobile, très excitable, et son esprit agité passait brusquement d’une impression à une autre, toute contraire. » Sur combien de justifications ne conviendrait-il pas de porter le jugement que les Éditeurs des Opera ont dû laisser tomber sur une certaine apologie de Bèze : « Calvin expose l’affaire tout autrement qu’il aurait dû le faire en réalité. Ce n’est pas une histoire authentique, mais la plaidoirie d’un avocat pour un coupable [968]. » Ses réquisitoires et ses plaidoyers pro domo seront encore beaucoup plus sujets à caution. À propos de la dénonciation de Servet à l’Inquisition, dont Calvin dit : « En un mot, il n’en est rien », F. Buisson doit formuler cette simple remarque de bon sens qui a le don de faire sursauter Doumergue : « Hélas ! les lettres sont là, et cette dénégation, avec son grand air de fierté, n’était – le mot fait peine à écrire, mais la conscience le réclame – qu’un hardi mensonge [969]. »
En lisant, ou en écoutant Calvin, il aurait fallu sans cesse se mettre en garde, comme le faisait, par exemple, le bon Zurkinden, contre « la calomnie inconsciente, la plus féroce de toutes [970] ». C’était passé chez lui à l’état de seconde nature : il force l’interprétation des faits, des textes, et même de la Bible qui n’est qu’un miroir déformant dans lequel il projette son image ondoyante et insaisissable.
Fernand Buisson a essayé d’expliquer le caractère de cette pensée fuyante : « Un des grands artifices dialectiques de Calvin, c’est, quand il rencontre une idée trop simple et trop claire à son gré, de refuser à la prendre isolément : il la rattache aux amples développements de quelque magnifique théorie générale... et peu à peu le point lumineux se perd et s’éteint dans cette vue d’ensemble qui prétend être une vue supérieure [971]. » Mais ce pouvoir de grossissement déçoit. Dans cette pensée cyclique reviennent régulièrement des « formes a priori » : les lieux communs psychologiques dans lesquels le moi inquiet du réformateur se retrouve justifié, religieusement apaisé.
Mais de quelle qualité est le sentiment religieux ainsi libéré, un spécimen typique nous le révélera mieux que toutes les théories. Calvin, au nom de Dieu, reproche à Zurkinden sa modération et son amitié pour Castellion : « Je le sais, rien n’est plus éloigné de ton intention que d’approuver les aboiements honteux et détestables de ce chien obscène : mais que la terre m’engloutisse plutôt mille fois, que de ne pas prêter l’oreille à ce que l’Esprit de Dieu me dit... Tu dis que je me « dispute » avec lui. Que plutôt ce mot irréfléchi ne te fût pas échappé ! J’en ai honte, tellement il est inconvenant pour un chrétien. Si nous avons en nous une goutte de piété, une pareille indignité doit nous enflammer de la plus violente indignation. Pour moi personnellement, je préfère être emporté par la fureur, plutôt que de ne pas être en colère. À toi de voir comment tu pourras un jour rendre compte à ton juge suprême [972]. »
Tout commentaire semblerait superflu. Mais c’est ici que Doumergue trouve bon de se pâmer d’admiration : « Quelle vivacité d’impressions ! Calvin vibre tout entier ! Et quelle sincérité dans tous ces sentiments si francs, si profonds, et si vifs ! Le tribunal de Dieu est là [973]... » Pauvre Doumergue, le voici qui se lance dans la peinture : « Il serait difficile d’imaginer une révélation plus exacte de Calvin, de son tempérament, de ses sentiments, de sa puissance d’indignation, de sa juste connaissance de lui-même. C’est un admirable Rembrandt peint par lui-même. » Tant pis pour Rembrandt, mais il est incontestable que tout Calvin s’exprime dans cette frénésie. Le sentiment religieux exige le maximum de fureur : il faut donc s’échauffer artificiellement, esquisser de grands gestes prophétiques, évoquer, chaque fois que le souffle menace de manquer, les grands sujets déclamatoires : le jugement, la colère de Dieu, les cent et mille morts possibles et impossibles, mais qu’on ne l’accuse pas de s’être disputé !
« Je ne sais pas, observe Doumergue, s’il y a jamais eu de styliste plus amoureux de l’expression forte, la plus forte possible. En dehors de toute colère ou de toute passion, il ne peut pas ne pas se servir du mot extrême, dirai-je. En dehors de toute passion ? – Mais son style est toujours passionné. – C’est exagéré et c’est comme si ce n’était pas exagéré. Il est exagéré et vrai [974]... » C’est exagéré comme si c’était faux et cependant c’est vrai... « On n’est pas plus naïf, ajoute l’incomparable panégyriste. Il ne faut pas le contester, Calvin excelle dans cette violence. Cette violence est inépuisable : elle est terrible, étonnamment, admirablement terrible... » Oui, on n’est pas plus naïf. Mais comment cette violence est-elle vraie ? Par quoi le réformateur se distingue-t-il de son adversaire traité par Doumergue de « forcené et parfait énergumène » ? C’est à n’y plus rien comprendre. « À travers la violence, c’est une grande clarté qui jaillit. Et je l’envie. Cependant, Calvin a eu tort [975]. » Voit-on le danger signalé par les livres du pasteur O. Pfister ? On peut envier et condamner, regretter et poser en exemple les pires aberrations pourvu qu’elles soient véhémentes et jettent la clarté d’une « franche » colère.
Nous entrons ainsi dans le jardin intérieur, dans le paradis de la joie calviniste, dont notre guide inséparable Doumergue nous détaille les fleurs ardentes : « C’est un besoin, et une joie. À dire toute sa pensée, avec toute la force que le langage humain peut lui prêter, Calvin éprouve de la satisfaction, une satisfaction non pas de haine, de méchanceté, mais de plénitude, d’équation entre le mot et la chose [976]. » Un nouveau principe est choisi comme critère de la connaissance objective : « Procéder doucement et mollement, c’est montrer signe de timidité et d’un esprit mal assuré en bonne cause. » Il est nécessaire de crier le plus fort possible, moins pour convaincre les autres que pour se convaincre soi-même. Aussi Calvin ne se gêne-t-il pas : il s’abandonne au besoin « d’écorcher vif un adversaire [977] ». Après avoir donné des échantillons de ces insultes ordurières, Doumergue trouve encore que ce n’est pas méchanceté : « Ce vilain est digne qu’on lui crache au visage. »
L’idée que Calvin se fait de la joie évangélique n’a rien de bien original. Elle s’apparente à l’exaltation qui inspire la lutte des classes ou la lutte des races. Pour se situer en compagnie des Juifs dans l’Ancien Testament, elle ne présente aucun charme nouveau : c’est la joie des défenseurs de la citadelle « sainte », heureux de se croire plus haut, amusés de cracher contre les Philistins. « Il y en a qui se plaindront qu’on est sanguinaire, sitôt qu’on parle de faire justice qu’il n’y a que cruauté. Que telles gens s’adressent à Dieu et qu’ils aillent plaider contre lui pour voir s’ils gagneront leur cause. Et non seulement les pendards parleront ainsi, je dis ceux desquels les fautes et les crimes sont manifestes : mais ces suppôts de taverne qui contrefont les prêcheurs. Oh, ils sauront bien alléguer humanité et miséricorde, et leur semble que je n’épargne non plus le sang qu’ils feront le vin, lequel ils entonnent et engouffrent sans mesure et sans raison. Mais tels blasphèmes s’adressent à Dieu et non point aux hommes : car nous oyons ce qui est prononcé. Que ces chiens mâtins aboyent, et qu’ils grondent. Cette doctrine qui est procédée de la bouche de Dieu est suffisante pour les rendre confus... voici des nouveaux théologiens qui voudront faire miséricorde. Et où ?... Qu’on demande à Dieu, et il déclarera que sa miséricorde n’a point lieu, sinon là où il y a repentance [978]. » Il faut être dur comme Dieu. Et s’il est question de se réjouir, que ce ne soit pas sans haine. Notre époque a entendu des prédicateurs de fanatisme plus effrénés ; leur mystification présentait au moins l’avantage appréciable de ne pas « procéder de la bouche de Dieu ».
Et Doumergue de s’émerveiller qu’avec ses compagnons de lutte Calvin ait ri, d’un rire qui éclatait « à pleine bouche ». Il a parfois consenti « à jouer au palet, à la clef, ou à tel jeu licite [979] ». Il n’est donc pas « ce grand fantôme noir, à figure glaciale,... sombre, sec, pressé, en proie à une idée exclusive », entrevu par A. Franklin. Calvin est un modèle d’humour, parce que, dans sa préface aux « Disputations chrétiennes » de Viret, il préconise la moquerie de propagande et la caricature apostolique : « En déchiffrant les superstitions et les folies dont le pauvre monde a été embrouillé par ci-devant, il ne se peut faire qu’en parlant de matières si ridicules, on ne s’en rie à pleine bouche. Bien est vrai qu’il y a aussi occasion de pleurer et de gémir... Mais l’un n’empêche pas l’autre... en racontant des rêveries si sottes et des badinages tant ineptes (que) nous usions de moqueries telles qu’ils méritent. »
Le charme de Calvin ne se résume pas là. A-t-il ri pour ne pas pleurer, incapable autrement de dompter cette « bête féroce de son impatience [980] » ? Il réalise parfois qu’on ne peut empêcher toutes les inepties de la jeunesse. Mais ensuite il pleure comme une femme, nous assure Doumergue, sans se douter que des maladies psychiques expliqueraient beaucoup mieux les phénomènes d’exaltation et de dépression de ce dictateur, que le vers de Goethe sur l’amoureuse : « Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt [981]. » On est évidemment surpris en lisant dans sa correspondance des formulés littéraires « exquises » et on souhaiterait que Calvin ait toujours été ainsi « embrassant les enfants d’un ami comme les siens propres [982] » ; ou recevant l’affection éloquente de Bèze, qui « le porte dans ses yeux et dans tout son cœur, le baise et l’embrasse [983] » ; ou consolant Viret sur la mort prochaine de sa femme : « Que ne puis-je voler jusque chez toi pour soulager ta douleur, ou au moins en prendre une part. Mais un si long voyage à cheval serait pénible pour moi [984]... »
« La douceur et la délicatesse qui multiplient tous les jours, aux yeux de Doumergue, ses (sic) plus touchantes démonstrations [985] », sont malheureusement réservées à un cercle fermé d’admirateurs qu’il accable de prévenances indiscrètes et d’attentions importunes. Viret n’a presque pas le temps de devenir veuf, que Calvin voudrait déjà le marier à une jeune fille de son goût : « Elle a une mine très modeste, et tout le maintien de son corps est admirablement beau [986]. » Le projet échoue mettant le réformateur dans une fureur qu’il a toutes les peines du monde à dissimuler.
Terrible pour les ennemis, Calvin intime n’est pas un fort, mais un faible. Qui dira tout ce qu’il a perdu dans l’affection maternelle d’abord et dans celle de sa femme ensuite ! Si quelqu’un sait capter sa confiance, il peut agir assez librement avec lui, disposer de son temps, encombrer sa maison. Car, pour les fidèles, disons les familiers, la maison ressemble bien à « cette auberge de l’amitié, à ce bureau de placement, à cette agence matrimoniale » que Doumergue décrit avec complaisance. On peut abuser de lui, le voler, le tromper, sans qu’il s’en aperçoive. Un domestique bossu l’exploite longtemps, entraîne sa belle-sœur dans l’adultère. Calvin n’y voit du mal que quand le scandale est public. Et alors la femme de son frère n’est plus qu’une louve qu’il faut chasser de la ville [987].
Il est désarmé par des importuns qui jouent la comédie de la tendresse et de l’hystérie ; des femmes déchaînées lui font perdre, sinon son latin, du moins le sens de l’humour [988]. Son cœur hypersensible se glace au premier froid comme il fond à la première marque de déférence ou d’admiration. Et, sans doute, la sympathie qu’il inspire à ses intimes est autant à base de compassion que de respect et de fascination. Ce que Bèze et ses amis appellent « l’imbecillitas, la debilitas corpusculi », son apparence chétive, faisait un contraste étrange avec un don génial de la parole et du commandement, avec une fièvre d’action contagieuse.
Toutes les besognes l’excitent et l’entretiennent dans une agitation continuelle. Il croit qu’il doit tout décider et revoir lui-même, que les ministres, par exemple, loin de l’aider ne peuvent que multiplier ses difficultés [989] et que nul autre ne pourrait le décharger et faire aussi bien à sa place. Viret lui suggère doucement un peu de répit. « J’ai toujours admiré comment tu pouvais, tout seul, être capable de t’occuper de tant d’affaires... Tu n’ignores cependant pas le dicton : ce qu’on fait sans se donner dû relâche ne dure pas [990]. » Un nerveux qui commande doit tout diriger par lui-même. Il ne sait comment choisir ses activités, filtrer ses correspondances, souvent insignifiantes et fastidieuses, malgré la netteté formelle du style. « Je suis tellement accablé de correspondances continuelles et pénibles pour la plupart que je suis presque dégoûté de la vie [991]. » Mais plus il a de raison d’étouffer dans l’atmosphère irrespirable qu’il se crée à lui-même et plus il y persévère. « La difficulté est des fâcheries et des rompements de tête qui interviennent pour interrompre vingt fois une lettre et encore davantage [992]. »
Qui, sinon son tempérament dominateur, l’oblige à exercer tous les métiers et à compliquer l’existence des autres de mille interventions tracassières ? Il ne lui suffit pas d’être théologien et ministre, il faut qu’il soit la seule autorité juridique, le seul conseiller politique, le seul auteur, le seul polémiste, le seul moraliste et pédagogue ; qu’il ait le monopole de toute « l’institution chrétienne ». On ne joue pas tous ces rôles à la fois sans s’épuiser. « Cette correspondance continuelle me lasse au point que, dans mon dégoût, je déteste les lettres. Ah, si ta modération avait la même valeur pour les autres, de façon qu’on puisse cultiver fidèlement l’amitié en ménageant la correspondance ! Mais, dans ce domaine, nos Français m’importunent d’une manière plus qu’indiscrète... Ajoute à cela que je me fais l’impression de dire des sottises, à moins qu’un sujet déterminé ne se présente à moi, quand je prends part, de loin, à ces discussions communes [993]. » Il oublie de dire qu’il importune les autres et les sollicite autant qu’il en est lui-même assailli.
Il s’épuise, mais cette agitation qui semble un supplice lui épargne le tourment qu’il redoute par-dessus tout : rester seul avec lui-même, céder à d’autres une partie de son autorité. Il travaille pour oublier son arthritisme, sa gravelle, sa dyspepsie, sa dysenterie et ses migraines : debout ou couché, ce malade s’étourdit, si l’on peut dire, en donnant des ordres à des messagers, en corrigeant des manuscrits que des imprimeurs attendent avec impatience, en décidant de la politique européenne et du sort des martyrs. Il se fait porter au sermon, il enseigne et prêche jusqu’à extinction de voix et des forces ; imaginant que chacun de ses actes et de ses discours a une valeur irremplaçable. Son travail est toujours appliqué et tendu : quelle œuvre de lui, à partir de sa conversion, reflète l’image d’une âme sereine et harmonieuse ?
Et plus il force la nature, moins il atteint à la grâce, moins il se dépasse et s’élève au-dessus de lui-même. Le premier contretemps, la moindre surprise déchaîne les instincts du vieil homme. Il peut se chagriner jusqu’à en devenir malade, parce que des papiers ont été égarés, ou parce qu’un ami lui a écrit une parole qui lui fait mal [994]. Il faut que ses amis, les intimes, comme les « vulgares amicos » [995], ne pensent et ne sentent que comme lui, sous peine de blesser la sensitive. Dans un climat de serre-chaude, avec les admirateurs des « abbayes » bibliques et du « grabot », avec des magistrats et des ministres qui se plient à des jeux de pensionnaires, il cesse de frissonner.
Mais en dehors de cette dévotion, de cette intimité calfeutrée, la fièvre le brûle, le déséquilibre et trouble son zèle [996]. Et quel zèle ! Farel, Bucer, Sturm et les collègues de Strasbourg songent à une réconciliation avec Caroli : « Là, j’ai manqué gravement... je n’ai pu garder la mesure. La bile avait tellement envahi tout mon esprit, que mon amertume se répandit de tous côtés... Je conclus en disant que j’étais décidé à périr plutôt que de signer (une formule de compromis). À ce moment, l’indignation fut telle de part et d’autre, que je n’aurais pas été plus emporté, si Caroli lui-même avait été présent. Enfin, je m’élançai hors de la salle. Bucer me suivit et après m’avoir calmé par ses paroles, me ramena auprès des autres... Rentré chez moi, je fus pris d’une crise extraordinaire (mirabili paroxysmo) et je ne trouvai d’autre consolation que dans les gémissements et les larmes [997]... »
Peu après son mariage, pendant cette « lune de miel » qui touche le cœur de Doumergue, mais sur laquelle il ne trouve guère autre chose à signaler que des catarrhes, des syncopes, des crises de bile et de dysenterie des deux époux, Calvin est bouleversé par un différend survenu entre son frère et une dame réfugiée, recueillie dans sa maison : « J’ai coutume, dit-il, quand la bile ou quelque inquiétude un peu considérable me brûle, de m’oublier en mangeant, et de dévorer avec plus d’avidité qu’il ne faudrait. C’est ce qui m’arriva. Après avoir surchargé mon estomac pendant le souper avec une nourriture trop abondante qui ne me convenait pas, je me sentis le matin torturé par une énorme crudité. » Il aurait alors fallu faire diète. Mais pour ne pas indisposer un jeune homme qui partage son repos, il se résigne à nuire à sa santé [998]. Calvin passe ainsi de la bile furieuse qui le fait paraître fort et terrible, à la tendresse et à la dépression.
Ces « paroxysmes, ces flots de larmes, ces agonies [999] » se situent à Strasbourg, dans la période la plus sereine de la vie du réformateur. Un jour viendra, à Genève, où il suffira de murmurer le nom de Calvin à l’oreille des suspects, pour les faire déguerpir en vitesse de la cité sainte [1000]. « Une gravité chagrine, une humeur sombre, et pour tout dire morose, tel nous l’entrevoyons à travers ses actes et tel aussi il s’est dépeint lui-même. À cette vie agitée, « tumultueuse », manque l’épanouissement de la joie... Son ironie même, âpre, un peu lourde, meurtrit plus qu’elle n’effleure. Le masque froid ne se détend pas, ne se déride que par moments et on chercherait en vain, sous les traits rigides, cette gaîté sereine qui nous fait communier avec les choses comme avec les âmes [1001]. »
Calvin sait qu’il n’est pas aimé : « J’éprouve chaque jour par ma propre expérience combien répugne aux bonnes natures la cruauté tyrannique décrite par le poète : “Qu’ils me haïssent pourvu qu’ils me craignent !” S’il fallait choisir, je préférerais être le dernier de tous. Mais puisqu’il plaît autrement à Dieu, supportons-le. Il viendra en aide aux siens. Entre-temps, le meilleur soutien est celui qui vient d’une bonne conscience [1002]. » L’illusion de la bonne foi est parfaite. De même quand il conseille savoureusement François Hotmann de Strasbourg : « Je voudrais que tu ries des bouillonnements excessifs de ta colère, afin de ne pas exciter le rire des uns et les soupirs des autres... Plaise au ciel que tu apprennes à rire et à te moquer de ces douleurs qui te torturent sans mesure, afin que l’intempérance que tu laisses échapper à ton insu ne nuise, ni ne détruise l’estime de beaucoup de gens de bien... Crois-moi, si tu ne te domines pas à temps, on portera sur toi un jugement qui te fera bien plus de peine que les bagatelles dont tu te soucies avec trop d’inquiétude. Si même dans leur sympathie et leur bienveillance ils te pardonnent, ils n’approuvent pas pour autant les vices dont je t’avertis librement... Il est sûr que tant que ta bile ne se sera apaisée, elle s’enflera tout à coup pour un rien. Tu te souviendras que ces conseils te sont donnés par un homme qui est bien conscient d’avoir une violence plus âpre qu’il ne voudrait, mais qui soutient chaque jour d’une âme tranquille bien des assauts, en comparaison desquels ta lutte avec Baudoin est un jeu d’enfants [1003]. » Voyez comme je suis doux et humble de cœur !... Les Éditeurs des Opera regrettent « que celui qui se connaissait si bien ait tant cédé à son tempérament ». Ce Baudoin, par exemple, qu’il reproche à Hotmann de traiter sans modération, sera demain poursuivi par Calvin lui-même avec des insultes rabiques dont Doumergue, pour une fois, semble lui aussi presque écœuré [1004].
Il est bien tel que le dépeint le portrait dit de Strasbourg : un front ridé par l’inquiétude, un regard comme halluciné par des visions terribles, un nez d’oiseau de proie, la lippe désenchantée et méprisante [1005]. Cependant une influence mystérieuse rayonnait de ce malade et lui assurait une audience illimitée auprès d’une foule d’esprits inquiets et d’intellectuels audacieux. C’est que le génie, infirme ou bien portant, fascine d’autant plus qu’il déborde la « normale ». Le contraste criant entre des faiblesses trop humaines et une puissante inspiration frappe la curiosité et exerce une attirance magnétique sur les natures les plus vibrantes. Les tares de Beethoven ou de Wagner, par exemple, semblent creuser encore des profondeurs à l’arrière-plan de leur œuvre.
Calvin n’est pas seulement un être supérieur par son esprit. Il l’est encore davantage par la mission qu’il se donne et qu’on lui reconnaît. Il est le prophète de la justice, le porte-parole de ces revendications révolutionnaires autour desquelles se cristallise la passion des foules [1006]. On le suit, moins pour ce qu’il est ou pour ce qu’il enseigne, que pour ce qu’il représente : d’une part, une mystique assez logique apparemment, assez brillante pour séduire des élites cultivées ; de l’autre, un mythe irrationnel, assez virulent pour troubler et remuer profondément le vulgaire.
II
UN GÉNIE MALSAIN
C’est aux maladies de Calvin que l’on revient toujours pour excuser ses écarts de conduite et de doctrine. Le pasteur Benoît écrit : « Ce qui aggravait son dogmatisme intransigeant, c’était la sensibilité “presque” maladive de cette âme : Calvin, a-t-on dit, était tout en chair vive, d’une extrême susceptibilité nerveuse [1007]. » Mais il faut ajouter immédiatement que la dogmatique effrayante à laquelle il avait donné ses préférences aggravait ses maladies, déchaînant en lui une fièvre qui lui coupe l’appétit et la digestion, mais ne l’effleure même pas d’un léger scrupule. L’homme qu’Érasme était bien obligé de regarder comme un « homo rabula, un “rageur”, effréné de langue et de plume », affirme peu de temps avant de mourir : « Je n’ai écrit aucune chose par haine à l’encontre d’aucun [1008]. »
L’influence réciproque d’une théologie morbide et d’une mauvaise hygiène, écartant toute diversion, fortifiait encore chez le réformateur le sentiment de sa mission prophétique. C’était un nouveau Jérémie se lamentant sur les épreuves des justes persécutés, un Job prédestiné. Plus simplement, pour nous servir d’une explication peu respectueuse, mais aussi objective qu’elle est circonstanciée, nous pouvons penser avec l’enthousiaste panégyriste contemporain, Colladon, qu’il était embarrassé de corps et d’esprit, depuis dix-sept ans. « La cause de si grande indisposition était, qu’en ne donnant nul repos à son esprit, il était en perpétuelle indigestion [1009]. » Est-il besoin de s’indigner, comme le fait Doumergue, pour réfuter les « Calomnies » qui ont couru sur la mort de Calvin. Ce ne sont sûrement pas les jésuites qui ont inventé les maladies plus ou moins intéressantes dont le réformateur était accablé [1010]. Les innombrables infirmités du prophète ne sont pas un mystère et aucune légende ne saurait les étaler d’une façon plus inconvenante que ne le fait la correspondance de Calvin.
Partout le sentiment de la tristesse et de la douleur s’insinue. Calvin est un nerveux qui souffre, physiquement et moralement, à l’état continu. La perspective de la joie elle-même s’exprime en termes de souffrance. « Il me fait mal que je ne puis être là avec vous, du moins un demi-jour, pour rire avec vous, en attendant que l’on fasse rire le petit enfant, en peine d’endurer, cependant, qu’il crie et pleure. Car c’est la première note pour entonner au commencement de cette vie, pour rire à bon escient quand nous en serons sortis [1011]. » Dans ce mince rayon de soleil qui tombe sur le berceau du fils d’un ami alors très cher, de Falais, Calvin trouve le moyen de glisser plusieurs soupirs désabusés : il me fait mal, en peine d’endurer, pleurer, mourir... Il faut cependant beaucoup chercher, dans les 59 volumes des Œuvres de Calvin, pour découvrir d’aussi douces clartés. Il ne peut pas, il ne veut pas oublier le mal, la Bible le lui défend [1012]. Il se complaît sans doute dans l’expérience de ses misères, avec une résignation austère, fataliste.
La juste mesure, cette honnêteté confortable et cette sagesse bourgeoise, qui, en développant le sens des affaires, apaise, autour de Calvin, le cœur des puritains, se résume pour lui dans un régime de valétudinaire. Car ce douloureux qui ignore l’art de bien souffrir, n’ignore pas moins, pour son propre compte, l’art de bien vivre, tout en convoitant des jouissances plus substantielles, hélas interdites à sa complexion délicate [1013] : « Mes familiers savent combien j’aime ardemment les poissons et les autres mets : je m’en abstiens spontanément pour ne pas être obligé de payer ces délices au prix de ma santé [1014]. »
Calvin a pu connaître une bonne part des médecines, des drogues de son temps. Dès l’âge de trente ans, il se familiarise avec les diètes et les clystères, les compresses et les bouillottes stomacales. Il s’habitue à une activité fébrile et anormale, qui bientôt ne saura plus distinguer entre le lit et la table de travail. Les paperasses et les livres le suivent jusque dans son repos. « Arthritisme... hygiène déplorable... S’il avait pu, de nos jours, consulter un médecin, on lui aurait conseillé le repos, l’absence de soucis, le séjour en plein air à la campagne, un régime presque exclusivement lacto-végétarien [1015]. » Laissons au médecin consulté par Doumergue, la responsabilité de ce diagnostic. Le grand panégyriste a ébauché une monographie détaillée de toutes les infirmités de son héros, victime de Dieu, des hommes et surtout de ses propres idées. À la dyspepsie et aux migraines s’ajoutent les catarrhes, les coliques, les hémorroïdes, l’eczéma, les ulcérations cruellement incriminées par Bolsec, la fièvre, le paludisme, les vers, la phtisie, la goutte... Est-ce merveille si ses ennemis, lui appliquant ses propres théories et ses méthodes d’argumentation ad hominem, se sont permis de suggérer qu’il pourrait bien être puni par où il avait péché [1016] ?
Il serait difficile d’exagérer plus que Calvin lui-même. Dans sa nervosité, il semblait éprouver comme un soulagement à étaler ses raretés pathologiques. Qu’on y voie de l’humilité, ou un jeu de clair-obscur destiné à rehausser, par contraste, la force exceptionnelle de son intelligence et de son énergie morale, le fait est que les effusions, sur ce chapitre, ne lui coûtent pas. Il en régale Bullinger, Farel, Viret, Falais, Vermilius, Sulzer, Melanchthon et bien d’autres correspondants. Tous n’y trouvent sans doute pas le même intérêt : « Je n’ignore pas combien vous êtes paresseux pour écrire », observe-t-il à Melanchthon. Mais cela n’empêche pas Calvin de penser qu’« il fait bon déposer dans son sein les misères dont il est accablé [1017] ». Il distribue ses bulletins de santé, comme des bulletins de victoire. Des personnages, comme Monsieur de Soubise ou Renée de France, sont mis au courant des détails de ce martyre étrange [1018]. La duchesse de Ferrare doit savoir qu’il « souffre de diverses maladies, défaut d’haleine, la pierre, la goutte et un ulcère aux veines hémorroïques qui m’empêche de prendre aucun exercice auquel serait toute l’espérance de soulagement [1019] ».
Il ne lui déplaisait pas qu’on s’intéressât aux détails de sa précieuse santé. Comme le prouve le document adressé par Calvin à un groupe de médecins de Montpellier. Pour leur témoigner sa reconnaissance, il les prie « de prendre, de leur côté, dans ses écrits, la médecine spirituelle qui leur est offerte [1020] ».
Cette lettre gêne visiblement les panégyristes de Calvin. Bèze en a publié une version corrigée, destinée vraisemblablement à faire oublier les trivialités de l’original trop connu. De nos jours, Doumergue a savamment tourné la difficulté. Il fragmente le texte et noie ces perles dans les flots de sa prose admirative. Calvin n’était pas si délicat [1021]. Il savait que ses misères, par leur excès même, avaient quelque chose de prodigieux. Surtout quand il entendait ses amis lui assurer, à grand renfort de citations grecques, qu’on était à la fois consterné et émerveillé de le voir continuer à consumer toute sa vigueur pour l’Église, alors « qu’en lui il n’y avait plus rien de sain, sauf l’esprit ». Pour sauver cet être surhumain, ses amis « échangeraient volontiers leurs vies contre sa mort, si c’était possible », de peur de ne plus l’avoir au milieu d’eux « pour venger l’impiété du monde [1022] ».
On comprend la fascination exercée par ce Job de la Renaissance, quand on voit, après quatre siècles, l’enthousiasme que ses épreuves éveillent encore dans l’âme de Doumergue... « En définitive, de tous ces détails de cliniques, de toutes ces questions de rhume, de toux, d’hémorroïdes, de clystères, d’ulcère, de goutte, de coliques, de pierre, de ce corps ridé, émacié, flétri, brisé, avili, une âme se dégage d’autant plus noble par le contraste, plus apitoyante par sa souffrance, plus étonnante par son labeur [1023]. »
« Sauf l’esprit, il n’a plus rien de sain », écrit Spina. Il serait bien délicat de poser la question si l’esprit pouvait bien être sain dans un cas pareil. Sans doute la vivacité de certaines de ses facultés ne fait que s’exciter davantage au fur et à mesure que son corps s’affaiblit. Mais l’équilibre et l’harmonie de cette personnalité, toujours menacée de division, s’en ressentent péniblement. Si la ruine de la santé n’a pas fait vaciller ce génie de chef, d’orateur, de politique et de théologien, bien des signes montrent que l’orientation de ses goûts religieux, de ses jugements moraux a été fâcheusement influencée par son état pathologique. Il y a des cercles de pensées obsédants, des étroitesses, des exagérations dont Calvin se serait plus facilement évadé s’il avait été physiquement un être normal. « Trop souvent il perdit la pleine possession de ses nerfs », observe Doumergue [1024].
Malade incurable, il se soigne avec une fatalité pessimiste, répétant que « c’était en vain, regardant vers le ciel et disant souvent ces mots : Seigneur, jusques à quand ? qui était la sentence qu’il avait prise de longtemps pour sa devise [1025]. » Telle est sa devise : subir impatiemment une vie de néant suspendue à la grâce, comme à un fil. Toute sa sagesse se réfugie dans une foi désenchantée : Je crois donc je suis. Ce n’est que par la foi que l’existence lui devient supportable et logiquement la vie des incroyants, des « impies » perd toute valeur à ses yeux. Assombri de la sorte, son esprit durcit une volonté implacable. Il est bien permis de supprimer « un scarabée qui s’agite dans son marécage ?... Nous devons user d’une telle rigueur, non seulement envers une seule personne, mais envers toute une ville... Pour moi, je préfère être emporté par la fureur plutôt que de ne pas être en colère [1026]. »
Castellion s’indigne vainement contre cette hypocondrie théologique : « Mais, au nom de Dieu, que veut-il dire avec le massacre de toute une ville ? Alors quand il aura réuni les forces nécessaires, Calvin envahira la France et les autres nations qu’il répute idolâtres, il ira, renversera les cités, passera les hommes au fil de l’épée, n’épargnera ni les femmes, ni les enfants... Est-ce là qu’il nous ramène, ce juif qui lit Moïse avec un voile sur le visage [1027] ? » Non, Calvin n’est certainement pas si sanguinaire. Il tient plus que personne à la justice, au bon ordre, à la parfaite discipline civile et religieuse. La sagesse de sa politique, condensée dans le vingtième chapitre du IVe livre de l’Institution, embrasse à peu près tous les éléments de la philosophie et du droit de son temps, toutes les normes essentielles d’un bon gouvernement. Mais c’est le ton qui fait la chanson.
Il en va de même de sa morale, de la substance de sa doctrine théologique. Tout avait déjà été dit avant Calvin. Il n’a presque rien ajouté aux dogmes protestants épars dans les différentes tendances de la Réforme. Un pouvoir d’affirmation olympien, un esprit de synthèse hallucinant suppléent à la profondeur et à l’originalité de la pensée. Calvin se situe régulièrement sur le méridien de l’orthodoxie... mais aux antipodes : à la fois très proche, par la matière, de l’enseignement traditionnel, et très éloigné, plus éloigné qu’aucun autre réformateur, par la mentalité, par l’impondérable fluide qui magnétise le monde protestant. En poursuivant, par exemple, à la manière du dominicain C. Friethoff, une étude parallèle des thèses principales de la théologie de Thomas d’Aquin et de Calvin, on serait étonné du nombre considérable de points de contact qui rapprochent le fond des deux systèmes [1028]. Non seulement l’idée de la souveraineté de Dieu, mais même des doctrines aussi discutées que la prédestination, la liberté, le péché originel, semblent reposer sur des bases communes. Ce qui tranche, c’est le contour formel, c’est l’accent des thèmes calvinistes toujours frémissants d’une sourde passion. Jamais sereins, ses raisonnements émotifs et intéressés, véhiculent autant d’ombres que de clartés. Le regard est subjectif, la tournure d’esprit agressive, les obsessions négatives et inquiétantes : « L’homme n’est autre chose, de soi-même, que corruption... il n’y a rien de pur et de net de sa pourriture mortelle... il n’y a nulle partie en lui exempte de péché... » Les biens de ce monde ne sont que « fiente et ordure [1029]... ».
Les prédicateurs avaient déjà apostrophé à l’envi les fils d’Adam, d’aussi galante manière, mais sans doute jamais avec le sérieux mépris de ce misanthrope. Le mépris de Calvin est unique en son genre. Il est immense, universel, colore même la piété et les amitiés les plus intimes [1030].
L’homme est jugé par lui sommairement : « Nous voyons qu’il y a beaucoup de gens simples (comme on dit) et idiots, qui ne connaissent non plus que bêtes brutes. Ceux qui sont ainsi, Dieu les met ainsi devant nos yeux, comme des miroirs pour nous humilier. Voyons-nous un homme de tout idiot, qui n’ait point de sens, ni de raison ? Là il nous faut arrêter : car c’est un miroir de notre nature. D’où vient la raison et l’intelligence que nous avons ? N’est-ce point un don singulier que Dieu nous a fait ? Notre-Seigneur a fait les uns plus aigus que les autres... les autres sont tardifs et pesants, tellement qu’il faut frapper comme à grands coups de marteau, quand on leur voudra apprendre quelque chose [1031]. » « Toutes les sciences par lesquelles on acquiert quelque prudence sont dons de Dieu, mais elles ont leurs limites... il faut les estimer vaines et de nulle valeur, jusqu’à ce qu’elles soient du tout assujetties à la Parole et à l’Esprit de Dieu [1032]. »
Dans la perspective calviniste, le salut, l’éducation religieuse, la pédagogie, le ministère apostolique constituent une étrange histoire, celle de la lutte de Dieu contre l’homme, contre le damné qu’il s’agit d’aveugler pour manifester une justice transcendante, et contre l’élu qu’il faut « abattre » jusqu’au désespoir pour qu’il ne se fie plus qu’à Dieu seul. Jeu illusoire, puisque aussi bien c’est le Seigneur qui, à son gré, fait le bien et le mal, dans l’homme, contre l’homme. On ne saurait être sérieusement pour Dieu qu’en se méfiant de l’homme. Et Dieu est obligé de nous châtier pour nous corriger : « Quand il nous laissera à notre aise, il est certain que nous serons comme des bêtes sauvages... Il faut donc qu’il nous mate à grands coups... Il est vrai que souventes fois il laissera les méchants, il les nourrira comme on engraisse une bête, voire pour attendre le jour qu’on la doit égorger et l’envoyer à la boucherie. Quand on nourrira bien un pourceau ou un bœuf, ce n’est sinon que sa mort approche d’autant plus. Ainsi, Notre-Seigneur laissera aller les méchants à l’abandon... cependant, il les tient serrés de près... il les dompte... ». Quant aux fidèles qui subissent le même sort, « ils connaissent et aperçoivent toujours que Dieu les gouverne [1033] ».
On dirait que Dieu lui-même n’est pas exempt de ressentiment : vision du monde à la mesure d’un regard aigri. Victime d’une raison raisonnante, ce révolté refoule sans cesse les raisons du cœur : « Il faut que nous soyons du tout vides de notre propre raison, afin d’être remplis de la sagesse de Dieu [1034]... » Mais loin de s’effacer devant cette sagesse, il la contraint de s’identifier à la sienne. Il est apparemment convaincu « qu’il n’y a pas de pire peste que la raison humaine [1035] ». Malheureusement, son système soumet Dieu à cette peste. Son mépris de la nature lui fait ériger en dogme cette Antiphysie raillée si cruellement par Rabelais [1036].
Quelques Genevois ulcérés et sans pitié appelaient ce pauvre malade, Caïn ; et même les amis, autour de Mélanchton, étaient bien en peine de trouver un terme de comparaison pour définir avec indulgence ce « Zénon » atrabilaire [1037].
Les goûts de l’époque n’étaient pourtant pas très délicats. Calvin pouvait se permettre beaucoup dans le genre du pamphlet avant de choquer les habitudes de ses contemporains. Mais, même alors, sa « rabies theologica », sa colère théologique, surprenait encore les habitués de la littérature du XVIe siècle. Rarement, si l’on excepte le romantisme ou le naturalisme, ivresse verbale fut plus incontinente. Chacun abonde et surabonde dans son sens. C’est à qui trouvera les formules les plus massives. Comme Lucien Fèbvre s’évertue à le démontrer, on n’éprouve à cette époque « ni le besoin impérieux d’exactitude, ni le souci d’objectivité [1038] ».
Le français, encore tout ruisselant de verdeur populaire, se prête bien aux discussions savantes, voire pédantes, à condition de ne pas trop se gêner, de ne pas sacrifier le trop plein de sa malice. À l’imitation des « libres prêcheurs » que Calvin a vraisemblablement connus, les hérauts de la Réforme se livrent volontiers à une polémique qu’on dirait sans vergogne, mais qui n’était souvent que l’expression d’une conception toute différente de l’éloquence, de la satire, de la poésie, de tous les genres littéraires [1039]. Les goûts, les idées, le ton moralisateur et doctrinal, le climat social, tout est soumis alors à un éclairage fumeux, qui diffère presque autant du nôtre que les lampes à huile diffèrent des lampes électriques.
La crudité de Calvin parlant de ses hémorroïdes à la duchesse Renée de Ferrare, son franc parler, une certaine brutalité sincère à l’égard de ses ennemis, ne doivent pas nous effaroucher. Rabelais fut son condisciple. L’exaltation factice, les outrances, les plaisanteries triviales et une faconde intarissable sont, en ce moment, le nec plus ultra de l’art oratoire. Nous ne voudrions donc pas chercher noise à Calvin pour quelques redondances verbales ou sentimentales. Mais, justement, lui sait écrire mieux que personne de son temps. Lui réagit et proclame, au nom de sa réforme, une épuration, un refoulement sévère de toute exubérance humaniste, de cette naïveté turbulente. Alors, il devient difficile de comprendre que le censeur formaliste d’Agrippa, de Simon de Neufville, des Périers, de Gouvea, de Rabelais, « des moqueurs qui, sous couleurs subtiles, se gobent de la chrétienté [1040] », ait pu les dépasser tous par l’âpreté et la violence. Lui, le raffiné, le puriste, qui ne supporte pas la grosse plaisanterie littéraire, se contentera d’hyperboles théologiques, de menaces déclamatoires et fanatiques. Avant lui, les facéties, le sans-gêne, les truculences, traduisaient seulement l’amour de la Renaissance pour tout ce qui ébahit et fait sensation, l’irrespect inconscient et l’étourdissement d’un monde qui se croit émancipé. Il faudra tout l’art de Montaigne et de Pascal, toute la raideur de Malherbe et de Boileau pour calmer cette effervescence et ce bruyant pédantisme.
Calvin n’a pas l’excuse de la candeur, ni de l’humour. Il a le sens esthétique de la mesure, de la sobriété, de la correction. Toute la démesure se transporte chez lui sur le sentiment religieux. Faut-il prendre au pied de la lettre ses exagérations pieuses ? Dès qu’elles effleurent le monde religieux, ses passions ne connaissent plus de limites. Il est tout à son affaire quand il se réjouit « que Dieu fasse (des moqueurs) une exécution terrible et qui fasse dresser les cheveux sur la tête », quand il préconise comme vertu royale « de raser les méchants de la terre afin que tous les iniques soient exterminés de la ville de Dieu [1041] ».
S’il fallait choisir, il serait incontestablement plutôt partisan « d’un prince sous lequel rien n’est permis, que d’un autre qui laisse toute chose en abandon... Les bigots, les rustres » qui brocardent la Réforme, les catholiques fidèles à leurs « sottes dévotions » méritent la mort à ses yeux... « Dieu l’ordonne [1042]. »
Il n’est plus question de littérature. Transfuge de la Renaissance, dont il renie l’« impudence », c’est-à-dire l’insouciance et la joie de vivre, dont il abomine l’exaltation superficielle, Calvin passe, si l’on peut dire, du superlatif relatif de la vanité humaniste au superlatif absolu de l’orgueil théologique. Il y aura encore des outrances, des cris, de la surenchère, des audaces et des menaces : mais, désormais, il faut y croire. Car tous ces excès reçoivent une estampille biblique. Les inventions ahurissantes de quelques beaux esprits « débordés » ne sont qu’un jeu d’enfant en comparaison des trouvailles d’une imagination surchauffée, trop nourrie d’histoire juive.
Calvin a cherché sincèrement dans la piété biblique le remède à sa propre misère, à l’anarchie, au malheur des temps. Son esprit juridique, son génie organisateur gardent la nostalgie des belles ordonnances, des constructions classiques. Mais la Loi de Dieu avant tout ! Celle-ci est sombre et mystérieuse. Elle exige des simplifications énormes, un bouleversement révolutionnaire. Dieu commande. Dieu est le seul refuge et la seule fierté de cette âme obsédée. Quelles fièvres ardentes, quelle véhémente colère, elle fait rejaillir jusque sur Dieu lui-même ! L’abandon à la divine Providence se double d’un ressentiment idéalisé, qui justifie, mais cette fois-ci contre l’homme, encore plus de « licence », encore plus d’emportement et d’exagération que ne s’en permettaient ceux qu’on va stigmatiser du nom d’impies et de libertins.
Calvin est un extraordinaire professeur d’énergie, de fidélité à la « cause de Dieu », mais non moins de violence, et de la plus regrettable, la violence religieuse. Étant donné son prestige et la force d’expansion de son système, il fera exemple, il sera le modèle par excellence d’une animosité « fervente ». Le tapage des humanistes retombera vite dans le silence. Mais aujourd’hui encore, la passion déversée par le réformateur, au plus profond des consciences, n’est pas encore neutralisée [1043]. Combien de préjugés contre l’Église circulent encore dans le monde sous la seule garantie de ces « témoins au poing tendu » comme Febvre les appelle, qu’il serait bon de ne plus citer comme s’« ils étaient de graves et scrupuleux historiens des idées, cherchant à définir, en conscience, les sentiments de leurs contemporains. Des propagandistes, tous [1044] ». Et il faut ajouter : des propagandistes révolutionnaires.
*
* *
En face de cette psychose de guerre, la mentalité que Loyola s’efforce de répandre autour de lui surprend comme un anachronisme. On se demande s’il appartient bien à la même époque. La violence lui est étrangère. La passion individuelle ou collective lui répugne. Il s’oppose fermement à tout emballement « désordonné ». L’aristocrate et le mendiant d’hier professe un amour des formes, un souci de la dignité, un respect du prochain à la fois très ancien et très moderne. Il sauve des valeurs si rares alors : la courtoisie, la distinction, l’humour, le sens de la mesure. Il pratique et recommande la tenue dans le style, le langage, les manières, une culture de l’esprit renouvelé par l’optimisme et la bienveillance. Il n’estime rien tant qu’une prédication objective et l’exactitude « édifiante ». Rien de négatif en lui.
Cependant, malgré la qualité douteuse de son sentiment religieux, Calvin demeure un surhomme d’une incontestable grandeur. En toute circonstance, il se serait révélé extraordinaire par la puissance de son esprit. Vu du dehors, il eut tous les dons et toutes les chances les plus contradictoires. Une jeunesse d’enfant prodige et d’adolescent modèle, une culture variée, servie par une merveilleuse capacité d’assimilation. Il a tout utilisé avec une application acharnée. Toutes les sphères intellectuelles, politiques, ecclésiastiques et sociales que toucha son activité ont subi l’ascendant de son génie autoritaire et de sa volonté de puissance. Il a séduit et subjugué la plus grande partie de la Réforme et une bonne fraction de l’humanité par le « glaive de la parole », par une certaine magie du verbe, par un sens politique supérieur, par l’invincible certitude d’une mission prophétique. C’était l’homme qu’attendait le troupeau sans berger qui avait déserté les cadres de l’Église, et qui errait, çà et là « à l’abandon », plein de nostalgie pour les doctrines fermes, pour la communion perdue. En un tour de main, le réformateur a simplifié un nouveau droit ecclésiastique, reconstitué une nouvelle hiérarchie, ou du moins un nouvel ordre clérical, de nouvelles traditions, une nouvelle orthodoxie. Comme par enchantement, la chrétienté apparaît restaurée... en simili : tout paraît net, logique, simple et rassurant. On peut s’en remettre à l’homme qui semble incarner la Bible.
Il représente surtout l’Ancien Testament, qui lui fournit ses meilleurs modèles et ses armes les plus efficaces, le zèle enflammé, la foi intransigeante, le dynamisme juif, qu’il apprécie encore mieux que Nietzsche : « Dans l’Ancien Testament, ce livre de la justice divine, il y a des hommes, des choses et un effort tendus vers un but si grand, que dans les écrits des Grecs et des Hindous, rien ne peut lui être comparé. On se tient plein d’effroi et de respect devant ces vestiges énormes de ce que l’homme fut un jour... Le goût pour l’Ancien Testament est la pierre de touche pour distinguer ce qui est grand ou petit [1045]. »
Nul ne contestera à Calvin ce goût du sublime et du grandiose, malheureusement un peu simpliste. Effectivement, il a été grand, mais beaucoup plus à la manière juive qu’a la manière chrétienne. Son emprise sur l’histoire fut surhumaine. Mais l’Évangile ne se mesure ni à la puissance, ni au génie. Il a peut-être manqué à Calvin d’être assez petit pour comprendre la nouveauté du Nouveau Testament, l’esprit de Jésus, la charité. Il a vigoureusement contribué à remettre en honneur, dans le christianisme, les instincts, les idées religieuse encore rudimentaires du judaïsme primitif. L’imitation de Jésus-Christ, les béatitudes, les conseils évangéliques vont céder le pas à un activisme et à un affairisme très bourgeois, pour ne pas dire israélite. Et l’ombre des grands personnages de l’histoire sainte, sans cesse évoquée et proposée en exemple, n’adoucira pas les mœurs des chrétiens.
Fasciné par un idéal fixé une fois pour toutes, le réformateur aurait volontiers ramené l’Église et la société de son temps, de tous les temps, à l’époque heureusement révolue de Samuel et de David, au type de la dictature théocratique. Beaucoup de ses disciples retiendront plus volontiers, de lui, les leçons pratiques, la clairvoyance juive pour les intérêts matériels. Doumergue célèbre à sa manière, avec un bruit de fanfare, ce triomphe calviniste. Il n’est peut-être pas mauvais que cet âge d’or touche à sa fin : « La banque, c’est Calvin... la banque est le symbole des temps modernes... Calvin a fondé la banque (?), il n’a pas fondé Monte-Carlo... Calvin a donné au monde une de ses plus grandes forces... Et je m’en vais. La Bourse et ses bienfaits sont une preuve de la vitalité du calvinisme. La bourse (sic) et ses méfaits sont une preuve de la nécessité du calvinisme pour les éviter [1046] !... »
Calvin reconnaît, en théorie, une grande autonomie aux compétences profanes, aux talents des laïcs dans les affaires terriennes. Il stimule le succès matériel, car les biens de ce monde sont une marque, aussi bonne qu’une autre, de la bénédiction divine, de la prédestination. Il faut réussir en affaires et en politique, pour prouver qu’on a le bon Dieu de son côté. Il recommande aux siens avant de mourir : « Si vous voulez être maintenu en votre état, il ne faut point que le siège auquel Dieu vous a mis soit déshonoré... il honorera ceux qui l’honoreront et, au contraire, mettra en opprobre ceux qui le mépriseront [1047]. »
Quand on songe à ces réalités qui ont tant favorisé le développement du puritanisme, on a de la peine à comprendre la conscience que le pasteur Caldesaigues a de sa supériorité : « En réalité, et au fond, le protestantisme est plus moral que le catholicisme qui joue sur l’intérêt et le calcul [1048]. » Nous ne demandons pas mieux que de le croire, mais il faudrait tout d’abord nous prouver que Calvin n’a jamais eu recours qu’à la seule persuasion, qu’il n’a jamais abusé de la force, de la menace, de la contrainte, de la diplomatie [1049]. Les mobiles de l’action calviniste sont-ils si purs, si désintéressés ? Il ne suffit pas de supprimer l’idée du mérite pour remédier à la cupidité.
En revanche, accordons au calvinisme le mérite posthume d’avoir, soit par inspiration indirecte, soit par réaction, facilité l’émancipation du monde laïque et la séparation de l’Église et de l’État. Mais ceci n’est que le rayonnement lointain des idées d’un dictateur religieux qui, dans sa conduite pratique, s’obstinait à assurer à la Vénérable Compagnie le monopole de l’éducation culturelle, morale, religieuse et même sociale. Beaucoup de saines tendances actuelles dérivent du libre examen. Mais par une déduction tout à fait opposée à l’esprit et aux intentions de Calvin. Les professeurs Borgeaud et Choisy répètent cette remarque suggestive : « Puisque la science pouvait produire un Michel Servet... il était important que ses avenues fussent surveillées et que les clés fussent commises à la seule autorité capable de faire bonne garde [1050]. » Moralisme désintéressé ?
Le protestantisme dirait plus volontiers aujourd’hui avec Vinet : « Je ne puis souffrir la spéculation... la théologie qui s’arrête à mi-chemin, parce qu’il ne lui convient pas d’aller plus loin ; celle qui raisonne et maudit le raisonnement ; celle qui se fâche quand on ne veut pas s’arrêter où elle s’est arrêtée. » À l’admiration de ses biographes Calvin apparaît parfois comme un pionnier du progrès moderne. Et de là à lui attribuer bien des transformations positives de la société actuelle, il n’y a qu’un pas. Cependant la « recherche de la nouveauté » irrite son esprit tendu par la nécessité de retourner aux origines. Son regard ne s’égare pas dans l’avenir, mais bien dans le plus lointain passé, dans cet âge d’or du Royaume de Dieu où tout était dominé par la Loi et la Parole saintes.
Très tôt prévenu contre la bêtise et le mauvais vouloir des pécheurs, ce théologien réaliste ne compte venir à bout de leur inertie qu’en employant les grands moyens. Cet homme « craignant Dieu » respecte trop la justice pour ne pas enseigner aux autres ce commencement de la sagesse, cette solution primordiale de tout succès et de tout salut. La majorité des hommes appartient d’ailleurs à cette « masse damnée » qui n’obéit qu’au mobile de la peur. Autant lui inspirer une « salutaire » crainte religieuse.
CHAPITRE IV
Loyola, le saint médiéval et moderne.
_______
I
UN ÉQUILIBRE LABORIEUX
À côté du génie qui a bouleversé le monde en prenant la tête de la révolution religieuse du XVIe siècle, qui, après avoir gagné de haute lutte tous ses procès et réalisé la plupart de ses idées, a transformé Genève, comme par enchantement, en second centre de la chrétienté, la personnalité du fondateur de la Compagnie n’offre rien de sensationnel. Aucun éclair fulgurant, aucune facilité oratoire, littéraire ou politique. Les triomphes de Calvin sont arrachés au destin. Il l’emporte contre la Renaissance, contre l’évolution naturelle de l’histoire détournée par lui de son cours normal. Il a forcé la fortune contraire, la foule hostile, il lui a imposé sa foi et sa loi ; en attendant que l’humanisme violemment refoulé reprenne sa revanche. Mais le message du réformateur n’est-il pas compromis par la rapidité de sa victoire elle-même, par la qualité des moyens mis en œuvre pour l’assurer ? Un triomphe payé par les sacrifices de Castellion, de Falais, de Bolsec, de Servet, de Berthelier ne se solde pas sans déficit.
Loyola n’a pas connu de ces réussites brillantes et violentes. Il avance péniblement. Sa lenteur et l’originalité de ses aventures déroutent l’observateur. Mais le jour où il se remet à construire, après vingt ans de patientes recherches, il établira son œuvre modeste sur un fondement durable. Malgré une forme beaucoup plus pauvre, la théologie de Loyola, sa psychologie, son enseignement moral et religieux semblent avoir moins vieilli. Ses idées reflètent une sagesse étonnamment équilibrée, acquise au prix d’essais très coûteux.
Il eut beaucoup de peine à savoir ce qu’il voulait exactement, ou plutôt ce que le Seigneur attendait de lui. En comparaison de l’infaillible certitude qui se manifeste à travers les œuvres de Calvin, les tâtonnements de Loyola ont de quoi surprendre. Les traces de naïveté et de gaucherie médiévale ne sont pas rares dans les expériences du fondateur de la Compagnie. Mais dans son doux entêtement à ne prendre partout que ce qu’il avait longuement éprouvé comme le meilleur, il évita les pires étroitesses.
Il a commis bien des imprudences, mais il s’en est libéré. Il a tiré de ses déboires des leçons précieuses pour sa conduite personnelle et pour la spiritualité de son Ordre. Expérimentation méticuleuse qui se méprend parfois sur les vrais moyens de réaliser la perfection mais qui la recherche toujours avec sincérité. S’il lui arrive d’envisager, ici ou là, le renoncement à soi-même, avec un radicalisme que l’Église n’approuverait plus aujourd’hui, cette lutte contre l’amour-propre, ce désir de la mortification continuelle, n’aboutissent jamais à des conclusions malsaines. Il entoure sa législation, et spécialement les directives les plus exigeantes, de tant de précautions et de correctifs que les abus ne sont pas à craindre. Ainsi des observances de régulier, un certain contrôle précis de la vie commune et des états d’âme, paraîtront exorbitants à des regards profanes. On verra une forme de contrainte intolérable dans la pratique du compte de conscience ou dans l’utilisation disciplinaire des Sacrements [1051].
Cette « ouverture totale de l’âme », ce sacrifice intime du moi le plus secret, sont proposés loyalement dans l’« Examen Général », avertissement préalable à tout candidat, avant son entrée dans la Compagnie. L’acceptation initiale est libre. L’usage pratique ultérieur fait continuellement appel au bon vouloir personnel. Plus les exigences de la vie commune sont austères, plus Ignace insiste sur la libéralité des inférieurs et sur la bienveillance compréhensive de l’autorité. Personne n’est choisi comme Supérieur à moins d’avoir cette bonté paternelle. La soumission est plutôt une élévation, une communion des volontés et des cours. Pas d’abdication méprisante et acerbe de la volonté, mais une sublimation religieuse de l’hommage féodal, une « oblatio sui ipsius », une offrande volontaire, et cordiale de soi.
Calvin a écrit de belles pages, ou du moins de belles phrases, inspirées de Luther et d’Érasme, sur la liberté chrétienne. Mais cela ne justifie pas encore Borgeaud à nous présenter « l’Église, l’école, la forteresse de Genève » comme la première place forte de la liberté des temps modernes. Pour libérer et pacifier les « consciences timides », Calvin souhaite qu’elles ne servent point « à la loi comme contraintes par la nécessité, mais qu’étant délivrées de la loi, elles obéissent libéralement à la volonté de Dieu [1052] ». Quelles sont les activités religieuses, sociales et civiles qui ne subissent pas, directement ou indirectement, la contrainte du « théocrate » ? Extérieurement d’abord, la contrainte se fait partout sentir. Mais plus forte encore l’emprise sur le vouloir et sur toute forme de pensée personnelle. La hantise du mal est la condition sine qua non de cette liberté calvinienne : « Les plus avancés... s’ils regardent la Loi voient tout ce qu’ils sauraient entreprendre de faire être maudit... ils sont perpétuellement en crainte et terreur... » Ce repoussoir est indispensable à toute confiance, à toute prière, à tout le sentiment religieux. On ne sait jamais s’il s’agit d’un abandon désespéré ou d’un désespoir confiant en Dieu seul.
« Nous reconnaissons toujours nos péchés en priant. » Pas de foi en Dieu sans la foi actuelle dans l’impuissance et la malice profonde de l’homme. « C’est la thèse favorite de la théorie calviniste, que, même l’enfant du catéchisme de 1542 est censé connaître... qui est clairement enseignée dans la première Institution, et qui, dès lors, fut le pivot de tout le système [1053]. » Tel est l’avis des savants rédacteurs des Opera. Dieu seul ! Les mystiques ne pensent pas autrement. Les âmes les plus nobles de la Réforme ont certainement vécu le côté positif de cette vérité centrale, une très vieille idée religieuse. Mais pour Calvin, elle reste trop négative et surtout agressive. L’obsession d’une misère universelle et, plus encore, la condamnation de tout ce qui n’était pas « son » Dieu ont-elles fait progresser le réformateur sur le chemin de la perfection évangélique ? Est-il de plus en plus uni à Dieu et détaché de lui-même ou, au contraire, n’a-t-il réussi qu’à enchaîner Dieu et les hommes à sa propre aventure ?
Pour Dieu seul, sans doute, mais dans un monde transformé par l’Incarnation et l’Église, Loyola travaille sans une ombre de pessimisme. Il invite chacun « à procurer sa perfection personnelle et celle du prochain ». Son influence est essentiellement persuasive et encourageante. On peut lui reprocher des excès de zèle, comme devait en commettre un lecteur assidu des Pères du désert et des auteurs spirituels du moyen âge. Certains de ses efforts contre le péché sont indéniablement maladroits et d’une raideur démesurée. L’ambiance canonique romaine le pousse à multiplier les « péchés réservés », parmi lesquels il classe « tout péché mortel actuel, toute pensée délibérée contre la Compagnie, ou son Supérieur, ou contre sa vocation, si elle est de quelque importance [1054] ». Tant il est convaincu que les mouvements intérieurs, les sentiments, les moindres mobiles ou intentions désordonnés peuvent être « réformés ». Son souci de régler les détails minimes de l’attitude, de la physionomie, de la démarche, de la mise, de la conversation, bref de tout le comportement intérieur et extérieur de ses compagnons frise le formalisme. Au moins, son bon vouloir sera-t-il toujours patient. Ses excès sont des excès d’optimisme. Il pense vraiment qu’il est possible, avec la grâce, de façonner des hommes nouveaux. L’ébauche initiale de l’image du Christ en nous se prête à des perfectionnements continus. On peut regretter trop d’étude, de recherche, un style spirituel trop travaillé, mais non lui reprocher d’avoir délibérément dédaigné des valeurs positives.
Il veut sincèrement réformer tout l’homme pour le « conformer au Christ ». Cette idée de réforme occupe une place prépondérante dans la mentalité de Loyola. C’est le but qui est exprimé dans le titre même des Exercices. Il se propose de « réformer les consciences », de « réformer avant tout le clergé, les monastères, les évêchés ». Quiconque est abordé par Loyola ou ses compagnons devrait être amené à « réformer sa conscience et son état de vie ». Au moment de l’élection du bon pape Marcel II, qui ne fit malheureusement que passer sur le trône, Loyola exprimait ainsi son sentiment sur la réforme de l’Église qui lui tenait tant à cœur : « Pour chaque pape, trois choses seraient nécessaires et suffisantes à la réforme du monde : la réforme de sa propre personne, la réforme de sa maison, la réforme de la cour et de la ville de Rome [1055]. »
Alors que Calvin commence la réforme en sens inverse, par une révolution générale de toute la structure de l’Église, puis de la ville de Genève, laissant presque de côté ou du moins négligeant sa réforme personnelle, Loyola poursuit pour son propre compte, pendant des années, une réforme profonde de son âme, comme celle qu’il prévoit pour le pape. Commencer par supprimer les abus dont nous sommes personnellement responsables, et spécialement le désordre intérieur, et s’efforcer de réformer les autres, dans la mesure du possible, en respectant les consciences et le jeu infiniment varié de la grâce. La réforme calviniste a le défaut de viser un peu trop haut. Idéologique, elle commence par une certaine théorie sur Dieu, sur la prédestination, etc. On dirait qu’il s’agit de réformer, sinon Dieu lui-même, du moins toute sa révélation, tout l’univers divin. C’est un effort de titan pour repenser dans toute sa plénitude la Pensée infinie, comme s’il s’agissait de sauver Dieu mis en danger par la pensée des hommes ; comme si toute la chrétienté pendant 1500 ans s’était fourvoyée et s’il fallait rattraper tout ce temps perdu. De là cette tension nerveuse de Calvin, cette impatience d’un homme qui doit refaire un monde et tout reprendre à zéro.
Malgré son âge avancé et ses infirmités, Loyola a tout le temps devant lui. Il progresse, avec effort mais joyeusement, vers la santé. Il a fait mille fois l’expérience que pour devenir humble, les grandes protestations verbales sur « le néant et l’ordure humaine » ne valent pas une bonne humiliation concrète, acceptée volontairement. Il commence par l’homme, ou plutôt, il commence par lui-même. C’est sa volonté libre qui a péché et qui doit se repentir, réparer, quoi qu’il en coûte. C’est le moi responsable qui s’est détaché de Dieu pour se plonger dans le désordre. Il est appelé à se retourner vers le Père qui l’invite toujours dans son intimité, s’il consent à s’arracher aux affections déréglées des créatures. C’est l’homme qui doit s’efforcer de rechercher Dieu ; les personnes divines, la « cour céleste », s’offrent toujours à communiquer, à communier avec le pécheur [1056]. En bon chrétien médiéval, quand Loyola lit dans l’Évangile : « Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres... prends ta croix et suis-moi... renonce-toi », il pense tout bonnement qu’il est appelé au dépouillement réel de ses biens, de ses plaisirs, et même à la souffrance volontaire. Il comprend la pénitence comme une privation, non seulement du superflu, mais de ce qui n’est pas absolument nécessaire.
Calvin s’est déridé une fois jusqu’à dire : « Il n’est en aucun lieu défendu, ou de rire, ou de se saouler, ou d’acquérir de nouvelles possessions, ou de se délecter avec instruments de musiques, ou de boire vin [1057]. » Mais immédiatement il redoute les abus et les scandales dont la peur non seulement tempère les joies « terriennes », mais assombrit la plupart de ses jugements de valeur. Le « juste milieu » bourgeois auquel se résout la sagesse morale de Calvin essaie de se tenir à égale distance de l’héroïsme évangélique et de l’humanisme renaissant. Ascèse qui voudrait être commode et raisonnable, mais ascèse pessimiste, limitée aux précautions, aux concessions involontaires, à la résignation. Les banquets et les habits de fête, les concerts et les jeux sont « permis » avec des réserves : l’homme convalescent doit bien parfois sortir de l’infirmerie, mais il ne doit pas respirer trop fort. Il y a plus de goût du réel et d’estime des créatures dans les pénitences excessives de Loyola et des ascètes chrétiens traditionnels, que dans la « mediocritas evangelica » à laquelle le réformateur de Genève voudrait arrêter le renoncement chrétien.
Loyola ne se prive pas parce que les créatures sont dangereuses, ou mauvaises, par peur des « débordements et des excès », mais parce que, dans son désir de dépassement, il a trouvé mieux. « Les pénitences extérieures se font principalement pour obtenir trois résultats : primo, pour expier les péchés passés ; secundo, pour se vaincre soi-même, c’est-â-dire pour que la sensibilité obéisse à la raison et que toutes les puissances inférieures soient soumises aux supérieures ; tertio, pour chercher et trouver quelque grâce ou don que l’homme veut et désire : par exemple, pour obtenir la solution de quelque doute dans lequel on se trouve [1058]. »
Sur les routes de son purgatoire, Loyola a risqué maintes fois sa vie [1059]. Il ne s’est libéré que peu à peu d’un goût sportif pour les records d’austérité. Une ascension impossible lui permit un jour d’entrevoir que les situations les plus pénibles ne sont pas nécessairement les plus parfaites. En route vers Venise, pour le rendez-vous de Terre-Sainte fixé avec ses compagnons, « j’eus bien des épreuves à subir. Surtout une fois que je perdis mon chemin. Je m’engageais le long d’une rivière qui roulait à une profondeur considérable alors que le chemin s’élevait. Plus je m’avançais, plus le chemin se rétrécissait. Il finit par devenir si étroit, qu’il me devint impossible d’avancer encore, ou même de reculer. Je commençai donc à ramper sur les mains et les pieds, pendant un long espace, avec une grande peur. Car chaque fois que je bougeais j’avais l’impression de tomber dans la rivière. Ce fut la plus grande fatigue et le plus grand effort physique que j’aie jamais éprouvés. Mais j’en sortis sain et sauf [1060] ».
Il avait eu peur, il avait épuisé ses dernières énergies dans la plus grande « varape » de son existence. La réaction de la nature est encore vive et jeune. L’instinct de conservation lui suggère des conclusions de sagesse. Il réalise que le maximum de souffrance physique n’est pas toujours le meilleur moyen de servir Dieu. Et, les maladies aidant, il reconnaît que la plus rigoureuse abnégation n’a pas pour but de « détruire la nature », ni même de la mutiler, mais seulement de l’émonder et de la parfaire [1061]. La sévérité avec laquelle il se traite lui-même ne l’empêche pas de constater que le « bon état de sa santé lui rendait plus faciles les rapports avec Dieu et l’accomplissement de toutes les besognes de sa charge... il se trouvait mieux quand il mangeait mieux » et il reconnaissait que Dieu désirait le voir prendre soin de sa santé [1062]. Maîtriser ses instincts est indispensable à une vie intérieure sérieuse : « Un homme mortifié, c’est-à-dire qui a conquis le contrôle de ses passions, trouve beaucoup plus facilement Dieu dans la prière, que l’homme immortifié et imparfaitement maître de ses penchants. »
Mais la mortification corporelle n’est pas aussi urgente que celle de la volonté et de l’esprit. Loyola n’enseigna pas sans peine à des ascètes illuminés le primat de la mortification intérieure, le renoncement à l’amour-propre le plus subtil, celui qui semble se confondre avec l’amour de la perfection. Il écrit à François de Borgia : « Pour ce qui est du jeûne et de l’abstinence, je serais d’avis que vous vouliez bien garder intactes les forces de votre corps en vue du service du Seigneur, au lieu de les affaiblir... Puisque vous appartenez au Seigneur corps et âme, vous aurez à rendre compte pour les deux, et n’avez pas le droit de nuire à votre santé corporelle. Quand le corps est affaibli, l’âme ne peut plus bien déployer son activité... Au lieu de s’affaiblir par des mortifications exagérées, il est plus sage de chercher l’honneur de Dieu par des actes intérieurs et d’autres exercices modérés. Car ainsi, non seulement l’âme se trouve mieux, mais un esprit sain habitant un corps sain, tout l’homme aura meilleure santé et une plus grande aptitude à servir Dieu [1063]. »
« Solidarse en el medio [1064] ! » Pour s’établir solidement au milieu, Loyola ne perd jamais de vue l’amour de Dieu et des hommes. Acquise au prix de rudes imprudences, sa sagesse est des plus joyeuses. Il n’est, en aucune manière, agité par la peur des abus et des scandales. Il trouve déraisonnable de redouter quelque chose qui, en soi, n’est pas un mal, a cause d’un abus qui a pu survenir. « Les excès de certaines gens ne doivent pas empêcher le bon usage des autres [1065]. » Ses compagnons ne seront pas des ermites, ni des moines, mais avant tout des apôtres pour lesquels les vœux, l’austérité, n’auront pas seulement le sens négatif de privation, de préservatifs, mais la valeur positive d’instruments de charité.
Loyola réservait la fine fleur de sa sévérité aux religieux « illuminés ». Des hommes comme Simon Rodriguez, François de Borgia, Fr. Onfray, André de Oviédo, Antoine Soldevilla furent l’objet de vigoureuses remontrances et même de mesures disciplinaires énergiques. Soldevilla, entre autres, s’était mis dans la tête que les jeunes religieux du Collège Romain n’étaient pas assez mortifiés. Il organise en conséquence, avec certains d’entre eux, des veillées nocturnes de méditations et d’exercices, si fatigants qu’un de ces jeunes gens faillit en perdre la raison et la santé. Ignace intervint avec rigueur. Il imposa au religieux trop austère de se donner une discipline en public et de se présenter au réfectoire avec une paire d’ailes angéliques et en répétant quelque chose comme : « On ne peut voler sans ailes. » Exclu temporairement de la Compagnie, Soldevilla demande à y rentrer et, après une épreuve de quatre mois, fut accueilli cordialement par Ignace et chargé par lui de postes de confiance, comme si rien ne s’était passé [1066]. Ce n’est pas un des paradoxes les moins piquants de cette personnalité multiple.
L’ascète imprudent d’Alcala et de Salamanque, le don Quichotte surnaturel de Manrèse, ne manque pas d’humour quand il prend la défense du bon sens, justement contre ceux de ses compagnons qui peut-être lui ressemblent le plus, quand il sévit contre ceux qui, comme lui naguère, manifestent un penchant excessif pour la fantaisie spirituelle et les pénitences déraisonnables. Et lui qui avait tant cherché et multiplié, avec un raffinement d’introspection, les épreuves et les contre-épreuves, il voudrait qu’on cessât de chercher. Décidé à épargner aux autres son épuisante expérience, il ne montre qu’une faible sympathie pour les âmes inquiètes et surtout très peu pour celles qui chérissent et cultivent leur inquiétude. Il sait trop le danger des aventures. Son regard ne dévie pas du but. Pas plus que Calvin il n’aime qu’on regarde en arrière : mais il permet, sans amertume, qu’on se sépare de lui.
La mortification a révélé à Loyola la valeur du réel. Libéré, il aperçoit plus nettement les vraies dimensions de « toutes ces choses qui sont créées pour l’homme, pour l’aider à servir Dieu [1067] ». C’est ainsi que l’ascète infirme, peu à peu, se transforme en professeur d’optimisme. Le recrutement des collaborateurs est suggestif de cette confiance dans la bonne nature purifiée par la grâce : « Dans le choix de ses compagnons, remarque Ribadeneira, notre Père estimait surtout chez un candidat le caractère et le naturel, et mettait la prudence et le sens du réel, l’aptitude à remplir les emplois de la Compagnie, au-dessus de la simple pénétration d’esprit et des capacités intellectuelles. Aussi, admettait-il de préférence des jeunes gens qui pourraient se distinguer dans les activités extérieures de la Compagnie, même s’ils avaient moins d’érudition et de talents spéculatifs, plutôt que ceux qui possédaient un grand savoir et une compétence déterminée pour des connaissances spéciales, mais aucune inclination, aucune facilité pour l’apostolat extérieur [1068]. » À des capacités unilatérales et tournées vers des recherches abstraites, il préfère des talents plus ordinaires, mais compensés par un ensemble de dons harmonieux du cœur et de l’esprit...
Les mesures prises par le fondateur de la Compagnie pour entretenir chez les siens la vigueur de la santé physique et morale sont parmi les plus caractéristiques de sa mentalité. « Quand les compagnons remarquent que quelque chose leur nuit, ou leur est nécessaire, concernant la nourriture, l’habillement, le logement, l’emploi ou le travail dont ils sont chargés, et ainsi du reste, qu’ils avertissent le Supérieur ou celui qui en est responsable », en veillant seulement à rectifier leur intention dans la prière, et à se tenir dans une disposition d’esprit désintéressée [1069]. « La sollicitude d’Ignace pour la santé et le bien-être corporel de chacun des siens était si grande, nous assure encore Ribadeneira, que c’était un objet d’admiration pour tous ceux qui le voyaient, alors qu’à ceux qui ne le connaissaient pas de près elle paraissait aller trop loin. Il est impossible de dire en peu de mots tout ce que cela comporte [1070]. »
Les compagnons n’iront pas comme des vagabonds négligés, mais ils s’efforceront d’être bien mis, en toute simplicité, comme des prêtres « réformés » de bonne condition [1071]. Leur table ne sera pas celle de mendiants, mais de gentilshommes pauvres, et le service sera distingué [1072]. Précis, méticuleux même, en fait de discipline domestique, il n’est jamais mesquin. Son détachement de l’argent s’affirme partout. En voyage avec Ribadeneira, il commande à ce dernier de donner de larges aumônes quand l’occasion s’en présente, et, dans les auberges, de payer avec empressement la note demandée par l’hôte, afin de ne donner à personne raison de se plaindre [1073]. De même qu’il distingue l’abnégation d’un angélisme puritain, il insiste pour qu’on ne confonde pas l’amour de la pauvreté avec celui de l’économie.
Lorsque Loyola découvrit l’ascèse au monde de la Renaissance, ce n’était nullement comme certains l’imaginent, une belle inconnue rencontrée par lui au bois dormant. Elle avait atteint depuis longtemps l’âge canonique et le droit de se montrer dans l’Église. C’est une patronne vénérable qui peut se vanter d’avoir veillé sur le berceau de tous les Ordres religieux. Loyola veut que la Compagnie s’incline à son tour devant elle, mais elle n’est sûrement pas sa véritable Dame, ni non plus Dame Pauvreté, ou Dame Obéissance. Comme tous les chrétiens authentiques, il aime tout simplement Dame Charité. C’est pour lui plaire qu’il accorde un si grand prix à ces impondérables qui facilitent à la fois l’influence apostolique et la maîtrise de soi : l’éducation, la courtoisie, le savoir-faire, l’amabilité, la culture, bref tout ce qui peut contribuer à rendre la conversation entre les hommes à la fois plus humaine et plus chrétienne, « à la plus grande gloire de Dieu ».
La Renaissance préconise un culte exubérant de la personnalité. Ignace l’oriente vers un renouveau plus large et plus profond de toute la condition humaine. Sa largeur de vue contraste avec les idées prétendument progressistes de la pédagogie calviniste. À Genève, tout est obligatoire. Tout est soumis à la contrainte. On ne devient bourgeois qu’en prêtant serment au nouvel évangile, c’est-à-dire en devenant calviniste [1074]. Les enfants ne sont admis à l’école qu’après avoir fourni la même garantie. Il y a des serments et des professions de foi pour tout : pour les ministres et les magistrats, pour les enfants et les professeurs. Le même schème juridique est décalqué chaque fois qu’un nouvel acte de soumission semblera nécessaire [1075]. Tout doit assurer à la cause l’impulsion maximum, au mépris des goûts et des aspirations individuelles.
Ce n’est pas ainsi que Loyola entend l’épanouissement de la réforme chrétienne. Il n’est pas favorable au nivellement des consciences et à l’uniformité des obligations. De même qu’il veille à utiliser tous les avantages matériels de l’humanisme (salubrité et bonne organisation des collèges, maisons de campagne, congés, atmosphère de confiance), il prend soin de dilater les âmes. La piété doit être personnelle. On ne demande pas de serment d’entrée aux étudiants. Si les visiteurs bénévoles ne veulent pas s’immatriculer, « il ne faut pas les exclure pour autant : pourvu qu’ils se comportent paisiblement et sans scandale. Et on peut le leur faire savoir, en ajoutant seulement qu’on prendra plus de soin de ceux qui sont inscrits [1076] ». À Genève, le catéchisme est obligatoire sous peine de fouet et autres corrections. L’enseignement religieux de l’Académie est d’un conformisme à toute épreuve. Les sciences naturelles sont un danger, « diabolica scientia » [1077] ! Calvin redoute « la curiosité impudente et l’audace », c’est-à-dire l’indépendance d’esprit dont il a usé et abusé lui-même.
Quelle école catholique aurait pu laisser dans son esprit l’empreinte indélébile dont il marque, de gré ou de force, les écoliers de Genève ? S’il n’éprouve que de la rancœur pour son passé, s’il est incapable non seulement de reconnaissance, mais simplement d’objectivité, à qui la faute ? Les torts ne sont habituellement pas d’un seul côté : « La méchante instruction que j’ai eue dans mon enfance... il y a toujours je ne sais quoi qui demeure... Quand nous aurons eu quelque méchante instruction... quand un homme, dès son enfance, aura été mal enseigné, qu’il aura été en une maison débauchée, encore qu’il travaille étant devenu à l’âge de vingt ans, qu’il travaille toute sa vie pour oublier les corruptions qu’il a vues et desquelles il a été abreuvé, il n’en pourra venir à bout, qu’il n’en retienne toujours quelque macule [1078]. » « Cependant, notre Walker, une école qui forma le style de Calvin et qui lui enseigna la dialectique, ne pouvait être sans valeur [1079]. » S’il enlevait ses lunettes sombres, Calvin découvrirait même d’autres bienfaits plus signalés reçus des écoles catholiques auxquelles il doit presque tout. Car il n’a pas connu d’autre enseignement. On peut même dire que si l’école de Genève, en devenant « collège de Calvin », se transforme en pure école « de la crainte de Dieu », l’originalité de l’institution n’est pas si complète qu’elle le paraît. Bien des aspects rappellent visiblement Paris et spécialement Montaigu : la discipline, la sévérité, le préjugé de la défiance contre une jeunesse portée a priori au mal, comme si d’eux-mêmes, les enfants devaient fatalement se « déborder, être outrecuidés, dissolus [1080] ».
L’esprit pédagogique qui inspire la IVe partie des Constitutions ignaciennes supporte la comparaison avec l’ordre imposé par le réformateur à l’enseignement genevois. Si les collèges de Loyola semblent, encore aujourd’hui, non seulement viables mais prospères, ce n’est certainement pas pour avoir démarqué l’art éducatif calviniste, comme le pense encore Wendel. Des objectifs religieux et moraux très élevés, souples et réalistes ; un souci constant du bon esprit et de la santé ; l’estime de toute perfection humaine, de la concorde ; le soin de « conserver les amis et de concilier la bienveillance des adversaires eux-mêmes » ; tout cet ensemble législatif en impose. Le caractère harmonieux du recteur jésuite n’est pas éclipsé par ce que Calvin dit du Principal. Il suffit de lire Érasme, ou même seulement Gargantua, pour se rendre à l’évidence que l’enseignement humaniste avait gagné la partie avant l’établissement de la théocratie genevoise [1081]. De la Réforme ou de la pédagogie nouvelle, qui favorise et qui exploite l’autre ?
Typiquement calviniste est la raison qui motive le choix du « Principal », qui doit être « d’un esprit débonnaire et non point d’une complexion rude et âpre... afin qu’il porte tout doucement les fâcheries de sa charge » ! La bonté elle-même, qui devrait ensoleiller l’éducation des enfants, n’est envisagée que comme un remède au mal [1082]. L’école calviniste est essentiellement une école de « correction » et de contention partisane. Le maître ne doit jamais se départir d’un sentiment de défiance contre les rebelles, les nonchalants, les esprits volages. Sans cette tension continuelle, l’œuvre de la réformation serait menacée de s’effondrer sous les assauts de la plaisanterie des écoliers. La nature est mauvaise, la jeunesse dévergondée et le peuple toujours prompt à se débaucher, car les justes, les élus sont un petit nombre.
Loyola est encore de la vieille école : de la piété libre et cordiale. L’idéalisme purifié de la Renaissance est accueilli avec entrain par la pédagogie de ce médiéval. Il souhaite évidemment amener les étudiants à la ferveur, aux pratiques religieuses : on ne négligera rien dans les églises et les écoles de la Compagnie pour stimuler l’intérêt de la jeunesse aux offices religieux, et surtout pour former la vie intérieure personnelle et responsable, par exemple par les « declamationes » : exhortations que les élèves sont chargés de se faire entre eux. « Mais il faut les persuader avec amour d’y prendre part, sans les y forcer, et s’ils n’y consentent pas, on ne doit pas pour autant les chasser des écoles, à moins qu’ils ne soient dissipés ou scandaleux [1083]. » Cet idéal d’une religion personnelle et du respect des consciences est proclamé par Loyola une dizaine d’années avant le fameux « Ordre du Collège de Genève », auquel Doumergue et Wendel voudraient attribuer une influence sur la pédagogie des jésuites [1084] !
Des écoles de la Compagnie, le protestant Karl Daendliker dira : « Les méthodes scolaires des jésuites dépassaient alors celles des protestants. Il n’était pas rare de voir les protestants fréquenter les écoles des jésuites. Une méthode plus rationnellement pédagogique y régnait. On accordait plus d’attention aux usages du monde, aux convenances, à l’hygiène [1085]. » Le collège de Genève, avec ses fenêtres de papier, n’était probablement pas le nec plus ultra des écoles de cette époque. La remarque de R.-F. Lombard sur Calvin dictateur, « esprit pessimiste... dont les tendances n’étaient nullement favorables à l’idée de progrès telle qu’on l’entend aujourd’hui », s’applique également à sa pédagogie [1086]. Son but essentiel, c’est d’apprendre aux enfants « à haïr les vices », parmi lesquels, cela va de soi, le plus odieux était la foi catholique.
Malgré un souci très exact de la discipline, la confiance domine l’éducation, telle que Loyola la comprend. Tous les buts offerts à l’esprit sont positifs : amour de Dieu, amour du prochain, amour des vertus. Même avec les délinquants dont on doit se séparer, « il faut agir autant que possible avec un esprit de douceur et conserver la paix et la charité avec tous [1087] ». Loyola croit à la possibilité d’un renouveau religieux et moral pour tous les hommes de bonne volonté. Il apprécie à sa juste valeur, comme le fait Calvin, après tant d’autres, les qualités d’un « naturel et d’une complexion débonnaires ». Mais il estime encore davantage la maîtrise de soi, une mortification des instincts acquise de haute lutte et, en particulier, la bonté d’âme établie sur la vie intérieure, à l’abri des surprises et de la « complexion ».
Le reproche le plus sérieux que l’on pourrait adresser à Loyola, comme à Calvin d’ailleurs, c’est un excès de zèle, une intransigeance radicale à réaliser ce qu’ils considèrent comme l’idéal évangélique. L’exagération de Calvin est toute répandue au dehors : c’est une impatience nerveuse qui charge d’un courant électrique à haute tension tous ses discours, ses écrits, ses démarches, ses projets et ses entreprises, et qui ne s’apaisera que le jour où tous penseront comme lui et subiront passivement l’impulsion de son activité incroyable. Si jamais un mot peut qualifier cette extériorisation, cette expansion irrésistible d’une idéologie véhémente, c’est bien celui de dynamisme. Mais quel feu brûle ce zèle ? Un feu révolutionnaire qui tombe à plat, comme dans la Genève du XVIIe siècle, dès que l’aliment d’une opposition lui est enlevé. La démesure de Loyola est peut-être de même force, mais en sens contraire : c’est parfois son ascèse qui dépasse les bornes, c’est son introspection qui devient excessive. Ce qui désoriente, c’est un tel raffinement de la vie intérieure, trop cultivée, trop analysée et recherchée, qu’elle sent, non seulement le travail et la méthode, mais encore l’artifice. Du moins, l’énergie ainsi concentrée au profond de l’âme, si elle peut gêner la spontanéité du « naturel », ne risque jamais de s’abandonner à la brutalité, à la fureur démolisseuse.
La théologie et l’animosité de Calvin sont des vases communicants. Le doctrinaire qui tend, avec une telle fougue, à assurer la « pureté » dans le culte, l’enseignement, la prédication et toute la vie publique, semble oublier de purifier la source de ses propres idées. Sa spiritualité est trouble et les canaux par lesquels il s’évertue à communiquer aux autres son sentiment religieux auraient un sérieux besoin de contrôle, d’hygiène psychologique. Loyola savait bien ce qu’il faisait, quand il insistait infatigablement sur cette intériorité : pureté intérieure des affections, mortification intérieure, vie intérieure, etc. Il n’a pas dédaigné la psychologie... « Les tenants du néo-calvinisme, écrit un professeur protestant, n’ont guère abordé l’histoire ; par une sorte de suspicion de principe, défiance de la psychologie religieuse et souci de faire disparaître, en Calvin, l’homme derrière l’œuvre... ils s’attachent tous à donner une traduction métaphysique de Calvin, à interpréter pour le public, qui a besoin de croire en termes de culture, la foi paradoxale de Calvin [1088]. »
Le christianisme n’est pas seulement une doctrine ; il doit être une vie. Cette limitation métaphysique de la personnalité du réformateur n’est pas une recommandation. « La gloire des grands hommes, disait La Rochefoucauld, se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l’acquérir. » Comment la théocratie genevoise s’est-elle établie et maintenue ? Chacun connaît la réponse. On ne laisse subsister du calvinisme que la doctrine. Il sera moins difficile de l’idéaliser et les disciples dépasseront le maître dans l’application d’un système plus beau en théorie qu’en réalité. La mystique ignacienne est une action vivante dont l’intensité ne soulèvera pas toutes les générations suivantes de disciples à la hauteur des Xavier, des Favre, des Laynez, des Borgia et des Canisius. La belle éloquence d’un prédicateur peu édifiant peut rendre ses fidèles meilleurs que lui, alors qu’on se lasse à suivre un modèle trop parfait. Bien des jésuites se sont essoufflés sur les traces de Loyola.
II
LE SAGE ET LE SAINT
La psychologie religieuse a ses points faibles dont les théologiens réformés se méfient peut-être à bon droit. Ni la foi, ni la religion, ne sont réductibles à la simple psychologie. Que vaut la piété volontaire de Loyola ? Des protestants regrettent avec le Dr Schlemmer que des individualistes, disciples de Barrès, puissent « savourer l’ivresse de la culture raffinée de leur être le plus intime et découvrir avec enthousiasme que la méthode de Loyola, transposée, pourrait merveilleusement servir leur dessein de faire vibrer leur solipsisme [1089] ». Mais pour admettre une telle parenté entre Barrès et Loyola, il faudrait renoncer à présenter l’obéissance et l’austérité ignaciennes, ainsi qu’on le fait volontiers, comme des éteignoirs de la personnalité. Il serait trop paradoxal que le même homme soit un autocrate interdisant « de se former des convictions personnelles et d’y conformer sa vie [1090] » et, en même temps, le maître de la psychologie la plus individualiste qui soit.
Loyola possède à un degré exceptionnel la connaissance des hommes ; mais cette clairvoyance est une force rayonnante. C’est la confiance dans le bien qui le guide toujours. Marcuse l’a entrevu et exprimé à sa manière emphatique : « Loyola a été un organisateur du bien qui a étendu son action à toute la terre... Le vieux rêve des hommes, d’une vie juste et digne, rêve qui de Platon à Marx n’a pas évolué, n’est plus, grâce à Loyola, l’objet d’une prière (?) mais un but de combat... C’est lui et non Napoléon qui a été le plus grand organisateur européen de l’univers humain... cet homme de Dieu, serviteur des Princes, était un grand révolutionnaire. Il ne connaissait qu’un moyen de salut : l’abandon total de soi pour la réalisation de son lointain but temporel : une humanité unie et fraternelle [1091]. » Cette fraternité humaine, Loyola ne songeait à la réaliser que dans l’union divine.
Avant d’être un grand manieur d’hommes, il fut et resta un homme de Dieu, un maître d’oraison [1092]. C’est ce qui devait lui permettre à lui-même et à ses disciples de travailler « au milieu du monde, sans être de ce monde ». Il disait, nous rapporte Ribadeneira, « qu’un homme maître de lui-même et pourvu de l’intelligence nécessaire et du savoir-faire propre à aider les autres, pourra comme le soleil descendre jusque dans la poussière... Il disait encore que les moyens (indifférents) qui servaient au diable pour pervertir les hommes devraient nous servir à les sauver. De même que celui-ci s’applique à découvrir la nature de chaque individu et les tendances de son caractère et s’y adapte, et qu’il propose des choses brillantes aux orgueilleux, du profit aux âmes cupides, du plaisir aux jouisseurs et même des apparences de piété pour séduire les âmes dévotes ; et il ne fait pas irruption subitement, mais s’introduit insensiblement et s’insinue dans l’intimité d’une âme jusqu’à la pénétrer tout entière ; de même l’artiste spirituel et habile doit tenir compte de la nature de chacun et, dans les débuts, taire bien des choses, fermer les yeux sur d’autres, et ensuite, une fois la confiance gagnée, conquérir par leurs propres armes ceux avec qui on a affaire. Quant à lui-même, Ignace pénétrait jusqu’au fond le caractère et le naturel des gens qu’il fréquentait, par une sorte de perspicacité moins humaine que divine. En effet, après une seule rencontre, dans une seule conversation, les sentiments les plus intimes de ses interlocuteurs lui devenaient évidents et transparents, si bien qu’on aurait pu dire qu’il avait eu le temps de manger avec eux toute une mesure de sel, et qu’il les connaissait par le dedans, comme s’il avait été dans leur peau [1093] ».
Cette connaissance n’a rien d’une prudence machiavélique. Elle en est même l’antithèse parfaite. Car elle est à base de charité. Loin de vouloir utiliser le prochain à des fins politiques, il s’agit de se plier et de s’adapter à lui, pour « se faire tout à tous », pour respecter les lois de croissance spéciales à chaque âme. Pour « ne pas éteindre la mèche encore fumante », pour relever « les roseaux blessés », l’apôtre doit s’imposer des ménagements, user de délicatesse, chercher les germes de foi et d’espérance partout où il est encore possible d’en découvrir. Il n’est, pas pour les méthodes expéditives. Il n’exige beaucoup que là où il est sûr de ne pas décourager. Mais quand la bonne volonté est affaiblie, il songe d’abord aux moyens de guérir. Cet ancien soldat et gentilhomme paysan a gardé un doigté et une finesse extraordinaires : il ne s’intéresse pas seulement aux siens, mais à tous les hommes, les frères de Jésus-Christ, qu’il aime avec une véritable tendresse. Son discernement est sans cesse en éveil : « Tout bien n’est pas également bon. Il s’agit de choisir le meilleur. Aussi faut-il préférer le bien de l’ensemble au bien particulier. Il ne suffit pas que quelque chose soit bien et beau en soi ; il faut qu’il le soit dans tous ses rapports et toutes ses conséquences. » « Ce qui est le plus utile, dira-t-il encore, ce n’est pas ce qui paraît le meilleur (dans l’abstrait), mais ce qui, dans les circonstances données, est le plus approprié [1094]. »
Et l’amour du bien doit être incomparablement plus fort que la peur du mal : « On n’a pas le droit de détruire quelque bien à cause d’un abus »... « On ne doit pas abattre l’arbre pour cueillir les fruits... Il faut savoir récolter le froment sans prendre l’ivraie [1095]. » Il parle rarement du démon. Ce n’est pas pour lui un thème favori d’imprécations sonores, un épouvantail pour frapper de terreur l’esprit des « fidèles », comme c’est si souvent le cas chez Calvin. C’est pour lui un adversaire spirituel, dont on ne vient pas à bout avec des cris et des éclats de voix, mais avec une vigilance intérieure aussi attentive que confiante. Fort de la promesse, que « pour ceux qui aiment Dieu tout contribue au bien », Loyola ne s’exalte, ni ne s’indigne. Il semble même défier l’ennemi, le séducteur, que la docilité « au bon esprit » lui permettra de démasquer et de vaincre : « À malin, malin et demi [1096]. »
À combien plus forte raison ne se laissera-t-il pas désemparer par des adversaires humains, qu’il se refuse à regarder comme des ennemis. Lors de la tempête déchaînée contre son nouvel Ordre en Espagne, par l’archevêque de Tolède, Jean de Siliceo, et par ses pareils, « dès qu’Ignace reçut la nouvelle de l’orage, nous raconte Ribadeneira, il me dit avec le visage rayonnant et serein qu’il avait toujours : il faut compter cette opposition parmi les bonnes chances qui nous arrivent, puisqu’elle n’a pas été provoquée par notre faute. C’est la preuve évidente que le Seigneur veut réaliser des œuvres fécondes, par notre Compagnie, à Tolède... Il ajouta encore : l’archevêque est vieux, la Compagnie est jeune ; d’après le cours naturel des choses, la Compagnie vivra plus longtemps que l’archevêque [1097]. » La Compagnie est jeune... Sa réaction ne recourt pas à la polémique, ni aux disputes : « On ne doit rien écrire ou faire d’où pourrait naître quelque amertume. » Marcuse même le reconnaît en parlant du conflit avec Paul IV : « Pas une fois, Loyola, dans ses lettres les plus intimes, ne prend prétexte du scandale qui règne dans la maison de son puissant ennemi, pour rendre à ses juges indignes, les mesquineries et les humiliations qu’ils lui ont fait subir... Ignace ne combattait pas par amour de la lutte, ou parce qu’il était irrité contre un ennemi. Il ne combattait jamais par soif de vengeance ou par haine [1098]. »
À force de tourner son attention vers les bons côtés des hommes et des choses, il perd de vue les aspects négatifs. La critique acide, le dénigrement et la médisance, qui sont comme les condiments indispensables du style de Calvin, sont absents des lèvres et de la plume de Loyola et lui répugnent profondément. Il a besoin d’estimer et d’aimer l’adversaire qu’il combat. C’est un sage, plein de modestie, qui prend avec humour les contradictions que son amour ne parvient pas à résoudre. Au lieu de déplorer les maladresses de Paul IV, pourquoi ne pas détourner son regard et songer qu’il n’est pas le seul pape de la série. Avant lui, il y eut Marcel qui était un ange. « Parlons du pape Marcel », disait-il en souriant à ses compagnons vexés de la raideur de Caraffa. D’ailleurs, l’inlassable bienveillance de Loyola finira même par gagner le cœur du pontife, farouche adversaire des Espagnols [1099].
Le langage de ce grand ami des hommes était réaliste et sobre. Il n’essayait pas d’imposer son avis. S’il discute, c’est pour rapporter des arguments scrupuleusement exacts, qui doivent parler d’eux-mêmes [1100]. Il n’aurait attribué aucune valeur aux protestations, adjurations, serments, que la passion arrachait si facilement au réformateur genevois. Ribadeneira et d’autres témoins, observateurs attentifs des moindres faits et gestes de leur Père, nous assurent que pendant trente ans et plus, il n’a jamais appelé quelqu’un insensé ou stupide, ni employé d’autre terme injurieux quelconque. « Dans ses remontrances, nous avons souvent remarqué que sa parole pouvait être sévère, mais l’âpreté en était toujours absente. L’expression n’avait pas besoin d’être mordante : l’exposé des faits devait suffire à susciter des regrets... S’il ne prodiguait pas les louanges, il était surtout avare de reproches. Il ne lui arrivait guère d’employer des superlatifs. Jamais il ne dénigra personne, ni ne prêta l’oreille à des médisants. Les vices d’autrui, même publics et qui étaient dans toutes les bouches, n’intervenaient pas dans sa conversation et il prenait soin qu’on évitât ces sujets. Venait-on à y céder, il s’efforçait d’élever le niveau de la conversation, d’excuser le fait, ou du moins l’intention et la volonté. Et si l’énormité du fait rendait l’excuse impossible, il recourait au principe : Ne jugez pas avant le temps. Dieu seul voit les cœurs... Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés [1101]. »
À côté de la fièvre si souvent négative et agressive de Calvin « vieux et cacochyme à 35 ans [1102] », l’activité de Loyola sexagénaire déborde de confiance et de vitalité juvénile. Rien ne semble pouvoir le dérouter, ni le décevoir. En lui, la paix et la tranquillité régnait : « Tout son extérieur attestait ce recueillement... Aucune nouvelle que je lui annonçais, raconte son collaborateur immédiat, Gonzalez, aucune surprise qui lui arrivait, fût-elle heureuse, ou triste, ne provoquait dans sa manière d’être, ou dans ses gestes, le moindre signe d’agitation ou de trouble [1103]. » « Il était toujours égal à lui-même et parfaitement maître de lui... C’était une chose merveilleuse de voir comment il se possédait... Par la grâce de Dieu et par un effort attentif, il avait réussi à vaincre complètement toutes ses tendances naturelles et à les soumettre au jugement, en sorte que, sans être « apathès » et dépourvu de sentiment, ce qui serait contraire à la nature de l’homme, il semblait certainement libéré de tout trouble intérieur et de mouvements violents de l’âme [1104]. » Un des meilleurs historiens de la Compagnie, Astrain, a bien caractérisé cette maîtrise qui n’était pas « olympienne », mais simple, souriante et paternelle. « Il aimait ses fils, mais avec mesure et jugement ; il se laissait émouvoir et attendrir, mais avec mesure et discernement ; il punissait, avec mesure et jugement ; il témoignait sa compassion, donnait des avertissements, faisait des concessions, mais toujours avec mesure et jugement [1105]. » Il ne domine, ni par la supériorité du verbe ou du savoir, ni par la virtuosité dialectique, ni par le génie politique, mais il s’impose par l’ascendant de sa personnalité religieuse. La valeur personnelle de cet homme de Dieu réside dans un bel ensemble de dons variés, de qualités solides, sinon brillantes ; confiance et joie surnaturelle, sagesse aimable et bienveillante, jusque dans les manifestations de la force et de la sévérité.
Les disciples de Loyola ne seront pas, aussi facilement que ceux de Calvin, tentés de cacher pudiquement l’homme derrière certaines réalisations extérieures, derrière certains aspects « grandioses » de sa doctrine. La plus grande objection contre le système calviniste, c’est Calvin lui-même, c’est sa mentalité, son caractère en contraste continuel avec la pensée chrétienne, c’est-à-dire, avec l’esprit de charité du Nouveau Testament. Les disciples de Loyola ne sont pas embarrassés de voir leur chef agir, parler. Ils ont, au contraire, observé et analysé tous les aspects de cette physionomie si attachante. Loyola était gêné par l’insistante vénération, la béate admiration avec lesquelles on le dévisageait. Cette attention était bien justifiée à l’égard, de celui qui soulignait, avec tant d’énergie, la nécessité d’unifier la vie et les idées, qui n’enseignait et ne recommandait que ce qu’il savait réalisable. Dans sa personne comme dans sa conduite, tout s’enchaîne, non par des liens dialectiques, extérieurs, mais par la vie intérieure. Celle-ci ne s’épanouit pas en étouffant la vie humaine, mais en commandant son effloraison harmonieuse. Les qualités naturelles doivent mûrir avec la perfection surnaturelle. Dieu exprime sa grâce dans les hommes autant par le visage, le regard, les attitudes empreintes de charité, par la démarche, le ton de la voix, par tout le maintien et le comportement vivant du chrétien que par des sermons éloquents ou des discussions savantes. Les « règles de la modestie » ou les « règles pour sentir avec l’Église » sont, parmi beaucoup d’autres, le témoignage de cette certitude que, dans la vie spirituelle, tout se tient. Une unité étroite doit tendre dans le même effort de perfection, le physique et le moral, l’intérieur et l’extérieur, la liberté et l’engagement personnel, la discipline et l’obéissance, l’esprit et son décor, le cadre religieux, l’ambiance liturgique. Ces recommandations minutieuses situent Loyola bien au-dessus de son temps qu’il dépasse dans les deux sens.
Il reste médiéval, il croit aux mystères, au symbolisme, à la prière et à la poésie des choses. Et bien plus encore, il est moderne par son attention clairvoyante pour tous les problèmes de la psychologie religieuse et du composé humain. Il possède un sens profond de la fidélité, de la Tradition : une foi naïve. Mais l’univers de la Renaissance étale aux yeux du moderne la gloire et les bienfaits de Dieu : « Tous les êtres à la surface de la terre sont créés pour l’homme, pour l’aider à atteindre son but, Dieu [1106]. » Cela reste vrai à travers toutes les défaillances de l’homme. À quelque bas-fond qu’il le voie tombé, Ignace pense pouvoir découvrir le point de départ d’une vocation divine nouvelle et, même dans l’irréparable, « chacun doit s’efforcer de se rendre parfait, dans la mesure du possible [1107] ». Le bilan des misères humaines, établi avec une conscience scrupuleuse, s’achève encore sur une conclusion d’enthousiasme reconnaissant : « Cris d’admiration et émotion intense, en parcourant du regard toutes les créatures ; voir comment elles m’ont permis de vivre et m’ont conservé vivant : les anges qui sont les glaives de la justice m’ont supporté, gardé, et ont prié pour moi ; les saints tout occupés à intercéder et à supplier en ma faveur ; les cieux, le soleil, la lune et les étoiles, les éléments, les fruits, les oiseaux, les poissons, les animaux de la terre qui ne s’est pas entr’ouverte pour m’engloutir... Conclure par un entretien pour exalter la miséricorde divine, pour rendre grâces à Dieu qui m’a donné la vie jusqu’à présent ; et décider de m’améliorer à l’avenir avec sa grâce [1108]. »
Il ne faut jamais désespérer de personne. Que Dieu veuille sauver tous les hommes est, pour Loyola, une de ces vérités premières qui ne se discutent pas. Il s’efforce de la réaliser par toutes les inventions d’un apostolat aussi souple qu’universel. Demain, certains de ses disciples, comme le Père de Nobili, prendront les dehors des gens de caste pour convertir les Hindous ; d’autres se feront parias avec les parias, esclaves avec les esclaves, comme saint Pierre Claver ; d’autres s’introduiront dans la société japonaise ou chinoise et y seront reçus au titre de grands dignitaires, de savants ingénieurs ou astronomes, voire de mandarins. À travers toutes ces métamorphoses, l’apostolat ignacien ne perd pas de vue le principal : « Servir la plus grande gloire de Dieu et le bien commun, qui est pour nous le but unique en toutes choses [1109]. »
Non seulement, Calvin n’a pas de regard pour la majeure partie de l’humanité, les païens ; non seulement le problème des missions lointaines, pour des générations, ne se posera pas à Genève ; mais encore à quelle chrétienté réduite on voudrait limiter la grâce du salut ! Castellion relève un contre-sens biblique par lequel le réformateur tente d’échapper à la doctrine du salut universel : « Cet homme ne veut absolument pas que Dieu veuille sauver tous les hommes ; il se donne mille peines, il torture les textes et se torture le cerveau, pour que, en dépit des promesses les plus claires et les plus générales, la grâce de Dieu en Jésus-Christ ne puisse être salutaire à tous. Encore n’y parvient-il pas [1110]. » L’homme devrait se sentir perdu « pour qu’un beau désespoir alors le secourût » et le soulevât par-dessus l’abîme de la prédestination éternelle.
Calvin sait quelles prémisses il faut choisir pour fonder sa hiérarchie des valeurs chrétiennes : « La bonne conscience et la foi, c’est-à-dire en un mot, la piété et la crainte de Dieu est mise au-dessus, comme chef : et de là, après est déduite la charité [1111]. » On ne saurait être plus explicite. Avant toute chose, la piété calviniste. Sans elle, la charité ne s’impose pas. Celle-ci se confond simplement avec la solidarité partisane. Et cette piété, pour être authentique, doit se sentir traquée, haletante, comme aux abois : si « les fâcheries, incommodités, craintes et autres espèces de tentations nous molestent, l’accès nous est plus libre à Dieu, comme s’il nous appelait nommément... Je ne requiers point (que le fidèle) soit tellement délivré que nulle sollicitude ne le poigne, ou fâche, ou moleste, vu que plutôt, au contraire, il est besoin que l’ardeur de prier soit enflammée en nous par angoisse et grande détresse [1112] ». Piété puritaine, capable de tous les efforts, même les plus amers ; ardeur dynamique, c’est-à-dire merveilleusement tenace, avec une pointe contre le monde et le « reste des hommes ». Au terme de sa carrière, Calvin sera donc, plus que jamais, sûr de lui, un génie malade qu’« on craint de fâcher [1113] », qui « ne doute pas que le diable... ne suscite au monde méchantes gens, ayant esprits volages et frénétiques... pour pervertir la parole de (son) Évangile ». Mais tandis que ses remontrances ultimes ne se font pas d’illusion sur la méchanceté des autres, il trouve un peu trop facilement le moyen de mettre ses propres fautes, « affections trop violentes et infirmités », sur le compte de la Providence. Dieu ne saurait être plus exigeant, avec le David genevois, qu’avec le prototype auquel il se réfère volontiers. Le livre de chevet de Loyola, c’est l’Imitation de Jésus-Christ. On pourrait composer un traité avec les passages du réformateur suggérant une fidèle imitation de David [1114]. L’idéal était plus facile à suivre. Mais cette Réforme est-elle un progrès ? « Que si un homme tant excellent, riche et redouté est trébuché, que sera-ce de nous qui ne sommes rien ? Nous avons donc bien raison de nous humilier, et de cheminer en crainte et sollicitude, nous tenant cachés sous les ailes de Dieu auquel toute notre assurance doit être [1115]. »
Dans le « Flos Sanctorum », Loyola cherchait des exemples difficiles, des sujets d’admiration et d’émulation pour s’exciter à un continuel dépassement de soi-même. Trop souvent la vie des grands personnages bibliques offre à Calvin des ombres, des faiblesses qui lui servent d’excuses. Ceci explique aussi, d’ailleurs, une partie du succès de l’Ancien Testament à travers le monde réformé. Beaucoup d’enseignements religieux et moraux élémentaires fournis par cette histoire prodigieuse offrent des aspects plus catégoriques, plus tangibles que les conseils évangéliques. Les couleurs vives, voire violentes, attirent davantage que les nuances et la finesse. Surtout dans le domaine mystérieux du surnaturel. Loyola ne s’arrête pas à ces simplifications sommaires. Il prêche à qui veut l’entendre une recherche délicate de l’idéal chrétien : « Que chacun s’efforce d’atteindre le degré de perfection qu’il peut acquérir, suivant les grâces reçues par chacun, dans la mesure du possible, suivant les circonstances, suivant les dons et les capacités [1116]... »
Toujours plus, « magis » : il croit qu’il peut donner et se donner toujours davantage. Il croit à l’amour de Dieu, comme y croyait le patron qu’il s’est choisi, Ignace d’Antioche, dont il emprunte une devise adaptée au goût de sa piété : « Jésus mon amour est crucifié [1117]. » C’est un saint, qui croit à l’utopie de la perfection progressive. Il aime la vertu, toutes les vertus, toutes les formes possibles de ressemblance avec Notre-Seigneur, dont il n’éprouve jamais la plénitude, mais seulement un avant-goût, une promesse attirante. « Dirigé insensiblement et suavement vers le but qu’il ne connaît pas encore... il avance pas à pas, il s’efforce, ainsi que l’a si délicatement noté le subtil et docile Nadal, il est en chemin, avec une sage imprudence, dans la simplicité d’un cœur qui se repose dans le Christ [1118]. »
Présomption, naïveté ? – Il insiste aussi fort sur l’état de grâce et ses exigences libres, que Calvin sur l’état de péché et la résignation obstinée qu’il implique. Son « tant pis » évite les simples humiliations de l’expérience et s’abîme verbalement pour s’exalter aussitôt, sans transition comme sans remords. Le balancement de l’antithèse satisfait le goût de Calvin pour le fortissimo oratoire et soulage la tension d’un tempérament tragique qui, tourmenté d’un besoin religieux immense, ne réagit plus qu’avec des émotions excessives : « Plutôt mourir mille fois... Je me penserais être maudit... J’aimerais mieux être confondu en abîme... devant le tribunal et le juge suprême [1119]... » On a l’impression que Calvin trouve la paix de la « pauvre conscience » et la consolation, dont il a toujours été avide, dans ces frissons qu’il se donne et qu’il s’évertue à transmettre autour de lui : Je tremble, donc je crois. C’est son point d’appui, pour soulever le monde : « Il craint Dieu et n’a point d’autre crainte. » Genève doit avoir peur de Dieu.
Le Dieu devant lequel Loyola veut incliner doucement les libertés humaines, c’est au contraire, comme il l’écrit si souvent, « la Bonté Infinie, la Divine Miséricorde, la Sagesse et l’Amour éternel, la Charité de Dieu Notre-Seigneur [1120] ». Il n’identifiera jamais le respect de Dieu avec la peur. Malgré son éducation de soldat, malgré un style viril et des consignes sévères, il souhaite ne voir autour de lui, dans les rangs de la Compagnie, que des âmes reconnaissantes et chantantes, qui servent le Seigneur par pur amour. Le remarquable document connu sous le nom de « Lettre aux scolastiques de Coïmbre » est typique : « Par-dessus tout, je voudrais exciter en vous le pur amour de Jésus-Christ et le désir de son honneur et du salut des âmes qu’il a rachetées. » Le Seigneur est si libéral qu’il « continue à vous accorder tous ses dons et ses bienfaits, même si vous avez été ses adversaires révoltés ». Chacun par reconnaissance est « absolument obligé de servir avec élan et de procurer l’honneur de Jésus-Christ [1121] ».
III
LES ŒUVRES
Joie, reconnaissance, louange, optimisme généreux : les pédagogues, les missionnaires, les humanistes jésuites traduiront cette mystique, chacun à sa manière, sans doute avec davantage d’excès d’imagination créatrice que d’abus de servilité et de conformisme. Autant la piété de Calvin est exclusive, autant le catholicisme de Loyola est inventif et universel. Un des pionniers des missions d’Amérique exprime avec tout le grossissement nécessaire cet enthousiasme religieux [1122].
« Voulez-vous savoir ce que je fais ? Je fais de la musique et je danse. Je sais bien que la prédication de la parole de Dieu est l’occupation principale de l’Apôtre. Aussi l’Écriture dit-elle : “Leur parole a pénétré jusqu’aux confins de la terre.” Mais vous savez qu’au même endroit il est dit aussi que “le son a retenti dans le monde”, par quoi il m’est sans doute permis de comprendre le chant. Je chante donc de toute ma voix, je joue de l’orgue, je touche la cithare, je joue de la trompette et de la flûte, je fais vibrer les violons, les grands et les petits. Je joue de tous ces instruments et je les enseigne à mes enfants les Indiens, pour qu’ils fassent de la musique, même si moi-même, je n’en ai jamais joué auparavant. Mais qui donc construit ces orgues, ces violons, ces cithares ? Eh bien, personne d’autre que justement “le long Schmid”. Le besoin et la pauvreté nous rendent si inventifs que nous savons ici et pouvons bien plus que nous ne pensions. Sinon, qui pourrait réaliser tout ce qui se fait ici : les maisons, les églises, voire même bâtir des cités entières, et fabriquer par-dessus le marché les instruments nécessaires, sinon les missionnaires, qui en forgeant (comme Schmid) sont devenus forgerons et ont mis sur pied le nécessaire. De fait, dans tous les villages retentissent déjà les orgues que j’ai construites et les tribunes des églises sont pleines d’instruments de toutes sortes. On entend maintenant, dans toutes les églises, le chant et la musique tous les jours. Mais je viens de parler de danses. Comment la danse peut-elle s’accorder avec la dignité du missionnaire, demanderez-vous [1123] ? »
La justification éducative et religieuse de cette rythmique aurait-elle choqué Loyola qui ne dédaignait pas de danser des airs basques pour secouer la désolation d’un ami ? Loin de nous la pensée de proposer en exemple toutes les audaces missionnaires qui se sont donné libre cours dans les Réductions du Paraguay. La formation en serre chaude d’Indiens incapables de se conduire eux-mêmes trouvera toujours des critiques et des défenseurs [1124]. Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’au point de vue de la confiance, de la charité, de la bienveillance apostolique, les sauvages des réductions jouissaient d’un régime d’autorité paternelle qu’auraient peut-être envié les sujets civilisés de la Cité de Calvin. Et qui oserait dire que ces « enfants » qui priaient, et priaient beaucoup, en chantant et travaillant au son de la musique, n’adoraient pas, de bon cœur, le vrai Dieu ?
L’universalisme ignacien a beaucoup influencé le courant de la culture baroque, mais il en a subi le contrecoup. Si l’on peut faire un reproche aux disciples de Loyola, ce n’est certes pas d’avoir méprisé l’humanisme et la science, mais de les avoir parfois trop aimés. Il leur est aussi arrivé, ici et là, en contradiction formelle d’ailleurs avec les principes de leur fondateur, de surestimer les moyens d’apostolat naturels et humains. La perspective du Règne donnait à leur zèle des allures conquérantes et il n’est pas de domaine culturel ou social qu’ils n’aient essayé de comprendre dans leur champ d’action. Suivant les schèmes et les préjugés, on appréciera diversement ces efforts enthousiastes pour baptiser, sans leur faire violence, toutes les coutumes et tous les usages ethniques, toutes les mentalités philosophiques, de la Chine, du Japon, de l’Inde, et aujourd’hui encore de l’Amérique.
Mais il reste vrai qu’ils se sont ingéniés à être « tout à tous ». Non seulement par diplomatie, avec une prudence qui se cache « derrière mille masques », comme le pense Fülöp-Miller, « hommes du monde avec les gens du monde, savants avec les savants, artistes avec les artistes, politiques avec les politiques », mais par amour du prochain, vraiment pauvres avec les pauvres, miséricordieux avec les pécheurs, encourageant toutes les valeurs et toutes les générosités. La Compagnie a efficacement contribué à élargir les frontières de l’influence européenne et chrétienne, de même qu’elle a ouvert le vieux monde aux influences venues des continents à peine explorés. Dans ces découvertes et ces échanges culturels, ils ont fourni un grand nombre de pionniers, géographes, ethnologues, linguistes [1125]. Herder exagère-t-il les mérites des jésuites devant la civilisation ? « À peu près toutes les sciences leur doivent quelque chose [1126]. » Genève a conquis une place de premier rang sur le marché mondial du livre. Mais cet essor de la presse compense-t-il tout à fait la suspicion jetée par le calvinisme sur la culture de la Renaissance. Ce n’est pas la Réforme qui a suscité l’humanisme des Estienne et des Budé, mais c’est bien Calvin qui se survit dans l’étroitesse d’esprit des Théodore Tronchin et des Jean Diodati [1127]. En soulignant avec la même force l’importance du livre, les jésuites n’ont pas négligé pour autant les arts et les sciences, le théâtre et les missions.
Au point de vue artistique, il est indéniable que l’influence de Calvin a été stérilisante. On peut lire entre les lignes du grand admirateur Bonivard tout ce que Genève avait perdu en devenant calviniste : « Quoique le contenant de la ville soit encore beau et délectable, ce n’est à respect de ce qu’elle était le temps passé de fraîche mémoire ; beaucoup de plaisants édifices ont été abattus, tant pour assurer la ville des ennemis comme pour ôter les superstitions papales. » « Les brèches faites à la cathédrale de Saint-Pierre par la ferveur dévastatrice des premiers réformés n’étaient pas encore réparées (à la mort de Calvin) : à la place des portes qu’ils avaient enfoncées, des fenêtres qu’ils avaient brisées, des vides demeuraient béants ; les hirondelles s’engouffraient, gâtaient les accoutrements des fidèles ; l’édifice offrait un aspect de « halle », déconcertant pour ceux qui en avaient connu l’imposante splendeur [1128]. » En devenant la seconde capitale de la chrétienté, « la ville la plus haïe et la plus aimée », Genève, constate l’historien littéraire Marc Monnier, « était devenue une ville triste ».
Sans aller jusqu’à dire avec le protestant libéral O. Douen que le réformateur a été « antilibéral, antihumain et antichrétien », il est certain que l’homme qui se réjouissait de la destruction des trésors artistiques de notre pays a, pour le moins, « opéré le divorce entre la Renaissance et la Réforme [1129] ». L’art de commande et de raison qu’il veut contrôler exactement est-il encore un art : « L’usage de peindre et de tailler doit être gardé pur et légitime. » « Il faut toujours donner garde que les oreilles ne soient plus attentives à l’harmonie d’un chant simple et pur des paroles divines. » Il ne connaît et n’admet qu’un seul moyen d’expression, celui qui trouve une traduction adéquate dans les mots du langage logique. Et il veut dicter les règles de la peinture, de la sculpture, de la musique, comme il dirige la politique et contrôle la gastronomie et la toilette des Genevois, précisant les plats et les tissus permis aux différentes classes : gentilshommes, grands et petits bourgeois [1130].
Calvin, comme Loyola, aime à recruter ses adeptes de préférence dans une élite intellectuelle et sociale. Il note avec satisfaction : « Nous comptons aujourd’hui, parmi nos disciples, des personnes de plus haut rang et des savants de premier mérite. » Des philologues et des juristes, cela va de soi, et de beaux esprits, des prêcheurs éventuels, des talents semblables aux premiers ténors de la Réforme, tels que Michel Cop, Nicolas des Gallars, Bèze, Colladon, Knox et autres grands serviteurs de la parole et démolisseurs d’idoles. L’idéal du pasteur, au dire de Bèze, « ce serait encore l’orateur qui fusionnerait la puissance imprécatoire de Farel, le charme persuasif de Viret et la majesté sentencieuse de Calvin [1131] ». La Réforme abomine toutes les images, à l’exception des images verbales qui, elles, sont idolâtrées.
« Nous concluons infailliblement que la Parole est vrai Dieu... Dieu a tellement parlé en créant le monde... » De même c’est en parlant que les ministres de la parole pensent recréer le monde, en se faisant « comme la bouche de Dieu [1132] ». Un sens plus délicat des figures et des formes artistiques, un style moins éloquent auraient préservé Calvin de ces pièges de rhétorique, où les idées apparemment claires voilent leur pauvreté derrière les grandes phrases. Et demain, une fois la pure doctrine calviniste établie, il faudra s’en tenir au psittacisme qui règne à Genève, après la disparition du réformateur. Les cérémonies seront réduites à leur plus simple expression : « In numero paucitas, paucissime » : le maximum de prédication, jusque dans la prière, avec le minimum d’action liturgique et de culte proprement dits. L’art et le sentiment religieux concrets auront peur de s’épanouir dans cet air raréfié.
« Ce fut trop ridicule et inepte imitation papale que d’orner les temples et de croire rendre à Dieu un culte plus noble, en employant des orgues et beaucoup d’autres amusements de cette sorte [1133]. » « Les chants et mélodies qui sont composés au plaisir des oreilles seulement, comme sont tous les fringots et fredons de la papisterie, et tout ce qu’ils appellent musique rompue et chose faite et chants à quatre parties, ne conviennent nullement à la majesté de l’Église, et ne se peut faire qu’ils ne déplaisent grandement à Dieu [1134]. » Une récitation touchante de textes pieux, c’est le moyen d’inculquer la discipline et la doctrine : c’est encore du discours. Mais Calvin ne saurait tolérer davantage. Le protestant O. Douen le disait sans ménagement : « Calvin, qui n’était pas musicien, proscrivait l’harmonie avec un rigorisme qui n’a peut-être pas été moins nuisible à la Réforme que le supplice de Servet [1135]. »
Et cependant Calvin était un « humaniste », un artiste du discours, qui a façonné, dans une large mesure, la langue de l’éloquence et de la vulgarisation. Mais les nécessités de la lutte partisane dévorèrent en lui l’artiste et ne laissèrent intact que le théologien polémiste. Toute sa culture s’est confinée dans un domaine : la perfection du verbe, le culte de la pensée logique, beaucoup plus que de la vie réelle [1136]. La facilité d’expression l’emporte chez lui sur la plénitude et la profondeur du contenu indéfiniment répété avec toutes les variations d’une magistrale virtuosité. Sa parole est tellement sûre, impeccable et définitive que la substance évoquée en est comme stérilisée. Pas de frange mystérieuse, pas d’arrière-plan analogique.
Le contraste est frappant entre cette pensée et la sagesse religieuse de Loyola, ouverte dans tous les sens : sur le monde divin qu’elle invite à explorer chacun pour son propre compte ; sur l’univers élargi par la vision de la Renaissance. L’impulsion optimiste de cet ancien officier illettré se révèle plus favorable au développement des sciences, à l’épanouissement d’une culture universelle, que la personnalité puissante et richement cultivée de Calvin, juriste, dialecticien, philologue et écrivain remarquable, dont le savoir unilatéral ne voyait pas de meilleur moyen d’honorer Dieu qu’en humiliant l’homme et la nature. Les épais volumes de Doumergue et de L. Wencelius ne persuaderont que des esprits déjà convaincus de la cause calviniste [1137]. Le seul fait que Calvin ait déclaré les arts « inanes, donec verbo spirituoque (sic) subjectae prorsus fuerint », vains et superflus tant qu’ils n’auraient pas été soumis à la parole et à l’esprit calvinistes, exclut d’avance la possibilité d’une esthétique, c’est-à-dire d’une philosophie autonome de l’art.
L’épithète « calvinienne » ajoute-t-elle quoi que ce soit à l’intelligence et à la valeur des créations culturelles antiques ou classiques qui ont précédé ou suivi la destinée de Calvin de plusieurs siècles ? De même Rembrandt gagne-t-il à être mis au service du renouveau calviniste [1138] ? Il n’est pas urgent d’attribuer à Calvin la perfection de l’art hollandais aussi longtemps qu’on n’aura pas établi que Genève, où son influence demeura aussi longtemps toute-puissante, eut vraiment une vie artistique et scientifique digne d’être citée en exemple. Wencelius aurait été bien inspiré d’étudier ce fait, dans son interminable « esthétique », qui n’apporte rien de neuf, sauf une collection exhaustive des termes calvinistes se rapportant aux notions de beauté, lumière, splendeur, couleur, gloire, ordre, harmonie, etc. [1139]
Qui niera la savante et élégante organisation du monde religieux rêvé par lui ? Combien d’impératifs calvinistes obéissent inconsciemment à des préoccupations de « bon ordre » esthétique ? Il a cédé, plus souvent qu’à son tour, à la fascination des belles ordonnances, des apparences brillantes sur le plan de la discipline, comme sur celui de la politique. Mais quelle raideur dans cette harmonie que le Réformateur veut imposer à tous les esprits ! La souplesse des jésuites, en tout cas, paraît jouer, à cette époque, un rôle providentiel de compensation et d’équilibre.
Le réquisitoire dressé contre eux, et qu’on voudrait accablant, serait risible s’il ne leur faisait pas trop d’honneur. « Comparons son esthétique à celle que les jésuites feront fleurir aux XVIe et XVIIe siècles. Eux ne s’embarrasseront pas de Dieu, ils le relégueront au ciel pour se donner au monde... Et ce sera l’art baroque [1140]. » Bah ! leur intention était sûrement religieuse, aussi pieuse que celle qui poussait les amis et admirateurs de Calvin dans le vandalisme iconoclaste [1141]. Ils voulaient élever l’homme tout entier vers Dieu, non seulement par le cerveau et les oreilles, mais par toutes ses facultés et toutes ses puissances spirituelles. En multipliant des églises pleines de lumières, des autels peuplés d’une décoration enthousiaste, soulignée par des perspectives ascensionnelles, ils pensaient, ce que même un agnostique du genre de Fülöp-Miller peut entrevoir, qu’il est possible d’arracher l’esprit à l’obsession de sa propre misère et de soulever l’âme vers le Divin [1142].
Mais n’en déplaise à M. Wencélius, il est inexact d’attribuer aux jésuites l’art baroque. Sans doute, ces hommes apostoliques ont cultivé des contacts avec tous les milieux influents de l’intelligence européenne et ils se sont servis de l’art de la Renaissance pour appuyer la Contre-Réforme. Mais il n’y a pas eu d’école artistique jésuite, de « style jésuite ». Leur grand architecte A. dal Pozzo fait plutôt figure d’exception dans les cadres de l’Ordre. Si beaucoup de jésuites se sont directement métamorphosés en constructeurs, c’était par nécessité, comme dans les missions ou dans des centres de second ordre. Ils n’avaient pas l’ambition de se mesurer avec les laïcs dans leur domaine. Mais il est sûr que les architectes, les peintres, les poètes, les musiciens, les hommes de théâtre et les humanistes en général, se sentaient plus à l’aise dans le voisinage de la Compagnie de Jésus qu’ils ne le seront à l’ombre de la Vénérable Compagnie de Genève.
Les jésuites ont laissé, à peu près dans tous les pays, de beaux édifices, même en Suisse. Ils s’adaptaient à la mentalité des peuples où ils travaillaient : dans l’Allemagne du Nord et en Belgique, ils continuèrent à élever des églises gothiques. Ailleurs, si l’influence italienne prévalut, ce fut peut-être, par la faute de la Réforme. Les préventions du calvinisme contre l’art religieux, accentuèrent encore le triomphe du baroque, en renversant les seuls barrages efficaces : les traditions des imagiers et des artistes régionaux. Devant le vide ainsi provoqué, l’art nouveau put déployer sa démesure, sans le frein d’une concurrence clairvoyante. Les jésuites ont favorisé l’art de leur temps : ils ne l’ont pas commandé. Dans les milieux où s’exerça l’influence ignacienne, autour des Michel-Ange, des Bernin, des Pozzo, des Rubens, des Van Dyck, leur préoccupation dominante resta le souci de la « plus grande gloire de Dieu ». Il est faux de prétendre que leurs églises donnent l’exemple d’une décoration excessive. Leurs sanctuaires manifestent, à l’origine, une sobriété et un sens de la dignité que n’offrent pas d’autres monuments de l’architecture contemporaine. Pour la même époque et le même style, à Rome, le Gesu est moins surchargé que la Chiesa nuova ; à Naples, le Gesu Nuovo n’a pas l’exubérance du S. Filippo ; à Vienne, l’église de l’Université ne s’abandonne pas à l’ivresse de certaines églises conventuelles. Le baroque inspiré par St. Michel de Munich put, sans danger d’exagération, servir à la formation du goût et de la piété de l’Allemagne méridionale [1143].
La même constatation se vérifié dans d’autres domaines. Le vieil écolier a un sens des langues plus moderne que le jeune humaniste. À quarante ans, il se met à apprendre, avec Dieu sait quelle peine, non seulement les lettres anciennes et les disciplines requises par sa formation sacerdotale, mais tout ce qu’il peut assimiler de portugais, d’italien, de français. Il n’a pas le don des langues et les mélange avec le basque et l’espagnol de son enfance, mais il pense en moderne à l’humanité réelle. La Compagnie sanctionne d’une façon spéciale le mérite des membres, qui réussissent à posséder une langue indigène particulièrement difficile [1144]. En bon philologue et légiste, Calvin ne comprend les hommes qu’en les transposant dans l’antiquité, romaine, grecque ou hébraïque, dont il croit détenir tous les secrets. En revanche, il ne connaît pas l’italien, malgré son voyage à Ferrare et l’afflux des réfugiés transalpins. Il ne cherche même pas à comprendre l’allemand qui lui a fourni les thèses fondamentales de son système. Son séjour à Strasbourg, ses voyages, ses contacts réguliers avec le monde germanique n’ont pas entamé sa mentalité de légiste français [1145].
L’idéal puritain a développé les vertus civiques. Sur le plan social, les cités protestantes, héritières de la bienfaisance ecclésiastique prirent conscience de leurs responsabilités à l’égard des pauvres, des malades. La solidarité bourgeoisiale, plus directement intéressée au bon ordre général, trouva, ici et là, pour l’assistance publique, des solutions d’autorité plus efficaces que les œuvres charitables privées. Mais la valeur de la bienfaisance ne se mesure pas seulement à la façade administrative. Quant aux mérites de Calvin en faveur de l’esprit bourgeois et démocratique, ils sont très sujets à caution. Marc-Édouard Chenevière résume son ouvrage sur la « Pensée politique de Calvin » par ces mots : « Il n’y a aucune parenté spirituelle entre la Réforme (de Calvin) et la démocratie moderne [1146]. »
Autrefois, Max Weber, E. Troeltsch, Doumergue et bien d’autres croyaient peut-être grandir Calvin en lui attribuant la paternité du capitalisme [1147]. Ce temps semble révolu : « Quand les timides principes affairistes de Calvin seront mis en pratique par les protestants d’Angleterre et d’Amérique, une sorte d’identité s’établit entre le capitalisme et le puritanisme. L’espèce de pharisaïsme satisfait du milliardaire philanthrope est un fils bâtard du calvinisme [1148]. » Loyola n’a rien renié de l’estime traditionnelle dans l’Église pour la pauvreté volontaire. Mais il ne renonce pas pour autant à son sens pratique. Il entreprend, avec une confiance illimitée dans la Providence, les constructions les plus audacieuses, presque à crédit, comme ce fut le cas pour le Collège Romain et bien d’autres fondations, cependant que son réalisme mobilise tous les moyens d’influence, tous les dons et toutes les initiatives de ses compagnons. Personnellement ou par ses amis, il intervient « partout où le prochain réclame un secours corporel ou spirituel » : réglementation de la mendicité, canalisation des secours en période de disette, création d’orphelinats, de refuges pour filles tombées, etc. Par plus d’un côté, Loyola devance son époque [1149].
Le succès de Loyola et de ses disciples a été jugé équitablement par le luthérien F. Paulsen : « Où résidait le secret de leur force ? Dans le fait que ces hommes incarnaient la méchanceté, comme l’imagine Ranmeyr ? Parce qu’ils exploitaient avec plus de ruse et moins de scrupule que les autres la crédulité des masses, l’impuissance et l’ignorance des gouvernements en face de la révolution ? Il me semble que c’est attribuer à la ruse et à la méchanceté plus de pouvoir qu’elles n’en ont. Le mensonge et la malice ne sont pas des forces qui créent une communauté, et où y a-t-il eu une société plus fortement unie que la Compagnie de Jésus ? La malice et le mensonge ne sont pas des moyens par lesquels on obtient une influence durable sur les hommes. Selon un ancien proverbe, le plus fort est celui qui triomphe de lui-même. La plus grande efficacité rayonne de celui qui possède la plus forte domination de soi. Or, je crois qu’il n’y a jamais eu une société d’hommes qui ait poussé plus loin que les jésuites la maîtrise sur les instincts de la nature, le sacrifice des penchants et des aspirations individuelles. De grandes individualités n’apparaissent pas dans l’histoire de l’Ordre. Il offre peu de matière à la poésie. Mais il possède toujours un grand nombre de forces dignes de confiance et d’une efficacité certaine. Il agit en quelque sorte à la manière silencieuse et irrésistible des forces de la nature. Sans passion, sans bruit de guerre, sans exaltation ni précipitation, il avance pas à pas, sans devoir presque jamais revenir en arrière. Sécurité et supériorité caractérisent chacun de ses mouvements. Certes, ce ne sont pas là des qualités qui rendent aimables. Aimable, personne ne peut l’être sans faiblesse humaine. Une absence absolue de passion a quelque chose d’inquiétant et de redoutable... Mais d’où venait cette force ? Je crois que finalement elle ne peut venir que d’une grande Idée et non pas de convoitises égoïstes. Celles-ci dissolvent, celle-là seule est capable de durée. L’idée qui pénétrait tous les membres de l’Ordre, leur faisait étouffer toutes les passions individuelles et les remplissait d’un grand enthousiasme, était la suivante : que l’Ordre était l’instrument choisi pour sauver l’Église de Dieu [1150]. »
L’élan qui soulève le parti réformé, ou du moins une certaine élite puritaine, participe à la même conviction, au besoin d’accomplir une mission indispensable. Nous laisserons à d’autres le soin de dire si ce fut avec « des passions et des faiblesses qui les rendaient aimables ». Le culte de la Bible fut la grande Idée ou vocation protestante. L’Écriture fut propagée et commentée avec une ferveur passionnée, mais aussi avec l’illusion qu’on venait de la découvrir pour la première fois. Cet aveuglement diminue l’originalité des « ministres de l’Évangile ». Ils étaient souvent moins soucieux de pénétration et d’exactitude que de changement extérieur. La cause de la Bible a-t-elle progressé au cours de cette longue tourmente ? Il serait juste d’en finir avec ces légendes hostiles de la Bible cachée, condamnée, « enchaînée » par l’Église. « Bien avant la Réforme et même bien avant la découverte de l’imprimerie, l’Église a, dès l’origine et sans interruption, conservé l’Écriture ; elle a toujours encouragé ceux qui en multipliaient les manuscrits ou les commentaires... C’est grâce à l’Église que nous avons la Bible ; sans elle nous ne l’aurions pas [1151]. » Calvin croit incarner la Bible ; Loyola ne veut que servir l’Église.
_______
CONCLUSION
I
LA GRANDEUR DE CALVIN
Notre parallèle n’a pu aboutir, hélas, qu’à une frange de points de contact entre lesquels un abîme reste ouvert. Pour avoir marqué cette cassure quasi insurmontable qui se retrouve dans tous les domaines, on nous accusera d’être négatif et d’ignorer délibérément les mérites de Calvin. S’il ne s’agissait que d’une grandeur profane, nous serions, au contraire, le premier à la lui accorder pleine et entière. Mais nous n’étudions pas la supériorité incontestable de l’homme d’État, du théologien, du penseur, de l’écrivain. Nous comparons l’une à l’autre deux réformes religieuses, donc deux vies intérieures, deux types de spiritualité.
Malgré toute la dignité et la valeur des discussions d’idées, nous pensons que l’examen le plus instructif doit porter de préférence sur les tendances concrètes des mouvements confessionnels. Comme le disait naguère un sagace observateur de l’esprit du protestantisme, « ce ne sont pas le dogme catholique et le dogme luthérien ou calviniste qui s’affrontent aujourd’hui. Que reste-t-il du dogme luthérien ou calviniste ? Ce sont d’une part le dogme catholique... et d’autre part la tendance (protestante) avec l’infinité des “évangiles” contradictoires qu’elle pourra successivement annoncer au monde [1152] ». La mentalité de Loyola va dans le sens du développement historique de l’Église et ne tend qu’à vivre, aussi pleinement que possible, toutes les exigences de l’esprit catholique traditionnel. La tendance de Calvin s’efforce, en sens contraire, de rejoindre un christianisme primitif, régressif et agressif, qui a besoin de s’opposer pour s’affirmer.
Sans doute, les deux réformateurs ont voulu globalement les mêmes choses. Ils ont cru mener le bon combat et ont lutté sans relâche et sans merci pour ce qu’ils regardaient comme le Règne de Dieu, la véritable Église, le salut des âmes. Ils ont poursuivi un idéal authentique de vie religieuse. Ils ont essayé de le pratiquer, avec des chances diverses, sans tolérer aucune concession à ce qui leur paraissait indigne de la majesté de Dieu. À cette cause sainte, ils ont tout subordonné, tout sacrifié même, avec une logique inflexible, avec un esprit de suite que rien ne pouvait faire dévier. Telle est la parenté profonde de ces deux hommes, mais telle est aussi la cause de leur éloignement. Avec des convictions, même peu divergentes, qu’ils poussent jusqu’au bout, jusqu’à leurs plus lointaines applications, ils ne cesseront jamais de s’écarter toujours plus l’un de l’autre.
La formation de Calvin avait été hâtive et ses préoccupations sont restées celles d’un légiste converti, d’un rationaliste et d’un dialecticien, d’un redresseur de torts qui pense tout en fonction de l’ordre public. Dans sa ferveur juvénile, il n’avait d’ailleurs guère connu autre chose : une hiérarchie qui se perdait dans l’affairisme, dans les disputes verbales, dans l’agitation d’une piété toute extérieure. Il fut naturellement tenté d’établir sa réforme sur ce terrain peu profond, et il ambitionna, avec Dieu sait quel zèle, de ramener à l’ordre absolu ces affaires, ces institutions ecclésiastiques, cette doctrine et cette discipline lamentables.
Fort de la vocation que donnent les circonstances, le génie et l’appui des plus audacieux, Calvin se croit vite responsable en conscience de toute la cité de Dieu. Il la trouve presque noyée dans la politique de ce monde. Il compte la sauver en faisant une meilleure politique, en s’appuyant sur une police qu’il cherche vainement à rendre divine. Héros douloureux, il croit que ses ennemis le déchirent, alors qu’il est surtout écartelé intérieurement par des aspirations contradictoires, incapables de changer le cœur de l’homme. Ses intentions abstraites sont toujours élevées, ennoblies par le discours d’une intelligence trop rapide. Son assurance et sa confiance en Dieu sont à l’abri de toute hésitation.
Immunisé par sa mission providentielle, Calvin ne s’arrête pas à examiner ses affections plus secrètes où se joue pourtant la partie du bon ou du mauvais esprit. Il ne mise plus – et c’est le côté grandiose de cette aventure prophétique – qu’avec des moyens de réforme empruntés a priori à une certaine inspiration théologique, transcendante, avec laquelle ni lui ni personne ne peut transiger.
Il jette franchement dans la balance de « l’honneur et du service de Dieu » tout le poids de ses facultés géniales. Il croit ne rien y soustraire pour lui-même. Comme il a reçu à peu près tous les dons, à l’exception de la charité, les plans qu’il développe, les solutions qu’il préconise semblent s’imposer tout naturellement. Son esprit a l’air de saisir d’un coup le fond des problèmes et son verbe magistral, qui simplifie et amplifie tout, propose une substance abondante et solide. Aucune négligence dans cette argumentation, aucun laisser-aller, aucune difficulté imprévue. Les collaborateurs proches ou lointains, les correspondants, sont débordés par ce fleuve de suggestions, de raisonnements, par cet enchaînement d’initiatives aussitôt réalisées que conçues. Pour échapper à son emprise, il aurait fallu tarir ce jaillissement de paroles et d’œuvres multiples capables d’absorber dix existences. Il est partout présent, partout agissant. Dès ses premières rencontres avec les pionniers de la Réforme, sa vivacité et sa clairvoyance emportent la décision : il a déjà conclu que ses interlocuteurs sont encore embarrassés dans les préambules du débat.
Il a une réponse et un remède à tout. Il n’a pas plus tôt entrevu un obstacle qu’il l’a déjà tourné ou renversé. Dans les crises de la petite cité ou du vaste mouvement réformé, ses interventions précèdent tout le monde et surprennent par leur habileté autant que par leur vitesse. Ses doctrines séduisent par leur netteté et leur vigueur, ses écrits par leur élégante structure. À peine quelques points mystérieux, au centre du système, évoquent d’insondables profondeurs devant lesquelles le réformateur s’incline en interdisant tout commentaire et toute discussion superflus.
À suivre ce surhomme, deux sentiments également exaltants soutiennent le disciple : celui d’avancer par des chemins inconnus avec une audace souveraine, et celui de ne rien risquer quand même, tant son assurance est invincible. Le moi public de Calvin, celui qui occupe tout le devant de la scène, celui dont il a habituellement conscience, fait bien l’impression que signale Bèze, d’une majesté intimidante. Ascendant et autorité naturelle qui disposent à son gré des comparses, exaspérés autant par cette grandeur qui les dépasse que par le pressentiment d’une dangereuse fascination. Le moi intérieur de Calvin, en effet, contraste avec les belles déclarations et les nobles attitudes. Jusque dans l’action généreuse du prophète qui commande aux assemblées et aux conseils, percent les fausses notes d’un caractère étroit et toutes les misères d’une pauvre âme tourmentée.
Ainsi, pour une légère fissure intérieure, invisible à la base du système, pour un manque de charité et d’humilité élémentaire, la plus grandiose construction se trouve compromise. Calvin est le modèle le plus éclatant d’un triomphal échec, dû non pas à l’absence des moyens, mais au contraire, au déséquilibre entre une surabondance de dons et de forces disponibles et la pauvreté de la mystique destinée à les soutenir. Cet homme est prudent comme personne, austère et d’une endurance indéniable. Il est intègre et pieux, il se dépense fiévreusement au service de ses amis et des pauvres fidèles qui accourent à lui des quatre coins de l’Europe. Il se tue au travail de la prédication, de l’étude, de la composition, du ministère ecclésiastique, de l’organisation de la cité et de toute la Réforme. On lui attribuerait presque une foi capable de transporter des montagnes. Et cependant, tous ces efforts surhumains, faute d’amour chaleureux et universel, répandent plus d’ombres que de lumières ; ils inspirent plus d’inquiétude et de crainte que de confiance.
*
* *
Sans prétendre faire le bilan complet de ces deux réformes, – il y faudrait une comparaison approfondie des théologies proprement dites – arrêtons-nous sur quelques résultats.
Avec un brin de malice, nous dirions volontiers que Calvin a bien mérité de l’Église catholique elle-même. Car, c’est bien un peu par réaction, au contact agressif de Luther et de Calvin, qu’elle a dû mieux distinguer entre l’essentiel et l’accessoire ; entre les surcharges et les valeurs fondamentales ; entre le spirituel et le temporel ; entre la vie intérieure et les moyens d’expression du surnaturel ; entre les pratiques facultatives, les dévotions privées, les gestes conventionnels et l’unique chose nécessaire : le Règne de Dieu. En face d’une véritable révolution qui séduisait le grand nombre en réclamant, à grands cris, la pureté de la doctrine et des mœurs, le sérieux et la simplicité de la foi, le bon ordre des consciences et de la cité, – les prélats les plus assoupis devaient se réveiller. Par contrecoup, la dogmatique catholique s’est ressaisie. Il ne lui fut pas inutile de refaire l’inventaire de ses vraies richesses et de reprendre le chemin des sources. Le cardinal Baudrillart note cet apport de l’influence réformée sur l’évolution du catholicisme : « Les excès et les écarts doctrinaux de Calvin, comme ceux de Luther, ont amené l’Église catholique à affirmer et à préciser son enseignement sur les points fondamentaux du dogme chrétien [1153]. » Doumergue lui-même attribue généreusement au seul protestantisme tout le mérite du relèvement religieux et moral du clergé et de la hiérarchie catholiques [1154].
Calvin a également bien mérité de l’Évangélisme. De même qu’après avoir supplanté la Révolution, l’Empire doit s’effacer, comme une simple phase transitoire dans le développement des idées révolutionnaires ; ainsi la dictature religieuse calviniste se contente de sauver l’Évangélisme de la décomposition et de permettre à cette religion mort-née de se survivre sous une forme un peu différente, plus rigide, mais aussi plus combative, plus conquérante. Seul, l’Évangélisme aurait difficilement résisté aux parlements, à la police royale, à la réaction des autorités religieuses. Il aurait surtout été bien faible contre sa propre fantaisie individualiste, contre l’incohérence et surtout contre l’influence de courants spirituels très profonds qui militaient en faveur de la Tradition. Calvin empêche la Réforme française de se perdre dans le sable de la tolérance ou de la prudence « nicodémite ».
Avant Calvin, on dénonçait bien (mais avec quelles chances de succès ?) une piété superficielle ou formaliste, qui préférait la Légende Dorée à l’Évangile, les cérémonies à l’adoration de Dieu en esprit et en vérité. On gémissait bien, mais avec trop de résignation, contre la nécessité de cheminer dans la forêt obscure des règlements, des canons, des privilèges, des indulgences, des prestations, des redevances, des bénéfices. Calvin donne aux mécontents et aux inquiets l’impression d’ouvrir une allée toute droite vers le décalogue et la simplicité de la loi naturelle. Avec une vie sacramentelle réduite à sa plus simple expression, avec une liturgie et un clergé dépouillés de toute pompe extérieure, avec des dogmes éclatants de netteté et de hauteur, il réalise ce qui semblait impossible : accréditer une foi exclusivement basée sur la Bible ; un culte uniquement centré sur la prédication de cette Bible ; une morale et une discipline ecclésiastique soi-disant dictée littéralement par cette seule Bible. Et toute une partie de la chrétienté accepte cette rééducation radicale et sévère. Tout n’est pas conforme à la Bible dans ce système. Mais une fois la curiosité scripturaire déclenchée, l’exégèse indépendante trouvera son chemin. La revanche du libre-examen aura son heure.
Et par là, Calvin aura aussi bien mérité de la Réforme en général. Calvin réussit là où Luther, Zwingli, Bucer et Farel avaient presque échoué. Car il est vraisemblable que, sans l’exemple de Genève, les autres confessions chrétiennes auraient difficilement évité la désagrégation ou l’absorption par le catholicisme. Le redressement de la situation internationale est déjà extraordinaire. Mais plus extraordinaire encore peut-être la métamorphose intérieure de la mentalité chrétienne. Calvin a donné un visage au protestantisme. Il a créé un type religieux bien original qui figure avec honneur dans beaucoup de pages glorieuses de l’histoire. Inspiré de son exemple et surtout de son système religieux, le puritain témoigne de la vitalité de certaines idées chrétiennes fondamentales, même isolées, une fois qu’elles sont vraiment prises au sérieux. Et c’est non seulement au sérieux, mais souvent au tragique, que le puritain prend son ensemble d’obligations strictes, nettement délimitées, facilement reconnaissables : un idéal austère, pratique, le même pour tous, accessible à chacun... à condition de fournir les signes de la prédestination.
Le réformateur a su diffuser sur le monde protestant une atmosphère de gravité et inspirer des attitudes morales d’une belle correction. Comme instrument de formation civique, de fidélité au pouvoir, de conscience publique, le légalisme puritain fait merveille. De cette piété toute raisonnable, si moralisante qu’elle n’est presque plus qu’une prédication, émanent la force et la certitude : l’attachement à la vocation entendue comme devoir d’état et sens des responsabilités professionnelles ; enfin, par voie de conséquence, une ardeur au travail presque désespérée [1155]. De cette ténacité il ne faut pas s’étonner : noblesse oblige. La fierté, le sentiment d’une supériorité un tantinet pharisaïque, la dignité : ce sont là de vigoureux stimulants à l’action et au prosélytisme. Le calvinisme a charmé la Réforme, qui ne savait pas encore ce qu’elle était, par une foi aux allures souveraines, par une clarté simplificatrice voisine du naturalisme et du rationalisme. Des formules sublimes transfigurent des applications commodes ; sans trop de piété, le commun des mortels peut se ranger parmi l’élite. Malgré le corset du cléricalisme genevois, nécessaire à sa croissance, le puritanisme est déjà, aux trois quarts, une religion laïque. Il n’y a pas de raison pour qu’il n’évolue pas dans le sens d’une autonomie toujours plus accusée. Du puritain dérivent, pour une bonne part, l’honnête homme, le bourgeois qui se suffit à lui-même, le gentleman et, peut-être aussi, mais seulement après une longue incubation anglo-saxonne, le fair play. Faut-il ajouter que ces dérivés, Calvin ne les a pas connus.
La personnalité de Calvin est soulevée par un zèle ardent des âmes [1156]. Ce qui frappe par-dessus tout, c’est « le sérieux tragique avec lequel il envisagea toujours sa vocation. Cette vocation, il la tient de Dieu ; c’est chez lui une conviction inébranlable, l’expérience fondamentale de sa vie... “J’ai bien occasion de me contenter de servir à un si bon Maître qui m’a accepté et retenu dans sa maison (plutôt que d’ambitionner les honneurs de la cour)... Je serais trop ingrat si je ne préférais cette condition à toutes les richesses et honneurs du monde.” »
Personne n’a pris son ministère plus au sérieux que lui ; il s’y donne tout entier. « Dieu s’est servi de moi jusqu’ici, et l’espérance n’est pas perdue qu’il s’en serve à l’avenir. Mon labeur a profité et profite encore aujourd’hui beaucoup à l’Église de Dieu [1157]. »
On ne s’attarde pas assez à l’analyse psychologique de la confiance qui animait ce travailleur infatigable, ce lutteur malade, écrasé de tant de besognes qu’il en était presque « dégoûté de la vie »... Tout disposé que nous pouvons être à croire que « la personnalité d’un homme est un tout complexe, où se concilient, quand elles ne se heurtent pas, les oppositions les plus accentuées », nous ne saisissons pas bien comment « Calvin était humble en dehors des cas où la doctrine était menacée. » Car la doctrine et la discipline, pour lui, étaient toujours menacées. Tout pouvait, à ses yeux de dialecticien, prendre une valeur doctrinale. Alors, pour un rien, il « se durcissait jusqu’à en devenir ombrageux et violent, fanatique même... Orgueil, je l’accorde, orgueil d’un homme qui a confiance dans la loyauté et le bon sens de son exégèse, sans que jamais aucun doute l’effleure, orgueil du moins fait de conviction absolue et de sérieux tragique [1158] ».
« Calvin fut passionné pour Dieu », nous répète le professeur Benoît, passionné pour sa propre cause que son orgueil fut d’identifier avec celle même de Dieu. Mais a-t-on jamais, sans passion, fait quelque chose de grand ? Calvin se savait ici-bas le défenseur de l’honneur de Dieu, le champion de ses victoires. La grande parole qu’il écrivait à Liner était bien l’inspiration de sa propre vie : « Faites que Dieu soit le plus fort ! » – S’il avait pu dire tout simplement : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts », la formule n’aurait pas été plus vraie, mais elle aurait eu l’avantage de ne pas être ambiguë. La mode était, à cette époque, aux slogans théologiques si propres à semer l’équivoque et capables d’édifier, mais aussi de démolir, de grandes choses.
De quelque côté qu’on l’aborde, même avec l’immense bonne volonté du professeur strasbourgeois, le psychisme tourmenté de Calvin apparaît toujours en équilibre instable. Le sérieux de la vocation, le zèle, la confiance, l’amour de la vérité qui semblent constituer le métal de cette destinée, ne se présentent nulle part purs d’alliage. Puissante coulée révolutionnaire, le calvinisme put bien rendre à la chrétienté le sens tragique de la foi, mais est-il destiné à lui faire retrouver son centre de gravité, son caractère essentiel ?...
Calvin a trop exclusivement connu l’envers du catholicisme. Au lieu de s’intéresser au renouveau de la spiritualité partout visible, il concentre son attention sur l’extérieur. Ignorant le cœur de l’Église, il en critique le revêtement juridique et conventionnel. Mais – paradoxe involontaire – ce qu’il retient et adapte à son système théologique, c’est justement les institutions qui semblaient périmées, l’excommunication, l’inquisition, la censure, le cléricalisme, c’est-à-dire tout l’appareil de contrainte extérieure que l’humanisme s’appliquait à desserrer et à transformer. Bien des formes archaïques de la mentalité chrétienne, comme la hantise du démon et de la sorcellerie, ont pris un regain de ferveur dans tout le monde chrétien, grâce à l’intervention du réformateur. La discipline, la liturgie, l’enseignement religieux se sont raidis, même dans l’Église catholique, sous l’influence indirecte de Genève.
Mais est-il besoin de rappeler encore le mal que Calvin a fait à l’Église ? Sans parler du recul des frontières du catholicisme, comment oublier qu’à force de combattre avec trop d’acharnement les abus de gauche (la licence, la piété naïve, les scandales de la spontanéité), il finit par déterminer une poussée exagérée vers la droite. Le concile de Trente lui-même ne subit-il pas, avec ses anathèmes, cette orientation défensive ? Bien des formules et des institutions, bien des usages et des méthodes se sont figés et n’ont malheureusement plus varié depuis le XVIe siècle. De cette lutte à outrance, non seulement la hiérarchie est sortie renforcée, mais, avec l’autorité, se développent la centralisation, la bureaucratie et le curialisme romains. Les attaques de Calvin et la riposte de Loyola établissent la papauté et l’Église toujours plus solidement sur le monde latin. Le catholicisme devient plus romain ; il risque parfois de s’italianiser et à certaines époques la politique du Saint-Siège s’« embourbonne », si l’on nous permet de caractériser ainsi le milieu du XVIIIe siècle.
La Réforme, galvanisée par Calvin, augmente la tension entre le monde méditerranéen et le monde nordique, présageant le divorce moderne entre la culture humaniste et spirituelle, d’une part, et la culture matérielle et technique, d’autre part. Le ralentissement des échanges entre les deux parties de la chrétienté empêche la naissance d’une civilisation commune. Les cadres réformés par Calvin étaient trop étroits et trop précipités. De la substance du christianisme, il abstrait quelques grandes idées-forces et il néglige, non seulement la folie de la croix, la mystique, mais des nuances précieuses du sentiment religieux et spécialement le sens du mystère, du sacré.
II
L’HUMBLE SERVICE DE LOYOLA
La réforme de Loyola ne touche pas à la structure de l’Église. Homme d’expérience et d’expérimentation [1159], personnage de transition qui vit de la pensée médiévale et prévoit les besoins les plus modernes de la société, le fondateur de la Compagnie n’envisage pas l’apostolat et la civilisation comme deux objectifs séparés. Il n’y a qu’un Règne de Dieu, une Église très réelle et visible, « aussi réelle et visible, dira le jésuite Bellarmin, que la république de Venise ».
Il ne rêve même pas de sauver le christianisme, la religion, la cité chrétienne ou n’importe quel idéal trop abstrait, mais seulement de servir les réalités existantes, « ayudar las animas », aider les âmes de bonne volonté à se retrouver, à donner le meilleur d’elles-mêmes, en tenant respectueusement compte de tout ce que les autres ont déjà entrepris avant lui. Avant d’imprimer les Exercices, cette sèche grammaire de la spiritualité, Ignace consulta aussi d’autres livres, nous assure le confident Nadal, et il demanda les conseils de la théologie dans toute son étendue. « Il lui fallait la confirmation de tous les livres, de tous les théologiens et de toute l’Écriture [1160]. »
Dans sa modestie, il se défend, même avec l’inspiration du Saint Esprit, de rien innover qui ne présente des garanties de durée. Il s’appuie donc sur la vie sacramentelle et sur l’ordre hiérarchique, sur la tradition. Ses initiatives cependant, déterminèrent très efficacement la réorganisation des forces catholiques. Considérable fut particulièrement l’influence de ce « Père Maître » de l’Église moderne dans l’établissement des noviciats et des séminaires, dans l’introduction de programmes d’exercices spirituels, de méditations, etc., pour le clergé et les religieux ; dans la formation des élites, dans le renouveau des études, des sciences ecclésiastiques et profanes. La Compagnie de Loyola contribue à stabiliser non seulement le front extérieur de la catholicité, mais plus encore peut-être les formes intérieures de la piété catholique. Rôle plus providentiel à une époque où tout semblait se défaire qu’à d’autres moments de l’histoire où la fixité pourrait constituer un écueil.
Les idées religieuses de Calvin, une fois débarrassées de leur écorce blessante, valent mieux que les applications qu’il en a faites. En revanche, l’exemple vécu de Loyola vaut parfois mieux que certaines des formules qu’on lui prête. Nous ne vivons plus dans un siècle où les Pic de la Mirandole sont pris tout à fait au sérieux. Nous savons que le plus grand génie peut être unilatéral : Calvin le fut autant qu’un révolté peut l’être. L’hagiographie, d’autre part, nous a familiarisés avec le côté humain, voire trop humain des bienheureux et des saints. La canonisation ne supprime pas le fait que Loyola fut un homme. Mais ses imperfections, la plupart du temps involontaires, n’ont pas fermé son cour, qui demeure, en dépit de tout, compréhensif, parce que modeste et défiant de lui. Ses naïvetés, ses tâtonnements, ses lenteurs suggèrent le contraire d’un esprit buté. Les aberrations de Calvin, en revanche, frappent par leur étroitesse ; car, avec ses prétentions de savoir universel, il refuse d’aller au delà des points de vue bornés dans lesquels il s’emprisonne. De ses « erreurs », qu’il reçoit de son milieu, comme un vêtement superficiel, Loyola serait prêt à se libérer s’il était mieux informé. Ignorances excusables, routine de la pensée collective.
Calvin est bien plus enchaîné à ses formules, à sa méthode. Ses outrances expriment son moi profond, avec une véhémence telle qu’on lui arracherait l’âme en détachant une seule pièce de son système. Au sein du parti réformé, ce prophète qui ne dépend de personne, qui ne doute jamais de lui-même, toujours malade et occupé à mille entreprises de propagande, se dresse avec toute la grandeur et la force sombre d’un génie surhumain. On sait bien que ce n’est pas un ange. Mais on se demande parfois quel esprit l’agite et lui assure ses terribles triomphes.
À la culture variée qu’il a puisée dans une Renaissance encore catholique, Calvin préfère un art de discussion emprunté à un autre âge : la dialectique. Et c’est justement à la matière la plus délicate, la plus subtile, au sentiment religieux, qu’il applique cet art plein de rudesse. Il en résulte, dans le calvinisme, une propension à la dispute, un zèle pour la polémique infatigable. La réforme calviniste ne prévient les dissensions que par la mobilisation des esprits contre l’ennemi extérieur. Elle en inventerait presque, s’il n’y en avait plus. Érigée en unique « parti de Dieu », elle maintient davantage sa cohésion et son orthodoxie par réaction que par conviction intime. La protestation et l’animosité partisane excitée plus ou moins artificiellement ne constituent encore qu’une unanimité négative. La critique est aisée ; un parti de mécontents a plus vite fait d’opposer l’idéal à la réalité de l’Église que d’en construire une qui s’impose et qui dure. Que reste-t-il du système calviniste proprement dit ? Une méthode conceptuelle, un « outillage mental » qui ne satisfaisait déjà plus « du temps des hauts bonnets ». Et si son génie réussit à en prolonger l’usage au delà de son époque, ce n’en est pas moins une relique gênante pour un mouvement révolutionnaire [1161]. Que reste-t-il encore ? – Un parti d’opposition, peut-être aussi providentiel dans la chrétienté qu’une majorité ultraconservatrice ?
Loyola n’est pas seulement un catholique « conservateur ». Il est progressiste à la manière des saints. Son action est solidement positive. Son influence ne gagne en étendue que dans la mesure où elle travaille en profondeur. Le protestant Th. Schoell conclut le parallèle Castellion-Calvin du pasteur E. Giran par cette réflexion : « On assistera à une véritable résurrection de Castellion, et, si Calvin s’en trouve amoindri, le vrai sentiment religieux n’en souffrira pas [1162]. » Castellion et Loyola présentent beaucoup de tendances pareilles. La résistance inégale du premier au réformateur de Genève semble se prolonger dans l’œuvre du second : la Compagnie de Jésus continue à mettre l’accent sur la vie intérieure, sur l’imitation de Jésus-Christ, sur le rôle de la liberté, sur la dignité naturelle de l’homme, sur l’humanisme chrétien. Comme Castellion, Loyola attribue une importance primordiale à la pénétration toute personnelle des idées évangéliques [1163]. Seuls, la contemplation, la garde du cœur, le « discernement des esprits », peuvent assurer une expérience religieuse authentique. Et plus que chez Castellion, pour Loyola, la charité prime tout. Pour que ce service du prochain soit plus efficace, il le veut lucide, clairvoyant. C’est la discreta caritas, la délicatesse de l’amour, qui se paie d’un prix élevé.
*
* *
Quels que soient les qualités et mérites respectifs des hommes, la question la plus importante reste de savoir de quel côté se trouve le vrai. Le caractère assez peu sympathique de Calvin ne serait pas une excuse suffisante pour rejeter son système s’il était l’expression adéquate de la réalité. Réciproquement, il faudrait abandonner la sagesse de Loyola au domaine des souvenirs historiques si, malgré l’héroïsme de sa sainteté, sa perfection humaine et sa vie intérieure ne reposaient pas sur des principes justes.
Nous avons déjà entrevu comment, dans la théologie du réformateur, s’opère une transposition de sa psychologie. De nos deux théologiens, le plus objectif n’est pas le plus intellectuel. On ne saurait trouver à redire qu’une spiritualité fût personnelle. Mais, dans le cas de Calvin, le subjectif, l’égocentrisme va fort loin. Les grands thèmes qui inspirent nos deux réformateurs semblent souvent pareils, puisés aux mêmes aspirations ambiantes de leur époque et à la formation parisienne commune. Ils ne parlent, l’un et l’autre, que de la gloire et de l’honneur de la divine Majesté ; du vouloir de Dieu ; de sa Providence et de l’abandon ; de l’élection, de la vocation et de la réforme ; de la discipline, de l’obéissance ; du règne de Dieu et de l’Évangile ; du service et du zèle des âmes... Mais quelles notions et quelles attitudes presque opposées recouvrent les mêmes formules ! En affirmant la même transcendance et immanence du Verbe incarné, l’un s’oublie fréquemment jusqu’à s’identifier avec la Parole de Dieu ; l’autre se perd dans la joie d’une « humilité et d’un respect toujours plus aimants [1164] ».
Chacun exploite à sa manière les valeurs religieuses héritées du christianisme, avec des moyens de connaissance et des techniques spirituelles qui n’ont rien de commun. L’un dispute jusque dans la prédication et la prière. L’autre prie au cours même de la conversation. Calvin a la dialectique, méthode magistrale, dans tous les sens du mot, effort intrépide qui ramène tous les éléments de la révélation à une synthèse dessinée d’avance. Elle présente aujourd’hui son expression la plus parfaite, mais aussi la plus forcée, dans l’ouvre de la « dialektische Théologie » barthienne. La connaissance religieuse de Loyola est bien plus lente et plus attentive ; c’est le « discernement des esprits » : introspection analytique, intuition réflexive des rapports vivants, établis par la grâce, entre l’âme et le monde surnaturel. Non seulement ce « discernement » enrichit la spiritualité, éclairant d’un jour nouveau la « théologie ascétique et mystique », mais surtout procure une réforme active et profonde de la conscience chrétienne. Ici théologie veut dire sagesse des saints.
« Il importe beaucoup, dit Loyola dans ses Règles, de s’offrir généreusement pour les tâches dans lesquelles l’humilité et la charité s’exercent davantage... »
*
* *
Le lecteur qui nous a suivis jusqu’ici, se demandera peut-être comment il serait possible de concevoir, sinon une réconciliation, du moins un rapprochement entre ces deux esprits si opposés.
Dans le monde paganisé du XXe siècle, le moment semble venu de faire des avances mutuelles, d’oser quelques pas les uns au-devant des autres. Au moins sur le plan de la connaissance. Malgré les apparences parfois négatives de ce travail, ou plutôt, malgré les données déplaisantes qu’il ne pouvait taire, nous avons sincèrement cherché à comprendre et à estimer, comme il se devait, Calvin et Loyola.
La Réforme de Calvin nous oblige à constater, dans une lumière très crue, l’importance de la question de la foi. Au XVIe siècle, les chrétiens les meilleurs prisaient ce bien inestimable au-dessus de tout. Pour la foi, tout fut sacrifié : patrie, fortune, vie, et même l’existence de la société chrétienne. Des esprits remarquables, parmi les plus grands, n’ont pas hésité à bouleverser la face du monde pour sauver ce qu’on se représentait comme la vraie religion. Mais avec Vinet, il faut aussi accepter l’évidence que « la Réforme est encore à faire et qu’elle sera toujours à refaire ».
La Réforme de Loyola nous rappelle que la charité est la valeur la plus indispensable. Car, après l’incendie des guerres de religion et de celles qui s’ensuivirent, l’aboutissement final est désolant : « La foi s’est beaucoup refroidie dans le monde. » Et sa chaude lumière ne se rallumera qu’au contact de la bonté.
_______
ÉCRITURE DE LOYOLA : LE GÉNIE DE LA PATIENCE
(La profession dit général, 1541. Lettre de direction.)
Tout sent l’application, le souci de l’ordre et de la clarté. Une maîtrise constante de soi, un détachement souverain des impressions futiles. Tout respire l’équilibre, l’énergie, le don de soi, l’amour de la chose parfaite.
APPENDICE
UN PEU DE GRAPHOLOGIE
Les documents iconographiques concernant Calvin et Loyola ne nous apportent que de maigres renseignements sur leur caractère. À défaut de portraits plus fidèles, nous avons pensé que le lecteur s’intéresserait à un examen graphologique sérieux des manuscrits de nos deux réformateurs. Nous avons donc réuni des photocopies de leurs écritures, en prenant bien soin d’écarter toutes les données historiques qui auraient pu amener une identification trop facile des personnages. Ces documents anonymes simplement numérotés furent confiés à une graphologue non prévenue, très douée, Me Olga Eberle (Zurich-Montagnola), dont nous traduisons les conclusions remarquables de lucidité. Notons que cette spécialiste n’est pas catholique. Sans connaître les auteurs des écritures analysées, elle fait les déclarations suivantes qui nous semblent résumer assez adéquatement les impressions générales de notre étude psychologique.
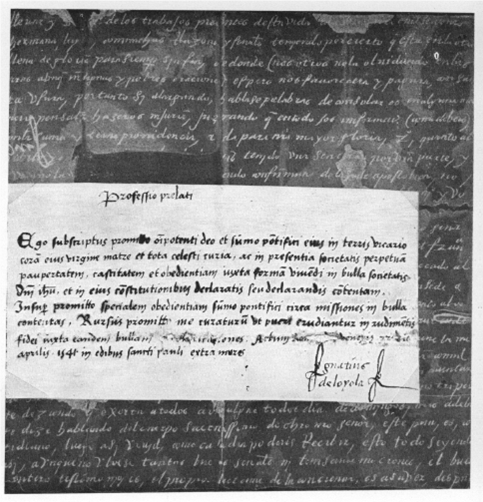
« La première constatation immédiate, c’est que l’auteur doit suivre un appel. Tout ici tend au détachement de la terre et tout indique que l’auteur atteindra son but suprême. Une force de concentration énorme s’y manifeste et il est visible que cet homme pourra se donner à sa tache jusqu’à l’oubli de soi. De plus, une tendance ascétique est nettement sensible. Celle-ci facilitera encore davantage sa fidélité à suivre sa voix intérieure. Cependant, cet homme éprouve un insatiable désir qui le pousse à la plus haute perfection. Il n’y a donc en lui aucun danger d’étroitesse. La disposition spirituelle et psychique (das Geistig-Psychische) de cet homme évoque un saint qui est prêt à accepter tout calice, du moment qu’il est convaincu que cela doit être. Il ne connaît pas la crainte : âme vigoureuse dont émane un rayonnement extraordinaire. Il va son chemin, tout seul, loin du monde. Sa mentalité révèle l’ermite. À vrai dire, sa place n’est plus parmi les hommes ; et cependant, il les aime par-dessus tout et il se fait leur serviteur. Il prend héroïquement sur lui sa souffrance, et cependant travaille beaucoup à l’œuvre de sa vie. L’intelligence, les talents, la largeur de vue sont loin au-dessus de l’ordinaire et caractérisent un homme béni de Dieu. Il se donne simplement comme le serviteur d’une mission, d’un appel dont il subit l’attirance. Il a déjà conquis non seulement la clarté, mais la transparence. Il ne veut aucune facilité pour lui-même et il s’impose de grands devoirs.
On a vraiment affaire ici à une rare personnalité, douée, pour ce qui regarde le but de sa vie, d’une force constructive supérieure. Ici, tout tourne autour d’une grande idée : devenir et s’effacer (Werden und Vergehen). Mais ici, il n’est pas question seulement de philosophie, mais de travail et de mise en œuvre. Grande maîtrise de soi, sobriété, oubli de soi, sont les signes de cette écriture. Il apparaît dressé en face du monde et le domine de haut. Il aime la solitude par-dessus tout et se consacre uniquement à sa tâche. Un sens artistique profond lui fait aimer les choses anciennes.
À première vue, la carrière de cet homme ne semble pas beaucoup mouvementée, mais se déroule tout droit vers le but de sa vie. Malgré de grandes aptitudes intuitives, il se tient docilement ouvert, comme un vase, pour recevoir les inspirations, qui, effectivement, s’épanchent en lui. Pour lui-même, l’auteur ne recherche plus rien. Il veut seulement donner ce qu’il reçoit. Chez cet homme tout est esprit et âme, et ce n’est que dans cette perspective qu’on peut le comprendre. Être parfaitement tranquille et harmonieux, il eut la chance d’être conduit dès sa première jeunesse sur le bon chemin. Une éducation sévère l’a préparé à la plus grande obéissance : car il apprit déjà bien tôt des attitudes de dévotion et de respect à l’égard de tout ce qui est au-dessus de nous. Les caractères graphiques font songer à un homme demeuré parfaitement intact. Mais même dans les circonstances les plus difficiles, le tempérament et les dispositions de cette personnalité auraient produit un grand homme, étant donné qu’il était capable d’aller jusqu’au don total de soi. Un large horizon éclaire le monde de ses pensées. L’auteur est pour la résistance passive et apportera partout la paix avec lui. »
ÉCRITURE DE CALVIN : LE GÉNIE IMPATIENT
Caractère tourmenté, hérissé de contrastes. Facilité bouillonnante, volonté impérieuse, sensibilité démesurée et égocentrique. Esprit rapide et violent ; raisonneur inépuisable, pressé par le besoin de se libérer, de s’affirmer. Ardeur généreuse et obstinée.
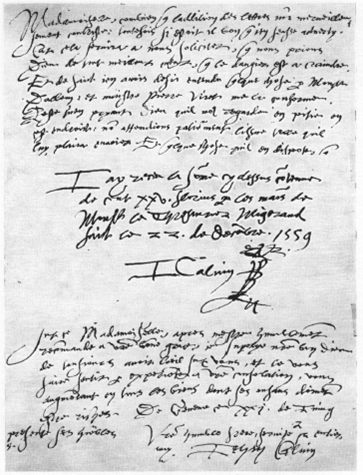
« Une impression d’ensemble suggère de grandes contradictions intérieures chez l’auteur. Mais, en même temps, on sent une personnalité forte et pleine de vie, d’un courage intrépide, capable d’explosions révolutionnaires. La carrière de cet homme n’aura pas été simple et aura provoqué bien des remous. Cet homme, plein de tempérament, passionné, d’un naturel même un peu jouisseur, se frayera avec beaucoup de bonne volonté un chemin à travers bien des difficultés et des luttes. Le besoin d’expansion travaille cet homme, qui, malgré un esprit élevé, ne parviendra pas à la paix intérieure. Dans son champ d’action, il démolit et construit tout à la fois, exigeant qu’on marche avec lui sans discussion. Dans son élément, il trouve rarement le juste milieu et il sera facilement capable de verser l’enfant avec la baignoire. La raison domine cet homme qui, cependant, tourne tout son et port vers un idéal grand et élevé, et se trouve dans cet élan, en perpétuel conflit avec lui-même. Il est foncièrement honnête, ouvert et, dans sa spontanéité, souvent brutal et sans égard. De toute façon, il se donnera toujours tel qu’il est, comme il pense et comme il sent. L’auteur est très attaché à la terre, sujet à des tendances érotiques ; il est bien capable de grands élans et de beaux essors, mais il ne parvient pas à se détacher. La simple ascèse lui est étrangère. Il s’efforce de tout réaliser d’une manière pratique ; sa manière de penser est positive ; cela lui permet de mettre en branle des mouvements qui prendront de l’ampleur. Dans son amour de la vérité, il agit avec une grande force de conviction, bien que, en fin de compte, l’acquiescement et la soumission suprêmes soient impossibles. Malgré la grandeur de ses dons et de ses vues, il semble n’avoir pas pu dépasser un certain point, celui qui consiste à se vaincre soi-même. Il regarde tout d’un point de vue naturel et, par le fait même, ne parvient pas à sortir de la nature. Cet esprit combatif et agressif peut répandre beaucoup de lumières, mais tout autant d’ombres, car il lui est donné d’exercer un grand pouvoir de suggestion. Si cet homme pouvait atteindre un âge très avancé, peut-être agirait-il alors d’une manière toute différente de celle qu’il adopta précédemment [1165]. En toute hypothèse, il changera souvent d’opinion, car sa pensée n’a pas encore atteint la sagesse et la sérénité. Il est très intelligent. C’est un homme né pour agir en public : il doit se lancer dans la mêlée, en pleine vie, même quand elle lui est contraire. Dans toute sa mentalité, l’auteur est beaucoup plus raison qu’âme. En outre, il a encore beaucoup à lutter contre le besoin de se faire valoir. Il se laisse emporter par le plaisir de la critique et ses opinions peuvent blesser brutalement. Il se fera des ennemis de ses amis et inversement. L’auteur manque d’une certaine finesse, mais il ne parvient pas à sortir de son naturel. »
*
* *
Il nous semble que la graphologue, en insistant sur le « naturalisme » de Calvin, a souligné un des traits essentiels de sa psychologie religieuse. Sa théologie si vigoureusement théocentrique n’y contredit pas. Car le raffinement « surnaturaliste » du théoricien pénètre et change si peu ses passions qu’on ne saurait conclure trop facilement, comme le fait le professeur Benoît, à une « grande richesse d’âme ». (Calvin, directeur d’âmes, p. 180). Autre chose l’idéologie et autre chose la vie pratique. La monotonie des formules pieuses de Calvin suggère une cause différente. Prisonnier de ses cadres conceptuels, le biblicisme de Calvin ne suppose pas nécessairement une spiritualité fervente, une vie intérieure profonde, mais bien une routine intellectuelle sélective aux goûts de l’exégète. Et dès que l’homme mesure le surnaturel à son aune subjective, le « surnaturalisme » le plus radical retombe pratiquement dans le « naturalisme ». – À côté du grand intellectuel, de l’inépuisable théologien resté « naturel », Loyola se détache comme un « spirituel » authentique, au sens paulinien du mot.
_______
Ce livre était déjà imprimé quand parut l’important vol. II des « Fontes Narrativi de S. Ignatio de Loyola » (Monumenta historica Soc. Jesu, vol. 73, Rome, 1951). Nous n’avons pu en faire état ; cependant, l’essentiel de ces documents de Nadal, de Ribadeneira, de Polanco, était déjà connu par ailleurs. Il ne semble pas que l’image de Loyola doive en être notablement modifiée.
TABLE DES MATIÈRES
_______
Abréviations et bibliographie.
INTRODUCTION.
1. Une Réforme indispensable.
L’idéal mystique de la Réforme. – Crise latente pendant des siècles. – Le malaise généralisé par l’évolution des idées et des institutions. – Pouvoir temporel et religieux. – Décadence du clergé et de la hiérarchie. – Routine ou retour aux sources. – Réforme et Contre-Réforme incarnées par Calvin et Loyola.
2. La Méthode et les Sources.
Essai de psychologie et théologie comparées. – Intention, méthode et esprit. – Les données historiques du parallèle. – Deux types religieux. – Les sources de la biographie de Calvin. – Les sources de la biographie de Loyola.
PREMIÈRE PARTIE.
ÉVOLUTION.
Chapitre premier. – Le Basque et le Picard.
I. Le Basque.
Milieu et mentalité aristocratique et médiévale. – Influences nationales et familiales. – Le clerc malgré lui et le cadet ambitieux. – Les défauts de sa race.
II. Le Picard.
Siècle et pays bourgeois. – Le fils d’un agent d’affaires clérical. – Ambiance critique. – Aspirations intellectuelles. – Arrivisme. – Inquiétudes.
Chapitre deuxième. – Le chevalier errant et l’enfant prodige.
I. Le chevalier errant.
À la cour avec le Grand Trésorier de Castille. – Mœurs galantes et militaires. – Le mythe chevaleresque.
II. L’enfant prodige.
Le précoce disciple de Cordier. – Le modèle de Montaigu. – Le mythe du savoir et de la vertu. – Scrupules. – Contrainte et disputes.
Chapitre troisième. – L’amoureux et le lettré.
I. L’amoureux.
La Dame de ses pensées. – Le fol héroïsme. – Le blessé de Pampelune et le converti. – Le rival des croisés et des saints.
II. Le lettré.
Complexe antiféminin ? – Amitiés choisies. – Humanisme orléanais. – À Bourges. – Ambitions intellectuelles. – Le commentaire de Sénèque. – Esprit de tolérance ? – Le juriste.
Chapitre quatrième. – Le pèlerin et le prophète.
I. – Le pèlerin solitaire.
Conversion intérieure. – Tâtonnements et exploits de l’ascète. – Montserrat. – Manrèse et les Exercices. – Mendiant et mystique. – Le voyage à Jérusalem, p. – 8s. – Le goût de l’expérience.
II. – Le prophète malgré lui.
a) L’état d’âme. – Évolution insensible. – Influence du milieu hétérodoxe. – Recherche inquiète et indécise. – Le discours de Cop. – Le choc imprévu.
b) Le tournant décisif et involontaire. – L’entraînement du militant évangélique. – La conversion forcée. – Le prophétisme. – L’apaisement.
Chapitre cinquième. – Le vieil écolier et le jeune maître.
I. – Le vieil écolier.
Besoin d’apostolat et d’étude, Barcelone. – Premiers exercices avec compagnons suspects. – Procès d’Alcala. – Salamanque et Erasme. – Paris, exercices avec compagnons formés. – Épreuves nouvelles. – Unification intellectuelle. – La première Compagnie de Montmartre. – Austérité et humanisme. – Amour fraternel.
II. – Le jeune maître.
Zèle de converti et de partisan. – Avocat de la cause. – Le défenseur des martyrs. – Sincérité et profondeur de la nouvelle foi. – Caractère juridique de l’homme et de l’ceuvre. – Révolutionnaire et controversiste. – Réforme critique de l’Église.
III. – Examen de conscience.
Légitimité des titres du réformateur. – Anxiété de du Tillet et hésitation de Calvin. – Appel à une réforme personnelle et objective. – Option d’une certitude extérieure.
DEUXIÈME PARTIE.
DEUX LIVRES, DEUX RÉFORMES.
Chapitre premier. – Deux Manuels de base.
Caractères généraux.
I. – Les Exercices.
Intention exclusivement spirituelle. – Composition. – Influences. – Originalité de la retraite.
II. – L’Institution.
Contenu mêlé. – Eléments empruntés et personnels : révélation ? – Science philologique. – Esprit de système et fidélité à soi-même. – Succès littéraire. – Influence.
Chapitre deuxième. – « À l’école de Dieu ».
I. – Deux hommes de Dieu.
Théocentrisme. – Leitmotive semblables. – Le Règne de Dieu. – L’humilité. – Le tant pis et le tant mieux. – L’idée de Dieu chez Calvin. – Chez Loyola. – La domination théocratique.
II. – Deux moralistes.
a) Objectif de la morale calviniste. – Nécessité d’abattre l’homme devant Dieu. – Distinction difficile entre le bien et le mal. – Le surnaturel partout. – Applications pratiques. – Supériorité morale calviniste ? – Calvin, meneur d’hommes.
b) Confiance de Loyola. – Vie intérieure et réforme personnelle. – La méditation du modèle humain, Notre-Seigneur. – Humilité durement acquise. – Primauté de l’amour. – Morale optimiste et joyeuse.
III. – Deux maîtres d’oraison.
a) Les conditions de la prière calviniste. – Sa nature oratoire. – Critère émotif.
b) L’oraison ignacienne. – Technique de la vie intérieure – Facilité de l’union à Dieu.
IV. – Deux Évangélistes.
a) La Bible dans la mentalité catholique de Loyola. – L’Évangile actuel et vécu. – Objet de contemplation.
b) La Bible monopolisée par Calvin. – L’Ancien Testament. – Dogmatisme légaliste. – Base de l’autorité ecclésiastique et civile.
TROISIÈME PARTIE.
DEUX CHEFS, LEURS LUTTES, LEURS AMITIÉS.
Le chef de parti et le chef de compagnons.
Chapitre premier. – Calvin chef de parti.
I. – Coups d’essai à Genève.
Le lecteur de la Bible dans la ville à peine libérée. – Dispute de Lausanne. – La discipline ecclésiastique des Ordonnances. – L’excommunication. – – Contrainte et résistance. – Épreuve de force politique. – Intransigeance du jeune chef et expulsion.
II. – La formation internationale, Strasbourg.
Importance de Strasbourg. – Mariage et détente. – Rayonnement international. – Orientation politique donnée à la Réforme. – Genève et la réponse à Sadolet. – Sens et valeur de cette apologie. – Tergiversations à propos d’un retour éventuel. – Nouvelle vocation subie. – Considérations politiques. – Retour à Genève. – La royauté de Calvin. – Les faces de Calvin.
Chapitre deuxième. – Le chef de compagnons.
I. – Apprentissage missionnaire.
Les débuts incertains de la Compagnie. – Le compagnonnage libre. – Genre de vie des compagnons. – Quelques types, Favre, Xavier. – Charité missionnaire universelle. – Vœux et pérégrinations. – Au service du prochain malade et pauvre. – L’épreuve de la peste. – La gamme des premières activités. – Dévouement d’Ignace et succès des Exercices.
II. – Réalisations apostoliques.
Les compagnons sont fort recherchés. – Union des cœurs. – Réponse aux vexations. – Esprit pacifique. – Soin dans le choix des compagnons et des activités. – Le caractère du chef. – Valeur religieuse accordée aux réalités humaines. – Ascendant personnel de Loyola. – Ferveur commune et élan mystique. – Développement rapide des vocations et des collèges. – Multiplicité des œuvres et confiance mutuelle entre les compagnons.
Chapitre troisième. – Maître Calvin et sa Vénérable Compagnie.
I. – Les instruments du pouvoir.
La fascination du prophète. – L’ordre rétabli par les Ordonnances. – Par la Compagnie des pasteurs et par le Consistoire. – Le rôle des pasteurs et leur édification. – La juridiction ecclésiastique mêlée à tout. – Lutte sur tous les terrains. – Réactions et intrigues. – Omniprésence de Calvin. – Politique partisane. – L’appui des émigrés. – Le génie procédurier. – Excès de cléricalisme et médiocrité spirituelle.
Il. – La révolution calviniste.
Vigoureux esprit de suite de Calvin. – Le sauveur de la Réforme. – Rigidité plus grande contre l’Église catholique. – – Contraste entre l’homme public et l’homme privé. – La transformation des valeurs. – Pédagogie calviniste. – La dureté de la discipline. – Le contrôle de la vie et des mœurs. – Ecole évangélique ou Etat dirigé par l’Église.
III. – Domination de la Cité.
Succès relatif, les apparences parfaites – Le parti fiançais. – La haine des Genevois contre les étrangers. – Théologie et politique de la crainte. – Le revers de la médaille.
Chapitre quatrième. – Le Général de la Compagnie.
I. – La libre obéissance.
Hésitations des compagnons avant d’adopter le vœu. – Longues délibérations sur l’opportunité d’un Ordre religieux. – Le mot « Général ». – Les qualités indispensables du Supérieur. – L’engagement volontaire des compagnons. – Des vues peu réactionnaires. – Les sujets d’élite. – Les modèles de la vie religieuse traditionnelle. – Importance respective de l’obéissance, de la pauvreté et de la charité. – La lente rédaction des Constitutions. – Discussion libre. – L’esprit monastique. – L’obéissance, soutien de l’initiative et de la dévotion personnelle. – Comment le Général obéit. – Soumission aimante à toutes les exigences de la vie réelle.
Il. – Le gouvernement paternel.
Le mobile : esprit d’amour et non de crainte. – Les objectifs exclusivement religieux de l’Ordre. – Organisation consciencieuse de la vie commune. – Simplification de l’idéal monastique. – La centralisation, la correspondance. – Directives pour les missions spéciales. – Entraînement méticuleux des recrues dans la vie domestique. – Latitude et responsabilités des Inférieurs dans leur champ d’action. – Connaissance et respect des personnalités. – Liberté d’esprit et d’action.
QUATRIÈME PARTIE.
TRIOMPHE ET TRAGÉDIE.
Chapitre premier. – Les martyrs du calvinisme.
Raidissement de la résistance française à la Réforme. – L’ordre social menacé se défend. – Loyola et Calvin en face de l’Inquisition. – L’influence personnelle de Calvin dans les procès. – Influence plus grande de la doctrine que la répression elle-même. – La révélation de Servet. – Conséquences dogmatiques et politiques. – Recul de l’esprit de tolérance. – Isolement théologique de Calvin. – Explication de la psychose. – Cruauté. – Mentalité contagieuse. – Conséquences spirituelles. – L’agressivité, levier du système. – Déviation de la bonté naturelle du réformateur.
Chapitre deuxième. – Loyola, les hérétiques et l’Inquisition.
Loyola poursuit les hérétiques qui l’accusent à Rome, p. – Jugement exigé et obtenu. – Opinion sur la répression des hérétiques. – Mentalité conservatrice. – Absence d’animosité dans les rapports avec les protestants. – Affection des siens pour les frères séparés. – La lutte des jésuites et de la Réforme en Allemagne. – Indulgence de Loyola dans le cas d’Ochino. – Amour de Loyola pour ses ennemis. – Les contradicteurs de Loyola et de Calvin. – Danger d’affadissement.
Chapitre troisième. – Calvin intime, le malade, le surhomme.
Le cœur et la séduction de Calvin. – Les maladies de Loyola.
I. – Mens sana in corpore sano. L’âme de Calvin.
Nervosité et intelligence. – Attachement à ses idées. – Orgueil de l’esprit. – Mémoire et fixité. – Paroxysme verbal. – Impressionnabilité et véhémence. – Le sentiment religieux. – La joie et l’amertume. – Faiblesse et instabilité. – Agitation. – Crises d’emportement et d’abattement. – Complexes.
II. – Un génie malsain.
Interaction du physique et du moral. – Résignation et philosophie de valétudinaire. – Côtés pathologiques. – Le subconscient religieux. – Misanthropie théologique. – Hyperbole et violence érigées en système. – Grandeur apocalyptique de Calvin. – Mentalité laïque, matérialiste.
Chapitre quatrième. – Loyola, le saint médiéval et moderne.
I. – Un équilibre laborieux.
Originalité et lenteur des expériences ignaciennes. – Liberté intérieure chez Calvin et Loyola. – Souci constant de toute perfection. – Sens optimiste de tous les efforts de pénitence. – Équilibre et maîtrise de soi. – Pas d’exaltation mystique. – Estime des valeurs solides. – Culture des personnalités. – Pédagogie confiante. – Idéalisme et largeur d’esprit. – Le zèle de Loyola et de Calvin.
II. – Le sage et le saint.
Fausse idée de la grandeur de Loyola. – Connaissance profonde des hommes. – Bienveillance amicale pour tous. – Dignité des sentiments et du langage. – Sens de la mesure et souci d’unité. – Foi naïve et charité apostolique. – Imitation de David ou de Jésus-Christ. – La haine du péché ou le culte de la grâce.
III. – Les œuvres.
L’exubérance des missionnaires. – Universalisme ignacien. – Influence sur les arts et la culture. – Musique et Humanisme. – Esthétique calvinienne. – Esthétique baroque. – Influence politique et économique du calvinisme. – La force des jésuites.
CONCLUSION
I. – La grandeur de Calvin.
Supériorité extérieure, intellectuelle et politique de Calvin. – Le moi public et le moi profond. – Le mérite de Calvin à l’égard des deux Églises. – Sa vocation : le contrepoids du catholicisme.
II. – L’humble service de Loyola.
Fidélité aux petites choses. – Sagesse des saints. – Discernement des esprits. – Primauté de la charité.
APPENDICE GRAPHOLOGIQUE.
Écriture de Loyola.
Écriture de Calvin.