Mes tristes aventures
de Sibérie
par
Auguste de Kotzebue
Occasion de mon voyage en Russie. – Mon arrestation. – Je suis emmené à Mittau, de là à Saint-Pétersbourg, puis en Sibérie. – Mon arrivée à Tobolsk. – Premier entretien avec le gouverneur. – Déception et mortelles angoisses. – Défiance injurieuse à mon égard. – Les premières journées en Sibérie. – Différentes classes de prisonniers et traitements qu’ils subissent. – Mes occupations. – Sympathie des commerçants de Tobolsk. – Aventures diverses. – Description de la ville ; climat ; particularités intéressantes. – On m’oblige à quitter Tobolsk. – Préparatifs de départ. – Voyage à Kurgan. – Mon exil dans cette triste localité. – Mon logement. – Anecdotes curieuses. – Le mal du pays qui me torture partout. – Emploi de mon temps. – Mon domestique Rossi. – Le voisinage des Kirghizs. – Un ami ménagé par la Providence : le polonais Sokoloff. – Une fête à Kurgan. – Détails de mœurs et description du pays. – Mes nouveaux projets. – Craintes et espérances. – Arrivée d’un courrier, porteur de ma grâce. – Joie universelle de la population. – Mes adieux. – Mon heureux départ.
AUTEUR dramatique allemand, j’avais autrefois composé une pièce sur le comte Beniowski, dans laquelle je faisais un tableau assez effrayant des souffrances que le malheureux exilé endura en Sibérie. Depuis longtemps j’avais oublié ce détail. Hélas ! l’empereur de Russie allait se charger de m’en faire ressouvenir !
Au commencement de l’année 1800, j’eus l’idée de faire avec ma famille un voyage en Russie, patrie de ma femme. Nous partîmes très gais, comptant nous procurer le double plaisir de voir du nouveau et de renouer connaissance avec nos parents ; mais à peine avions-nous passé la frontière qu’on arrête notre voiture et on nous réclame nos passeports. Nous les donnons. Le douanier reconnaît qu’ils sont parfaitement en règle, mais il m’annonce qu’il a reçu l’ordre d’arrêter le voyageur porteur de ces passeports.
Qu’on juge de notre stupéfaction ! On ne nous donnait aucune raison de cette étrange façon d’agir. Notre voiture fut à la disposition d’un Cosaque, qui nous fit conduire à Mittau. Là, tandis que je me croyais au bout de mes peines, on me sépara de ma femme et de mes trois enfants encore en bas âge, et on me dirigea sur Saint-Pétersbourg. Puis, après m’avoir horriblement trompé en me promettant qu’on allait simplement me conduire à quelque distance, on prit la route de la Sibérie. Un conseiller impérial était chargé de moi et devait répondre de ma personne.
Je ne m’étendrai pas sur ce voyage, pendant lequel je fus en proie à la colère la plus vive, ainsi qu’à une sorte de désespoir, en même temps que torturé par la maladie. Mon récit commencera à mon départ de Kasan, ville peu éloignée de la Sibérie.
Ce fut le 29 mai que nous la quittâmes. Nous trouvâmes, malgré la chaleur qu’il faisait depuis quelque temps, beaucoup de neige dans les bois. La distance de Kasan à Perme est de six mille verstes environ, et le chemin côtoie toujours des forêts affreuses ; à peine y trouve-t-on un misérable village de quatre en quatre verstes. Quoique cette route soit large et droite, elle a le désagrément d’être très marécageuse ; l’épaisseur des arbres offre aux voyageurs l’image horrible d’un désert, et ce spectacle déchire l’âme.
Nous rencontrâmes ici, pour la première fois, de grandes troupes d’exilés, qui, enchaînés deux à deux, allaient à pied, soit à Irkoutsk, soit aux mines de Nertchinsk. Chaque troupe était accompagnée par des paysans, les uns à pied, les autres à cheval. De tels exilés sont souvent plus de six mois en route. Leur garde est changée à chaque village. Ils nous demandèrent la charité, que nous leur donnâmes de bon cœur. Hélas ! quoique je passasse à côté d’eux dans une bonne voiture, ma position n’était-elle pas aussi cruelle que la leur ? À cela près de quelques commodités de la vie, n’étais-je pas exilé comme eux ? D’ailleurs la juste mesure de nos peines nous est donnée par notre âme, et la mienne me faisait croire que j’étais le plus infortuné des hommes.
L’aspect de ces victimes, les ténébreuses forêts, les chemins affreux, le récit des meurtres naguère commis dans ces déserts, tout devait augmenter ma douleur et mon effroi en ce moment ; mais je fis des efforts pour me distraire de pensées qui eussent redoublé mes souffrances. Je m’imaginai de chercher s’il n’y aurait pas quelque espoir de fuite. Quel n’était pas mon aveuglement de courir après un rayon d’espérance, à travers ces sombres feuillages qui ne laissaient pas même percer un rayon de soleil ? N’est-il donc pas d’obstacle pour l’imagination ? Non, il n’en est véritablement point. Je le sentis en ce moment : j’eus en effet l’idée de comploter avec ma femme, pour qu’elle m’aidât à fuir de la Sibérie. Je lui confiais mentalement mes projets, je lui en détaillais l’exécution ; je me reposais sur son adresse. Elle m’assurait que la réussite n’était point douteuse, et je me trouvais au comble de la joie. Je la félicitais de l’empressement qu’elle avait mis à venir me retrouver. Croirait-on que ce plan, d’abord purement idéal, fut, un moment après, le sujet de sérieuses réflexions, qui ne tendaient à rien moins qu’à une exécution réelle ?
Au milieu de toutes ces rêveries, nous arrivâmes à Perme sans accident. Là, on me fit descendre chez un horloger qui tenait une espèce d’auberge. Cette ville de Perme est très misérable ; mais nous fûmes bien chez l’horloger Rosenberg, où l’on nous mena. Cet homme avait été autrefois au service du prince Biron, qui fut exilé. Le conseiller, qui me laissait souvent seul chez lui, avait oublié, en sortant, de fermer ma cassette. Je profitai de son oubli pour séparer cent roubles de ce qui restait de mon argent comptant, et je les serrai avec soin, comme si j’eusse prévu que mon conducteur allait faire une dernière sortie sur ma pauvre bourse. En effet, une heure après que j’eus pris cette précaution, il me demanda de l’argent. Je le refusai nettement ; il témoigna la plus grossière humeur, laissa échapper mille paroles dures, et finit par me menacer de faire des rapports désavantageux sur mon compte. La crainte qu’il ne se vengeât de cette manière me força à céder ; mais je lui dis, quand ma cassette fut ouverte : « Voyez, il ne reste là que cent dix roubles : c’est bien peu pour un homme qui aura mille besoins dans un lieu étranger, et qui n’aura aucune autre ressource, jusqu’à ce qu’il ait écrit dans son pays. Je veux bien cependant partager encore avec vous ce qui me reste, mais c’est pour la dernière fois. Voilà cinquante roubles ; je ne puis vous en donner davantage : si vous n’êtes pas content, faites contre moi tel rapport qu’il vous plaira ; je saurai de mon côté porter aussi mes plaintes quelque jour, et nous verrons qui des deux l’on désapprouvera. » Ces derniers mots parurent lui déplaire extrêmement, et même le rendre honteux ; mais il n’en prit pas moins mes cinquante roubles. Je gagnai, à lui avoir parlé aussi sèchement, qu’il ne me fut plus à charge sous ce rapport ; au reste, il parut adopter une pratique toute contraire à celle des mariniers. Ceux-ci sont ordinairement très malhonnêtes dans le commencement du voyage, et se radoucissent à mesure qu’ils approchent du port. M. le conseiller devint plus déplaisant, plus haïssable, plus cruel, à mesure que nous approchions du terme de notre route. Apparemment qu’il ne craignait plus que, lassé de ses vexations, je cherchasse à lui échapper. Je vais donner encore un trait qui montrera le plaisir qu’il prenait à me contrarier. La punition suivait de près sa cruauté.
Un soir, étant encore à Perme, nous vîmes éclater un violent orage. Au moment où l’on changeait de chevaux, le tonnerre gronda si fort, les coups devinrent si multipliés et si effrayants, que je priai le conseiller d’attendre, pour partir, que l’orage eût cessé. C’était faire une demande à laquelle tout homme sensé se fût rendu : il refusa. Je le suppliai de rester seulement une petite demi-heure où nous étions ; il voulut partir. Je lui représentai le danger que nous allions courir, soit parce que nous étions obligés de traverser une forêt, soit parce que notre voiture était couverte d’une grande quantité de fer qui pouvait attirer la foudre sur nous : il se mit à rire, et me répondit que c’étaient des contes d’écoliers. En vain je l’assurai que tout voyageur surpris par un orage avait la précaution de descendre de voiture, et de s’arrêter même en plein champ, plutôt que de continuer sa route : il rit encore plus fort et me dit que j’étais un enfant de croire de pareilles choses. Je n’eusse pas dû me fâcher contre lui, mais je ne pus me contenir. Seulement, au lieu d’insister encore pour attendre la fin de l’orage, je sautai dans ma voiture, en lui disant : « Si la foudre tombe sur moi, j’ai moins à perdre que vous ! »
Nous nous mîmes donc en route : les coups de tonnerre devenaient toujours plus forts. Environ à deux verstes de la station, nous parvînmes à une lande couverte de petites broussailles, qui du côté droit du grand chemin était tout enflammée. L’aspect d’un incendie de ce genre se distingue facilement de celui d’un bois tout en feu. La flamme court, rampe, serpente sur la terre, tantôt doucement, tantôt vite ; elle s’élance de temps en temps vers le ciel ; ensuite elle redescend, couve, sans se montrer, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré une autre place où l’herbe haute et desséchée lui fournisse un nouvel aliment. Nous n’avions autre chose à craindre dans cet embasement qu’une épaisse fumée ; mais l’aspect en était effrayant, il y avait de quoi avoir peur. À droite, cette lande tout en flammes ; à gauche, le ciel tout en feu ; c’est ainsi que nous allâmes pendant plusieurs verstes, jusqu’à ce que nous eûmes atteint un bois de pins très élevés et de bouleaux épais, qui heureusement n’était pas fort étendu. Nous l’eûmes bien vite traversé, et nous trouvâmes, en le quittant, de grandes eaux débordées qui interceptaient le passage jusqu’au village suivant. Il y avait bien un radeau tout prêt pour traverser ce lac, mais il était vide. La crainte de l’orage avait sans doute forcé les matelots à se retirer dans quelque maison. L’inondation était telle dans cet endroit, que nous fûmes obligés d’appeler et de crier longtemps avant que l’on nous entendît sur l’autre bord.
Enfin une nacelle conduite par un seul homme osa braver les flots. Je crus qu’elle n’arriverait jamais jusqu’à nous. Le malheureux qui la guidait se trouva épuisé de fatigue quand il nous eut rejoints, et ses forces furent insuffisantes même pour remorquer le frêle bâtiment sur lequel nous allions monter. Cependant nous étions résolus à passer. Nous lui dîmes d’approcher le radeau jusqu’à la terre ferme ; il nous déclara qu’il lui était impossible de le pousser tout à fait au bord, parce qu’il le ferait entrer dans la vase, et qu’on ne pourrait plus ensuite l’en retirer. Il ajouta que nos chevaux, qui étaient au nombre de cinq et qui paraissaient vigoureux, pouvaient bien conduire la voiture. Nous fîmes la sottise de le croire, et nous suivîmes son conseil. Les roues entrèrent dans l’eau jusqu’à l’essieu ; quatre des chevaux arrivèrent heureusement jusqu’au radeau ; mais le cinquième, un des limoniers, resta les pieds de derrière dans la vase, tomba sur le côté, et ne put se débarrasser ; les cris, les coups de fouet furent inutiles. Plus on faisait d’efforts, plus la voiture penchait, plus le radeau sur lequel tiraient les quatre autres chevaux menaçait de chavirer. Mes conducteurs, avant tous ces embarras, étaient sortis de la voiture ; mais moi, retenu par une malicieuse audace, j’avais voulu y rester. Cependant, lorsque je vis quels dangers je courais, et que la mauvaise corde d’écorce qui retenait le radeau au rivage pouvait être facilement rompue par les secousses multipliées des chevaux, je trouvai qu’il était prudent de descendre à mon tour et de gagner notre embarcation. Je me mis dans l’eau jusqu’aux genoux pour y parvenir. Dès que j’y fus, le conseiller prit lui-même le fouet à la main et s’assit sur le siège ; le postillon tira les chevaux par la bride, le courrier les frappa avec un morceau d’écorce d’arbre, le paysan tint la corde de toutes ses forces, pour qu’elle ne pût échapper ; mais tout cela n’aboutissait à rien.
Pendant que chacun criait, jurait, se mettait en fureur, le tonnerre continuait de gronder avec fracas, les éclairs semblaient se rapprocher de nous. Bientôt les coups de tonnerre devinrent si effrayants, que la crainte s’empara de moi ; je n’osai plus lever les yeux ; de quelque côté que j’eusse regardé, le ciel couvert d’épais nuages aurait ajouté à la terreur que je ressentais déjà. Le conseiller se mit à rire de pitié quand il me vit ainsi tremblant ; il bravait la tempête ; mais au moment où il montrait le plus de témérité, un éclair nous aveugla tous, et le feu du ciel tomba sur un bouleau, à trois cents pas de l’endroit où nous étions. Nous devînmes à la fois sourds, aveugles et pour ainsi dire muets. Mes deux conducteurs et le paysan ne retrouvèrent la voix que pour s’écrier : « Dieu, miséricorde ! » Le conseiller, pâle et défait, demeurait dans une stupéfiante immobilité ; lui-même, ainsi que le courrier et le paysan, ne cessaient plus de faire des signes de croix. C’est que, lorsqu’on se voit à deux doigts de la mort et que la puissance divine se manifeste parmi les éléments d’une manière si saisissante, il n’y a plus rien qui puisse retenir ou refouler le cri instinctif de l’âme vers Celui de qui seul on peut attendre du secours. Les blasphèmes n’oseraient plus se faire entendre ; l’homme est irrésistiblement entraîné à se prosterner devant Dieu.
Lorsque l’orage fut un peu calmé, le cocher Schulkins reprocha amèrement au conseiller l’entêtement qu’il avait mis à ce que l’on partît malgré le danger. Le paysan se plaignait de son côté de cette folie d’avoir voulu passer l’eau malgré l’orage. Je mêlai mes plaintes, mes reproches aux leurs, et M. le conseiller ne sut plus à qui répondre. Il était hébété comme un homme qui sent qu’il a fait une sottise.
Cependant le ciel redevenait plus clair et plus serein. Alors quelques hommes qui nous aperçurent de l’autre bord accoururent à notre secours. Ils nous aidèrent à relever notre cheval et à faire entrer la voiture dans le radeau ; nous partîmes ensuite. La traversée fut heureuse, et M. le conseiller voulut bien promettre de n’être plus aussi opiniâtre à l’avenir.
De Perme à Tobolsk, on compte encore plus de neuf cents verstes ; mais les chemins sont bien meilleurs, et le pays offre des sites autrement agréables qu’entre Kasan et Perme. On ne rencontre plus de forêts de sapins, mais de jeunes bouleaux : ces forêts en outre sont entrecoupées de terres ensemencées. Des villages assez grands et bien bâtis, habités soit par des Russes, soit par des Tartares, se trouvent à peu de distance les uns des autres. Les dimanches et les jours de fête, la multitude de gens qu’on voit se réjouir fait oublier que l’on entre dans la Sibérie. Les maisons de la plupart de ces habitants sont aussi plus propres et plus commodes que celles des autres villages russes. On y remarque dans chacune, outre la chambre qui est occupée ordinairement et qu’on nomme isba, une autre jolie pièce, la gornitza, où il y a des fenêtres de pierre spéculaire, ou talc transparent. De plus, on y trouve des meubles : une table couverte d’un tapis, des bancs commodes, des images de saints bien encadrées, etc., ainsi que des ustensiles que l’on ne voit pas communément dans les ménages de paysans. Les Sibériens paraissent porter l’amour de l’hospitalité à un degré plus haut que les Russes. On peut aisément les distinguer à un dialecte qui leur est particulier.
Mais si cette population paraît nombreuse les jours de fête, parce que tous les habitants sont réunis dans les places publiques, combien elle paraît faible quand chacun est employé dans les champs ! On fait quelquefois plusieurs verstes sans apercevoir un seul être humain.
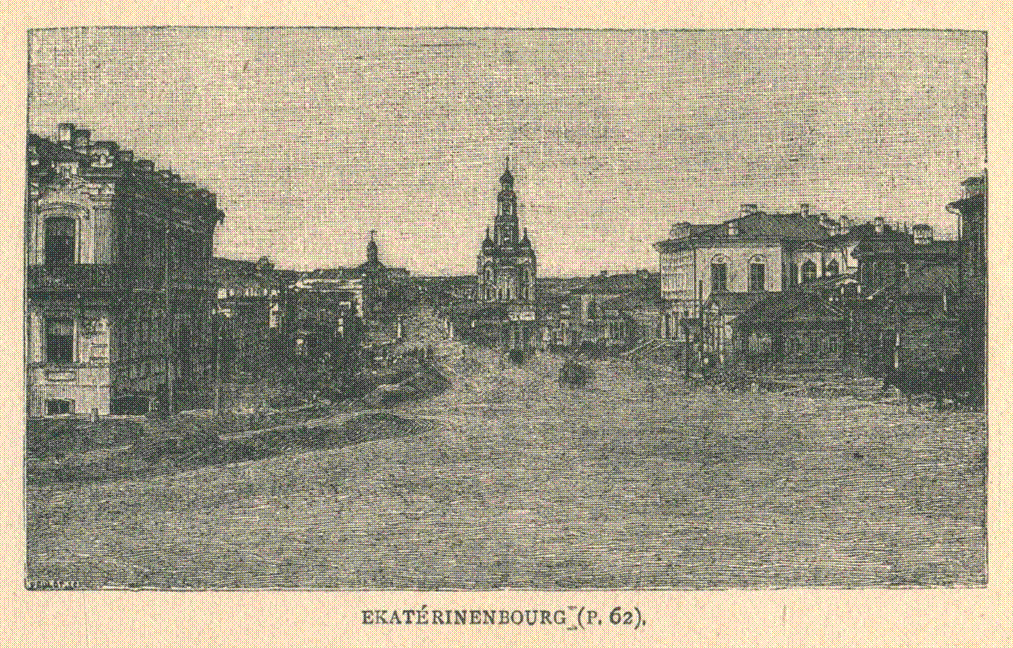
On ne rencontre dans le gouvernement de Perme qu’une seule ville d’importance : c’est Ekatérinenbourg. De là nous partîmes pour nous rendre à Tinnen. Quarante et quelques verstes avant d’y arriver, nous traversâmes, au milieu d’un bois, les frontières de la province de Tobolsk, qui y sont désignées par quelques poteaux. Le conseiller eut la cruauté de me faire remarquer ces premières indications du lieu de mon exil. Je ne lui répondis rien : un sentiment d’horreur déchira mon âme. Hélas ! mon imagination vive et ardente ne suffisait-elle pas à me tourmenter ? Fallait-il, par des observations minutieuses et barbares, augmenter l’amertume de mes pensées ? Mais il était écrit que je devais boire jusqu’à la lie ce calice amer de la douleur et qu’aucune sorte de souffrance, physique ou morale, ne devait m’être épargnée !...
J’étais véritablement sur la terre de l’exil !... Après un court arrêt dans une auberge, je remontai en pleurant dans ma voiture et nous partîmes. Je cachai mon visage dans mes deux mains ; de temps en temps des sanglots, que je m’efforçais d’étouffer, m’échappaient malgré moi. Mes conducteurs, qui ne concevaient pas pour quelle raison je m’abandonnais à ce désespoir, me demandèrent ce qui m’affligeait, et pourquoi je n’avais pas mangé à l’auberge ; je ne leur répondis rien : leurs cœurs ne m’eussent pas compris ; et peut-être j’aurais eu la douleur de voir tourner en dérision ma trop juste sensibilité.
Toujours déchiré secrètement comme par une douloureuse épine, j’arrivai à la dernière station avant Tobolsk. Les rivières d’Irtych et du Tobol avaient inondé tout le pays dans un espace de quelques verstes. Nous fûmes obligés de laisser là notre voiture, d’empaqueter tous nos effets sur une petite nacelle, et de faire le reste du voyage par eau. L’atmosphère était brûlante. Nous voyageâmes assez vite. Pendant ce temps, mes conducteurs s’endormirent, et je crus qu’ils le faisaient exprès pour n’être pas obligés de répondre à mes nouvelles questions ; car, plus j’approchais de Tobolsk, plus je doutais que ce fût là le lien de mon exil.
Après trois heures de navigation, j’aperçus, à une distance d’environ une demi-verste, cette ville qui devait, m’avait-on dit, être ma prison. Tobolsk est bâti sur les rocs escarpés de l’Irtych ; son aspect a quelque chose de pittoresque, à cause d’une multitude de clochers : son côté remarquable est principalement la partie haute, qui présente aux regards la citadelle et l’ancienne demeure du gouverneur. Ce château a été presque entièrement détruit par un incendie, mais il offre encore quelque chose d’imposant. Ici mes conducteurs se réveillèrent, et je vis bien quelle différence existe entre un cœur grossier, qui l’est par simple nature, et celui qui l’est par perversité. Dans ce moment, le conseiller s’abandonna à tous les transports de sa joie ; il ne cessa de plaisanter, de rire, de chanter ; et manquant aux égards, au respect que l’on doit au malheur, il ne semblait occupé que de faire admirer avec quel succès il avait terminé ce long voyage. Le courrier au contraire gardait un morne silence ; il paraissait rentrer en lui-même ; il savait bien que c’était là que mon sort allait se décider, et ne jetait sur moi que des regards à la dérobée. Je lui sus gré de cette réserve qui révélait quelque sensibilité.
Après avoir navigué dans la partie basse de la ville, qui était tellement inondée que les habitants allaient en bateau pour se visiter et vaquer à leurs affaires, nous débarquâmes à Tobolsk, le 30 mai, à quatre heures après midi, dans un endroit voisin du marché, appelé bazar. Là, nous fîmes venir un homme avec un chariot ; nous y transportâmes nos effets, et nous allâmes droit chez le gouverneur, qui demeurait sur la montagne.
Quand nous fûmes arrivés devant la maison, le conseiller descendit le premier, afin d’avoir une audience secrète, et me laissa seul avec le courrier. Pendant un quart d’heure que dura cet entretien, dont je redoutais l’issue, les domestiques du gouverneur sortirent les uns après les autres, me regardèrent avec curiosité, et se parlèrent tout bas. C’était moins le désagrément d’être ainsi en spectacle à tant de sots, qui m’affligeait, que la crainte d’apprendre un nouveau malheur. Le conseiller parut enfin : il me fit signe de le suivre, et me conduisit, par le jardin, au pavillon où le gouverneur venait de faire sa sieste. Je ne fis qu’une seule question en chemin : « Resterai-je ici ? » À quoi il me répondit : « Je n’en sais rien. »
La porte du pavillon s’ouvrit ; le conseiller me fit entrer, et resta derrière moi. Je m’avançai avec courage ; je fus bientôt devant le gouverneur, M. de Kuschelef, qui me parut âgé de plus de quarante ans, et dont la figure noble et spirituelle ne démentait pas la réputation qu’il avait d’être très humain. Les premières paroles qu’il m’adressa furent : « Parlez-vous français, monsieur ? – Oui, monsieur », répondis-je promptement ; j’avais cru, à ce mot, entendre la voix d’un ange, et je fus au comble de la joie quand je vis que je pourrais me faire comprendre. Il m’invita, non pas avec cet air sévère que l’on témoigne aux prisonniers, mais avec honnêteté, à m’asseoir près de lui ; j’obéis. « Votre nom m’est bien connu, monsieur, me dit-il d’abord ; il y a un homme de lettres qui le porte comme vous. – Hélas ! monsieur, je suis cet homme de lettres. » Celte réponse l’interdit ; il me fixa et s’écria : « Comment se peut-il que vous soyez ?... comment vous trouvez-vous ici ? pour quel motif ? – Je l’ignore : on n’a pas cru nécessaire de me l’apprendre. J’ai eu jusqu’à ce moment l’espérance que vous daigneriez m’en instruire. – Moi ? je l’ignore comme vous ; je ne sais rien autre chose que ce qui est renfermé dans cet ordre : il porte purement et simplement que le président de Kotzebue, venant de Reval, est confié à ma surveillance. » Il me montra l’ordre qui, en effet, ne paraissait contenir que cette courte instruction. « Mais je ne viens pas de Reval, ajoutai-je, je viens des frontières de la Prusse. – Vous n’aviez peut-être point de permission de l’empereur : il faut une passe, qui sans doute vous manquait. – Non, assurément, j’étais tout à fait en règle ; ma passe était donnée au nom de sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, et signée, d’après ses ordres, par le ministre ; mais elle n’a pas été respectée. On a fait plus : on m’a arraché des bras de ma famille, sous le prétexte de me conduire à Saint-Pétersbourg ; et dès que nous avons eu passé Riga, on a changé de route, et l’on m’a traîné jusqu’ici sans aucun interrogatoire, sans aucun examen. »
Le gouverneur allait me répondre ; il se retint par prudence, et continua en me disant : « Comment ! vous ne savez rien des motifs qui vous ont fait condamner à l’exil ? vous ignorez absolument de quoi l’on vous accuse ? – Absolument. J’ai cherché pendant toute la route, et je cherche encore la cause d’un pareil traitement, à moins que ce ne soit pour mon drame sur Beniowski. Mais qu’y a-t-il là de répréhensible ? » Il garda encore le silence après une espèce de contrainte, et poursuivit après, en ajoutant : « J’ai lu, de vos ouvrages, tout ce qui est traduit en langue russe ; je me réjouis fort d’avoir fait votre connaissance, quoique par rapport à vous, je n’eusse pas désiré que ce fût dans cet endroit. – C’est au moins, repartis-je, un grand adoucissement à mes maux, que d’être tombé entre les mains d’un homme aussi respectable : j’espère qu’il me sera permis de rester près de vous. – Je le voudrais, puisque je ne pourrais que gagner infiniment dans votre société ; mais hélas ! il n’est pas en mon pouvoir de satisfaire votre désir à ce sujet. – Que dites-vous, monsieur ? quel effroi vous me causez ! Quoi ! je ne puis pas même espérer de rester ici ? Ce n’est pas un malheur assez grand d’être obligé de regarder le séjour de Tobolsk comme une grâce ? Il faut que dans l’état de maladie où je suis, je voyage plus loin encore ! – Je ferai, monsieur, tout ce qui dépendra de moi pour adoucir vos peines, et je me trouverai trop heureux de vous soulager : croyez que je suis très affligé de ce que mon ordre porte de vous désigner un endroit pour habiter, non dans Tobolsk, mais dans le gouvernement de Tobolsk. Vous savez que je ne dois ni ne peux m’écarter de mes instructions ; cependant, pour vous prouver que j’ai du moins la bonne volonté de vous rendre service autant qu’il m’est possible, je vous laisse le maître de choisir, parmi toutes les petites villes de mon gouvernement, celle qui vous conviendra le mieux : je n’en excepte que Tinnen, parce qu’elle est sur la grand’route.
– Je vous remercie beaucoup de cette déférence, répondis-je ; mais comment voulez-vous que je choisisse d’une manière convenable ? Étranger, comme je le suis en Sibérie, je réclame, auprès de votre Excellence, la bonté de fixer elle-même mon choix ; je la prie, surtout, de m’éloigner le moins possible de Tobolsk. – Voulez-vous aller à Ischin ? c’est la ville la plus prochaine ; elle est à trois cent quarante-deux verstes, ou à peu près cinquante milles d’Allemagne : si pourtant vous consentez à suivre mon conseil, je vous engage à choisir de préférence Kurgan, qui est à la vérité plus éloignée, puisque l’on compte d’ici quatre cent vingt-sept verstes, ou soixante-quatre milles d’Allemagne, mais dont le climat est infiniment plus doux : c’est l’Italie de la Sibérie, et même il y croît des cerises sauvages ; ce qui vaut mieux encore, vous y trouverez de bonnes, d’excellentes gens, avec qui il est facile et agréable de vivre. – Je consens à me rendre à Kurgan. Dites-moi si je pourrai demeurer ici quelques semaines, pour me délasser des fatigues et des incommodités du voyage ? »
Le gouverneur réfléchit quelque temps, puis il souscrivit à ma demande avec complaisance, en me promettant même de m’envoyer un médecin. J’avais une seconde question à lui faire, question bien plus intéressante : je redoutais un refus, et je n’osais parler ; le gouverneur s’aperçut de mon irrésolution, me questionna ; alors j’avouai naïvement que je craignais de lui demander s’il me serait permis d’écrire à ma femme. « Assurément, me répondit-il. – Et à l’empereur ? – Sans aucune difficulté, mais ce sera sous le couvert du général-procureur : c’est lui qui fera passer vos lettres, si elles ne contiennent rien de répréhensible ou de dangereux. »
Je me levai aussitôt, et je sentis mon cœur soulagé d’un poids écrasant ; je priai M. de Kuschelef de me désigner un logement dans la ville ; il s’empressa de m’indiquer celui que je devais prendre. Je le quittai en l’assurant de ma reconnaissance et en me recommandant à lui.
Mon conseiller me parut être à ses yeux un homme de peu d’importance, car il reçut ses ordres d’une manière bien soumise. Dès que nous fûmes hors de chez le gouverneur, il me demanda si je demeurerais à Tobolsk. « Non », lui répondis-je d’un air qui lui fit comprendre mon mécontentement d’avoir été trompé. Mais je m’ouvris sans peine au courrier, et je lui dis que j’avais reçu de M. de Kuschelef d’agréables félicitations, comme étant le littérateur dont il croyait que je portais seulement le nom. Aussitôt mon conseiller s’écria : « Il a voulu savoir de moi si vous en étiez le parent ; je n’ai pu satisfaire sa curiosité. » Je souris à cette exclamation. Sa surprise fut extrême lorsqu’il remarqua que beaucoup de personnes dans Tobolsk me saluaient, m’embrassaient, et me comblaient d’honneurs. En réalité j’étais aussi très étonné de trouver, dans un coin de la terre si éloigné et si sauvage, tant de personnes de connaissance, et même des amis qui s’intéressaient à mon sort. Mais je ne dois pas interrompre mon histoire.
La police nous montra le quartier que doivent occuper à leur arrivée tous les malheureux exilés d’un rang distingué. Ce sont deux chambres vides, chez un bourgeois de la ville. Ces chambres, je ne sais pourquoi, ne sont pas payées. Ce bourgeois s’embarrasse donc fort peu de leur embellissement. Les fenêtres sont cassées, les murs couverts de quelques vieux morceaux de tapisserie ; la vermine y abonde, et il y a au-dessous de la croisée un bourbier qui exhale une odeur méphitique. Voilà les agréments que je reconnus au premier coup d’œil. Croirait-on que je n’en fus pas effarouché ? Je pouvais craindre de me voir jeté dans une noire prison. Avec le même droit qu’on avait eu de m’envoyer en Sibérie, on pouvait me plonger dans un cachot, me charger de chaînes, et me faire donner le knout.
Par une libéralité qui parut nouvelle à mon hôte, mais dont j’ai toujours tâché de me faire une vertu d’habitude, j’obtins bientôt quelques meubles, une table, des bancs ; pour un bois de lit, je ne pouvais espérer d’en avoir un ; il fallait que je l’achetasse, ainsi qu’un matelas : je m’y déterminai, quoiqu’il ne fût pas nouveau pour moi de coucher par terre. Je m’étais plus d’une fois déjà étendu sur mon manteau, et couvert de ma vieille robe de chambre de soie. Ce dernier de mes effets, que mon domestique avait emballé, me faisait éprouver, chaque fois que je le touchais, les plus douces émotions. Je me rappelais qu’on avait la coutume d’en envelopper mon jeune fils, et ce souvenir me rendait cet effet d’un prix inestimable. Je ne pouvais le poser sur moi, sans croire encore à la présence de mon aimable enfant.
Une heure après que j’eus pris toutes ces dispositions, et que je me fus installé dans mon logement, un officier de police se présenta, accompagné d’un bas officier. Il venait, suivant la forme, me recevoir des mains du conseiller. Sa visite me plut beaucoup, en ce que je pressentis que je serais débarrassé de ce désagréable conducteur, et que je n’aurais plus rien à démêler avec lui. L’officier de police, M. Katalinsky, me parut très aimable. Il me dit honnêtement que, comme il était de son devoir de faire tous les jours son rapport sur moi, il viendrait chaque matin prendre de mes nouvelles. Il ajouta que le bas officier devait rester près de moi, mais plutôt pour me servir que pour me garder. Ensuite il me quitta. Je n’eus qu’à me louer, pendant mon séjour à Tobolsk, de la liberté qu’il me laissa.
Le conseiller se voyant débarrassé de moi, et conséquemment dégagé de sa responsabilité, devint moins méfiant, moins empressé à me contrarier. Il me promit, en sortant de ma chambre, de m’amener un ami qu’il avait accompagné un an auparavant, et dont il n’avait cessé de me faire l’éloge pendant la route. Comme j’étais intimement pénétré du peu de discernement de M. le conseiller, j’avais une mauvaise idée de ceux qu’il disait ses amis. Les louanges qu’il leur prodiguait me faisaient craindre qu’ils ne fussent dignes de lui ; et ceux chez qui j’avais logé devaient me donner une juste opinion des autres. Je ne parus donc pas très curieux de voir ce personnage qu’il voulait me présenter ; mais je fus bien agréablement surpris, quand je vis M. Kiniœkoff, avec qui il revint un moment après. Ce jeune homme, aussi instruit qu’aimable, m’aborda en me parlant français. Il commença par m’assurer qu’il m’estimait et m’honorait, comme homme de lettres ; il plaignit mon malheureux sort, et surtout il me témoigna la plus vive compassion de ce que j’avais fait la route sous la garde du conseiller qui l’avait lui-même accompagné. « Mais il se vante d’être votre ami ! lui dis-je. – Dieu me préserve d’une pareille liaison ! me répondit-il aussitôt ; vous concevez facilement que j’ai dû le ménager, et je le dois encore, puisqu’il me procure une connaissance aussi intéressante que la vôtre. » On ne pouvait rien dire de plus obligeant.
Kiniœkoff était fils d’un riche seigneur de la ville de Simbirsk. Il avait été, au moment où il s’y attendait le moins, arrêté et conduit à Tobolsk avec deux de ses frères et trois autres officiers. Leur crime était d’avoir laissé échapper, dans un repas joyeux, une plaisanterie un peu libre qu’un traître avait promptement rapportée à l’empereur. Lui seul avait eu le bonheur de rester dans cette ville. Deux d’entre eux avaient été envoyés à Irkoutsk ; et le plus jeune de ses frères était à quatre mille verstes de Tobolsk, dans un petit fort où on le tenait enchaîné. Un autre languissait à Bérésov, c’est-à-dire « dans l’enfer » de la Sibérie.
La rencontre de ce jeune infortuné contribua à me donner quelques jours de tranquillité. La délicatesse, la pureté de ses sentiments, me permettaient de me livrer avec lui aux douces impressions de l’amitié. Pour la première fois, je remerciai le conseiller. C’était à vrai dire la première consolation qu’il me donnait.
Kiniœkoff, après toutes les cérémonies d’usage entre gens qui ne se connaissent pas, me témoigna la plus grande confiance et le désir sincère de se lier avec moi. Il en chercha les moyens et les trouva sans peine. D’abord il me parla d’une petite bibliothèque dont il était possesseur ; quelle bonne nouvelle ! Il me promit des livres ; quel bonheur ! depuis si longtemps je n’en avais pu voir ! J’appris de lui que l’empereur avait défendu, depuis peu, l’entrée de tous les ouvrages étrangers dans ses États ; par conséquent, chaque livre de contrebande que l’on pouvait se procurer devenait un vrai trésor. Il me raconta que plusieurs de mes compositions avaient de la vogue en Sibérie. Et il ajouta, ce qui était bien flatteur, que mon arrivée à Tobolsk avait fait plus de sensation que celle des six généraux envoyés par l’empereur. Il finit par me proposer sa maison et sa table. Nous nous quittâmes après une heure d’entretien, très satisfaits l’un de l’autre.
Peu à peu je reçus les visites d’autres exilés ; d’abord le baron de Sommaruga, né à Vienne, qui se disait colonel au service de l’Autriche, et chevalier de l’ordre de Marie-Thérèse. Quinze jours après qu’on l’avait emmené, sa femme s’était séparée avec courage de ses parents, pour le rejoindre. Sans savoir un seul mot de la langue russe, et accompagnée d’un simple voiturier, elle s’était mise en route, décidée à aller jusqu’au lieu où son époux avait été exilé. Apprenant à Moscou qu’il était malade à Tver, elle était revenue tout de suite sur ses pas et l’avait retrouvé dans cette ville. Là, prodigue de soins envers lui, elle était parvenue à le guérir ; ensuite elle l’avait suivi jusqu’à Tobolsk. Je fus à même d’admirer cette merveille de constance et d’affection ; je pus admirer aussi sa charité ; car, dans les premiers jours de mon arrivée, comme je n’avais à manger que du pain, puisque je ne savais rien préparer moi-même, encore moins demander ce que je désirais, elle eut la bonté de m’envoyer plusieurs fois de la soupe et d’autres mets de sa table.
Je vis encore un autre exilé, le comte Soltikov, homme très âgé qui, à ce qu’on me dit, était déjà à Tobolsk depuis plusieurs années, pour avoir eu des livres prohibés. Ce comte tenait dans cette ville une fort bonne maison ; il savait plusieurs langues et paraissait être de très bonne société. Il me proposa de me faire lire les gazettes françaises et allemandes : j’acceptai avec reconnaissance.
Trois marchands de Moscou, dont deux Français, et un Allemand nommé Beker, furent du nombre de ceux qui vinrent me visiter. Ils avaient été exilés pour avoir fait la contrebande jusqu’à concurrence de la somme de deux cents roubles. M. Beker, surtout, me sembla un aimable et excellent homme. Sa femme était allée à Saint-Pétersbourg, dans l’espoir d’obtenir la grâce de son mari, et de le faire mettre en liberté. Si elle ne réussissait pas, il l’attendait avec ses enfants. Je fis des vœux secrets dans ce moment pour que ma famille fît route avec la sienne.
Trois ou quatre Polonais dont j’ai oublié le nom, et qui avaient été exilés pour affaires politiques, se présentèrent aussi chez moi. C’étaient de pauvres gentilshommes qui recevaient par jour de la couronne vingt kopeks pour leur nourriture et leur entretien. Enfin ma chambre ne fut pas vide de la journée. Ces hommages commençaient à devenir gênants, et je soupirais après le soir pour être seul et tranquille. Je désirais me jeter sur mon lit et m’y livrer à mes pensées.
Ce moment arriva. Je me couchai, mais j’eus une peine infinie à m’endormir. Il m’arriva cette nuit un singulier évènement, dont j’abandonne l’explication à mes amis Huffeland et Gall ; voici le fait :
Je m’éveillai tout à coup. Il me sembla que j’étais sur un vaisseau : non seulement j’en sentais le mouvement, mais encore j’entendais le murmure des vagues, les voix et les cris des matelots. J’étais cependant en pleine connaissance. Mon lit étant très bas, je ne pouvais apercevoir par la croisée que le ciel azuré ; cet aspect ajoutait à mon illusion. Enfin je croyais si bien que tout cela existait tel que je l’imaginais, qu’il me fut impossible de ne pas me lever. Eh bien ! mon erreur subsistait toujours. J’étais partagé entre ces deux sentiments de la crédulité et de l’illusion. J’avais beau me promener dans ma chambre, voir le conseiller qui dormait, retrouver tout ce que j’avais remarqué la veille, je me sentais toujours sur un vaisseau. Quand je m’approchai de la croisée pour fixer les maisons, je vis devant moi un grand édifice construit en pierre : il était seul immobile ; toutes les autres maisons de bois m’offraient l’aspect de bâtiments qui voguaient autour de moi sur l’immensité de la mer. « Où me conduit-on ? » me disais-je ; je me répondais à moi-même : « Nulle part ; je suis dans ma chambre, et mon erreur est complète. » On ne saurait décrire à quel point cet état fait souffrir. Je fus ainsi pendant une demi-heure. Peu à peu l’illusion se dissipa, et cessa tout à fait, il ne me resta qu’une forte palpitation de cœur. La crainte, le trouble avaient agité mes sens ; mais je n’avais ni mal, ni chaleur, ni oppression dans la tête. Je pensais que c’était un signe avant-coureur de la folie, et je me retraçai aussitôt l’image du vieillard à qui l’égarement ne laissait que le souvenir de sa famille. Si je dois devenir tel que lui, m’écriai-je, au moins que la même pensée m’occupe jusqu’à la mort 1 !
Le jour suivant je reçus la visite du conseiller de la cour, Peterson, chirurgien-major de Tobolsk, originaire de Revel : je me hâtai de lui raconter ce que j’avais éprouvé pendant la nuit. Il me répondit que cette espèce de délire provenait de la fatigue du voyage et des peines continuelles qui avaient un peu aliéné mon esprit ; mais il m’assura qu’il n’y avait aucun danger. Cette définition ne me parut pas très psychologique ; je m’en contentai à défaut d’une autre plus satisfaisante ; d’ailleurs, j’avais pour ce brave homme la prévention la plus favorable : c’était un compatriote de ma femme. Sans ce motif, il avait bien d’autres titres à mon estime : son humanité seule devait me le rendre infiniment cher, si l’intérêt qu’il me témoigna n’eût dû lui gagner toute ma confiance. Pendant mon séjour à Tobolsk, il me prodigua tous les secours de son art avec un empressement inimaginable ; il me soulagea même quand je fus loin de lui ; car j’avais emporté, par suite de ses conseils, une petite provision de médicaments qui me devinrent bien nécessaires à Kurgan, où je fus obligé d’être mon propre médecin. Il fit aussi tout ce qui dépendit de lui pour engager le gouverneur à me garder dans cette ville ; mais M. de Kuschelef ne pouvait déroger à l’ordre qu’il avait reçu. Il est toujours spécifié dans les instructions remises au gouverneur, aussitôt l’arrivée d’un prisonnier, que l’exilé est envoyé à Tobolsk, ou dans le gouvernement de Tobolsk. Dans le dernier cas, le lieu est quelquefois désigné, comme Bérésov, Omsk, etc. ; s’il n’est pas indiqué, le gouverneur est le maître de déterminer l’endroit ; et c’est là-dessus que mes amis fondaient leur espérance de me voir rester avec eux. Mais, suivant la règle générale, le gouverneur ne pouvait choisir de préférence Tobolsk. S’il prenait ce parti, ce n’était qu’en faveur de quelque prisonnier de peu d’importance, et duquel on ne s’occupait plus le lendemain de sa punition. Mais moi, j’étais par malheur trop connu : la manière dont on m’avait exilé avait été accompagnée de circonstances particulières qui devaient nécessairement faire ouvrir les yeux sur moi. Je devenais intéressant pour le public qui me voyait victime d’un acte arbitraire, et je l’étais bien davantage pour celui qui avait injustement provoqué mon exil ; alors le gouverneur ne pouvait faire pour moi ce qu’il eût osé si j’eusse été dans la foule du peuple ; il avait à craindre qu’on ne fît au ministre des rapports secrets qui le compromettraient. Je ne pouvais donc l’accuser s’il ne prenait pas envers moi une décision plus favorable ; je dirai même qu’il souffrit beaucoup de ne pouvoir accéder à la demande de mon médecin, qui appuyait la nécessité de mon séjour à Tobolsk sur les raisons de ma faible santé. Il ne lui fut possible que de m’accorder la permission de venir dans cette ville, toutes les fois que mes maux physiques l’exigeraient.
Je passai la première journée, pendant laquelle je me vis libre, à m’occuper du Mémoire que j’avais résolu d’envoyer à l’empereur. Comme j’avais rassemblé tous les matériaux utiles pour le faire, je n’avais plus besoin que de transcrire. Je le divisai en dix-huit articles, que j’appuyai chacun de la preuve la plus forte. Voici comment se terminait cette défense :
« Kotzebue croit avoir prouvé par tout ce qui précède que, depuis vingt ans, il a vécu sans reproche ; qu’il n’a jamais eu d’opinions révolutionnaires ; qu’il n’a jamais entretenu de correspondances cachées ; qu’il n’a jamais écrit sur la politique ; qu’il a toujours respecté et honoré ses souverains ; qu’enfin il aime sa femme, ses enfants, la vertu et l’obscurité.
» Par quelle faute a-t-il donc été assez malheureux pour attirer sur lui le courroux de sa Majesté l’empereur de Russie ? Il n’en sait rien ; il cherche en vain à le deviner. Il ne lui reste d’autre suspicion que celle-ci : un ennemi secret aura pu tirer de ses écrits quelques principes, quelques phrases, et les aura placés dans un jour défavorable. Plein de cette idée, il réclame de sa Majesté la permission, la grâce de se défendre. Elle n’ignore pas que les choses les plus innocentes peuvent être présentées d’une manière perfide. Kotzebue a pu se tromper souvent ; c’est un malheur qui arrive à tous les gens de lettres ; un mot irréfléchi, une phrase équivoque, échappent au plus scrupuleux des littérateurs ; mais il jure devant Dieu, comme devant sa Majesté, que cette faute est involontaire, et n’a jamais été préméditée ; il n’a jamais voulu s’écarter davantage des bornes du respect que de celles de la vertu. Si enfin il est coupable d’un pareil tort, n’en a-t-il pas assez supporté la peine ? C’est à la main paternelle de son souverain à le tirer de l’abîme où il est plongé quoique innocent, et à rendre au bonheur le plus soumis des sujets.
» Que sa Majesté daigne jeter un regard de pitié sur l’infortuné Kotzebue ; qu’elle envisage sa cruelle position ! La douleur creuse peut-être en ce moment le tombeau d’une malheureuse épouse. Bientôt aussi la fortune de Kotzebue sera renversée, et cette ruine entraînera celle de ses enfants ! Sa réputation est en jeu, et toute la terre va le croire coupable d’un crime : enfin, il est d’une santé faible et languissante, et manque de tout dans un climat affreux. Le désespoir, la misère, les souffrances auront bientôt fini d’épuiser les sources déjà éteintes de sa vie. Un époux tendrement chéri, un père de six enfants sera abandonné de toute la nature, au moment de rendre le dernier soupir ! Et ce sera là le sort d’un innocent ! Non... non ! Paul le juste, Paul vit encore ; il rendra à cet infortuné l’honneur, la vie et le repos, en le ramenant dans les bras de sa famille. »
Lorsque j’eus fini ce Mémoire, le conseiller de la cour entra, et me dit qu’il allait faire une visite au gouverneur. Je le priai de s’informer de l’heure à laquelle je pourrais le lendemain lui rendre mes devoirs, et lui faire part de ce que j’avais écrit. Il me promit de le faire. Je relus, pendant son absence, plusieurs fois mon Mémoire, et le trouvant simple comme la vérité, je brûlai d’impatience de voir le conseiller rentrer de chez M. de Kuschelef. Il rentra en effet peu de temps après, et m’annonça que M. le gouverneur serait à mon service depuis cinq heures du matin jusqu’à onze du soir. Il était impossible de me témoigner plus de déférence : aussi le conseiller ne pouvait concevoir comment on avait tant d’égards pour un exilé, et comment on faisait si peu de cas de sa propre personne.
Le lendemain matin, je me rendis de bonne heure chez M. de Kuschelef, et sans être accompagné de gardes. Il me reçut avec une considération marquée. Je lui lus mon Mémoire. À la fin de la lecture, à l’endroit où j’invoque l’empereur, où j’implore son humanité, pour qu’il ne fasse pas périr à la fois ma femme et moi, pour qu’il ne ruine pas mes enfants ; à ce moment, dis-je, il ne put retenir ses larmes, me prit la main avec affection, la pressa vivement, et dit avec une assurance consolante : « Soyez tranquille, monsieur, votre malheur ne peut durer. » Il eut ensuite la bonté de relire lui-même mon Mémoire, d’en peser chaque phrase, chaque mot, et de me montrer les expressions qu’il croyait nécessaire d’adoucir. Je notai exactement toutes ses remarques ; je fis les sages corrections qu’il me demanda, et je remis le tout au net, sur de beau papier qu’il eut la complaisance de m’offrir. La copie faite avec soin, je la déposai entre ses mains, comme un gage de ma confiance en lui, et comme le monument du malheur et de l’innocence. Il la prit, m’assurant qu’il l’enverrait à l’empereur par le conseiller qui m’avait accompagné, et qui devait retourner à la capitale sous peu de jours. Je le remerciai de tant de bienveillance. Il me fit voir, par son émotion sincère, que tout ce qu’il serait obligé de statuer contre mon désir lui coûterait infiniment.
Comment ne pas reconnaître toute ma vie de pareils traits de générosité ! Voilà bien le type de l’homme en place ; il sait ne pas confondre la victime avec le coupable ; il sait ce qu’on doit à l’infortuné, fidèle à la vertu. Il ne tenait qu’à M. de Kuschelef de m’envoyer à Bérésov, sur les côtes de la mer Glaciale, où, dans les jours les plus chauds, on voit à peine quelques portions de terre dégelées, mais cet homme respectable choisit exprès le climat dont il connaissait les habitants pour de braves et honnêtes gens. Au lieu de m’abandonner à Tobolsk, et de me laisser dans une affreuse solitude, il m’invita tous les jours à sa table ; il brava pour moi les regards de deux sénateurs qui étaient alors présents pour surveiller son administration. C’étaient précisément ceux à l’occasion desquels le courrier m’avait donné à Kasan une espérance à la fois si douce et si cruelle.
M. de Kuschelef fit encore plus : comme il s’aperçut que je n’étais pas très versé dans la langue russe, et que souvent cette ignorance me mettait dans le plus grand embarras, il me permit de prendre un domestique qui, outre la langue russe, en saurait une autre avec laquelle je serais familier. Cette nouvelle attention me fit un plaisir inexprimable : mais le choix d’un pareil sujet n’était pas très facile à Tobolsk ; il ne s’y trouvait qu’un seul homme, un Italien nommé Rossi, qui pût remplir mes vues. Il était aussi exilé depuis vingt ans ; ayant servi autrefois sur la flotte de Cherson, il avait fait, avec plusieurs de ses camarades, le complot d’assassiner l’officier qui les commandait, et de livrer leur vaisseau aux Turcs : la conjuration avait été découverte avant qu’elle pût être mise à exécution, et mon Rossi avait été envoyé par le prince Potemkine en Sibérie ; il s’était fait inscrire comme paysan, et était obligé de payer les impositions ; mais il recevait chaque année une passe du prévôt de village, pour se nourrir par son travail dans la ville. Aussi savait-il mille métiers : aujourd’hui il faisait des habits ou des souliers ; demain des pâtisseries ; il se présentait aux voyageurs comme domestique de place, et les suivait partout, lorsqu’ils ne dépassaient pas les frontières du gouvernement ; en un mot, c’était une espèce de factotum. Une physionomie fine, le regard vif et rusé, faisaient connaître au premier abord son caractère. Son talent inné était de tromper, et le gouverneur me prévint de me méfier de lui, parce qu’il avait déjà friponné les cent maîtres qu’il avait servis. De tels renseignements n’étaient pas faits pour m’inspirer beaucoup de confiance dans M. Rossi ; rien n’était moins rassurant que la société d’un tel homme : il pouvait fort bien recommencer le complot qu’il avait tramé contre l’officier de son bord ; il pouvait me dévaliser comme il avait coutume de le faire ; cependant j’avais besoin de lui ; il me devenait de plus en plus indispensable, et je ne pouvais faire un autre choix, puisque lui seul réunissait les avantages de parler le français aussi couramment que le russe, de faire le pain et la cuisine, et de connaître tous les endroits du pays. Je le pris donc à mon service, moyennant la nourriture, et trois roubles et demi par mois. Le gouverneur eut encore la bonté de m’accorder la permission de l’emmener avec moi quand je partis pour Kurgan ; faveur, qui, si elle eût été sue à Saint-Pétersbourg, eût pu lui faire perdre son gouvernement. À la vérité, le nom de Rossi ne fut point porté sur la passe de poste que l’on me donna ; ce coquin de valet n’avait pas besoin de passe, par la connaissance qu’il avait de tous les villages ; il n’était jamais rencontré, et voyageait librement.

Mais revenons à toutes ces honnêtes personnes de Tobolsk, qui s’étaient empressées tour à tour de me visiter. Rien ne s’opposait à ces liaisons aimables, on venait chez moi, j’allais chez les autres : c’était mon nouvel ami Kiniœkoff qui me voyait le plus souvent ; à peine était-il sorti de ma demeure, que je courais le retrouver dans la sienne. Il avait un logement aussi propre que commode ; sa bibliothèque, qui consistait pour la majeure partie en ouvrages français, me fit passer bien des moments agréables : je lui empruntais des livres ; j’allais seul me promener hors de la ville et me livrer aux douces émotions de la nature, au charme bienfaisant de la poésie.
Rien n’était plus consolant pour moi, au sein de la captivité, que cette espèce d’indépendance. La société, les marques d’estime et de considération, la lecture, l’amitié, tout versait un baume adoucissant sur les blessures encore fraîches de mon pauvre cœur. J’avais été si martyrisé par le conseiller, que j’étais forcé de trouver mon nouveau sort plus heureux, ou plutôt moins cruel : aussi je goûtais avec délices tous ces instants de liberté, et surtout je ne cessais de remercier M. de Kuschelef des égards et de l’humanité qu’il avait pour moi. Hélas ! tant de douceurs ne furent pas de longue durée ! Un matin le gouverneur me fit appeler. Je vis, en entrant chez lui, l’embarras peint sur sa figure ; je tremblai ; il le remarqua, et ne me laissa pas plus longtemps dans l’incertitude : « Votre arrivée, me dit-il, continue de produire dans cette ville une sensation si extraordinaire, qu’il m’est impossible de vous regarder comme un simple exilé ; je suis forcé d’être, au contraire, très circonspect à votre égard. Le conseiller, votre conducteur, ne se dispose pas encore à s’en retourner. Peut-être a-t-il reçu en secret l’ordre d’examiner ma conduite envers vous ; et ce sont des gens pour qui la plus petite attention envers les exilés est un crime punissable. Peut-être aussi les sénateurs, qui se trouvent dans mon gouvernement, remarqueront-ils que je vous traite plutôt en ami qu’en prisonnier. Votre propre sûreté et la mienne exigent donc impérieusement que je restreigne la liberté que je vous ai laissée jusqu’ici. Je me vois forcé de vous prier (car je n’ai pas le courage de vous l’ordonner), de vous prier, dis-je, de ne plus recevoir d’autre visite que celle de votre médecin, et de n’aller chez personne que chez lui et chez moi, car ma maison vous sera toujours ouverte. »
Des inquiétudes fondées sur des motifs aussi puissants ne pouvaient m’indisposer contre M. de Kuschelef. J’étais bien loin de vouloir compromettre un homme aussi généreux, et qui avait mis tant de délicatesse à m’obliger. Je ne pouvais douter que ses craintes ne fussent sincères : il s’exprimait avec cette candeur qui décèle la vérité. Où a-t-on vu un supérieur comme lui prier ses subordonnés de se rendre à ses raisons, et n’appuyer la nécessité de ses rigueurs que sur le bien qui peut en résulter pour eux ? Le gouverneur ne me vit donc pas recevoir avec déplaisir un ordre qui me séparait cependant d’une société charmante, et à laquelle j’étais déjà très attaché. Sa bonté, en me faisant part de ses sollicitudes, devait m’imposer silence sur les regrets que j’éprouvais ; je ne lui dis rien autre chose que de lui demander la permission de voir seulement M. de Kiniœkoff. À ce nom il leva les épaules, et me répondit : « J’estime beaucoup l’amabilité de ce jeune homme ; il a vraiment de l’instruction et du mérite ; ses formes sont douces et affables, sa compagnie est amusante ; moi-même je suis charmé de me trouver avec lui ; mais c’est un des exilés qu’il est le plus dangereux que vous voyiez souvent. M. de Kiniœkoff est innocent, je le crois, j’en suis même persuadé : cependant il est mal vu à la cour de Saint-Pétersbourg, et je crains qu’une intimité publique avec lui ne vous fasse partager la haine qu’on paraît lui porter injustement. C’est donc encore pour votre bien que je vous chagrine par ce nouveau refus. » Que pouvais-je dire à cela ? Chaque parole de M. de Kuschelef n’était-elle pas un trait de bienveillance pour moi ? Cet homme respectable ne voyait que mon bonheur ; et comme un père qui aperçoit son enfant se jeter dans un buisson d’épines, il s’empressait de me garantir de tous les dangers auxquels je m’exposais étourdiment. Je le quittai donc, en l’assurant de mon obéissance. Il chercha à lire dans mes yeux quel était le sentiment qui m’agitait, si je prenais bien ou mal ses observations ; il n’y trouva que l’expression de la plus vive amitié ; et nous nous séparâmes, comme les autres jours, en nous promettant de nous revoir bientôt.
Je rentrai chez moi. Jusque-là je n’avais eu pour ma garde qu’un bas officier, nommé Ivanovitch, homme fort avancé en âge ; j’en trouvai un second, plus jeune. Mon vieillard, quoique borné, était assez bon diable, et ne m’avait gêné en rien, car il passait toute la journée à dormir ; je craignais que le nouveau venu ne fût plus sévère ; mais je fus bientôt détrompé : tous deux se disputèrent le plaisir de m’être utiles ; c’était à qui me servirait plus promptement : ils me faisaient mon thé, allaient au marché prendre les provisions, se chargeaient de tous mes messages ; seulement ils refusaient l’entrée de ma demeure à toute autre personne que le médecin, et chaque fois que je sortais, un d’eux m’accompagnait toujours. Je ne pouvais leur en vouloir ; ils exécutaient leur consigne. Je m’aperçus bientôt qu’il leur était recommandé de prendre garde que je ne parlasse à qui que ce fût, et surtout que je n’entrasse dans aucune maison étrangère. Ces bonnes gens y mettaient de la douceur, et ne se plaignaient jamais, malgré le chemin que je leur faisais faire à l’intérieur ou au dehors de la ville, où j’étais libre d’aller.
Je me trouvais néanmoins un peu contrarié de ne pouvoir correspondre avec mes amis ; il fallut que j’eusse recours à la ruse : mon intelligent domestique me servit avec adresse. Nous nous donnions rendez-vous au marché, dans les boutiques couvertes ; et là, en faisant semblant de marchander quelque chose, nous trouvions le moyen de nous dire quelques paroles à la dérobée. Je pouvais me reposer sur la discrétion des marchands. J’avais remarqué que le malheur d’être exilé en Sibérie donnait des droits à l’estime générale et à l’assistance publique. Plusieurs marchands que je voyais pour la première fois de ma vie me proposaient tout bas, en passant devant leur boutique, de se charger d’une lettre pour ma famille. « Confiez-vous à moi, me disaient-ils, je vous proteste que je ne vous trahirai pas, et que votre lettre sera remise exactement. » Ces propositions les rendaient d’autant plus recommandables à mes yeux qu’elles m’étaient faites sans aucun intérêt de leur part, et qu’elles n’étaient payées en aucune manière. Ce qui me fit observer que les exilés dans ce pays y sont traités, pour la plupart, avec ménagement, et même avec bienfaisance, c’est qu’on les nomme Neschtschastii, malheureux. Passe-t-il un d’entre eux dans la rue ? on dit : « Voilà un malheureux. » Je n’ai jamais entendu nommer différemment les exilés, ou du moins on ne leur donne jamais de nom qui puisse rappeler l’image de quelque crime. Il faut avouer aussi qu’on y est généralement persuadé de leur innocence. De là vient sans doute l’intérêt qu’ils inspirent.
Je dois dire que les étrangers se font de ces mots, exil en Sibérie, une idée très sombre et assez inexacte ; aussi je crois leur rendre service en mettant sous leurs yeux les différentes classes d’exilés.
Première classe. – Ce sont les personnes reconnues pour criminelles par la justice, et suivant les lois, leur arrêt a été confirmé par le sénat de Saint-Pétersbourg. Ces coupables sont, outre la peine de l’exil, condamnés à travailler aux mines de Nertchinsk ; ils font la route à pied et enchaînés. Leurs souffrances sont mille fois plus cruelles que la mort : ils ont ordinairement reçu le knout avant leur départ, et leurs narines ont été fendues.
Deuxième classe. – Elle est composée des personnes reconnues également coupables par la justice, suivant les lois, et dont l’arrêt a été confirmé par le sénat de Saint-Pétersbourg ; mais leur crime étant moins horrible, elles sont inscrites en Sibérie comme s’occupant de culture, et sont obligées de travailler à la terre. On voit aussi parmi elles beaucoup de nez fendus. Ces coupables peuvent, s’ils sont laborieux, gagner assez d’argent pour adoucir leur sort et se mettre à même de supporter agréablement leur captivité. Cette punition, les contraignant au travail, est propre à leur inspirer des remords et à les ramener à la vertu.
Troisième classe. – Elle est composée de gens qui ont été condamnés, suivant les lois, à l’exil pur et simple, sans aucune autre circonstance afflictive et déshonorante. S’ils sont nobles, ils ne sont pas déchus de leurs titres à cause de ce châtiment ; il leur est permis de vivre librement dans le lieu qui leur est assigné, de faire venir l’argent qui leur est nécessaire ; lorsqu’ils sont pauvres, ils reçoivent de la couronne vingt, trente kopeks par jour, quelquefois davantage.
Quatrième classe. – Elle est formée de ceux qui, sans arrêt et sans aucun droit, sont exilés par le seul ordre et la seule volonté du souverain. Ces derniers sont ordinairement traités comme ceux de la troisième classe : on leur permet d’écrire à leur famille et à l’empereur ; il faut seulement que leurs lettres soient remises entre les mains du gouverneur. Plusieurs exilés de cette classe sont néanmoins conduits dans des places fortes, et tenus aux fers ; mais, Dieu merci, ce cas est très rare 2.
Je ne sais dans laquelle des deux dernières classes était mon malheureux compagnon de voyage, le lieutenant-colonel de Rœsan, dont je n’ai point parlé depuis longtemps, quoique nous ayons fait presque toujours route ensemble ; mais il me parut qu’il était destiné à éprouver un sort bien cruel. À son arrivée à Tobolsk, le gouverneur lui avait d’abord fait espérer qu’il resterait dans cette ville : ranimé par cette espérance, il avait commencé à s’y établir ; mais il reçut, le surlendemain, l’ordre subit de se rendre sur-le-champ à Irkoutsk. Deux heures après, il était déjà parti, et je n’entendis plus parler de lui ; à peine lui laissa-t-on le temps d’envoyer chercher chez son tailleur ses habits qui n’étaient encore que coupés. Il fallait que M. de Kuschelef, si généralement reconnu pour un homme humain et bienfaisant, eût de bien graves raisons pour employer contre ce malheureux de pareilles mesures de rigueur.
Pour moi, toujours dans la même situation, je passais beaucoup de temps à écrire à ma femme. Plus de dix lettres devaient être arrivées jusqu’à elle, par l’entremise de mes nouveaux amis, et par le moyen des honnêtes marchands. Du reste, je jouissais d’une meilleure santé, et je cherchais à me distraire autant qu’il m’était possible ; je n’étais plus gêné dans ma solitude par la présence de mon conseiller, qui logeait chez un de ses amis : aussi j’employais mes après-dînées à écrire l’histoire de mes malheurs. Je n’avais point d’encre, mais j’en faisais avec un bâton d’encre de Chine, que je délayais dans un petit vase. Vers midi, j’allais faire un tour de promenade ; je gravissais les rochers qui sont autour de Tobolsk, et qui s’élèvent pittoresquement au milieu des torrents impétueux ; je découvrais les vastes plaines d’eau et les immenses forêts dont elles sont entourées ; mon œil se reposait sur chaque navire que j’apercevais ; mon imagination ardente me faisait croire que ma famille naviguait vers moi, et je regardais avec angoisse si je ne la verrais point débarquer. Après ces continuelles illusions, je revenais dîner chez le gouverneur, ou chez le conseiller de la cour, Péterson : je mangeais rarement chez moi. C’était surtout auprès de M. de Kuschelef que j’aimais à me trouver ; je ne le quittais jamais sans quelque consolation, ou sans quelque adoucissement à mes peines : la sensibilité de son cœur lui faisait toujours découvrir de nouvelles routes pour parvenir jusqu’au mien ; il savait saisir avec empressement la moindre occasion de faire luire à mes yeux un rayon d’espérance.
Hélas ! lui-même n’était pas très heureux. Souvent, lorsque nous nous trouvions en tête-à-tête dans le pavillon de son jardin, et que nous promenions nos regards sur la plaine argentée et sur les bois à perte de vue, il laissait échapper un soupir, et me dévoilait ses secrets sentiments. « Voyez-vous, me disait-il, ces forêts qui s’étendent au-delà d’un espace de onze cents verstes, jusqu’à la mer Glaciale ? Personne n’a encore osé les traverser ; elles sont habitées par des bêtes sauvages : cependant elles sont dans mon gouvernement ; il embrasse un territoire plus vaste que l’Allemagne, la Turquie et la France réunies ; mais quels avantages, quels plaisirs en puis-je retirer ? Dans l’intérieur même de la ville où je gouverne, quels sont mes agréments ? Il ne se passe pas un jour sans que je sois affligé par un spectacle cruel. On traîne devant moi des infortunés, seuls ou par troupes, et je ne dois ni ne peux les secourir. Leurs cris seuls déchirent mon cœur : eh bien, il faut que je prononce un arrêt qui ajoute à leur désespoir ! Si je fléchis, si je ne suis pas insensible comme l’exige le poste que je remplis, je m’expose à le perdre. Une responsabilité effrayante pèse sur moi ; et quoique je m’acquitte bien de mon devoir, qui me répondra qu’un rapport secret et calomnieux ne compromettra pas mon honneur et ma liberté ? Ce malheur est toujours possible. Je n’en serai instruit qu’au moment où une sentence injuste me frappera. C’est une triste existence que de vivre au milieu des infortunés, dans un pays sauvage, et sous le glaive de l’autorité arbitraire ! »
J’oubliais alors mes propres infortunes, pour consoler cet honnête gouverneur, aussi vertueux que sensible. Je lui disais qu’il était placé à ce poste par le Ciel lui-même, comme le père et l’ami des malheureux ; je le priais de ne pas donner sa démission, comme il était souvent tenté de le faire. « Que deviendraient, m’écriais-je avec chaleur, tous ces pauvres exilés qui sont sous votre surveillance paternelle ? Le seul soulagement qu’ils éprouvent dans leur adversité, c’est de se voir entre les mains d’un homme juste et bon, qui adoucira leur misère plutôt que de l’augmenter. Les bénédictions de ces innocentes victimes rassemblées autour de vous avec respect, avec amour, n’ont-elles aucun attrait pour votre âme ? Ces prisonniers font entendre leurs cris, quand ils arrivent à vos pieds ; mais dès qu’ils se voient dans vos bras, ils ne versent plus que des larmes secrètes, et leur douleur se calme peu à peu. Restez dans un poste où vous ne cherchez qu’à faire du bien, où vous vous honorez par la générosité, où vous vous faites estimer par une douce puissance ! Vous sacrifiez, dites-vous, à un devoir rigoureux des moments que vous voudriez passer dans le repos ; mais vous avez comme moi de la religion, votre bon cœur me le dit assez : vous croyez donc que tout ne finit pas avec cette vie et qu’au moment où nous en sortirons, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu. C’est là qu’il faut attendre votre récompense. Aussi bien, est-on jamais récompensé de ce qu’on fait pour ce monde-ci ? Cette vie tranquille, à laquelle vous aspirez, pourriez-vous vous promettre qu’elle ne fût pas empoisonnée par la méchanceté des hommes, les maladies ou les accidents ? Non, il n’y a rien de stable ici-bas. Ne travaillez plus que pour ce monde meilleur où un juste salaire de vos sacrifices vous est réservé. Encouragez-vous à la pensée des nombreux témoins et défenseurs que vous retrouverez aux pieds du souverain Juge. Vous nous y verrez tous, malheureux exilés, l’environnant, et lui répétant à l’envi : « Il a mêlé ses larmes aux nôtres, lorsqu’il n’a pu en tarir la source ; il a tâché de calmer nos souffrances, quand il n’a pu les faire cesser ; c’est le bienfaiteur par excellence ; il mérite toutes les faveurs du Ciel. » Comment le Créateur pourrait-il ne pas vous faire jouir d’une félicité proportionnée au bien que vous aurez fait sur la terre ? »
J’avoue que je ne saurais dire à quel point ces réflexions, puisées dans mon âme, charmaient celle de ce respectable gouverneur. Il me laissait voir qu’il partageait mes pensées et que je le récompensais bien des égards qu’il tâchait d’avoir pour moi.
Je le quittais habituellement après ces petits entretiens, pour me promener dans la ville ou pour me rendre au marché. La ville est assez grande ; elle a trois rues droites et larges. Quoique les maisons soient presque toutes bâties en bois, le coup d’œil n’en est pas moins agréable : on y voit du reste quelques bâtiments construits en pierres, mais d’une architecture moderne. Les églises, dont il y a un grand nombre, sont toutes en pierres ; les rues sont à moitié planchéiées en solives, ce qui est plus propre que des pavés, et plus commode pour les piétons. Toute Ia ville est coupée par des canaux navigables, sur lesquels sont établis de très beaux ponts. Le marché ou bazar est grand, et l’on y trouve, outre les objets de nécessité journalière, des marchandises d’Europe et de la Chine : ces dernières sont, à la vérité, très chères, mais on peut se procurer les premières à très bon compte. Chaque marché fourmille toujours d’hommes de différentes nations, plus particulièrement de Russes, de Tartares, de Kirghizs et de Kalmouks : ils y apportent des poissons de toute espèce et en quantité innombrable. Ce spectacle était tout à fait nouveau pour moi ; une foule de poissons, que je connaissais seulement d’après les descriptions que j’en avais lues, étaient tous les jours en vente, dans de grandes barques ou dans des chaloupes. Les esturgeons, qui sont si chers ailleurs, se donnaient pour une bagatelle. Je remarquai le poisson royal, la bisa et beaucoup d’autres de toute couleur et de toutes proportions. J’eusse visité plus souvent ces marchés s’il n’y eût pas régné une odeur insupportable.
Il y avait encore à Tobolsk une autre ressource pour passer le temps ; c’était un casino qui était tenu par un Italien. Les narines de cet exilé étaient fendues ; puni comme assassin, il avait résisté au knout. Son casino le faisait vivre : je ne voulus jamais y aller.
Pendant mon séjour dans cette ville, je fus aussi témoin des mascarades qui eurent lieu en l’honneur des deux sénateurs qui venaient d’arriver. On me pria avec beaucoup d’instance d’y figurer. Je refusai constamment. Je n’étais pas désireux de mettre ma misère au grand jour : au lieu de chercher ces divertissements, j’allais hors de la ville ; je préférais admirer la campagne, et m’y livrer à mes réflexions. Cependant ce plaisir de la promenade ne m’était pas toujours possible ; quelquefois, le matin et à midi, une chaleur insupportable m’en privait ; le soir, c’étaient les mouches qui me retenaient chez moi. On ne peut se faire une idée du temps qu’il faisait à Tobolsk pendant l’été : presque tous les jours, d’abord, le thermomètre de Réaumur montait à 26 ou 28 degrés ; ensuite cinq ou six orages nous venaient de toutes les régions célestes, et procuraient une pluie abondante qui pourtant ne rafraîchissait pas l’air. Croirait-on que, malgré cette chaleur, la nature était très avare de ses dons ? Je n’ai pas vu un seul arbre fruitier. Le jardin du gouverneur, qui est le plus beau du pays, est entouré de murs en planches, sur lesquels on a peint des arbres fruitiers. À la vérité, il était très orné de viornes, de pois de Sibérie et de bouleaux. Ce dernier arbre est très commun en Sibérie, mais il est presque toujours tordu ; on prend de loin les plus vieux bouleaux pour des arbres d’une jeune pousse. La viorne est préférée à Tobolsk. Chacun en plante dans les rues, devant sa maison, sans doute à cause de ses fleurs, qui ont la plus agréable odeur. Ce que j’ai remarqué encore dans le jardin du gouverneur, ce sont des groseilliers verts et rouges, quelques pieds de choux, et des concombres en espérance. Du côté de Tinnen, il croît une espèce de pommiers qui donnent des fruits gros comme des noix.
Mais si la nature a privé d’arbres fruitiers cette partie de la terre, elle n’en est que plus prodigue en fruits de la campagne. Le blé noir de Sibérie, qui est si renommé parmi nous, se sème tous les ans de lui-même ; on ne se donne d’autre peine que de le recueillir : toute espèce de grains réussit parfaitement, et l’herbe y croît d’une manière étonnante. Partout la terre ressemble à ce terreau de jardin qui n’exige point d’engrais. C’est si vrai que le fumier abonde au point de porter le paysan à une extrémité ridicule. Le conseiller de la cour Péterson, qui, en qualité de physicien officiel, est obligé de faire des tournées dans le pays, m’a raconté qu’il se trouva plus d’une fois dans des villages où les paysans abattaient leurs maisons pour aller s’établir plus loin ; ils trouvaient plus facile de transporter leur cabane que les tas de fumier qui les environnaient.
Le froid, dans ce pays, est aussi insupportable en hiver que la chaleur l’est en été ; le thermomètre descend jusqu’à quarante degrés. Le conseiller de la cour m’a dit encore que tous les hivers, il faisait l’expérience de laisser geler du vif-argent, pour en former ensuite, avec un couteau, toutes sortes de figures qu’il envoyait, emballées dans de la neige, à M. de Kuschelef.
Du reste ce climat, malgré son excessive chaleur et son froid épouvantable, est très sain. Mon docteur m’a souvent assuré qu’on n’y était guère sujet qu’à la fièvre causée par le changement subit de la température ; or, avec un habit chaud, on n’est point exposé à trop sentir le refroidissement de l’air. Ainsi donc il suffit de ne point faire d’excès et de prendre quelques précautions contre le froid pour se porter à merveille en Sibérie, et l’on y parvient à un âge très avancé.
Le terme de ma permission pour Tobolsk approchait, et M. de Kuschelef ne me disait rien de mon départ. Je me flattais donc de l’espoir d’y rester. Mes amis présumaient que, pour m’annoncer cette heureuse nouvelle, il attendait que les sénateurs et le conseiller se fussent éloignés. Les premiers partirent pour Irkoutsk, mais l’autre ne paraissait pas disposé à retourner à Saint-Pétersbourg : enfin je vis passer tout à fait les quinze jours, terme fatal où je devais être instruit de mon sort. Le dimanche suivant, je me rendis, comme il était d’usage, à l’audience du gouverneur, avec tous les exilés de la troisième et quatrième classes, qui se faisaient un devoir de se trouver chez lui ce jour-là en uniforme, mais sans épée. Le gouverneur me prit à part, et m’annonça qu’il fallait que je me disposasse à partir le lendemain matin, et me répéta avec chagrin les motifs qui l’avaient déjà forcé de restreindre ma liberté. Je ne puis dire l’effroi que cet ordre me causa ; je n’eus pas la force de répondre : « J’obéirai. » Ce ne fut que longtemps après qu’il me fut possible d’articuler une parole. Alors je priai le gouverneur de m’accorder encore deux jours qui m’étaient nécessaires pour réunir plusieurs provisions de première nécessité que je ne pourrais pas trouver à Kurgan. Je prétextai qu’il me fallait ce temps-là pour vendre ma voiture dont je n’avais plus besoin, et dont l’argent me servirait à réparer le déficit de ma bourse. Le gouverneur se rendit à cette nouvelle demande avec toute la grâce possible, et je me hâtai d’aller faire mes tristes apprêts afin de ne pas abuser de ses bontés.
Le plus riche marchand de Tobolsk m’avait, quelques jours auparavant, offert cent cinquante roubles de ma voiture : comme elle m’avait coûté plus du double, je m’étais refusé à la lui vendre ; mais la nécessité me força de lui faire savoir que j’acceptais ses offres, quelque désavantageuses qu’elles fussent. Ce Juif eut la bassesse, sachant que j’étais obligé de partir promptement, de ne vouloir plus la prendre qu’à cent vingt-cinq roubles : je fus révolté, mais il fallut que je consentisse à passer par tout ce que voulait ce détestable marchand. Je lui donnai donc ma voiture, car je ne peux pas appeler cela vendre. Le gouverneur, en apprenant ce calcul mercantile, fut de si mauvaise humeur, qu’il me proposa très sérieusement de faire de cette anecdote une petite pièce en français, qu’il se chargerait de traduire en russe ; il ajouta qu’il la ferait représenter sur le théâtre de Tobolsk. Je souris à ces propositions, mais je n’étais pas dans une situation d’esprit à faire des comédies.
Aussitôt ce marché terminé, je fis ma provision de thé, de sucre, de papier, de plumes et autres choses semblables. Hélas ! je ne pouvais me munir également de livres ; cependant me serait-il possible de passer l’hiver sans m’occuper de lecture ? Le bon M. Péterson m’offrit bien tous ceux qu’il avait, mais sa bibliothèque consistait principalement en livres sur la médecine ; il avait quelques voyages que je connaissais déjà. Ce n’était que mon ami Kiniœkoff qui pouvait me procurer ce que je désirais si ardemment. Je commençai par lui faire savoir mon départ ; ensuite je lui écrivis que j’étais au désespoir de m’éloigner sans emporter avec moi quelques bons livres : il me fit répondre de l’attendre à minuit à ma fenêtre. Je ne manquai pas d’être exact au rendez-vous, et trois nuits de suite il eut la complaisance de m’apporter lui-même les meilleurs livres de sa bibliothèque.
Au milieu de tous les préparatifs qui m’occupaient, je me gardai bien d’oublier d’écrire à ma femme et à une douzaine d’amis, tant en Allemagne qu’en Russie ; je fis un paquet de ces lettres, je l’adressai à mon ancien et fidèle ami Graumann, négociant à Saint-Pétersbourg, et j’en chargeai Alexandre Schulkins, en l’assurant que s’il le remettait avec exactitude à mon ami, il lui serait compté cinquante roubles. Ce moyen me parut le meilleur pour que je ne fusse pas encore trompé. La suite m’a prouvé que j’avais raison : beaucoup de gens font par intérêt ce qu’ils dédaignent de faire par générosité.
Aussitôt que je fus prêt à partir, j’allai moi-même l’annoncer au gouverneur. Il vit avec plaisir que je me soumettais assez courageusement à cette dure nécessité, et me demanda s’il était encore en son pouvoir de faire quelque chose pour moi. Je profitai de sa bonne volonté pour obtenir une petite faveur à laquelle je mettais un grand prix. Je savais qu’un bas officier devait m’accompagner jusqu’à Kurgan ; je manifestai le désir que le choix tombât sur mon bon André Ivanovitch, malgré son grand âge et son habitude d’un sommeil perpétuel. M. de Kuschelef, qui ne pouvait rien me refuser, m’accorda cette nouvelle grâce. Il me pria ensuite, à son tour, d’accepter des lettres de recommandation pour les premiers habitants de Kurgan. Il me fit présent d’une petite caisse pleine de thé de la Chine, et me promit de me faire passer toutes les semaines le Journal de Francfort, qu’il recevait exactement. Rien ne pouvait me plaire davantage que ces petites attentions ; la dernière surtout méritait toute ma reconnaissance, à raison des dangers qu’elle faisait courir à M. de Kuschelef.
Quand on eut chargé le vieux chariot qui avait déjà servi, je fis mes adieux à mon conseiller de la cour. Il me dit que son départ était irrévocablement fixé au lendemain du mien. J’appris alors que le manque d’argent l’avait seul forcé à rester si longtemps à Tobolsk, qu’il attendait un marchand qui, n’ayant point de passe de poste, ferait le voyage à la faveur de la sienne. Je priai M. le conseiller de vouloir bien ne pas oublier qu’il était porteur de mon Mémoire à l’empereur. Il me jura de le remettre lui-même à son adresse. Il partit le lendemain, mécontent du gouverneur, qui, pendant son séjour à Tobolsk, ne l’avait pas une seule fois invité à dîner. M. de Kuschelef ne voulait point à sa table des gens mal élevés.
Ce fut le 13 juin, à deux heures après-midi, qu’après avoir pris congé de tous mes amis, je me rendis tristement au rivage, où j’aperçus le chariot sur la nacelle. Bon gré mal gré, il me fallut prendre la route de Kurgan, qui conduit d’abord à la petite ville de Jaluterski ; on compte jusque-là quatre cent vingt-sept verstes. Les eaux étant considérablement montées, nous fûmes forcés de nous retirer jusqu’aux frontières de Tinnen, afin de pouvoir nous diriger, de là, du côté du midi. Nous passâmes la nuit à Tinnen, chez un écrivain qui nous donna l’hospitalité avec une complaisance infinie. Nos chevaux furent payés dans cette route au prix de l’ukase, c’est-à-dire, un kopek pour deux chevaux par verste.
À quelque distance de Tinnen, je vis dans un bois humide une merveille de botanique que j’ai souvent racontée à d’habiles naturalistes, et qui leur parut nouvelle. Il y avait, dans un espace d’environ six cents pas, une quantité innombrable de fleurs rouges, sur lesquelles semblait être un petit tas de neige : ce spectacle me frappa ; je fis arrêter ma voiture ; je courus à l’endroit où j’avais jeté les yeux, et je trouvai cette fleur vraiment surprenante. Sur une tige d’environ cinq pouces, ornée de feuilles qui diffèrent très peu de celles du muguet, pendait un petit sac à ouvrage comme ceux que portent les dames : ce sac pouvait avoir un pouce et demi carré ; il était garni, aux coins supérieurs, de rubans pour le fermer. Il était décoré d’une feuille, sous la forme d’un cœur parfaitement proportionné, dont la superficie, blanche comme de la neige, paraissait émaillée, mais dont les parties inférieures se rapprochaient de la principale couleur, qui était purpurine : on pouvait facilement voir dans ce petit sac, l’ouvrir et le fermer à volonté. Je ne saurais exprimer combien cette fleur, qui du reste n’avait aucune odeur, me parut charmante. Je doute que je me sois expliqué d’une manière scientifique, mais du moins j’ai donné l’idée de cette petite merveille, et je pense qu’elle serait un ornement délicieux pour nos jardins. Combien j’ai de regrets de n’en avoir pas pris quelques pieds avec moi ! mais la voyant en si grande quantité, je crus qu’elle était commune en Sibérie : j’appris trop tard que personne, au contraire, ne la connaissait.
À une demi-journée de Kurgan, nous passâmes la nuit chez un pope, où nous trouvâmes une chambre très commode, des lits très bons, et où nous reçûmes l’accueil le plus amical. Je fus bien surpris de me voir ainsi traité ; je le fus encore plus le lendemain matin, quand personne ne me réclama de paiement. J’appris que les habitants de ce village tenaient à leurs dépens cette chambre toujours prête, et y traitaient les voyageurs à leurs frais. Peut-on donner un plus bel exemple de l’hospitalité ? Ce n’est pas tout ; ils poussent la délicatesse jusqu’à se soustraire à vos remercîments, lorsque vous les quittez : j’ai eu la douleur de m’éloigner sans avoir entrevu quelqu’un qui portât aux autres le tribut de ma reconnaissance.
Il était quatre heures de l’après-midi, quand nous aperçûmes pour la première fois Kurgan. Une seule tour, de chétive apparence, s’élevait au milieu d’un groupe de maisons à moitié détruites, et d’autres de fort mauvaise mine. Cette petite ville est située au-delà et sur les bords les plus élevés du Tobol ; elle est entourée d’une lande déserte qui s’étend, de tous côtés, à la distance de quelques verstes. Après ces landes, on voit des montagnes couvertes de bois, qui sont coupées par de petits lacs pleins de joncs. Le temps des pluies étant passé, l’aspect en était aussi agréable qu’il pouvait l’être ; et assurément il ne me séduisit pas.
Le nom de Kurgan qui, dans son véritable sens, veut dire Colline des Sépulcres, me parut convenir tout à la fois à la ville et à ma situation. Rien n’était plus triste que la vue de cet endroit, et je pensais bien qu’il serait mon tombeau. « C’est donc là, me disais-je, le terme de mon voyage, et le commencement de mes nouvelles peines ! » L’inondation de la lande nous forçant à faire des détours continuels ne nous permit d’approcher que lentement de cette ville, et j’eus le temps d’examiner de tous côtés ce tombeau qui s’ouvrait devant moi.
Parmi les cahutes de bois, qui n’avaient toutes qu’un seul étage, je distinguai avec surprise une maison en pierres assez bien bâtie : c’était un palais pour un pareil lieu. Je m’informai à qui elle appartenait : on me nomma un M. Rosen, autrefois vice-gouverneur de Perme, et qui possédait des terres dans ces contrées. J’avoue que le goût extraordinaire et bizarre d’acheter des terres dans ce pays sauvage ne me donna pas bonne idée de l’acquéreur et ne m’inspira pas d’abord grande envie de le connaître : cependant son nom paraissait allemand ; je présumai qu’il pouvait être originaire d’Allemagne. Ce nom, d’ailleurs, m’était bien cher depuis plusieurs années. Il me rappelait mon brave ami, le baron Frédéric Rosen, et son excellente épouse qui fut ma seconde mère. Devais-je trouver dans cette maison quelqu’un de leur famille, qui avait les mêmes droits sur mon cœur ?
Après avoir fait bien des détours, comme dans un labyrinthe, nous parvînmes à un singulier pont, qui consistait simplement en solives liées ensemble. Ce pont, quoique affermi sur les deux rives du Tobol, était mouvant. Chaque voiture qui passait dessus devait nécessairement s’enfoncer dans l’eau ; et quand on arrivait en face, il fallait avoir bien soin d’en prendre le milieu : un mouvement de la voiture, à droite ou à gauche, vous faisait courir de grands dangers.
Kurgan n’a que deux grandes rues, parallèles et très larges : nous en traversâmes une, et nous nous arrêtâmes devant une maison que l’on me dit être celle de la Justice du pays. Le bas officier qui m’avait accompagné y entra, et revint, bientôt après, m’annoncer que le chef de la police était en voyage, mais que le président du même tribunal le remplaçait : il fallut donc me laisser conduire devant le président. Nous allâmes quelques centaines de pas plus loin, et nous arrivâmes à sa demeure : je me nommai, et je fus introduit quelques instants après.
Je trouvai un vieillard d’une figure respectable et pleine de bonté ; mais dans ce moment il crut qu’il était de son devoir de prendre un certain air de dignité. Il me fit donc un accueil très froid, mit ses lunettes avec un peu d’importance, ouvrit, sans me regarder, les ordres qui me concernaient, et les lut les uns après les autres.
L’espèce d’indifférence qu’il me témoignait me donna l’envie de lui faire connaître la manière dont je croyais devoir être traité, dès ce jour comme à l’avenir ; en conséquence je pris un siège et je m’assis. Il jeta sur moi du coin de l’œil un regard qui marquait sa surprise ; je feignis de ne pas m’en apercevoir ; il continua sa lecture.
Une troupe de curieux vint de la chambre voisine se rassembler autour de moi. Il y avait parmi eux beaucoup d’enfants déjà grands, et un homme d’un âge moyen qui portait l’habit polonais. Ils me regardèrent tout en gardant le silence, et cette scène mystérieuse dura jusqu’à ce que M. le président eût fini de parcourir ses papiers. Alors le visage de ce magistrat s’épanouit ; la lettre du gouverneur, qui sans doute m’avait recommandé à lui d’une manière toute particulière, l’engagea à renoncer à cet air dédaigneux que sa place lui avait fait prendre. Son cœur parla pour moi dès cette première entrevue. M. le président vint à moi, me tendit la main, me présenta à sa famille, ensuite au Polonais qu’il complimenta d’avoir trouvé un compagnon d’infortune ; il le recommanda à mon amitié : le même sort nous unissait. J’embrassai ce malheureux exilé, et je sentis comme lui, dans ces premiers instants, que bientôt la conformité de nos goûts, de nos habitudes, égalerait celle de nos destinées.
Ce président était M. de Gravi. Son père, officier suédois, avait été fait prisonnier au combat de Pultava, et envoyé en Sibérie avec nombre de ses compatriotes ; il s’y était allié à une femme du pays, et était mort dans le lieu de son exil. M. de Gravi fils était entré au service, avait fait la guerre de sept ans, et était revenu dans son climat sauvage, où il avait quitté l’état militaire pour embrasser l’état civil. Il vivait actuellement, dans cette localité, avec un revenu très borné ; mais il était toujours gai, toujours content. Je ne me rappelle pas l’avoir vu une seule fois de mauvaise humeur ; il venait d’être nommé conseiller de la cour, place qui lui convenait parfaitement.
Après les premiers compliments, il fut question de me procurer une demeure, qui, suivant les ordres de M. de Kuschelef, serait une des meilleures de Kurgan ; ce logement était donné par ordre de la couronne, et tout propriétaire de maison était obligé de loger un exilé, quand on l’en requérait. On imagine bien qu’alors chacun faisait son possible pour se débarrasser d’une pareille charge ; et dès qu’il se présentait un malheureux pour obtenir gratuitement un asile, on lui donnait une si vilaine chambre, on le traitait si mal, qu’on tâchait de le dégoûter d’y rester.
M. de Gravi, après avoir réfléchi longtemps, indiqua à une espèce d’adjudant, petit homme tout bossu, le logement où il devait me conduire. Il me pria de venir souper chez lui le même soir ; je le remerciai : j’avais besoin de quelques instants de repos et de solitude ; il fallait de plus que je m’arrangeasse dans mon nouveau logement.
Je suivis mon guide ; il me mena à une petite maison si basse, que je faillis me briser la tête en entrant. Cet accident, qui provenait des ridicules proportions de la porte, ne me fit augurer rien de bon de l’intérieur de la maison. J’avançai néanmoins ; hélas ! je vis des chambres, ou plutôt des trous obscurs dans lesquels je pouvais à peine marcher, et qui n’étaient ornés que d’une table et de deux bancs de bois ; point de lit ; les fenêtres étaient couvertes de papier. À cet aspect, je poussai un profond soupir ; l’hôtesse en fit autant, et dérangea, avec un chagrin concentré, les bouteilles et le linge qui étaient çà et là dans la pièce qu’elle me destinait. Elle ramassa aussi quelques vieux habits et de la mauvaise vaisselle qui remplissaient tous les coins. Ensuite, elle me fit signe que j’étais maître d’agir dans cette chambre comme il me plairait. C’était véritablement dans un tombeau que je venais de faire mon entrée, et je m’y voyais seul avec mes pensées sinistres et mes sombres perspectives, seul en face d’un ennui et d’un dégoût qui s’augmentaient à chaque moment.
Combien cette sorte de rechute dans le malheur et la souffrance est pénible à l’homme qui ne s’est pas aguerri dès sa jeunesse à endurer les peines de la vie et qui surtout n’a pas contracté l’habitude de recevoir indistinctement, de la main de Dieu, tous les biens et tous les maux ! Aussi longtemps que les souffrances se suivent pour ainsi dire sans interruption, une nouvelle douleur physique ou morale ne fait pas une forte impression, parce qu’on est jusqu’à un certain point déshabitué du bien-être. Mais quand on a passé quelques jours plus heureux, que la considération, l’amitié, les douceurs d’une vie facile ont fait sentir leur charme à l’esprit et au corps, oh ! qu’il est dur pour l’homme de retomber dans la misère et l’isolement !
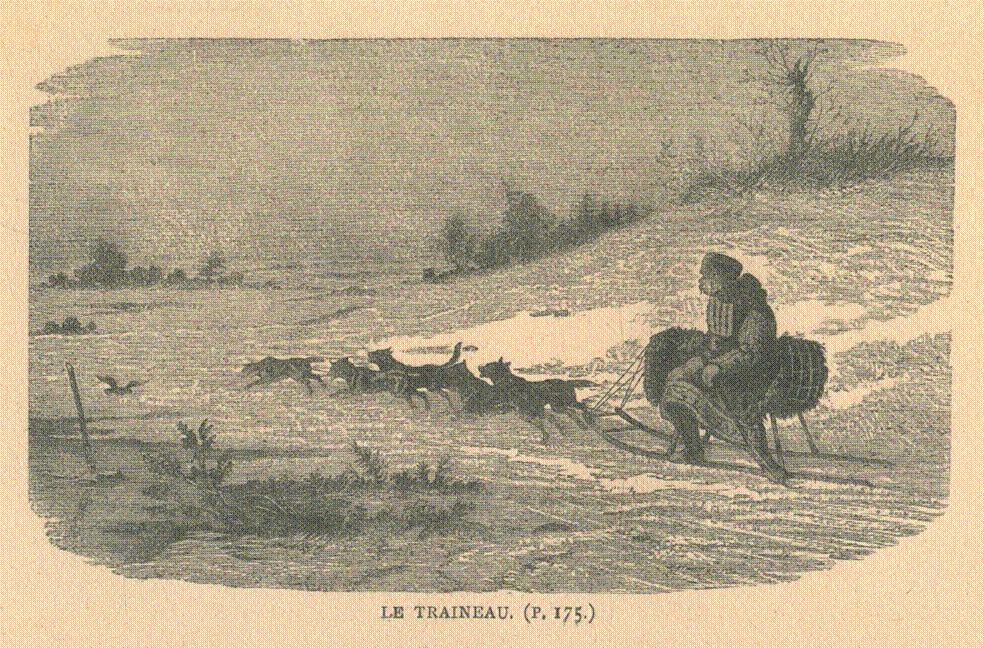
Insensiblement, je repris pourtant un peu de courage, je tâchai de vaincre mes répugnances, et je m’occupai de mes petits arrangements.
Une heure était à peine écoulée depuis le moment de mon installation dans ce pauvre logis, que le bon M. de Gravi m’envoya, en l’honneur de ma bienvenue, un jambon, quelques pains, des œufs, du beurre frais, et autres choses semblables, avec lesquels Rossi prépara un excellent souper, plutôt pour lui que pour moi. Après ce repas, je cherchai à reposer un peu sur mon noir plancher ; mais la vermine et le chagrin éloignèrent le sommeil de mes paupières.
Le lendemain matin je me levai d’assez bonne heure ; je reçus la visite de différentes personnes qui composaient les autorités de cette ville. Je vais les nommer les unes après les autres, afin de donner une idée de ce qu’on nommait, à Kurgan, la bonne société.
Étienne Osipovitch, kapitan ou chef de la police générale, chargé de l’inspection des rues, des ponts, et, en outre, juge suprême des différends qui s’élèvent entre les paysans : c’était un homme bon, serviable, jovial et fortuné. Il régnait même dans sa maison une espèce de luxe ; mais il me parut n’avoir pas de goût. Je me rappelle, par exemple, qu’il avait dans sa chambre quelques petits dessus de tables et plusieurs plateaux qui représentaient des sujets copiés de bonnes gravures connues, et qui avaient été laqués dans une fabrique située près d’Ekatérinenbourg. Ces copies lui avaient coûté beaucoup d’argent ; mais il ne s’en servait ni comme de tables, ni comme de plateaux : il avait fait ôter les pieds et placer les uns et les autres sur les murs, en forme de tableaux : c’était une bizarrerie singulière.
Juda Nikitich, assesseur à la chambre basse de la justice. J’avais de sa sœur une lettre de recommandation pour lui. Cet homme était très vulgaire, et surtout très borné.
Un autre assesseur, encore plus vulgaire.
Le secrétaire de ce tribunal, bon et respectable vieillard, qui paraissait avoir une grande idée de son habileté dans les affaires : il était le seul, dans toute la ville, qui fît venir des gazettes de la Moscovie.
Un chirurgien, fort ignorant. En l’absence du premier chirurgien de la ville, qui était en voyage, il fallait que je remisse le soin de ma vie entre ses mains.
Le plus intéressant de tous ceux que je vis à Kurgan fut indubitablement le Polonais Ivan Sokoloff : cet étranger possédait autrefois une terre aux nouvelles frontières de la Prusse, et n’avait ni servi ni même été initié dans les affaires de la révolution. Un de ses amis qui entretenait une correspondance, apparemment assez suspecte, avait cru devoir, pour plus de sûreté, se faire adresser ses lettres sous le couvert de Sokoloff, et avait recommandé à ses correspondants de les lui envoyer ainsi. La première lettre écrite de cette manière fut interceptée. Sokoloff n’en savait rien, n’ayant pas été instruit de cette manœuvre. Or un jour qu’il dînait chez un de ses voisins, à la campagne, un officier se présenta, et lui fit connaître l’ordre qu’il avait reçu de l’arrêter, ainsi que plusieurs autres personnes, innocentes ou coupables. En vain Sokoloff se récria sur l’entière ignorance des motifs pour lesquels il se voyait arrêté : il fut conduit, avec ses compagnons, dans je ne sais quelle citadelle. Cette affaire fut jugée à Saint-Pétersbourg ; et là on leur dit qu’ils seraient exilés en Sibérie. Sokoloff fut donc jeté, ainsi que les autres, sur un chariot. Le chemin qu’il devait suivre n’était qu’à quelques verstes de sa terre : il demanda en grâce qu’on lui permît de voir, pour la dernière fois, sa famille, et de prendre du linge et des habits qui lui manquaient. Ses prières furent repoussées : il se vit obligé de se rendre à Tobolsk dans l’état de dénuement où il se trouvait. Là il fut séparé de ses camarades et conduit à Kurgan, où, quand il me raconta cette histoire, il traînait depuis trois ans la plus misérable existence, sans avoir la moindre nouvelle de sa femme ni de ses six enfants.
Ce malheureux Sokoloff ne recevait pour vivre que vingt kopeks par jour, au compte de la couronne : il fallait donc qu’il se privât de toutes les douceurs de la vie. Il demeurait, en hiver, auprès d’un hôte presque toujours ivre et d’une hôtesse acariâtre, au milieu des chats, des chiens, des poules et des animaux les plus immondes. L’été, afin d’être seul, il logeait dans l’écurie, où j’ai été le trouver moi-même. Un bois de lit nu, une petite table, et un crucifix pendu au mur, étaient absolument tout ce qu’il possédait. Ah ! qu’il avait besoin de contempler l’image d’un Dieu mourant dans les plus cruelles souffrances pour s’encourager à supporter les siennes et ne pas tomber dans le désespoir !
Malgré la misère dans laquelle il languissait, il était impossible de lui faire accepter quelques présents : il vivait de pain, de laitage et de quass ; je le voyais toujours proprement habillé. Il était généralement aimé ; la famille de M. de Gravi le recevait avec plaisir, parce qu’il joignait à ses manières honnêtes une bonhomie remarquable. Ce pauvre Sokoloff conservait dans son malheur une égalité de caractère que j’ai bien souvent admirée, et à laquelle j’ai vainement tâché d’atteindre. Les seuls instants où son cœur paraissait faiblir, c’était lorsque nous nous trouvions seuls, que nous nous répétions l’histoire de nos peines, que nous comparions nos souffrances ; c’était surtout quand nous nous entretenions de nos enfants et que nous finissions par les nommer tous, les uns après les autres : alors les larmes s’échappaient de ses yeux comme des miens ; il tombait comme moi dans la plus sombre mélancolie.
Quel dommage qu’il ne sût pas le français, ou que moi, je ne pusse parler latin, langue familière aux Polonais ! Nos entretiens eussent été plus doux et moins pénibles. Sokoloff parlait mieux le russe que moi, quoiqu’il ne l’eût appris qu’à Kurgan ; mais son accent me rendait la plupart de ses mots incompréhensibles. Au reste, si nos idiomes n’étaient point d’accord, nos cœurs l’étaient bien : nous nous comprenions sans difficulté relativement à tous les sentiments inspirés par l’amitié ; l’expression de nos regards, chaque fois que nous nous revoyions, était un langage aussi sincère que facile à entendre ; enfin nous étions les deux plus tendres amis qu’il fût possible de trouver. Dans le sein du malheur, on s’unit bien vite et bien fortement. N’est-ce pas Dieu qui le permet pour offrir une compensation à ceux qui souffrent ? C’est ainsi, lorsqu’on y regarde de près, qu’il n’y a presque aucune douleur en ce monde sans quelque soulagement ou quelque motif d’espérance. La Providence ménage notre faiblesse et adoucit les épreuves qu’elle a nous envoie.
Aucune des personnes qui m’avaient rendu visite n’était venue les mains vides : chacune m’avait apporté des comestibles pour longtemps : il ne me manquait qu’un office pour serrer toutes ces provisions si généreusement offertes ; et bien loin de l’avoir, je ne trouvai guère à me loger moi-même. M. de Gravi, qui avait été du nombre de ceux dont j’avais reçu les hommages, revint dès qu’il me vit seul ; il s’informa si j’étais content de ma demeure ; je ne pus m’empêcher de lui avouer qu’elle me déplaisait beaucoup : il me proposa aussitôt de me conduire lui-même par toute la ville, de me faire voir tous les logements qui étaient disponibles, afin que je pusse choisir. J’acceptai cette offre avec reconnaissance, et nous sortîmes sur-le-champ. Après avoir couru une grande partie de la journée d’une maison dans une autre, avoir trouvé plus mal et rarement mieux, n’avoir vu que des chambres obscures et petites où j’aurais été forcé de loger avec mon domestique, ce qui ne pouvait me convenir, je priai l’honnête M. de Gravi de vouloir bien me laisser le soin de chercher moi-même un asile commode ; je lui dis que mon intention était d’essayer si l’argent, cet enchanteur universel, ne me ferait pas ouvrir une maison propre et agréable ; il y consentit, persuadé néanmoins que je ne réussirais pas dans mes recherches. Ce ne fut pas moi qui me chargeai de cette perquisition ; j’en confiai le soin à mon adroit Rossi, qui, en moins de vingt-quatre heures, avait déjà fait connaissance avec toute la ville, et sans doute avait trompé la plupart de ses habitants. D’après mon ordre, il commença son enquête, et je ne fus pas longtemps sans le voir revenir : il m’annonça qu’il avait trouvé une petite maison convenable, où je pourrais loger seul, moyennant un loyer de quinze roubles par mois ; il ajouta que le propriétaire, qui était un marchand, alléché par l’appât du gain, avait consenti à céder son propre logement, et à se retirer dans un petit corps de logis au fond de la cour. J’allai sur-le-champ voir cette nouvelle demeure ; je la trouvai si commode et si richement meublée, suivant la mode de Kurgan, que je n’hésitai pas à la prendre. Cette maison consistait en une grande et une petite chambre ; il y avait une cuisine très propre et une kladawai, ce qui veut dire une pièce destinée à tout ce qu’il faut serrer ; les murs de la chambre n’étaient à la vérité que des planches sans tapisserie, mais le propriétaire avait eu soin de les garnir d’une quantité de gravures coloriées et de tableaux à l’huile, qui faisaient une décoration assez agréable. Il résultait de cet ornement une illusion bien douce : on se croyait dans une partie de la terre moins sauvage et moins triste. Par exemple, on voyait des perspectives de Nuremberg, une marchande de pain d’épices de Vienne, etc. ; et sous chacun de ces tableaux se trouvaient des inscriptions allemandes. La lecture seule de ces mots écrits dans une langue que j’aimais me rendit si joyeux, que j’eus beaucoup de peine à m’en séparer. On remarquait encore dans cette pièce de très mauvaises copies des vues d’Herculanum, et autres sujets de plusieurs genres différents. Les peintures à l’huile, produits des arts du pays, représentaient d’anciens tzars ; ou plutôt le peintre avait fait quelques figures avec de la barbe, leur avait placé sur la tête des bonnets de tzar, leur avait mis dans la main la pomme impériale, et avait écrit au bas le nom d’un tzar qui lui était venu à l’esprit...
Les meubles de la maison consistaient en deux bancs de bois à dossier, – que l’on nommait sophas, parce que, sur chacun d’eux, on avait mis un coussin de lit, recouvert d’un morceau d’indienne ; – quelques chaises, une table et une armoire vitrée, dans laquelle il y avait de la porcelaine ; mais cette armoire était fermée, et tout ce qu’elle renfermait n’était qu’à l’usage de la maîtresse du logis.
La façade de la maison donnait sur la rue ; il y avait, sur le derrière, une cour propre, où il se trouvait une porte qui conduisait sur les bords du Tobil ; la promenade me devenait par là très commode. Toutes ces circonstances réunies m’engagèrent à accepter les propositions qui m’étaient faites, et me décidèrent à louer pour le prix demandé, quoiqu’il fût énorme, et qu’il m’eût paru très considérable, même à Saint-Pétersbourg. Ce marché s’arrangeait mal avec ma bourse, qui tous les jours, s’épuisait d’une manière effrayante ; mais dans ce moment je ne pensai qu’au plaisir d’être bien logé, et je ne désirai plus que de me rendre le jour même à ma nouvelle demeure.
En sortant de visiter cette maison, je rencontrai M. de Gravi, et je lui fis part de l’arrangement que je venais de conclure. Il se récria vivement sur la cherté du loyer, il me défendit de donner autant d’argent pour une simple location. Il ne cessa de me répéter : « Ce prix est inouï : depuis que Kurgan existe, personne n’a osé faire un tel marché. » À peine rentré chez lui, il ordonna qu’on fît venir le marchand, en disant qu’il allait le forcer à se comporter plus honnêtement. Le marchand vint. M. de Gravi le traita si mal que le marché fut sur le point d’être rompu. Je me vis obligé de paraître content de cette affaire, pour que mon marchand ne refusât pas de me recevoir chez lui. Dès qu’il fut sorti, le brave M. de Gravi dit et redit vingt fois ce proverbe russe : « Épargne ton argent pour les jours malheureux ! » Il voulait me prouver qu’il était de son devoir de veiller à mes intérêts. J’eus donc toutes les peines possibles à lui faire comprendre que j’étais en état de faire une pareille dépense, et que j’avais toujours eu pour principe de vivre moins bien pour être mieux logé. Il se contenta de murmurer, et je m’installai dans ma maison. Cependant je ne fus pas quitte, pour cette fois, de l’indignation de M. de Gravi : dès qu’il entrait chez moi, il recommençait à se lamenter sur la cherté de ce loyer ; je m’y étais accoutumé, et je l’écoutais sans faire attention à ce qu’il me disait ; je ne pouvais d’ailleurs lui en vouloir, puisque c’était pour mon bien qu’il radotait si souvent. Il est certain que si j’eusse été trompé dans mon espoir de recevoir de l’argent de la Livonie, que si toutes les lettres à mon adresse eussent été interceptées, je me fusse trouvé, six mois après, dans un grand embarras, puisque je ne recevais pas un kopek de la couronne ; mais j’avais de l’argent pour le présent, des espérances pour l’avenir ; devais-je craindre d’adoucir, autant que possible, les peines du moment ? D’ailleurs, tout était extraordinairement bon marché à Kurgan. Mes besoins étaient si modérés, les occasions de dépenser si rares, qu’avec l’économie d’un homme qui pourtant vit à son aise, je pouvais faire face à mes affaires pendant un an, et jusqu’à cette époque, il pouvait arriver bien des changements.
Pour montrer à quel point la vie était peu coûteuse dans cette ville, je vais citer quelques articles au prix coûtant pour moi, mais sur lesquels mon coquin de Rossi me trompait peut-être de la moitié.
Une livre de pain, un kopek 3.
Six livres de pain, cinq kopeks.
Une livre de bœuf, trois kopeks.
Un poulet, idem.
La paire de gelinottes, idem.
Un plat de poisson, idem.
Une corde de bois, quinze kopeks.
Le buveur le plus fort pouvait passer sa journée avec du quass pour un kopek.
On pouvait avoir un lièvre pour rien ; les Russes ne les aiment point, ils vous les donnent, et ne gardent que la peau.
Je demandais un jour à M. de Gravi, en présence du Kapitan Isprawnik, combien deux chevaux me coûteraient par an, pour l’entretien. « Trente roubles », me répondit-il. Le Kapitan me dit qu’il se chargeait de les nourrir parfaitement pour vingt-cinq roubles.
On peut juger par ces prix que les objets de première nécessité ne sont pas ruineux à Kurgan : le seul désagrément que l’on éprouve, c’est qu’il n’y a ni boucher, ni boulanger dans la ville. Une fois la semaine, il se tient un marché, où l’on est obligé de faire sa provision de viande et de pain pour huit jours : quelquefois aussi le marché manque de viande.
Mais, si ces denrées sont à très bon compte, en revanche, d’autres objets plus recherchés sont d’une excessive cherté. La pinte d’eau-de-vie de France coûte deux roubles et demi.
Une livre de sucre, un rouble.
Une livre de café, un rouble et demi.
Une livre de thé de Chine, trois roubles.
Un sixain de mauvaises cartes à jouer, sept roubles.
Une main de papier de Hollande, trois roubles.
Comme toutes ces choses ne m’étaient point utiles, je ne les achetai point ; et je me trouvai à la fin de la semaine, en comptant mon blanchissage, la lumière, et autres objets, n’avoir dépensé que quelques roubles. Il est vrai que mes repas étaient d’une frugalité remarquable ; je mangeais du pain de farine blutée, chose très rare à Kurgan, mais dont M. de Gravi me faisait ma provision, et un peu de beurre : outre cela, je mangeais encore quelquefois un poulet au riz, ou bien un canard sauvage que j’avais tué à la chasse, et je buvais un verre de quass qui composait tout mon dessert : cette sobriété faisait, qu’à peine sorti de table, j’avais appétit. Je dois à ce régime sage, non seulement d’avoir recouvré ma santé, mais encore de l’avoir améliorée.
J’avais de plus une manière uniforme d’employer ma journée. Je me levais tous les jours à six heures du matin ; je passais une heure à apprendre des mots russes : cette occupation m’était absolument indispensable, puisque personne ne parlait une autre langue dans Kurgan ; ensuite je déjeunais ; ce premier repas fini, je consacrais quelques heures à écrire l’histoire de mes peines, et après ce travail qui m’était presque devenu agréable, j’allais me promener, en pantoufles, sur les bords du Tobol, où je m’étais frayé un chemin à l’abri de tous les regards, et que je ne dépassais jamais : à mon retour, je lisais pendant une heure, puis je dînais frugalement ; un moment après, je me couchais ou bien je faisais encore une lecture jusqu’à ce que Sokoloff vînt me chercher pour aller à la chasse ; quand nous en étions revenus, il prenait ordinairement du thé avec moi : c’était là l’instant marqué pour notre entretien sur nos familles et sur nos malheurs : c’était alors que nous nous faisions part de nos espérances, et que nous cherchions à dissiper nos craintes par les plus légers indices de bonheur. Dès qu’il était parti, je reprenais un livre ; je mangeais un morceau, et jouais à la grande patience.
C’est ainsi que je passais mes jours. Je jouissais d’ailleurs d’une entière liberté, et je n’étais surveillé par personne. Mon bas officier, mon vieux André Ivanovitch, était retourné à Tobolsk deux jours après mon arrivée à Kurgan ; et M. de Gravi n’avait pas cru nécessaire de le remplacer près de moi, précaution que l’on avait pourtant prise d’abord avec le Polonais. À quoi m’eût servi cette garde ? La chasse me conduisait, à la vérité, à quelques verstes de la ville ; mais où aurais-je pu fuir ? Kurgan était autrefois aux frontières des Kirghizs, mais depuis plusieurs années on avait reculé les frontières de quinze milles, et l’on avait construit un petit fort. Quand même les frontières eussent touché à la banlieue de Ia ville, avais-je quelques moyens de fuir ? Je ne comprenais seulement pas la langue russe, et encore moins celle des Kirghizs. M’échapper, n’était-ce pas m’exposer à perdre la vie ! Les Kurganiens se rappellent encore avec effroi le temps où ils n’osaient même pas sortir de la ville pour aller se promener ! La crainte d’être surpris par des bandes de Kirghizs les retenait renfermés dans Kurgan. Ces peuples avaient la cruauté d’attacher à la queue de leurs chevaux ceux des habitants qu’ils pouvaient attraper, et fuyaient au galop, en traînant ainsi ces malheureux, sans avoir pitié ni de leurs gémissements ni de leurs cris ; ils ne regardaient même pas derrière eux si leur victime vivait encore ; ce n’était qu’à la porte de leur cabane qu’ils l’examinaient : alors, si elle existait encore, ils en faisaient leur esclave. Je devais donc, au lieu de penser à fuir parmi ces barbares, remercier le Ciel de ce qu’en allant à la chasse, je ne tombais pas entre leurs mains.
Quelque peu de ressources que nous eussions, Sokoloff et moi, pour rendre notre chasse agréable, cette distraction m’était néanmoins très bienfaisante. Nous n’avions que deux mauvais fusils, dont il fallait toujours tirer quatre ou cinq fois la batterie avant de pouvoir la faire partir. Il n’y avait pas dans toute la ville un seul chien de chasse, pas même un barbet capable d’aller chercher le gibier qui tombait dans l’eau. Comme toute la lande était coupée par une quantité innombrable de petits lacs, et comme les canards et les bécasses étaient le seul gibier que nous eussions à poursuivre dans cette saison, nous étions obligés de faire nous-mêmes le métier de barbets. Mon Polonais était beaucoup plus hardi que moi dans cette circonstance ; il faisait sortir le gibier des roseaux, et cherchait les volatiles qui étaient tués ou blessés.
Ce qui compensait le manque de chiens, c’était la grande quantité de gibier qui se présentait à nous, et qui devait facilement tomber sous nos coups. Je n’ai jamais vu en Europe de bandes de corbeaux aussi nombreuses que dans ces parages, et surtout des canards de tant d’espèces différentes. Il y en a de très gros, de très petits, avec des becs longs ou courts, plats ou ronds, des pattes petites ou grandes ; les uns sont gris, les autres bruns, ou bien tout noirs, avec des becs jaunes : quelquefois aussi, mais beaucoup plus rarement, j’ai trouvé des canards de Perse, tout à fait roses, qui avaient des becs noirs et une houppe sur la tête. Lorsqu’ils s’envolaient, ils jetaient un cri de douleur, quoiqu’on ne les eût pas touchés.
Les bécasses sont aussi très abondantes dans ce pays, et leur espèce est également variée : il y en a surtout de brunes et jaunes, qui ont de très grandes pattes et une couronne de plumes autour du cou ; elles sont à peu près de la grosseur d’un pigeon ; elles font leurs nids dans les joncs, s’envolent, quand on les approche, en poussant un cri désagréable, et en formant toujours un grand cercle ; elles sont fort aisées à attraper ; mais leur chair n’a rien de délicat.
J’ai trouvé deux ou trois fois des oiseaux blancs comme la neige ; ils étaient de la grosseur d’une oie, avaient de grandes pattes et un long bec ; ils allaient ordinairement cinq ensemble, pour chercher leur nourriture sur les bords de la mer ; mais ils étaient si farouches, qu’à une distance de deux cents pas ils prenaient leur vol : je n’ai jamais pu savoir leur nom.
Outre les canards et les bécasses, il y avait aussi une grande quantité de pigeons excellents, et enfin beaucoup de merles, qui formaient, en volant, un nuage épais, et qui couvraient tous à la fois un bouquet d’arbres lorsqu’ils venaient s’y reposer : ces oiseaux sont très bons à manger ; mais notre petite provision de poudre ne nous permettait pas de tirer un grand nombre de coups. Mon Polonais me répéta plusieurs fois que, dans l’arrière-saison, toutes les espèces de gibier s’augmentaient encore, et qu’il y avait même alors des lièvres, des gélinottes en très grande abondance. On trouve quelquefois auprès de Kurgan des coqs d’Inde sauvages.
Il n’y a point d’ours dans les forêts environnant cette ville ; les loups y sont même très rares, parce que le terrain est trop plat ; il n’y a que très peu de martres, mais on voit beaucoup d’hermines. L’air est souvent obscurci par une quantité innombrable de grands et de petits vautours qui sont si familiers qu’ils viennent dans la ville même.
Au plaisir de la chasse, pour laquelle je suis passionné, et qui me donnait une si agréable occasion de passer le temps, se joignait encore l’agrément de voir la lande ornée de mille fleurs différentes, parmi lesquelles j’ai remarqué la spiræa filipendula, si joliment émaillée. J’ai aussi respiré souvent l’odeur suave de plusieurs herbes qui embaumaient tous les environs ; j’ai remarqué entre autres l’artemisia abrotanum. On conduit de tous côtés, au milieu de ces herbes, un nombre prodigieux de bêtes à cornes et de chevaux qui y bondissent sans gardien. J’allais voir toutes ces curiosités pendant les jours les plus chauds de la saison.
L’été était brûlant et sec en Sibérie, pendant qu’il était froid et pluvieux en Livonie ; les orages que nous éprouvions se dissipaient promptement, et rafraîchissaient à peine l’atmosphère.
Parmi les livres que j’avais heureusement à ma disposition se trouvait un volume des œuvres de Sénèque qui me fut d’un grand secours dans ma douloureuse infortune. Les pensées de ce philosophe se gravaient dans mon esprit et m’aidaient à soutenir le poids accablant de mes maux. Je ne pouvais du reste m’empêcher de considérer la ressemblance frappante de ma position avec la sienne. Exilé, ainsi que moi, Sénèque a langui pendant dix ans sur les plages inhospitalières de la Corse. La description qu’il fait de son séjour, des sites affreux dont le seul spectacle lui était offert, ses plaintes au sujet de la langue barbare qu’il devait journellement entendre, tout cela me montrait l’analogie de nos situations, me rapprochait de lui, m’attachait à lui par le lien d’une mystérieuse intimité. Je ne saurais nier que, parmi ses maximes, il y en ait plusieurs qui demandent une sérieuse discussion ; d’autres ne sont que de belles pensées. Mais l’impression que me faisait cet ouvrage ne laissait pas d’être salutaire à mon âme et de lui procurer de précieuses consolations 4.
Malgré tout cela, un souvenir continuait à déchirer mon cœur, c’était celui de ma femme et de mes enfants. Il y avait si longtemps que j’étais privé du bonheur de les voir ! si longtemps que j’ignorais leur sort ! Je me disais, dans des moments de désespoir : « Peut-être ne recevrai-je jamais de leurs nouvelles ! » Ma femme et moi n’avions été séparés, dans toute notre vie, que la durée d’un mois, et cette absence nous avait paru mortelle à l’un comme à l’autre ; cependant nous nous écrivions tous les jours : au lieu que dans mon exil, je n’avais pas encore reçu une seule de ses lettres. Pouvais-je alors ne pas me rappeler ce voyage que je fus obligé de faire à Primont pour ma santé ? Mon épouse se trouvait empêchée de m’accompagner : j’avais dû partir seul. Il avait été décidé que j’y resterais au moins trois semaines, temps nécessaire pour ma guérison ; mais au bout de dix jours l’ennui m’avait gagné : je m’étais trouvé plus malade que jamais. Demandant vite des chevaux, j’étais revenu dans les bras de ma femme, au milieu de mes enfants. Et depuis près de huit semaines je me voyais isolé, languissant dans un coin de la terre ! Grand Dieu ! je vivais ! et comment donc pouvais-je vivre ! Espérance, quel était ton pouvoir ! tu soutenais seule mon âme abattue !
Les projets d’évasion hantèrent de nouveau mon esprit. Je combinais un plan où tout était prévu, calculé, pesé. Mon ami Kiniœkoff en avait proposé un autre. Il estimait qu’il était assez facile de se mettre à la suite d’une caravane venant de la Chine, en prenant un déguisement convenable : lui-même aurait tenté ce moyen, s’il n’avait pas craint de rendre, par sa fuite, le sort de ses frères plus rigoureux. Pour moi, qui étais étranger, je trouvai ce projet impraticable. Il fallait, pour le faire réussir, être un naturel du pays, ou en savoir bien la langue, afin qu’on vous prît pour un conducteur russe. Je m’en tins donc à mon propre plan ; je fis part à ma femme de tout ce qu’elle devait apporter avec elle pour le favoriser.
Comment, me dira-t-on, faisiez-vous passer des lettres aussi suspectes, puisque le gouverneur les lisait avant de les laisser partir ? Je dois avouer, pour ne laisser aucun doute sur ma véracité, que je trouvais à Kurgan un brave homme qui me proposa de se charger de l’envoi de mes lettres cachetées, et par les soins duquel ma femme les recevait plus promptement que toutes les autres.
Les bons Kurganiens, qui ont eu le bonheur de conserver les vertus du premier âge, me traitaient avec toute l’humanité, toute la bienfaisance qu’il est possible d’attendre des personnes les plus compatissantes. Ils m’invitaient à toutes leurs fêtes, ils voulaient que je partageasse leurs plaisirs et leurs festins. Ils ne me connaissaient pas d’abord comme homme de lettres ; mais aussitôt qu’ils entendirent parler de mes œuvres, ils me témoignèrent le plus grand respect, et je devins un homme célèbre à leurs yeux. Si cette estime générale était flatteuse pour moi, l’importunité avec laquelle ils me priaient de me rendre à leurs fêtes m’était cependant quelquefois à charge. Mon âme n’était pas disposée à se livrer au bruit de la société, ou peut-être la joie franche qui régnait dans leurs réunions n’avait-elle aucun charme pour un Européen. En voici un exemple.
Juda Nikititch, l’assesseur, voulait célébrer le jour de sa fête, jour qui est plus solennel en Russie que celui de la naissance. Il vint lui-même me voir le matin, et me pria de me rendre à midi chez lui, où les premières autorités de la ville se trouveraient rassemblées. Je répondis à son aimable invitation. Lorsque j’entrai, cinq chanteurs se hâtèrent de me recevoir ; ils tournaient le dos à la compagnie ; et pour augmenter le bruit de leurs chants, ils tenaient la main droite devant leur bouche, et entonnaient des couplets dans un coin de la chambre. L’usage voulait que l’on reçût ainsi chaque personne qui arrivait. Une grande table était couverte de vingt plats, mais il n’y avait ni couverts pour servir, ni chaises pour s’asseoir. Ce repas avait plutôt l’air d’un simple déjeuner. Les mets principaux consistaient en pirogues, espèces de pâtés faits ordinairement avec de la viande, mais qui, cette fois, étaient composés de toutes sortes de poissons. Il y avait en outre une quantité de poissons marinés et de pâtisseries préparées de différentes manières. Le maître de la maison se promenait dans la chambre avec des flacons d’eau-de-vie ; il ne se lassait pas de verser, et les convives ne cessaient pas de boire. À mon grand étonnement, personne ne me parut même étourdi, quoique l’on ne discontinuât pas de porter des santés. Il n’y avait pas de vin. Juda Nikititsch nous fit servir une boisson très chère en Sibérie où il n’y a point d’abeilles ; c’était de l’hydromel. Tous les convives, excepté moi, préférèrent l’eau-de-vie.
J’attendais à chaque instant que l’on ouvrît la chambre où le dîner devait être préparé. Ce fut en vain : chacun, l’un après l’autre, prit son bonnet et s’en alla. Il fallut bien que je me décidasse à en faire autant. « La fête est donc finie ? demandai-je à M. de Gravi qui sortait avec moi. – Oh ! non, me répondit-il. Chacun des convives se rend à la maison pour dormir. Ils vont se reposer jusqu’à cinq heures, et ensuite tout le monde se rassemblera de nouveau. » Je revins de mon côté à l’heure marquée ; la scène était tout à fait changée. La grande table se trouvait, à la vérité, encore au milieu de la chambre ; mais au lieu d’être couverte de pirogues, de poissons et d’eau-de-vie, elle l’était de gâteaux, de raisins, d’amandes et d’une quantité de confitures de la Chine, qui étaient vraiment excellentes, parmi lesquelles se trouvait une espèce de marmelade de pommes coupées par filets. On se mit ensuite à jouer au boston, tant que le punch, versé à profusion, permit de distinguer les cartes. Lorsque l’heure du souper sonna, chacun se retira comme le matin.
J’avais besoin assurément de toute ma complaisance pour prendre part à des fêtes semblables. Combien je fus content, lorsque je me vis libre de respirer dans ma chambre, lorsque, le fusil sur l’épaule, mon brave Sokoloff à mes côtés, je pus sortir pour aller me promener au milieu de la campagne !
Tels étaient mes occupations, mes plaisirs, mes ennuis à Kurgan. D’ailleurs, je jouissais constamment d’une bonne santé. Ce bonheur inattendu me donnait du courage. Je n’attendais plus que ma famille ; je n’aspirais plus qu’à la voir autour de moi, partageant mes travaux, mes amusements, et composant toute ma société. Devais-je l’y trouver un jour ? Un autre désir m’occupait encore : c’était de savoir si mon Mémoire était remis à l’empereur. Comme je souhaitais ardemment un bon voyage à mon conseiller de la cour ! Combien de fois je comptais les semaines, les jours qu’il avait dû mettre pour arriver à Saint-Pétersbourg, le temps qu’il fallait ensuite pour faire passer une décision des bords de la Néva aux bords de l’Irtich ! Je calculais qu’à la fin d’août je recevrais mon dernier arrêt. Mais Dieu soit loué ! je m’étais trompé dans mon calcul : ce devait être plus tôt !...
Le 7 juillet, mon réveil fut illuminé par le doux rayon d’espérance que mes nouveaux plans d’évasion projetaient sur mon avenir. J’avais l’esprit plus tranquille, le cœur moins oppressé ; en me levant, je repris le cours de mes occupations ordinaires, avec cette ardeur, ce courage nouveau que l’espoir, même le plus vague, donne à l’infortuné.
Sur les dix heures, M. de Gravi vint me trouver. Après quelques instants d’une conversation peu intéressante, il prit, suivant sa coutume, un jeu de cartes, pour jouer à la grande patience. Il avait mis si souvent la mienne à l’épreuve par cet ennuyeux amusement, que je n’étais pas tenté de suivre sa partie. Cependant il fallut m’asseoir à côté de lui, paraître même faire attention à ses coups, le regarder, lui répondre pendant une heure entière. Ce bon M. de Gravi croyait assurément me distraire, ne pouvant s’imaginer que le temps fût précieux à un exilé à Kurgan. Il resta donc ce jour-là jusqu’à onze heures passées, et il n’est point douteux qu’il ne fût demeuré plus longtemps, si, perdant patience, je ne me fusse levé sans dire mot, et je n’eusse fait vingt fois le tour de ma chambre, comme un homme très occupé qui désirerait qu’on le laissât continuer ses travaux. Ce qui détermina encore plus M. de Gravi à finir ce maudit jeu, ce fut la réponse que je lui fis, lorsqu’il me demanda sur quel objet il devait poser les cartes : « Sur l’espérance de voir bientôt ici ma femme », repartis-je. Comme il savait que j’aimais à être seul dans ces instants consacrés au souvenir d’une épouse chérie, il fit semblant de se rappeler quelques affaires à terminer et sortit.
Aussitôt je me remis à ma table, pour y écrire pendant une heure ; mais, au milieu d’une période, je fus interrompu par mon domestique, qui s’écria, en entrant : « Monsieur !... Monsieur !... encore quelque chose de nouveau ! » Je refusai d’abord de l’écouter, parce qu’il avait aussi l’habitude de m’ennuyer par le récit de certaines histoires dont il recommençait chaque jour les détails. Il me répéta encore : « Monsieur ! Monsieur ! il y a quelque chose de nouveau ! – Eh bien, voyons ; qu’est-ce encore ? lui répondis-je en tournant négligemment ma tête de son côté. Explique-toi vite et clairement, si tu le peux. – Monsieur, ajouta-t-il alors avec un ton mystérieux, Monsieur, un dragon vient d’arriver ici pour vous prendre, et... voilà tout ce que je sais... » À cette nouvelle, mon sang se glaça dans mes veines ; je fus saisi d’effroi, et, me levant brusquement, je fixai mon domestique sans proférer une seule parole. « Oui, oui, continua-t-il, nous irons peut-être encore aujourd’hui à Tobolsk... – Comment, nous irions ! » Je ne pus articuler le reste. Ma langue était enchaînée... : il introduisit auprès de moi un homme qui m’assura avoir vu ce dragon, et l’avoir lui-même conduit chez M. de Gravi. « Mais, savez-vous le contenu de ses dépêches ? demandai-je alors, en retrouvant tout à coup la parole. – Non », me répondirent-ils tous les deux, et ils s’éloignèrent.
Que devais-je conjecturer ? Devais-je penser à ma liberté ? Si c’était là le motif qui amenait ce dragon, pourquoi me reconduirait-on à Tobolsk ? Il y a un chemin bien plus court, en passant droit par Ekatérinenbourg. Pourquoi me ferait-on faire un détour de cinq cents verstes ? Cependant la réponse de l’empereur à mon mémoire ne pouvait tarder à me parvenir. Hélas ! par suite de toutes ces réflexions, il ne me resta dans l’esprit que l’affreuse certitude d’un exil plus cruel encore. Je ne doutai pas qu’on n’eût l’intention de me transporter plus avant dans les terres, peut-être jusqu’aux mines, peut-être jusqu’à Kamtchatka. Qu’on se représente alors l’excès de ma frayeur !
Je cherchai néanmoins à remettre mon esprit dans cet état de calme qui ne devrait jamais nous abandonner. Je pris vivement le papier où j’avais écrit ; je ramassai l’argent qui me restait encore ; je serrai le tout avec soin dans mon gilet, et j’attendis environ dix minutes que mon nouveau sort me fût annoncé. Ces dix minutes sont, je puis l’assurer, les plus cruelles que j’ai passées de ma vie, par l’incertitude où j’étais.
Un bruit que j’entendis dans la rue me fit mettre la tête à la croisée. J’aperçus M. de Gravi entouré d’une foule assez considérable ; à côté de lui marchait ce dragon dont mon domestique m’avait parlé. Mais pourquoi étaient-ils si loin encore ? Je ne pouvais remarquer l’impression de leurs figures, et mes inquiétudes ne faisant que s’accroître, je redoutais davantage la rigueur d’un nouvel arrêt. Cependant je m’efforçai en vain de m’éloigner de la croisée, jusqu’à ce que cette foule fût proche de moi : la curiosité m’y fit rester. Le malheureux est avide de nouvelles : il court même au-devant de celles qui peuvent ajouter à ses maux.
Enfin je pus distinguer tout ce monde qui se portait vers ma maison ; mais je ne regardais que M. de Gravi, dont le front me parut joyeux et serein. Quel rayon d’espérance vint luire dans mon cœur !
La foule pénétra dans la cour, et M. de Gravi marchait alors le premier. Je devais, je voulus sortir pour aller à sa rencontre ; mais cela me fut impossible. Je restai malgré moi immobile, les yeux fixés sur la porte de ma chambre. Elle s’ouvrit : je tâchai de parler : mes efforts pour le faire furent inutiles.
« Vous êtes libre ! » me cria M. de Gravi, les yeux baignés de larmes ; « soyez heureux, vous êtes libre » ; et il était dans mes bras ; il me serrait étroitement avec toutes les démonstrations de la plus vive, de la plus sincère amitié ; ses pleurs coulaient sur mes joues ; moi, je ne pleurais pas : je ne pouvais pleurer ! Je regardais avec surprise tous ceux qui répétaient autour de moi : « Vous êtes libre ! » Je me laissais embrasser par tous les amis qui m’attiraient vers eux, par mon domestique même qui disputait aux autres le plaisir de me prouver sa joie. Je n’étais qu’une idole de marbre : on m’honorait, on me caressait, on me révérait, on chantait mes louanges, on célébrait mon bonheur : eh bien ! je n’avais pas même la force d’ouvrir la bouche pour remercier cette foule empressée. Le spectacle de son ivresse et de ma froideur eût fait croire au plus clairvoyant des hommes que c’étaient eux qu’on délivrait, et que moi seul je restais prisonnier.
Le dragon, quand les cris de joie eurent cessé, s’avança vers moi et me remit une lettre du gouverneur de Tobolsk ; je l’ouvris avec précipitation, et je lus :
« MONSIEUR,
» Réjouissez-vous ; mais modérez vos transports ; la faiblesse de votre santé le demande. Ma prédiction s’est accomplie : j’ai la douce satisfaction de vous annoncer que notre très gracieux empereur désire votre retour. Exigez tout ce qui vous est nécessaire : tout vous sera procuré ; l’ordre en est donné : accourez et recevez mes compliments.
» Votre très humble serviteur,
» D. KOCHELEFF ».
Chaque ligne de cette lettre est profondément gravée dans mon cœur : je la transcris ici sans l’avoir sous mes yeux ; et, dans l’âge le plus avancé, je suis sûr que je pourrai la dire encore de mémoire.
Le gouverneur m’envoyait en même temps un paquet de gazettes et un petit billet de M. Beker qui se trouvait présent lorsque le dragon me fut expédié. Ce billet renfermait une invitation de la part de cet honnête négociant, à descendre dans sa maison à Tobolsk, plutôt que d’accepter un autre logement. M. de Gravi tira ensuite de sa poche l’ordre qu’il avait reçu personnellement de Russie, pour qu’on pourvût à mes moindres besoins, qu’on me donnât même de l’argent, si je le désirais, et surtout pour que l’on me mît le plus tôt possible en état de partir. J’étais encore muet de surprise et de joie ; mais quelques larmes s’échappaient de mes yeux... Ces larmes, j’allais les essuyer... quand mon cœur en ouvrit la source, et les fit couler par torrents. Oh ! qu’il est doux de pleurer au moment d’un bonheur inattendu, lorsque l’on se trouve avec des amis sincères qui, dans leur sein, reçoivent chaque larme, précieux témoignage d’une joie pure et partagée !...
Il était difficile qu’en ce moment, où mes larmes troublaient ma vue, je pusse remarquer tous ceux qui m’entouraient ; mais quand rien ne m’empêcha de distinguer leurs traits, quel fut encore mon attendrissement ! Sokoloff était près de moi, les yeux baissés, l’air morne et accablé ; il poussait de longs soupirs. « Je vais donc, me dit-il avec l’accent du désespoir, je vais donc me trouver encore une fois seul ? Pardonnez-moi, ajouta-t-il en se jetant dans mes bras, pardonnez-moi cette plainte dictée par la tendresse que vous méritez... Dieu m’est témoin de la joie que me cause intérieurement votre liberté... Adieu. » Il s’éloigna ; je l’appelai, il ne m’entendit plus.
De nouvelles visites me furent faites. Tous les habitants, de quelque rang qu’ils fussent, s’empressèrent de venir m’offrir leurs félicitations. Chacun d’eux me témoigna, comme il put, le plaisir que lui causait l’ordre de ma délivrance. En un instant, toute la maison fut pleine, au point que M. de Gravi, qui s’aperçut que cette foule, vu la faiblesse de ma santé, me faisait mal, se hâta de la disperser. Quand tout le monde fut sorti, il m’invita à dîner ; mais je n’acceptai point. Je n’avais nulle envie de perdre mon temps dans les ennuis d’un repas : je ne désirais qu’être seul et partir. M. de Gravi, qui ne pouvait m’en vouloir d’un pareil refus et de mon empressement à m’éloigner de Kurgan, m’assura que tous mes ordres seraient remplis exactement, et qu’il m’était libre de fixer le moment de mon départ. « Dans deux heures » fut ma réponse. Il me quitta en souriant, et je me trouvai enfin tout à fait seul.
Comment pourrais-je peindre ce qui se passa en moi dans cet instant ? Une heure après que M. de Gravi était sorti, mes genoux tremblaient encore ; j’allais çà et là sans réflexion ; mes idées se confondaient ; mes sentiments se succédaient avec rapidité ; des images incohérentes frappaient mes regards, et s’évanouissaient aussitôt. D’abord, un nuage semblait seulement me séparer de ma femme et de mes enfants : je m’avançais pour les embrasser. Alors mes yeux se dessillaient ; je ne voyais plus que l’espace immense qui était réellement entre moi et ces êtres chéris ; je devenais sombre, mélancolique, rêveur... Tout à coup, dans mon impatience, je demandais des chevaux... Mais les deux heures n’étaient point écoulées ! Je tâchais de réfléchir sur ma situation, de raisonner avec moi-même, de lire les gazettes, délassement qui m’était autrefois si agréable : rien ne pouvait suffire à mon âme : rien ne pouvait l’occuper, la distraire ; et, pendant ce moment d’une tendre anxiété, mes larmes coulaient toujours. Enfin, épuisé à force d’éprouver les plus vives émotions, je tombai sur ma table en m’écriant : « Mon Dieu ! mon Dieu !... »
Ce n’est en vérité qu’en Dieu qu’on peut trouver le calme et la paix dans les grandes joies comme dans les grandes douleurs. Il faut se confier en lui, s’abandonner à lui, et alors l’âme, se reposant sur le sein d’un Père tout à la fois si puissant et si bon, cesse de se troubler, de s’inquiéter, elle redevient paisible.
Jusqu’alors je ne possédai pas ce calme ; des larmes de tristesse se mêlèrent même à celles que la joie m’avait fait répandre. Le dragon m’avait bien raconté qu’il était venu un courrier de Saint-Pétersbourg pour me chercher, et que si ce courrier était resté à Tobolsk, c’est que son ordre l’obligeait de n’aller que jusqu’à cette ville. Mais ce dragon n’avait pu répondre à une question qui m’intéressait bien davantage ; il n’avait pu m’apprendre si le courrier était porteur de quelques lettres de ma femme, ou si, du moins, il avait des nouvelles à m’en donner. Au fait, n’était-il pas vraisemblable que ce courrier n’avait aucune commission directe pour moi ? Car le gouverneur de Tobolsk, qui connaissait mon attachement pour ma famille, se serait empressé de m’en faire part. Il avait souvent écouté avec intérêt tout le bien que j’en disais ; il avait souvent compati à ma douleur : hélas ! il gardait le silence dans ce moment. Peut-être avait-il quelque évènement sinistre à m’annoncer ; peut-être le chagrin de ma captivité, l’inquiétude de mon sort avaient abrégé les jours de ma femme ; mille pensées tristes, désespérantes, me poursuivaient déjà.
Par bonheur, les préparatifs de mon voyage vinrent me distraire ; mon Italien ne pouvait trop se hâter au gré de mon impatience. Je ne lui donnai que le temps de mettre tout pêle-mêle dans les portemanteaux ; ensuite je me pressai d’aller témoigner toute ma reconnaissance aux bons habitants de Kurgan. Ils reçurent mes adieux avec les plus sympathiques regrets.
En rentrant chez moi, j’y trouvai mon pauvre Sokoloff qui, respirant à peine, se promenait à grands pas dans ma chambre, comme un homme en délire.
Pour le calmer, cet ami infortuné, et pour distraire un moment sa douleur, je tâchai de faire quelque chose qui lui fût agréable ; je lui offris mon fusil, ma carnassière et toutes mes munitions. Il accepta ce don sans proférer une seule parole. Je le priai de me donner des lettres pour sa famille, en l’assurant que je regarderais comme le plus saint des devoirs de les faire parvenir fidèlement ; mais il n’y consentit point. Il poussait la délicatesse de conscience jusqu’à la cruauté envers lui-même. Ses refus n’avaient d’autre motif que la crainte de contrevenir aux ordres donnés contre lui, quelque rigoureux qu’ils fussent. Une telle conduite trouvera, hélas ! bien peu d’imitateurs ! Nous en avons trouvé pourtant un exemple parmi les déportés que la Convention laissait périr dans la Guyane.
La pensée que mon départ de Kurgan rendrait ce cher Sokoloff plus malheureux qu’avant mon arrivée fut encore un chagrin qui vint troubler un moment mon ivresse. Il s’était accoutumé avec moi à maintes douceurs de la vie, aux plaisirs de la société, à tous les charmes de l’amitié ; il avait pu déposer dans mon cœur ses souffrances et ses peines ; et mon départ lui faisait perdre toutes ces consolations, si précieuses dans l’adversité. De plus, après avoir quitté sa cahute enfumée pour venir habiter avec moi, il allait être obligé d’y retourner, et il y serait seul, sans ami, sans compagnon d’infortune ! À cette idée je tombai dans ses bras. Je le pressai si vivement, que nous fondîmes en larmes tous les deux, et que je ne pouvais plus le quitter. Il eut plus de courage que moi ; il me serra la main, me fixa, regarda le ciel et sortit. Depuis ce moment je ne le revis plus. À l’heure de mon départ, quand tous les habitants se rassemblèrent dans la cour, Simon Sokoloff n’était pas avec eux.
Je ne puis m’empêcher de dire encore un mot de tant d’honnêtes gens de cette ville. Pendant que je m’impatientais de la lenteur avec laquelle mes chevaux arrivaient, j’étais accablé de toutes parts des plus tendres gages de l’amitié. L’un me faisait du punch ; l’autre m’apportait des vivres ; celui-ci de petits concombres 5. Il m’eût fallu plusieurs chariots pour emporter tout ce que l’on m’offrait. Bonnes gens, que le ciel vous comble de bénédictions ! Quoique j’espère ne revenir jamais en ces lieux, croyez que je conserverai, jusqu’au tombeau, le souvenir de votre généreux attachement. Certes, une telle bonté mérite bien d’être citée comme modèle ; nous autres, lorsque nous faisons du bien à autrui, c’est presque toujours avec une arrière-pensée égoïste : nous espérons quelque chose en retour, tout au moins de la gratitude, de bons services si l’occasion s’en présentait. Vous, au contraire, vous étiez aussi désintéressés qu’il est possible de l’être, puisque nous nous séparions pour toujours et que vous n’aviez plus rien à attendre de moi, qui du reste n’avais jamais rien fait pour vous. Voilà la véritable charité chrétienne, celle qui donne pour obliger un frère et sans aucune vue d’amour-propre. Quelle leçon pour ceux qui se piquent d’appartenir aux peuples les plus civilisés du monde !
Enfin, mes chevaux furent attelés. Je mentirais en disant que je montai dans le chariot ; j’y fus porté après avoir reçu mille félicitations, après avoir été embrassé mille fois.
Le bon M. de Gravi, malgré son grand âge, voulut s’asseoir à mes côtés, et me conduire au moins jusqu’en dehors de la ville. Pendant que nous traversions les rues, j’entendis autour de moi faire des vœux pour le succès de mon voyage, et des prières pour la conservation de mes jours. Le tableau de tous ces braves habitants rangés sur mon passage émeut encore mon âme, et reste toujours présent à mes yeux.
Quand nous eûmes fait environ deux verstes, M. de Gravi, le visage pâle et triste, ordonna avec douleur d’arrêter les chevaux : alors il se pencha vers moi, laissa couler quelques larmes sur mes joues, s’en alla, revint, et ne me quitta qu’en répétant, au milieu de ses sanglots : « Dieu soit avec vous ! » Je me levai pour le suivre des yeux aussi loin qu’il m’était possible. Dès que je ne le vis plus, je dis au postillon de reprendre sa route au galop, me dégageant, à mesure que je m’éloignais de Kurgan, du souvenir de ces émotions qui m’oppressait, et ne songeant plus qu’au bonheur de retrouver enfin ma femme et mes enfants 6.
Auguste de KOTZEBUE, Mes tristes aventures de Sibérie.
Recueilli dans Les drames de la Sibérie,
Grammont (Belgique), Œuvre de Saint-Charles, s. d.