Le mystère de Perrière les Chênes
par
Paul BOUCHET
Couronné par l’Académie Française
Prix MONTYON 1958
À tous nos Amis ;
à ceux qui participent
toujours à la vie
de « Perrière ».
CHAPITRE I
– Monsieur Paul ?
– Oui ! Je descends !
Dégringolant l’escalier, je fais entrer le sympathique fonctionnaire qui depuis 17 ans apporte dans ma banlieue bonnes et mauvaises nouvelles.
– Bonjour, facteur. Que m’apportez-vous de beau ?
– Dites donc, Monsieur Paul, c’est-il pour vous, ça ? fit-il en me présentant dans le cahier des « recommandés » une lettre surchargée d’inscriptions manuscrites et toutes couleurs, et de multiples tampons :
« À Monsieur Émile BOUCHET
58, rue St-Jean
à Dunkerque »
(en cas de décès, prière de faire
parvenir à son fils aîné)
Interloqué, je contemplai un instant l’enveloppe maculée.
– Oui ! Il n’y a pas de doute, c’est bien pour moi !
– Eh bien ! elle en a fait du chemin avant de vous attraper ! et vous direz après cela que le service des Postes est mal fait !
– Je ne le dirai plus, facteur, car voici 25 ans que mon père est mort (en 1918), et j’ai déménagé bien des fois avant d’habiter ici... Une cigarette ?
– Merci ! C’est trop rare aujourd’hui pour qu’on les refuse. Vous avez signé ? À demain, Monsieur Paul !
Lesté de mon courrier, je m’enferme dans mon bureau et, après avoir encore retourné entre mes mains l’enveloppe mystérieuse, soigneusement, d’un coup de canif, j’ouvre le précieux document.
Deux fois, trois fois, je relus la missive extraordinaire, me demandant si je n’étais pas l’objet d’une mystification. Mais non, on n’inventerait pas une blague pareille, qui, d’après l’impression de l’adresse aurait eu de grandes chances de ne jamais toucher sa victime.
Louis Auguste Futaies.... ce n’est pas possible.... ça se saurait.... et pourtant....
Je vais chercher ma femme !....
– Là. Tu es bien assise dans ton fauteuil ? Tu ne tomberas pas à la renverse ? Alors, Chérie, écoute ça !
Assis sur un bras du siège, de façon que nous puissions voir ensemble cette lettre ahurissante, je lui lus :
Perrière, le 14 Juin 1943.
Mon Cher Émile,
« Je ne sais où et quand ceci te parviendra, mais ce dont je suis certain, c’est que cette lettre touchera son destinataire auquel je suis inconnu, parce qu’elle doit lui être remise, même après ta mort, même après celle de ton fils puisque vous avez dû subir l’un et l’autre à Dunkerque les pires épreuves au cours de l’une ou l’autre des deux guerres qui ont ravagé cette pauvre cité.
« Aussi étonnant qu’il puisse te le paraître, c’est ton oncle Louis Auguste, né le 20 Avril 1823 à Bourbon-Vendée, et disparu le 23 Décembre 1870, qui écrit aujourd’hui d’un village totalement perdu, dont tu rechercheras en vain le nom sur les cartes modernes de France, même celle d’état-major de ce département d’Eure-et-Loir.
« Je n’ai plus pour longtemps encore à vivre et désire te revoir, mon Cher Émile, avant de partir rendre mes comptes à notre Maître à tous.
« Comme ton grand âge t’empêchera de venir jusqu’à moi en ce village inconnu et d’abords difficiles, je te prie de confier cette mission à ton fils, ou à défaut à l’aîné de tes petits-enfants.
« J’attendrai encore sa venue quelques mois avant de mourir.
« Au reçu de cette lettre, mon Cher neveu, tu prendras à Paris l’autocar du matin pour Dourdan et demanderas un billet pour Perrière, assez haut pour être entendu des voyageurs.
« Le conducteur répondra qu’il ne connaît pas de localité ainsi nommée sur la ligne : alors, mon neveu, tu répéteras à voix haute : Mais, si, Perrière les Chênes !
« – C’est à Perrière les Chênes que vous voulez aller ? lui demandera alors un voyageur. Vous connaissez quelqu’un là-bas ?
« Lui ayant répondu : Oui, mon Oncle, le grand-père Louis, cet homme te dira :
« – Vous savez que vous n’arriverez que ce soir vers 10 h. 1/2 ?
« – Entendu, je le sais, répondras-tu. Et tu exécuteras les instructions que te transmettra ce guide.
« Malgré les difficultés actuelles de la vie dans notre France que je revois envahie pour la 3e fois en ma longue vie, ne t’inquiète de rien. Je suis assez largement logé et pourvu pour recevoir mon neveu, et ma petite nièce peut-être, jusqu’à mon dernier jour, tout proche, que j’attends sans hâte comme sans crainte, désireux d’avoir la force encore de m’entretenir avec toi.
« Reçois donc, mon Cher Émile, les affectueuses pensées de ton vieux, très vieil oncle.
« Louis Auguste Futaies.
« P. S. – J’oubliais de te le recommander, emporte une boussole. »
– Qu’est-ce que c’est que cette histoire de revenant ?
– Je ne sais pas plus que toi, car, tu penses bien que je ne suis pas très au courant des faits et gestes de mes grands oncles, tous morts à ma connaissance, bien avant ma naissance.
– L’enveloppe fut postée à Dourdan le 14 Juin, réexpédiée le 20 de Dunkerque à Paris, chez la sœur de papa, décédée, d’où elle fut envoyée à leurs enfants en Bretagne, et par eux ici.
– Nous sommes le 12 Juillet. Il ne serait peut-être pas tellement désagréable de passer quelques jours à la campagne... même si cet oncle Mathusalem n’existe plus... suggéra ma femme.
– Voyons, ma petite, examinons un peu les données de cette histoire... invraisemblable, avant de nous lancer dans une aventure qui peut être une fumisterie.
Nous avons :
1o – Un grand-oncle inconnu – disparu en 1870 – et qui un beau jour s’avise d’écrire à mon père, dont il connaît tout juste la résidence à Dunkerque.
2o – Un âge impossible... 120 ans !...
3o – Un patelin inconnu en Eure et Loir, auquel on n’accède que par le truchement de mystérieux voyageurs.
Pour moi, ça sent la blague, le coup monté.
Arquant ses sourcils, ma femme me regarde de l’air un peu « ailleurs » qu’elle a lorsqu’au travers d’une question elle cherche à deviner un « pourquoi » lointain et situé en dehors des communes limites de la compréhension.
– On va voir, dit-elle.
Et posément, elle s’en fut chercher dans le secrétaire une grande boîte où elle classe soigneusement : actes, diplômes, lettres et parchemins sous la rubrique : « Papiers de famille » et, l’ayant ouverte, en extrait un arbre généalogique dressé jadis et tenu à jour constamment depuis.
– ... Auguste... le voilà... 7e enfant de Louis Futaies, né le 20 Avril 1822, à Bourbon-Vendée (actuellement la Roche-sur-Yon). Chef de bataillon de Mobiles, disparu au cours des combats autour de Châteaudun en Décembre 1870. Jusqu’ici nous vérifions les dires de l’auteur de cette lettre.
– Mais Perrière enfin... Perrière les Chênes si l’on veut même... tu vois ça, toi, un village de France inconnu sur les cartes, oublié du cadastre, de la gendarmerie et du percepteur... où l’on se rend cependant par un autocar où fréquentent de mystérieux courriers... un pareil escamotage serait plus fort que toutes les histoires de Ponson du Terrail, de Jules Verne, et Maurice Leblanc et de Monsieur Pierre Benoit réunis... et où ça, ce village oublié ?... perdu ?... en Eure-et-Loir, à moins de 100 kms de Paris. Mais ça ne tient pas debout !
– Ce village peut fort bien n’être qu’un lieu dit, perdu... dans les bois, comme son nom l’indique, parmi une forêt de chênes ?
Après tout, on découvre bien, en France même, des cités disparues depuis des siècles, comme celle de Ker Hoël, par exemple, et l’on épilogue encore sur l’emplacement de villes gauloises florissantes avant l’invasion de ces barbares formalistes que furent les romains. Pourquoi n’y aurait-il pas quelque chose à Perrière ?
– Le plus simple, décida sa femme, c’est d’y aller. Voici la période des vacances ; on ne sait où aller, et, puisque l’occasion se présente de voir peut-être du nouveau, allons-y.
– Et zou. Puisque rien ne nous en empêche, nous partirons lundi pour la découverte de Perrière les Chênes, le village oublié.
20 Juillet 43.
Huit heures du matin. Une queue d’une vingtaine de personnes, la plupart chargées de valises, attendent l’heure de monter dans l’autocar. Je m’adresse à un homme, visiblement un campagnard, placé devant moi.
– Pardon, Monsieur, pour aller à Perrière, c’est bien ici ?
L’interpellé me regarde, les yeux ronds :
– Perrière ? connais pas. Ici, c’est pour Dourdan.
– Vous ne connaissez pas Perrière les Chênes ? fis-je à voix plus haute.
– Non. C’est près de quoi, ça, Perrière ?
– Je ne sais pas au juste ; on m’a dit que c’est sur cette ligne.
– Alors, demandez donc au contrôleur ; je n’ai jamais entendu parler de ce pays-là !
Cette tentative liminaire demeurée infructueuse, je me munis au guichet de deux billets pour Dourdan. Et j’attends. Ma femme observe les têtes des voyageurs.
Voici l’autocar : une grande voiture qui fut naguère élégante et dont la carrosserie fatiguée s’agrémente aujourd’hui d’un gazogène – le conducteur range l’engin contre le trottoir et ouvre la portière ; un aide fourgonne le gazo qui empeste et nous enfume.
Les candidats au voyage grimpent à la queue leu-leu dans la voiture et passent au chauffeur paquets et valises qu’il dispose sur la toiture.
– Pour aller à Perrière, s’il vous plait ?
– Perrière,... je ne sais pas. On n’y passe pas et je ne peux pas vous renseigner.
– Vous ne connaissez pas Perrière les Chênes ?
– Non.
Et le conducteur passe au suivant qui nous pousse en grommelant entre ses dents quelque chose comme « Il y a des gens qui feraient mieux de se renseigner d’abord avant de monter en voiture ».
Nous allons nous asseoir, dépités de n’avoir pas entendu la réponse espérée, et tâchons de glisser nos deux petites valises sous la banquette.
Pendant que je me livre à cet exercice, Lucienne s’occupe à ôter son manteau, à le plier, et, tandis que les yeux baissés vers ces préparatifs d’installation nous ne pouvons voir nos compagnons de voyage, j’entends une voix d’homme murmurer quelque part derrière nous :
– Perrière, vous n’y serez pas avant ce soir 10 h. 1/2.
Ma femme a entendu elle aussi et se retourne. Elle observe qui a parlé. Est-ce le campagnard endimanché encore debout, ou ce petit vieux barbu qui a prononcé les paroles attendues ? Peut-être encore ce vieux réjoui qui insère avec difficulté un ventre abondant entre les travées de fauteuils. Rien n’y paraît.
Enfin, les derniers voyageurs montés, la porte claque et l’autocar se met péniblement en route dans un fracas de ratés du moteur qui, mal nourri au gazogène, proteste énergiquement.
– Comment penses-tu que nous retrouvions l’oncle Louis ? demande ma femme assez haut pour être entendu de ses voisins.
– Je n’en sais rien et cela m’ennuie, car il ne pourra sûrement pas, à son âge, nous attendre au terminus, et je ne vois pas comment nous découvrirons seuls sa maison à Perrière ?
– Quelqu’un vous indiquera sûrement à Dourdan le chemin de Perrière les Chênes !
Intentionnellement Lucienne a mis l’accent sur ces mots et en attend quelque révélation... mais en vain. Elle aurait parlé de Saint Cayou sur l’herbe ou de Flicfloc des grenouilles, le résultat eut été le même.
Aussi jugeant inutile de renouveler l’expérience pour l’instant, nous essayons de lire pour tuer le temps, tout en observant nos voisins sans plus de succès.
Il est 10 h. 15 quand après deux heures de voyage sans histoire, la lourde voiture stoppe enfin sur une place coquette devant la grosse tour démantelée de ce qui fut le château de Dourdan.
Tous descendent, et, voyant l’heure, je grogne :
– Douze heures encore pour aller à Perrière... mais c’est donc bien plus loin que Perpignan... Perrière les Chênes ?
Un jeune homme qui s’occupe à descendre les bagages du toit de l’autocar nous dévisage curieusement :
– Y a-t-il ici une voiture pour nous conduire ?
– Ce ne sera pas facile en ce moment, si vous ne connaissez personne là-bas, Madame, émet le garçon réticent...
Évidemment c’est une invite à formuler le « Sésame ouvre-toi » qui nous mettra le fil conducteur en mains.
– Bien sûr, notre oncle Louis, Louis Auguste Futaies, le centenaire !
Quelques instants s’écoulèrent, notre informateur paraissant très absorbé par l’arrimage de paquets hétéroclites sur les porte-bagages d’une bicyclette :
– Vous êtes à pied, demande-t-il enfin ?
– Oui.
Pendant ce temps nos compagnons de route se sont tous dispersés.
– Alors venez avec moi.
– Ce n’est pas trop loin ?... J’ai été blessé en 40, et maintenant les kilomètres et moi...
– Si fait ; c’est à une bonne quinzaine de kilomètres mais vous prendrez le tacot.
– Comment, il y a donc un chemin de fer qui va dans ce trou ?
– Un chemin de fer – oh ! pas tout à fait. J’ai dit un tacot, une voix agricole qui va dans les champs ramasser les récoltes – et après, il reste un bout de chemin.
– Mais sapristi, faut-il donc quitter la France et l’Étranger pour dénicher ce Perrière ?
Notre guide nous observe curieusement.
– ... La France et l’Étranger... ma foi, p’t’être ben...
– Mon oncle m’a pourtant écrit de venir le voir ?
J’extrais la missive de l’ancêtre et la montre au jeune homme, qui se décide alors :
– Alors, c’est bien, si vous êtes invités, car j’ai moi aussi, des parents à Perrière, et ils n’aiment point à être dérangés les vieux de là-bas.
– Mais pourtant le ravitaillement, les cartes, les trente-six mille formalités qui...
Souriant sans répondre, le cycliste, tenant en main sa machine, nous arrête devant un hangar sous lequel s’alignent poussiéreux une demi-douzaine de wagons antiques, deux trucs, trois fourgons, une plate-forme, attelés d’une inénarrable locomotive, le tout reposant sur une voie étroite qui se perdait dans les champs.
– Courier ! – Ho, ho ! Ouque t’es ? héla le jeune homme, les mains en porte voix.
Et comme nul ne répondait il enfourcha sa bicyclette et fila vers Dourdan, nous laissant cet encouragement :
– Attendez-moi là, m’sieur dame ; je vais le chercher.
Onze heures sonnaient à l’église quand, sur la route poudreuse, nous vîmes apparaître notre jeune informateur.
– Le train partira vers les 2 h. J’ai vu le père Courier qui vous fera mettre une hotte de foin pour vous asseoir dans le fourgon. Il vous indiquera où il faudra descendre. Je tâcherai de venir vous chercher. Vous avez t’y seulement une boussole ?
– Oui, j’ai emporté, suivant les instructions de notre oncle, ma boussole militaire. J’ai même des cartes...
– Oh ! pour les cartes, ça ne dit que ça veut, ces machins-là. Le principal, c’est la boussole.
– Alors à ce soir, m’sieur dame... et vous tracassez pas si vous trouvez le temps long...
Remontant sur son vélo, le sympathique garçon nous lança :
– D’ici 2 heures, allez donc déjeuner à la Tête Noire ; je les ai prévenus ; ils vous prépareront aussi un bon casse-croûte pour dîner...
Et nous plantant là assez interloqués, il fila à toutes pédales...
CHAPITRE II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cahotés, brinqueballés dans un obscur et malodorant fourgon où poussait l’herbe sur un plancher enduit d’une couche de terre et de débris végétaux jamais nettoyés, nous mijotions de surcroît dans l’ombre sous un soleil ardent qui rôtissait le plafond de notre wagon et noyait d’une lumière dorée une campagne de champs de blés et de boqueteaux.
Le tacot du père Courier n’allait guère plus vite qu’un homme au pas... dans la terre labourée. Fréquemment, il s’arrêtait en plein champ, déposait quelque ouvrier avec ses outils, une faucheuse-lieuse que des cultivateurs venaient chercher, avertis de loin par le panache de fumée, les tonitruants coups de sifflet dont le chauffeur-mécanicien croyait devoir ponctuer ses arrivées en des lieux déserts comme il l’eut fait avant d’entrer dans une gare.
Là-dessus, un bout de causette, et, pour activer les opérations, une rincette bue à la régalade d’un bidon suspendu goulot en bas sous l’auvent du conducteur, suivant les meilleurs principes des coloniaux qui veulent boire frais au soleil.
Prodigieusement énervés par la longueur interminable d’un minuscule voyage en ce pays chartrain si proche de Paris, nous avions essayé de faire la route à pied, en précédant le convoi encore arrêté pour quelque déchargement, mais l’impossibilité de marcher ailleurs que sur les traverses irrégulièrement espacées d’une voie ferrée nous y avait bientôt fait renoncer.
Les quelques amorces de conversations engagées avec les passagers de cet étrange convoi ne nous avaient donné sur Perrière aucune espèce de renseignement.
Le père Courier, questionné à deux reprises, nous répondit en clignant de l’œil...
– Le gars m’a prévenu, vous tracassez pas, je vous dirai ousqu’il faut descendre...
Nous étions donc de fort mauvaise humeur quand, vers 17 h. 30, après trois heures et demie d’un abrutissant voyage aux arrêts multiples aussi longs que les heures de parcours, le tacot stoppa avec un bruit de ferraille ponctué d’un inutile et strident coup de sifflet, sous un hangar semblable à celui sous lequel nous l’avions découvert le matin.
À proximité s’élevait une ferme assez grande, bien tenue, dont le logis principal, en pierre, portait gravé sur le linteau de la porte
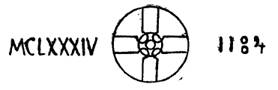
Une femme d’une trentaine d’années, robuste et plaisante, sortit de la maison traînant après soi un marmot déculotté.
– Agnès ! cria le conducteur de l’étonnant convoi, fais donc entrer Monsieur et Madame ils sont les neveux du Grand-père qu’ils vont voir an’huy.
Et, se tournant vers nous qui, descendus de l’inconfortable véhicule, attendions, valises à la main, qu’il nous fut donné d’autres précisions sur cet ahurissant voyage : « Entrez donc, Monsieur-dame, ma femme va vous offrir un rafraîchissement en attendant qu’on vienne vous chercher. Vous êtes chez vous. »
De plus en plus intrigués, nous suivîmes Madame Courier dans une grande salle fraîche dont une énorme cheminée au vaste manteau garnissait tout le fond.
Nous ayant invités à nous asseoir devant une vaste table de chêne aux pieds tournés, notre obligeante hôtesse s’étant munie d’une cruche, s’excusa de nous laisser seuls, et sortit.
Curieux, ma femme et moi examinions avec intérêt la salle aux poutres apparentes reposant sur des corbeaux de pierre sculptée, les montants de la cheminée ornés de la Croix celtique que nous ne nous attendions guère à trouver ici.
Les meubles, armoires et bahuts fort anciens en chêne massif eussent fait s’évanouir de joie un antiquaire. À première vue et sans hésitation possible, ils devaient dater du XVIe siècle.
Aux murs, quelques plats d’étain, et, faisant curieusement pendant à un moderne fusil de chasse, un antique mousquet à rouet avec sa fourche. Je ne pus me retenir d’aller l’examiner de près et constatai que l’arme, toute simple et sans incrustation, était bel et bien un authentique engin de guerre, soigneusement entretenu qui avait dû participer à maintes batailles des siècles passés, car des encoches pratiquées dans le bois de la crosse témoignaient du nombre des victimes abattues par lui au temps de son service actif. J’en comptai ainsi 17.
– Vous regardez le lance-pierre des anciens ? fit derrière moi la voix du père Courier.
– Excusez-moi, je n’ai pu me retenir d’aller voir de près ce beau mousquet, et je vous prie de croire qu’il n’y en a pas d’aussi bien conservé – et surtout bien entretenu – au Musée de l’Armée.
– Tout ce que vous avez ici, d’ailleurs, peut supporter avantageusement la comparaison avec les pièces les plus belles des demeures historiques les plus réputées... ajouta ma femme médusée par certain bahut à ferrures splendides. – On se croirait transporté à 400 ans dans le passé, tant votre belle maison y semble vivre encore !
– On n’en pourrait sûrement pas dire autant de vos meubles de Paris d’aujourd’hui... ajouta la femme rentrant à cet instant une cruche de cidre frais à la main.
Vous boirez bien un coup après ce voyage dans la poussière, par cette chaleur ?... dit-elle en posant devant nous deux bols à fleurs à l’ancienne mode, une miche de pain et du beurre.
– Décidément, il se confirme que nous faisons ici un voyage dans le passé... car votre famille a sans doute toujours habité ici ?
– Dame, ça fait longtemps !... répondit le conducteur du tacot tirant sur sa moustache... mais, vous ne mangez pas... allez donc, c’est de bon cœur, puisque vous êtes les neveux du Grand-père !
– Vous le connaissez ?
– Comme tout un chacun par ici, mais vous pensez bien qu’il ne sort guère à son âge !
– Cent-vingt ans !
– C’est bien possible... mes parents l’appelaient déjà le Grand-père !
– Alors, vous allez pouvoir nous renseigner, Monsieur Courier. Nous avons reçu il y a quelques jours une lettre de lui adressée au père de mon mari, mort depuis plus de 20 ans, nous invitant à le venir voir au plus tôt !... et ce Perrière mystérieux qui ne figure nulle part... au sujet duquel nous ne savons rien... et que tous par ici semblent connaître ?
– Tous... oh non !
– Un assez grand nombre en tous cas... et jamais secret de polichinelle ne fut mieux gardé !
Courier me regarda sévèrement :
– Il n’y a pas de secret de Polichinelle, Monsieur, il y a celui de Perrière ! que vous connaîtrez sans doute par votre oncle... et vous comprendrez !... Mais puisque c’est le Grand-Père qui vous a demandé de venir le voir, c’est Lui qui vous parlera.
– Allons, Monsieur Courier, ne vous fâchez pas !... mon mari seulement s’impatiente de ce trop long voyage pour une si petite distance et de la conspiration de mystère qui entoure ce Perrière où habite notre vieil oncle...
Sans répondre à l’intervention de mon épouse, le conducteur du « tacot » bourrait méthodiquement une pipe et l’allumait.
– Il nous reste à vous remercier de votre aimable accueil, Madame, poursuivit Lucienne se tournant vers notre hôtesse, et à vous prier de bien vouloir nous mettre sur la bonne piste pour nous rendre auprès de notre parent avant qu’il soit trop tard... car à son âge...
Le chauffeur souffla un nuage de fumée et daigna nous rappeler :
– Vous savez que vous ne pouvez point arriver à Perrière avant 10 heures 1/2 – à votre nouvelle heure...
– Pourquoi ? Il n’en est pas 6 et ce ne doit pas être si loin...
– Pourquoi ?... Parce qu’il fera nuit !
Et voyant notre mine déçue il poursuivit :
– Allez, si vous le voulez, faire un tour dans les environs et revenez souper ici vers les 7 heures 1/2... après, on vous conduira...
– Sur vos indications, nous irions bien tout seuls... Voici la carte d’État-major au 50.000e... je suis officier, combattant des deux guerres et...
– Ça ne se peut point... pensez donc que depuis 40 ans que j’habite ici vous êtes les seuls à venir à Perrière sans être du pays...
– Mais enfin... je comprends que vous ayez des instructions pour ne pas déranger mon oncle... qui ne doit guère aimer la société... mais puisque voici sa lettre... il nous attend...
– Il a été prévenu ; s’il dit de vous amener, on vous y mènera... excusez-moi, mais je m’en vais nettoyer ma machine à c’ t’ heure !
Et, se levant, notre trop discret interlocuteur se dirigea vers la porte, puis, se retournant sur le seuil, il ajouta : – Sans vous commander, vous pourriez comme ça aller vous promener jusqu’à la Pierre aux Fées – ça vous distraira...
Ne sachant que faire, et ne voulant importuner ces hôtes trop obligeants à certains égards, nous partîmes dans la direction indiquée contempler cette pierre aux fées.
Nous cheminions depuis un quart d’heure environ le long d’un mauvais chemin de terre, quand ma femme me fit observer que la prairie avait insensiblement succédé aux blés et bientôt même à une lande rocailleuse où poussait une plante à larges feuilles velues ombrageant des fruits ronds tenant de la courgette et de la citrouille pour la forme et la couleur, mais à peine aussi gros que des tomates. Des fleurs rouge-orange poussaient même encore à cette saison sur les tiges épaisses.
– On en cueillera quelques-uns au retour et nous demanderons à la ferme... lui répondis-je, intéressé seulement par l’apparition proche d’un énorme bloc de grès cylindrique de hauteur d’homme qui, tel un château fort, semblait régner, solitaire, sur cette lande rocailleuse parsemée des touffes de cette verdure aux larges feuilles.
Nous étions arrivés à la Pierre, et contemplions curieusement ce mégalithe.
– On dirait un menhir... il ressemble à celui de Bouillon [1].
– Ce pourrait n’être qu’un bloc erratique, bien que la géologie de ce pays ne s’y prête guère... fis-je en déployant ma carte pour chercher à en situer l’emplacement.
– Où sommes-nous ? demanda Lucienne se penchant sur la feuille déployée.
– Je n’en sais rien ; la Pierre aux Fées n’y figure pas plus que Perrière, et depuis Dourdan, j’ignore où nous a conduits le tacot du père Courier. – Vois-tu quelque clocher à l’horizon pour m’orienter ?
– Non, fit-elle après avoir scruté l’horizon... il n’y a que des bois par là-bas... une forêt semble-t-il... et par là des bouquets d’arbres... on ne voit même plus la ferme des Courier.
– Oh, mais ça... c’est curieux ; vois donc... j’oriente ma carte à la boussole et trouve devant moi le rebord ouest du plateau...
– Et puis ?...
– Et puis... regarde le soleil – et tiens mon stylo verticalement – que fait l’ombre ?...
– Mais elle ne fait plus angle droit avec le Nord... on dirait qu’elle part du N.-O.
– Je pense bien – elle fait un angle de 18°, tandis que si j’oriente ma carte au Soleil, nous avons au N. le bois de St-Benoît à 1 km environ, ce qui nous placerait ici – ... et je marquai au crayon un cercle approximatif.
– Qu’est-ce que ça veut dire ?
– Que ta boussole est détraquée !
– Ou que le Soleil s’amuse à nous faire des blagues, n’est-ce pas ?... Non, mon petit, il y a autre chose ?... mais quoi ?
– Les fées ?
– Ce seraient les fées qui dérangeraient l’aiguille aimantée ?
– Pourquoi pas ? Ne ris pas, je t’en prie, il y a ici, j’en suis certaine, la clef du mystère... Réfléchissons.
– C’est tout réfléchi : cette pierre est un bloc de minerai qui affole mon instrument. Si je vais me placer au N.-N.-O., de l’autre côté donc de la pierre dans le sens qu’indique l’aiguille, tu la verras faire un tête-à-queue et diriger sa pointe vers le rocher. – Tiens, regarde.
– Elle n’a pas changé de direction – elle indique toujours le N.-N.-O. J’y perds mon latin !
– Voilà le mystère de la Pierre aux Fées !
Violemment intrigué, je m’éloignai de l’énigmatique menhir et, lui tournant le dos, remontai vers le Nord.
Pendant une cinquantaine de mètres, ma boussole oscilla, affolée, sur le champ des 18°, puis, tout d’un coup, se décidant, elle reprit sa direction normale pointant résolument vers le N. magnétique.
Je fis alors le tour de la pierre, et constatai que, sauf dans cette direction N.-N.-O., son attraction cessait pour l’aiguille aimantée dans un rayon de 60 m., tandis que la boussole restait obstinément déviée vers le N.-N.-O. si, marchant dans cette direction, je tournais le dos au mégalithe.
Avec l’aide de ma femme qui toujours observait le soleil, juge infaillible, je traçai au crayon l’angle obtenu, mais, faute d’autres points d’observations, et dépourvu de tout instrument d’optique, je ne pus faire que rechercher, grâce au pendule radiesthésique que je porte constamment, le site de la Pierre aux Fées, qu’assez exactement je pointai sur la ligne magnétique des 18°.
– Paul ? ne crois-tu pas que nous sommes ici sur la piste de ce mystérieux Perrière ?
– J’en suis convaincu ; comme je pense que ce n’est pas pour rien que le père Courier nous a envoyés nous promener jusqu’ici.
– Si nous cherchions à retrouver l’oncle Louis tout seuls ? Ce serait amusant de voir la tête de l’ancêtre si nous arrivions par nos propres moyens jusqu’à lui ?
– Passe-moi donc sa lettre.
Ayant fixé la carte au sol avec 4 cailloux, je pris les radiations de l’oncle sur sa missive, et, appliquant le procédé de l’orientation mentale, cherchai, en suivant l’oscillation pendulaire, à déterminer une « ligne d’opération » entre la lettre-témoin et le domicile du scripteur.
L’expérience recommencée trois fois en plaçant successivement le témoin au Nord, à l’Est et au Sud de la carte nous permit, par intersections, d’obtenir un point sis à 3 kms 800 du menhir et sur la ligne même de déviation magnétique.
Ce point malheureusement se trouvait en dehors de la carte et ne pouvait être porté que sur la feuille voisine que nous ne possédions pas. Faute d’instruments, il m’était impossible de calculer les coordonnées.
– Cela n’a pas d’importance pour nous, fis-je enthousiasmé. Si tu veux nous allons de ce pas nous rendre à Perrière. Il n’y a qu’à marcher à travers la lande en suivant l’aiguille aimantée, et nous découvrirons le village inconnu.
– Et nos valises ?
– Diable, c’est pourtant vrai ! Elles sont restées à la ferme.
– Bah ! Tant pis... on reviendra plutôt les chercher.
Et, sans plus hésiter, joyeux d’avoir, tout seuls, découvert la piste de notre oncle, nous voilà partis à travers cette lande rocailleuse parsemée de ces bizarres bouquets de cucurbitacées.
Depuis une demi-heure nous marchions ainsi, lorsque, jetant un coup d’œil sur la boussole, je constatai avec surprise que celle-ci, obéissant à quelque nouvelle attraction, indiquait maintenant l’occident où le soleil déclinait.
– Que faisons-nous ? demanda ma femme. Suit-on la première indication avec la dérive Nord-Ouest de 18° ou celle-ci qui en fait presque 45 ?
– Suivons la boussole, – et repérons-nous.
C’est en vain que je cherchai un clocher, une cote marquante, un accident géographique quelconque. À l’Est, seule cote que me donnât ma carte, il n’y avait que des bois dont la configuration, modifiée par les ans depuis l’établissement du relevé, ne concordait en rien avec les données du plan que j’avais sous les yeux.
– N’as-tu pas l’impression que nous vivons un de ces contes bretons où les Korrigans s’amusent à perdre les voyageurs égarés sur les landes... suggéra Lucienne.
– Il y a de ça... et ce n’est pas le moindre attrait qui me pousse à vouloir percer le mystère de Perrière !
– De « Ferrière » peut-être ! car il y a certainement par ici des gisements métalliques qui affolent l’aiguille aimantée.
– Ferrière ou Perrière, il faudrait tout de même le dénicher.
– Ce n’est qu’une raison de plus pour observer la boussole... que l’oncle Louis nous a engagés à emporter, ne l’oublie pas.
Après un quart d’heure d’une marche fatigante, nous arrivâmes enfin au rebord du plateau d’ou l’on apercevait les cimes d’arbres touffus peuplant la vallée, quand surgit devant nous, remontant la pente, le jeune cycliste qui le matin même à Dourdan nous avait confiés au tacot du père Courier.
La même exclamation jaillit de nos lèvres :
– Vous !...
– N’allons-nous pas à Perrière par ici ? répliqua ma femme avec son plus gracieux sourire.
Interloqué, le jeune homme nous contemplait, hésitant à poser la question qui lui brûlait les lèvres.
– C’est Courier qui vous a indiqué cette direction ?
– Ah oui... avec ça ? fit-il en désignant la boussole que je tenais à la main.
– Avec ça, oui, et nous ne devons plus être loin maintenant de chez notre parent, n’est-ce pas ? questionna ma femme bluffant un peu.
– Je viens de le voir, et il m’a envoyé vous chercher à la ferme, avoua le messager.
– Conduisez-nous tout de suite auprès de lui.
– Ça ne se peut pas. – Il faut que je voie Courier d’abord, et lui fasse mes commissions. – Venez, et, après souper, je vous mènerai au Grand-Père avec vos valises.
Comme nous hésitions à le suivre, le bizarre agent de liaison de notre oncle ajouta :
– Venez, M’sieu dame, puisque je vous dis que vous le verrez ce soir, Grand-Père Louis.
– Mais pourquoi pas tout de suite ?
– Parce que ! fit le jeune homme nous regardant bien en face : on ne vient pas à Perrière quand il fait encore jour !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce fut après une marche silencieuse et pénible à travers champs et bois que notre guide, désignant un clocher massif dont la pointe se silhouettait à peine parmi les arbres, désigna pour nous renseigner :
– Voilà Perrière. Votre oncle habite ici, à gauche.
Et soudain, sans qu’aucun chemin ait pu nous faire présager l’entrée d’un village, nous débouchâmes à l’extrémité d’une place rectangulaire bordée de maisons à toits pointus encadrant l’église trapue qui en formait le petit côté, au Nord.
Le jeune homme, nous faisant passer par une ruelle, contourna l’une des maisons, nous fit pénétrer dans un jardinet et heurta le marteau d’une porte.
Une vieille femme en bonnet tuyauté vint ouvrir, un bougeoir à la main :
– Entrez donc, mes cousins, et soyez les bienvenus, mon grand-père vous attend.
Et, voyant notre étonnement, elle se présenta :
– Je suis Hermance Courier, la petite fille le votre oncle Louis et la Grand-mère de Philippe qui vous a amenés tantôt de Dourdan.
Un grand nez busqué, d’une pâleur de cire, émergeant d’une barbe neigeuse encadrée par les pointes d’un oreiller, telle fut l’inoubliable impression de blancheur que je ressentis en apercevant cet oncle énigmatique à la fuligineuse lumière d’une lampe qui n’éclairait que lui dans une vaste chambre enfouie dans la pénombre.
Calé par des oreillers dans une antique bergère à oreilles, enveloppé d’une houppelande, le chef couvert d’un bonnet grec, ses longues mains osseuses posées sur la chaude fourrure d’un chat blanc et roux couché sur ses genoux, le vieil homme semblait dormir.
Comme nous n’osions approcher, la voix faible mais nette du vieillard s’éleva :
– Je vous remercie d’être venus, mes enfants, mais j’ai peut-être trop tardé à écrire à mon neveu Émile pour joindre le dernier survivant direct de la famille, car maintenant les heures me sont comptées.
Comme, avançant doucement, nous regardions avec étonnement ce maigre visage quasi immobile, l’ancêtre, sans bouger le corps, souleva une main pour nous accueillir et ajouta :
– Vous voudrez bien m’excuser, ma nièce, de n’être pas allé au-devant de vous comme je l’eusse souhaité, mais depuis un mois il m’est impossible de me lever...
– Vous êtes souffrant, mon oncle ?
Notre parent alors ouvrit un œil, considéra ma femme, esquissa un sourire et laissa tomber :
– Je vieillis !
Le patriarche respira profondément, rassembla ses forces, nous observa tous deux de ses yeux gris, pénétrants et doux, se tira la barbe, puis s’adressant à moi :
– Tu es le fils aîné d’Émile ? Comment t’appelles-tu ?
– Paul, comme le frère de mon père qui est mort. Je suis le fils unique de votre neveu Émile, décédé en 1918. J’ai 44 ans. Voici ma femme, Lucienne. Nous avons un fils, nous aussi.
– C’est bien, Je suis heureux que ma lettre vous soit bien parvenue, et vous remercie tous deux d’avoir accepté les conditions bizarres de ce voyage. Demain, vous comprendrez les graves raisons qui motivent ces précautions ; c’est l’histoire même de Perrière qui les commande.
– Nous sommes à votre disposition, mon oncle, ce sera quand il vous plaira...
Le vieillard fit un geste léger :
– ... c’est le Temps qui n’est pas à ma disposition. Perrière a beau vivre en dehors de Lui, la Mort vient tout de même jusqu’ici... mon heure est venue, et je partirai avec la fin de cette lune – sans crainte et sans remords.
Excusez-moi, ma chère nièce, si je gâche ainsi des vacances que vous pouviez espérer plus gaies, mais chez nous la mort n’est pas un deuil...
Hermance vous a préparé une chambre agréable ; je vous souhaite une bonne nuit. Demain j’aurai besoin de toutes mes forces et te demanderai toute ton attention, mon neveu...
L’oncle Louis ferma les yeux et, reprenant son immobilité, nous fit comprendre que, pour ce soir, l’entretien était terminé et qu’il souhaitait reposer.
CHAPITRE III
L’ÉTRANGE AVENTURE DE L’ONCLE LOUIS
Tôt éveillés par le chant des coqs et rassurés par les bruits ménagers de la maison sur l’état de santé de notre oncle, nous étions descendus dans la cuisine où deux bols flanqués d’une miche de pain bis et d’une motte de beurre attendaient déjà notre venue.
– Avez-vous passé une bonne nuit, ma cousine ? s’enquit la vieille Hermance voyant ma femme descendre l’escalier de bois sculpté qui directement aboutissait dans la vaste cuisine aux poutres apparentes, à l’ancienne mode.
– Excellente, je vous remercie ; je me sens réellement reposée ; jamais je ne me suis trouvée aussi bien. Et... votre grand-père, comment va-t-il ce matin ? questionna Lucienne avec quelque hésitation, tant il lui semblait encore bizarre de parler de son grand-père à une aïeule.
– Il s’affaiblit ! J’ai dû l’aider à boire son bol de lait tout à l’heure... Mais il a toujours bien sa tête, et m’a dit de vous conduire près de lui quand vous aurez déjeuné...
– Tout de suite s’il veut !
Hermance s’indigna :
– Vous laisseriez le chocolat que je vous ai préparé ! Qu’est-ce que j’entendrais, moi, alors ! et ce disant, la cousine versait l’onctueux et odorant breuvage, dont nous avions depuis deux ans oublié la saveur. Du chocolat, du pain, du beurre ! mieux que tout ce qui nous avait encore ébahis dans ce voyage, la vue de ces largesses nous exprimait que Perrière était réellement hors du Temps, et que la guerre hideuse ignorait, elle aussi, le village oublié...
Assis maintenant au chevet du vieil homme bien calé dans son lit par un monceau d’oreillers, nous attendions, ma femme et moi, que l’oncle Louis se décidât à parler.
Le visage au ton d’ivoire était encadré de la mousse blanche de favoris s’épanouissant en une barbe broussailleuse sur le châle de laine blanche qui l’enveloppait, et donnait encore sur la netteté du linge la note majeure de cette symphonie en blanc qu’interrompait la ligne des sourcils demeurés inexplicablement noirs au-dessus de la sombre cavité des orbites.
La chambre, toute garnie de panneaux de chêne clair, donnait une impression d’un calme et d’une sérénité parfaites. Aucune autre décoration sur les murs que la croix aux quatre branches égales, encochées aux angles dans une triple couronne : de glands, de gui, et d’épis. Face au lit de milieu où reposait le « Grand-père », un portrait assez quelconque d’une femme coiffée en bandeaux.
L’une des fenêtres, fermée pour que le soleil ne fatiguât point les yeux du vieillard, laissait le lit dans une douce pénombre, tandis qu’un rayon doré allait rejoindre le cadre du portrait pour le flatter de sa lumière.
Une table, en chêne également, deux chaises et un fauteuil constituaient, avec la cheminée aux landrys de fer forgé, tout l’ameublement de la pièce. Aucun livre, aucun vêtement, aucun ustensile même de toilette n’était visible, happés sans doute par de mystérieux placards dissimulés dans les panneaux de revêtement.
Mon oncle, qui tout d’abord avait aimablement répondu à nos salutations, puis paru ensuite s’assoupir un peu, ouvrit l’œil droit, toussota, souleva la paupière gauche, parut s’intéresser au jeu de la lumière sur le mur, et, comme la blanche clarté atteignait le bord du cadre, il se décida enfin et entama son récit :
C’était en 1842, les Chemins de fer commençaient à étendre sur la France le réseau de lignes qui la sillonnent en tous sens aujourd’hui. De tous côtés des équipes d’ingénieurs des ponts, de géomètres, d’arpenteurs, étudiaient les tracés qu’emprunteraient les lignes futures. Sollicités par les uns, rebutés, voire menacés par les autres, ils suscitaient partout des conflits d’intérêts incompatibles avec les nécessités topographiques du tracé.
Mais de toutes ces intrigues ainsi que des spéculations auxquelles se livraient les hommes d’affaires d’alors, je n’avais guère souci. J’avais 19 ans, j’étais commis d’un géomètre ami de mon père, et de l’aube à la nuit par monts et par vaux, le niveau, la planchette et le théodolite en main, nous relevions le tracé envisagé pour la construction, par les Chemins de fer de l’Ouest, de la ligne Paris-Chartres-Le Mans.
Le soir, les équipes d’ingénieurs et de topographes se réunissaient à l’auberge pour collationner les relevés opérés dans la journée et prendre en commun le dîner, plantureux, bien arrosé de cidre ou de vin blanc. Notre patron n’hésitait pas à payer des 20 à 25 sous pour la pension. 1842 ! À Paris, on se plaignait de la vie chère !
Or, ce matin-là, le jeudi 20 Avril 1843, je m’éveillai joyeux. Un gai soleil se levait dans un ciel clair de printemps pour fêter mon 20e anniversaire. Mes compagnons l’avaient honoré la veille d’une bonne bouteille, et Monsieur Guérault, mon patron, d’une pièce de cent sous.
Descendant dans la salle commune, je trouvai ces messieurs en grande discussion avec les autorités locales autour des épures et des cartes déployées.
Je déjeunai tranquillement sur un coin de table sans que l’on s’occupât de moi, puis préparai ma sacoche, mes piquets de jalonnement, pour être prêt à partir.
M. Guérault m’interpella :
« Louis, nous n’irons pas sur le terrain aujourd’hui. J’en ai pour un moment encore avec ces Messieurs ; ensuite, nous mettrons au net les levées de la semaine dernière. Je n’ai plus besoin de toi ici ; et puisque tu n’as qu’à te promener, va donc faire un tour en direction Ouest, à travers les bois. Tâche donc de voir si le terrain présenterait de grosses difficultés pour faire passer la ligne au Sud de la forêt de Rambouillet... Emporte un casse-croûte, ton carnet de croquis. Prends ton temps, regarde ; promène-toi... de là... jusqu’à là-bas » me dit-il en me montrant sur la carte deux points distants de trois lieues environ. « Ne reviens que demain, mais surtout n’aie l’air de rien », et, baissant la voix, il ajouta : « Ces croquants d’ici ont de telles exigences pour leurs terrains que je ne serais pas fâché de leur jouer un tour et de proposer à la Compagnie mn itinéraire plus économique... Maintenant, file ! Suivant ta réponse, j’irai voir moi-même le trajet que je t’ai montré. »
Tout gonflé d’importance devant la délicate mission qui m’était attribuée, je partis aussitôt dans la direction indiquée en sifflant de tout mon cœur, je m’en souviens encore, tant les détails de cette journée me sont restés présents à l’esprit :
« On va leur percer le flanc »... et autres airs guerriers de l’Empire que mon père aimait encore à chanter en souvenir de la Grande Armée.
Dans le ciel clair, les alouettes invisibles semblaient partager ma joie de vivre. La campagne, toute fleurie, n’était qu’agrément, partout la jeune verdure habillait de neuf les champs et les arbres.
Quittant la route au premier tournant, je m’engageai tout droit vers la ligne plus sombre des grands bois tout proches, suivant mon ombre, avec mon destin.
Le vieillard ferma les yeux, et pendant quelques instants ce fut à nouveau le silence dans la chambre ; un vrai silence, absolu. Nous eûmes même l’impression curieuse que ce n’était point le « silence de mort » lugubre, qui eut paru tout naturel auprès de cet homme qui vivait ses dernières heures, mains un silence attentif, respectueux, comme celui de gens qui écoutent et attendent une parole. Dans cette pénombre, la longue théorie des souvenirs défilait devant les yeux clos de l’oncle Louis.
Inquiet de l’immobilité prolongée de notre parent, je fis un geste pour lui prendre le poignet. Sentit-il mon intention par une acuité aigue de ses perceptions ? Le centenaire souleva légèrement la main en signe de protestation.
– Non, ça va très bien ; je regardais mon passé. Je ne vous raconterai pas les observations que je fis ce jour-là sur la contexture topographique de la région. Le bois était assez touffu, giboyeux, me sembla-t-il, le sol y inclinait en pente douce vers l’Ouest. Je le traversai tout entier et déjeunai à sa lisière, bordée d’un ruisseau, au-delà duquel je remontai en terrain découvert.
C’est là, en haut de cette côte qui n’offrait aucun obstacle sérieux à la construction d’une voie ferrée que je remarquai un roc isolé curieusement perdu sur cette terre grasse totalement dépourvue de minéraux.
C’était le premier repère géodésique qu’il m’eut été donné d’observer depuis le matin. La nouvelle carte d’État-major récemment parue dont je disposais n’en faisait pas mention. J’essayai donc d’en relever sommairement les coordonnées pour les situer sur mon carnet quand je constatai à ma vive stupéfaction que l’aiguille aimantée de ma boussole semblait marquer une différence d’orientation avec l’azimut –270° que je suivais depuis le matin.
– Vous étiez à la Pierre aux Fées ! Pareille chose nous est arrivée hier après-midi !
– Comment ? vous avez découvert le secret de la Pierre ? s’exclama l’ancêtre en se soulevant sur ses coudes.
– Mais oui, mon oncle, fis-je d’un ton faussement modeste. Et en quelques mots, je le mis au courant de notre excursion de la veille.
Le vieil homme m’examinait curieusement. Il fit un effort pour me tendre sa main valide que je retins.
– Ésus l’a donc voulu ! murmura-t-il. Écoute-moi donc, tu auras l’explication du mystère.
Je ne vous demande aucun serment, mes enfants. Lorsque vous connaîtrez le grand Secret, notre secret, celui de Perrière-les-Chênes, c’est toi-même qui jugeras de ce qui peut en être dévoilé.
– Nous ferons selon votre volonté, oncle Louis.
Le centenaire nous regarda l’un après l’autre, et déclara :
– J’ai soif !
Ma femme déjà se dirigeait vers la porte.
– Non, s’il vous plaît ma nièce, pas par là. Ouvrez le placard, dans ce panneau, à gauche de mon lit ! Glissez vos doigts le long de la moulure, vous rencontrerez un taquet faisant saillie.
– J’y suis !
– Poussez le vers haut ; passez votre main dans la fente et tirez à vous.
Très intriguée par cette fermeture bizarre, Lucienne exécuta la manœuvre indiquée, et sans difficulté ouvrit le placard secret sur les planches duquel s’alignaient de nombreux paquets d’archives soigneusement étiquetés et ficelés, quelques flacons et des verres.
– Combien en reste-t-il ?
– Trois, mon oncle !
– Ce sera bien juste pour finir ensemble, observa simplement l’aïeul. Débouches-en une et sers-nous à boire.
Un joli vin blond glouglouta dans le verre présenté par ma femme.
– Vous aussi, mes enfants !
– À cette heure-ci ! protesta mon épouse choquée.
– Pour boire à « ma santé » ma nièce !
Devant cet argument sans réplique chez un mourant, sans plus insister, elle tendit son verre.
– À votre santé, mon oncle !
– Ma santé, voyez-vous, c’est tout ce qu’il reste... trois bouteilles !... ça vient d’une vigne que les Pères cultivaient sur le coteau... Elle a disparu... le phylloxera... Avidement, soutenu par nous, l’oncle en but une lampée ; j’y goûtai, ma femme y trempa ses lèvres.
– Est-il bon ?
Surpris d’abord du goût de ce nectar tant apprécié de notre parent, j’en dégustai à nouveau.
Le vin de Perrière avait un curieux arôme où le parfum de la fraise des bois s’alliait curieusement à celui de la pierre à fusil... ce n’était pas mauvais... non... plutôt agréable même, mais assez léger en somme.
– On dirait un vin d’Anjou, appréciai-je.
L’oncle Louis sourit avec quelque pitié :
– Vin d’Anjou ! vin d’Anjou... pourquoi pas d’Alsace ! Nous en reparlerons !
Et, ragaillardi, d’un trait, il sécha son verre.
Quelques instants il ferma les yeux, se recueillant pour revivre l’époque lointaine qu’il évoquait devant nous ; peut-être aussi pour savourer la boisson dont il faisait tant de cas et poursuivit :
– Intrigué comme vous le fûtes par la déviation de l’aiguille magnétique, je pris le parti d’en suivre la direction qui, vous le savez donc, me faisait obliquer de 18 degrés vers le Nord, au lieu de poursuivre la route vers l’Ouest, comme M. Guérault me l’avait commandé. Ce fut, je vous le jure, sans idée préconçue, par simple fantaisie... Ce que l’on croit une simple fantaisie... et qui n’est, je l’ai souvent constaté, qu’un impératif du Destin. Eussé-je marché sans boussole, au soleil, ou soustrait la déclinaison de 18° après avoir simplement noté le phénomène, ce que les géomètres n’eussent pas manqué de faire, je passais au Sud de Perrière sans en soupçonner l’existence, et toute ma vie en eut été changée.
Bientôt je parvins au rebord du plateau qui s’arrête, vous l’avez constaté, sur une faille abrupte d’où l’on domine les frondaisons des chênes au milieu desquels se dissimule ce village oublié.
Arrivé là, je m’assis pour noter sur mon carnet de croquis les coordonnées approximatives de l’endroit. L’épaisseur du taillis m’empêchait d’apprécier la profondeur du ravin dans lequel j’aurais à descendre tout à l’heure. Du reste, rien ne me pressait, le coin était charmant, les oiseaux – que je pouvais voir distinctement étant moi-même au niveau des hautes branches – gazouillaient sans arrêt ; un merle y lançait ses trilles que le coucou scandait de son appel monotone.
Par association d’idées, je me mis moi-même à siffler :
« Dans le jardin de mon père
Les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux du monde
Y viennent faire leur nid. »
Alors résonna du fond des bois une voix fraîche et cristalline enchaînant les paroles...
« La caille, la tourterelle,
Et la jolie perdrix... »
ne put s’empêcher de fredonner Lucienne.
– C’est cela même ; continuez, je vous en prie, ma nièce...
« Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon, fait bon, fait bon,
Auprès de ma blonde,
Qu’il fait bon dormir. »
Le vieil homme, paupières closes, écoutait, heureux, la banale chanson qui lui rappelait ses 20 ans.
Pendant quelques couplets nous avons ainsi continué sans nous voir, l’invisible chanteuse et moi, mêlant par jeu nos voix unies au concert des oiseaux...
Soudain je ramassai mes carnets de dessin, mes instruments et, avisant une manière de sentier de chèvre que je n’avais pas aperçu tout d’abord, j’en dévalai la pente, glissai, et me retrouvai assis par terre, aux pieds de la nymphe de ces bois dont je n’avais encore qu’entendu la voix.
Nous éclatâmes de rire tous les deux.
Pour moi, ce fut un éblouissement. Sans même songer à me relever, je contemplai l’exquise jeune fille qui se tenait devant moi comme si c’était la divinité même de ces lieux qui soudain m’était apparue.
– Incessu patuit dea ! me permis-je de suggérer à mon oncle qui, tels les hommes de cette époque, devait aimer les citations latines. Mais, tout à son évocation, il n’y prit pas garde.
– Un rayon plus malin qui avait réussi à percer l’épais feuillage changeait en or léger la mousse blonde des cheveux de mon apparition. Le mouchoir de couleur qui les devait couvrir avait glissé sur sa nuque, mais je n’avais d’yeux que pour les quenottes d’émail d’où partait comme d’un carillon le rire perlé dont elle accueillait ma chute.
Ce fut elle qui la première me tendit la main pour me relever, ce à quoi je ne songeais point, occupé seulement à contempler cette blonde, illustration vivante de ma chanson.
– Je suis sotte de rire ainsi, peut-être vous êtes-vous fait mal ?
– Non pas, j’ai simplement glissé dans la descente et, comme j’avais les mains encombrées, je n’ai pu me retenir... Mais peut-être, Mademoiselle, pourriez-vous me renseigner... où sommes-nous ici ?
La jolie fille parut alors me regarder avec méfiance :
– Vous devez le savoir puisque vous êtes venu jusqu’ici !
Je voulus alors en imposer à mon interlocutrice par l’énoncé de mes titres et qualités :
Louis Futaies, géomètre, chargé d’établir le tracé d’une nouvelle route de Paris à Chartres qui passera par ici, osais-je affirmer.
L’effet de prestige que j’escomptais ne rendit pas. Seul le mot « Paris » avait impressionné la jeune personne :
– De Paris... vous venez de Paris ?
– Dame... fis-je sans me compromettre, pour conserver ce titre à l’admiration de la demoiselle, alors qu’en réalité je venais de Châteaudun, où nous habitions mes parents et moi, et n’avais guère mis qu’une fois les pieds dans la capitale,... pour deux jours seulement.
– Oh, parlez-moi donc de Paris, on dit que c’est si beau ! et je voudrais tant y aller !
– Ce sera facile quand le chemin de fer sera construit, et... c’est moi qui aurai le plaisir de vous y mener... si vous le voulez bien... dis-je en lui prenant le bras avec une timide audace... mademoiselle... mademoiselle ?
– Lysiane, Lysiane de Chamou.
Quelques instants nous nous sommes regardés, échangeant en silence les mots que nous n’osions prononcer.
Puis les yeux couleur aigue marine de Lysiane se voilèrent d’inquiétude :
– Un chemin de fer, dites-vous, qui passerait par ici pour conduire à Paris ?... pourquoi un chemin de fer, ceux de pierre ne sont-ils pas aussi bons ?
Souriant de la naïve ignorance de ma nouvelle amie, je tentais de lui expliquer doctement la profonde différence qui existait entre ces deux voies de communications. Nous étions assis par terre, et, sur mon carnet, je dessinais pour elle locomotives et wagons.
– Alors, voyez-vous, Mademoiselle Lysiane, si nous faisons passer la voie ferrée par ici, je pourrai revenir vous voir... vous emmener à Paris... avec moi... puisque je travaille pour la Compagnie de l’Ouest...
Ce disant, sous prétexte de lui montrer le trajet futur de la ligne Paris-Chartres, j’avais pris la main de la jeune fille et de son doigt la faisais déjà voyager en ma compagnie à travers cette campagne chartraine où nous nous étions rencontrés.
Peu habituée à cette lecture, elle suivait mes explications avec la plus grande attention, lorsqu’ayant compris quel bouleversement le trafic envisagé amènerait avec soi dans cette contrée si paisible, elle tourna vers moi un regard où passait une sorte de terreur :
– Votre chemin de fer passerait donc ici même, dit-elle, par les bois de Saint Benoît ?
– Si vous le voulez... Lysiane.
– Ça ne se peut pas... il ne faut pas...
– Mais pourquoi ?... j’espérais que...
D’un bond elle s’était relevée.
– Non, ça ne se peut pas, il ne faut pas ! répétait Lysiane comme en proie à une inexplicable frayeur, et, me prenant par la main :
– Venez voir mon père ; il faut qu’il sache !
Sans hésiter je suivis ma blonde amie. Quelque temps nous marchâmes en silence ; puis j’osai la questionner :
– Monsieur de Chamou habite loin d’ici ?
– Non, à vingt minutes à peine.
– Ah... c’est que le prochain village n’est pas à moins de deux lieues...
Lysiane me regarda dans les yeux, parut hésiter, puis, sur un ton de confidence murmura :
– ... le prochain village, oui, mais maintenant, c’est à Perrière que je vous emmène.
Ayant gratté à la porte, Hermance entra portant sur le bras la robe de chambre fraîchement repassée de notre oncle :
– Il est 10 heures. Voulez-vous vous lever aujourd’hui, Grand-père ?
– Je vais essayer ; j’aimerais être aujourd’hui à table avec vous pour fêter votre arrivée, ma nièce... Tu nous as fait quelque chose de bon au moins, Hermance ?
– Il y a des rillettes, un pâté en croûte, du poulet aux glands comme ils n’en ont jamais goûté, avec de la salade et une crème fouettée... Je n’ai pas eu le temps de faire mieux, s’excusait déjà la vieille dame, tandis que nous nous récriions d’admiration.
– Alors si vous le permettez... dit l’Oncle Louis... vous pourrez faire un tour et visiter Perrière avant le déjeuner... un de mes amis que vous verrez tout à l’heure vous fera tantôt visiter l’abbaye...
– À midi donc, mon oncle, ménagez-vous...
– Ah, pardon, j’oubliais, prévint la cousine... nous déjeunons à 11 heures ; nous conservons les anciennes modes ici.
La première personne que nous vîmes en sortant fut notre jeune cousin Philippe qui nous avait confiés la veille au tacot du père Courier, puis amenés le soir jusqu’ici.
– Alors vous avez trouvé le grand-père encore debout ? nous dit-il en nous tendant la main sans façon ; vous savez maintenant pourquoi il ne faut pas venir ici dans la journée ? Les anciens défendent bien Perrière dans ses chênes – et c’est ainsi que depuis des siècles nul n’est venu ici sans leur permission.
Flairant une éclaircie dans le ténébreux mystère qui entourait ce village, ma femme m’alerta d’un coup d’œil et demanda :
– Nous avons ce matin longuement parlé avec Monsieur Louis notre oncle, et reprendrons cet entretien tantôt, mais nous ne sommes pas encore sortis et ne connaissons pas les autres anciens dont vous parlez.
– Il ne vous a encore rien dit ? Mais tout à l’heure vous aller déjeuner avec eux, depuis hier ma grand’mère me fait courir pour les invitations et pour les préparatifs de ce repas !
– Mon Dieu, et moi qui ne suis ni habillée, ni coiffée ! s’indigna Lucienne.
– Bah ! vous gâcheriez bien votre poudre de riz à vous pimparer pour eux ; ce sont tous de très vieux bonshommes dont le plus jeune doit avoir présentement 70 ans et le doyen est notre grand-père. Tenez, voyez-vous ces deux-là, souffla-t-il, en montrant d’un signe de tête deux personnages bizarrement attifés d’une sorte de houppelande blanche à capuchon et bavardant sur le seuil d’une porte avec une tierce personne invisible... eh bien, c’en sont deux.
– Deux... quoi ?
– Deux Pères, pardi ! Dans le temps ils habitaient l’abbaye, mais depuis la Révolution ils habitent séparément. Maintenant toute cette partie-là a été démolie ; il ne reste plus que la chapelle, le cloître et la salle du Chapitre ; voulez-vous voir ?
– Oh, ajouta-t-il voyant ma femme consulter son bracelet-montre, une demi-heure suffira, et Madame aura le temps de se refaire un brin de toilette avant déjeuner.
L’agglomération de Perrière, à l’extrémité de laquelle nous nous trouvions, n’était en réalité qu’une place d’une cinquantaine de mètres de large et longue de 300, bordée de chaque côté par d’antiques maisons à pignon aux bois apparents. Toutes possédaient un étage construit en avancée sur un rez-de-chaussée fort bas en pierre, du style roman le plus pur, souvent orné de sculptures aux motifs de feuillage ou d’épis. Quelques-unes possédaient même un déambulatoire couvert par l’étage supérieur et reposant sur des arches en plein cintre reliant entre elles de massives colonnes qui unissaient parfois deux et trois logis différents.
Il n’était pas une de ces maisons que l’administration des Beaux-Arts n’eût classée sans hésitation, si un inspecteur de ce ministère eût été admis à visiter Perrière.
Toutes semblaient habitées, bien entretenues. Des glycines, de la vigne, voire du chèvrefeuille plus sauvage encadraient parfois les portes, au-dessus desquelles se détachaient uniformément la croix celtique en son triple cercle, et une date.
De rares personnes, âgées pour la plupart, apparaissaient parfois aux fenêtres ou dans les jardins ; mais nul hormis nous trois ne circulait dans cette rue où l’on ne remarquait aucune boutique décelant une activité commerciale quelconque.
Tout bien considéré, le nom d’avenue eut mieux convenu à cette voie sur laquelle des chênes centenaires, poussés entre deux groupes de maisons, étendaient parfois leur ramure car, issue de sentes forestières, elle semblait n’avoir d’autre but que de conduire d’Est en Ouest à l’abbaye millénaire dont le clocher trapu dépassait à peine la cime des arbres. Eut-on passé en avion au-dessus de ces bois qu’il eut été impossible de distinguer l’agglomération.
Chemin faisant, Philippe n’avait pas manqué de saluer, avec plus de respect que n’en témoignent d’ordinaire les jeunes gens, les quelques rares cénobites rencontrés, et ceux-ci, hommes ou femmes, nous avaient également rendu notre inclination avec courtoisie, accompagnant le signe de tête muet du charmant geste de la main qu’ont parfois les ecclésiastiques.
Arrivés sous la lourde voûte percée comme après coup dans l’épaisseur des murs de la tour, notre guide nous quitta un instant pour quérir en une cachette l’énorme clef dont il ouvrit la porte bardée de fer de la mystérieuse demeure.
Aucune sculpture, aucun autre motif n’ornait l’entrée sauf, à la clef de voûte, la même croix encochée sertie en un triple cercle de feuillages, avec au-dessous l’inscription que je relevai soigneusement :

Nos yeux eurent tout d’abord quelque peine à s’accoutumer à la pénombre qui régnait en ce lieu. Les ouvertures qui auraient dû enchâsser les vitraux, étaient pour la plupart obstruées par des planches, ou tellement envahies par les plantes grimpantes qu’aucune clarté à vrai dire ne pouvait éclairer la chapelle aux voûtes surbaissées où nous nous trouvions.
De la toiture seule tombait un rayon qui éclairait le chœur d’une lumière dorée où dansaient des milliards d’atomes. Mais cette lumière si crue ne faisait qu’ajouter à la difficulté éprouvée par nos yeux à s’acclimater à l’obscurité, tant et si bien qu’il nous était impossible de rien distinguer dans l’architecture de ces lieux qu’elle fût éclairée ou non. Comme happé par la nuit, notre guide avait disparu.
Naturellement attirés par la lumière, nous tenant par le bras, nous nous dirigeâmes vers la seule partie éclairée de l’antique édifice, tout en tâtant de ma canne le sol inégal au dallage disjoint.
– Madame, Monsieur, je suis charmé de vous voir et vous remercie de votre visite. Votre grand oncle m’a parlé de vous, mais je n’espérais pas que Philippe pourrait si tôt vous conduire jusqu’ici !
Passablement interloqués, nous cherchâmes à distinguer l’invisible interpellateur qui, lui, se déclarait charmé de nous « voir ». Avançant de quelques pas encore, nous apparut, à la limite du cône de la lumière et de l’ombre, un personnage bizarre, vêtu d’un froc blanc comme celui des moines, qui nous tendit les mains en un geste d’accueil paternel. Philippe, debout près de lui, crut devoir faire les présentations :
– Nos cousins, Lucienne, Paul... le Père André, mon Grand-père.
Respectueusement nous saluâmes le religieux.
– Mes chers amis, je conçois votre étonnement de tout ce que vous voyez et entendez ici depuis hier, pour découvrir finalement dans une abbaye presque millénaire des « pères » légitimement mariés vivant avec leurs enfants.
Je n’aurai garde d’anticiper sur les explications que votre Grand Oncle voudra bien vous fournir, avec notre assentiment. C’est du reste d’accord avec lui que nous vous avons autorisés à pénétrer dans ce sanctuaire, où seuls les nôtres sont admis depuis que la dissolution des congrégations promulguée en 1792 nous a rendu notre totale liberté vis à vis de l’Église.
– En somme, si je vous comprends bien, mon Père, vous êtes les membres, en quelque sorte schismatiques, d’une abbaye de Bénédictins ; et depuis 150 ans vous vivez isolés et repliés en ce village que vous avez su, grâce à je ne sais quel phénomène géographique, tenir hors du siècle, en comprenant ce mot aussi bien dans le sens laïc que dans celui de l’Église ?
– C’est cela même ; mais j’ajouterai à votre observation que ce « schisme », pour employer votre expression, n’a fait pour nous que sanctionner un état de fait. La communauté de Perrière existait, vous apprendrez comment, bien avant que sa parfaite Sérénité, le Père Benoît, ne réussît à lui faire admettre une règle qui lui permit de vivre quelques siècles indépendante, au sein de l’Église, malgré les profondes divergences doctrinales qui l’en séparaient.
– Pardon, intervint Lucienne, je ne comprends pas qu’un ordre monastique comme le vôtre, cité en exemple parmi les plus sévères, puisse confesser des doctrines... hétérodoxes, et malgré ces divergences, vivre des siècles en bonne harmonie avec des autorités religieuses qui ne badinaient pas sur le respect des dogmes ?
Le père André sourit dans sa barbe :
– Distinguons, voulez-vous d’abord, entre l’ordre des Bénédictins, d’une orthodoxie incontestée, et l’antique communauté de Perrière, autonome dans le sein de cette congrégation.
– Je comprends de moins en moins.
– Cela se voit pourtant encore en bien d’autres cas, ma chère Madame, quand un personnage, ou un groupement (plus ou moins occulte à titres divers) a besoin d’une couverture officielle pour subsister... et lorsqu’il dispose de moyens suffisants pour faire respecter son indépendance.
Le Secret de Perrière ? Il fut, sachez-le, celui des Rois de France, rois très chrétiens presque constamment en opposition plus ou moins ouverte avec Rome – et en guerre contre le Saint Empire Romain germanique ou leurs Majestés très catholiques !
– Mais alors, mon Père, c’est toute l’histoire de la France qui s’inscrirait en ces murs ?
– Peut-être plus encore, mon cher Ami, car il n’y eut jamais plus fidèles alliés jusqu’à Louis XIV que les rois et nos pères. Tous les monarques français sont venus ici, ont revêtu notre robe de lin, et, au pied de cet autel, ont assisté au divin sacrifice... En ces temps, l’abbaye abritait avec les Pères près d’un millier de personnes... aujourd’hui...
– Apparent rari nantes in gurgite vasto... crus-je devoir apprécier par l’emploi d’une citation de Virgile.
Le Père André me toisa, et d’un ton sec :
– Nous n’avons jamais employé le latin ici, Monsieur ! Rien que le français... ou le celte. Et cet autel devant lequel se sont agenouillés Charles le Grand, Philippe Auguste, Saint-Louis, Jeanne d’Arc et Louis XIV est toujours le même depuis qu’il y a des millénaires Hû Gadarn est venu sous les chênes y verser son sang pour consacrer l’alliance des Gaulois et des Celtes.
Avec une respectueuse émotion, ma femme et moi, nous tenant par la main, contemplions l’antique autel de pierre brute, immuable sous le rayon doré qui le nimbait d’une douce lumière.
Par association d’idée, nous levâmes la tête ensemble pour voir l’ouverture par où tombait cette unique clarté illuminant le temple vénérable.
À notre stupéfaction, nous ne distinguâmes aucune fenêtre, aucune meurtrière, par où pût entrer le rayon solaire. Celui-ci semblait émaner de la voûte elle-même, de la coupole à vrai dire qui s’arrondissait au-dessus du mégalithe.
– Cela vous intrigue ? fit le père André.
– J’ai vu des églises modernes à coupoles en béton translucide, dis-je ; mais ici, j’avoue ne pas comprendre. La lumière paraît émaner des pierres même, sans que nous y puissions distinguer d’éléments translucides.
– Êtes-vous mathématicien, ou physicien ?
– C’est à grand peine que j’en ai appris quelques rudiments pour passer mon baccalauréat...
– Et vous Madame ?
– Je n’y entends goutte.
– Tant mieux, vous comprendrez plus vite. Je vais donc vous poser quelques questions : Pour vous, Madame, combien y a-t-il de dimensions ?
– Quatre ! répondit ma femme sans hésiter.
– Oh, parfait, se réjouit le vieillard, quatre, dites-vous ? Oui, au moins, et, quelle est la quatrième dimension ?
– Ça je ne sais comment l’appeler... c’est l’Invisible, l’immatériel, l’Éther, où se meuvent les astres...
– Regardez donc le symbole de la croix celte. Quatre branches égales, encochées de quatre cercles, et sertie de trois circonférences géométriquement espacées... horizontalement, deux branches : longueur et largeur, verticalement au-dessus, la hauteur, donc, en dessous !
La PROFONDEUR, c’est-à-dire tout ce qui se meut à l’intérieur des volumes comme des surfaces dans le Fini comme dans l’Infini, qui contient les QUATRE éléments répartis dans les trois mondes. Or, ces quatre dimensions sont, le voyez-vous par le dessin schématique de la croix, interdépendants par le POINT, un seul POINT de contact. Point commun à la longueur comme à la hauteur, à la largeur comme à la profondeur et à leurs résultantes : Surface, Volume, Éther. Ce point, c’est l’atome impondérable dont les innombrables possibilités de combinaisons expriment la Puissance Infinie de l’Incréé.
Plus ou moins agglomérés, répétant par telle ou telle disposition de la contexture de leur masse toutes les nuances de la lumière, les matériaux, agglomération statique de molécules, ne peuvent, quelle que soit leur densité, arrêter tous les assauts de tous les atomes dynamiques. Certains mourront du choc et demeureront sur l’obstacle qui les arrêta ; d’autres passeront, en plus ou moins de temps, voire même y proliféreront... De quelle durée sera ce passage à travers cette quatrième dimension – pour la lumière, ce sera de 300.000 km. à la seconde dans l’Éther – pour tomber à zéro devant certains corps d’une densité infranchissable ; mais plus lentement, elle en traversera d’autres.
Nous, hommes des Chênes, avons étudié ceci depuis longtemps non point en des laboratoires où les conditions de l’évolution naturelle se trouvent faussées par une expérimentation trop rapide, mais par des siècles d’observations et nous avons dépassé vos prétendues sciences exactes pour en arriver à la Physignose.
– La Physignose ?
– De Physis (nature) et de Gnose (connaissance).
– Je constate, dis-je, pour prendre ma revanche de la récente rebuffade que m’avait value ma citation latine, que vous n’avez point pour le Grec l’aversion que vous avez pour le latin ?
– Assurément non, car le grec, langue littéraire, nous a depuis 4.000 ans servi de truchement entre les penseurs occidentaux qu’ont asservis les tyrans de Rome.
– Soit. Que nous enseigne donc la physignose en l’espèce, mon Père ?
– Ceci :
Une combinaison d’hydrogène et d’oxygène parvient en un temps plus ou moins long à traverser une pierre, par exemple, d’un côté de laquelle suinteront encore des gouttes d’eau reconstituée alors que l’autre face sera sèche. C’est ce qui se passe sous nos arbres qui retiennent au passage des gouttes d’eau pour n’en laisser tomber qu’une partie au sol.
Des observations millénaires nous ont renseigné que tel corps, pierre, bois ou métal, est perméable ou non à telle qualité de bruit, à la chaleur, à l’humidité, à la lumière, et ce, avec divers coefficients de rapidité. Il en résulte que le temps terrestre est, à l’échelle humaine subsolaire, l’expression de la durée que met un atome ou une combinaison atomique quelconque à traverser une autre masse atomique condensée ou subtile.
Il fallait obtenir que l’autel du Sacrifice fût constamment exposé aux rayons solaires ou stellaires afin d’en recevoir les influx selon les prescriptions de notre antique religion, et concilier cette exigence avec l’obligation d’enfermer l’autel sous les voûtes d’un temple. Les compagnons de Sa Parfaite Sérénité le Père Benoît combinèrent donc, il y a neuf cents ans, une composition d’éléments minéraux d’une densité à peu près équivalente : quartz, marbre, ardoise cristal et calcaire, telle qu’elle puisse laisser filtrer les neuf qualités de rayons du prisme qui, de l’infrarouge à l’ultraviolet, constituent la lumière solaire, pour que celle-ci, diversement retardée dans son passage au travers de la voûte, puisse se reconstituer à l’intérieur, et, sauf pendant quelques heures des plus longues nuits d’hiver, éclairer constamment la Pierre sacrée.
Stupéfaits, nous regardions alternativement cette voûte opaque d’où filtrait une sereine clarté, et le massif autel gravé de signes mystérieux.
Le Père André, impassible, nous regardait, paraissant, selon son habitude, attendre une question. Je m’y hasardai :
– N’y a-t-il jamais eu de réparations à ce dôme, mon Père ? La concavité me semble quelque peu déformée, affaissée...
– Ne faut-il pas, pour obtenir la même lumière qu’au dehors, que la courbure de la coupole soit parabolique et reproduise à la même échelle, et sous le même angle de 23°, la calotte terrestre à notre latitude ?
– Comment, s’exclama mon épouse, vos fondateurs savaient-ils tout cela ?
– Galilée n’a fait que retrouver certaines lois que tous les mages des centres initiatiques de l’antiquité connaissaient.
– Pourquoi donc garder ainsi secrètes des connaissances que les chercheurs et savants ont patiemment redécouvertes, au lieu de faire avancer le Progrès ?
– Parce que, mon fils, les hommes n’ont jamais su faire avancer de front le progrès matériel et leur évolution morale ; et vous le voyez en cette sinistre époque : ils n’ont su cambrioler quelques-uns des mystères de la nature qu’à seule fin de mieux se combattre et s’exterminer.
– Je vous l’accorde bien volontiers, approuva Lucienne, mais avant de vous quitter, mon Père pour ne pas être en retard au déjeuner de mon oncle, permettez-moi de vous demander : comment a-t-on pu construire une telle voûte avec des éléments aussi divers, donc fragmentaires, sans trop les altérer par le mortier ou la chaux qui devaient les agglomérer ?
Déjà le vieil homme, passant entre ma femme et moi, nous prenait par un bras et nous entraînait :
– C’est bien simple, il n’y en a pas !
– Comment donc, depuis mille ans ?...
– Et l’attraction magnétique, vous l’ignorez évidemment. Sachez donc que Perrière se trouve au nœud de plusieurs grandes lignes d’ondes telluriques qui en font le foyer de radiations le plus intense de France. Mais nous pourrions parler de tout cela en déjeunant, si vous le voulez bien.
Comme le vieillard nous entraînait vers un point qui ne nous semblait être nullement celui de la porte d’entrée, Lucienne s’excusa :
– Ce serait avec le plus grand plaisir, mon Père, dit-elle, mais notre oncle nous attend pour onze heures, et nous ne pouvons...
– Il n’en est pas question, ma chère dame, se récria le père André ouvrant une invisible porte sur la forêt, puisque je vous accompagne... Mais oui, puisque je vais déjeuner avec vous !
CHAPITRE IV
Lorsque, à la suite du Père André, nous pénétrâmes dans la salle, l’oncle, entouré de quatre vieux bonshommes barbus, était déjà installé dans son fauteuil au haut bout de la table.
Tous les cinq portaient la blanche houppelande à capuchon par dessus leurs vêtements, et l’on sentait fort bien que cet habillement constituait pour eux un habit cérémoniel – j’allais dire liturgique – qui, par son seul endos, conférait aux paroles et aux actes de celui qui le portait un caractère sacré, comme l’étole et le surplis que revêtent les prêtres dans l’église avant de remplir les devoirs de leur ministère.
– Ah, voilà mes jeunes gens ! Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec ce vieux bavard d’André, qui a dû vous raconter ses histoires... Parfait, parfait, ajouta-t-il en échangeant nous sembla-t-il un regard complice aveu le nouvel arrivant.
Mes chers amis, j’ai enfin le plaisir de vous présenter mes neveux : Lucienne, Paul, qui, je l’espère, compteront, avec votre permission, parmi les nôtres.
(Le premier, un grand vieil homme sec, à peine voûté, nous tendit la main.)
– Le père Mathieu, notre médecin botaniste, qui réussit à conserver chacun de nous en bonne santé jusqu’à l’heure d’aller rendre ses comptes au Créateur. Il a toujours pensé que nous avons bien le temps, puisqu’Il a, Lui, l’Éternité. Le père Mathieu aura cent ans le mois prochain.
Le Père Jacques, maître des Rites ; il ne parle pas beaucoup, mais pense que si le Seigneur Jésus a changé l’eau en vin, c’est que ce liquide est la meilleure boisson qui convienne à ses disciples, aussi l’honore-t-il tout particulièrement.
(Le père Jacques, dont les yeux sombres frappaient étrangement dans un visage au teint fleuri, esquissa chaque fois de trois doigts un geste de bénédiction au dessus de notre main avant de la serrer.)
– Le Père Jean, maître des études sacrées, notre benjamin. Il enseigne notre science et nos traditions à ses élèves avec la même patience et le même amour qu’à ses propres enfants. Il en a une soixantaine...
Comme Lucienne considérait curieusement ce patriarche – personnage menu au doux visage – celui-ci, captant sans doute la pensée de ma femme, interrompit mon oncle :
– Ne vous scandalisez pas, nous ne sommes nullement polygames, et la fidélité conjugale est chez nous une règle absolue. J’ai eu 7 filles et 4 garçons qui, sauf une morte en bas âge, m’ont donné 52 petits-enfants. De ceux-ci je n’ai encore que 9 arrière-petits-enfants. Mais deux de mes fils ont été tués en 14 et en 17 ; deux autres fils puis sept de mes petits-enfants sont partis eux aussi – l’un d’eux tué en Alsace en 40. Il y en a donc bien 60 comme vous le disait le grand-père tout à l’heure. Plus 6 gendres et 4 brus...
Et d’un geste tout naturel, le Père Jean nous embrassa tous les deux.
– Enfin, reprit l’oncle Louis désignant un vieillard complètement chauve mais dont la barbe hirsute et les sourcils broussailleux semblaient vouloir recouvrir les lunettes, le Père Charles, notre historien, à la mémoire infaillible. Le seul qui connaisse toute la vie de notre pays depuis ses origines. Il pourrait, s’il le voulait, réfuter toutes les Histoires de France depuis Grégoire de Tours jusqu’à Malet...
– Ça ne servirait à rien qu’à me mettre en colère ! gronda le Père Charles... ils ne me croiraient pas !
– Mais... ajouta mon oncle qui n’omettait jamais de glisser une malice... Je ne sais pas s’il a entendu parler de Christophe Colomb !
– Je ne vous présente pas le Père André, notre Prieur, dont la connaissance des lois de la Matière est telle que le bon Dieu serait obligé de le consulter s’Il venait à les oublier.
Maintenant, à table, mes bons amis... (et, désignant le siège à sa droite)... ma Nièce, voulez-vous me faire l’honneur...
Lorsque chacun eut occupé sa place fixée selon les règles d’une étiquette assez curieuse, les deux bouts furent occupés par l’oncle Louis et le Père André se faisant vis à vis, Lucienne et la cousine Hermance encadraient le « Grand-Père », le Prieur m’avait à sa droite évidemment en qualité d’invité, le centenaire père Mathieu à sa gauche, puis le père Charles l’historien, le père Jacques, maître des Rites à la droite de mon épouse, tandis que le patriarche aux 60 descendants, toujours souriant, s’asseyait à ma droite. Entre Hermance et lui, restait une place vide que vint occuper Philippe quand les soins du service lui en laissaient le loisir. La cousine s’occupait de son grand-père, et sans qu’il y parût, le faisait manger.
– Ne pouvant me lever, je prierai votre Sérénité de bien vouloir prononcer la bénédiction, s’excusa mon oncle.
Levant les paumes au ciel, le Père André prononça en une langue inconnue l’invocation sacrée, puis Philippe lui présenta successivement sur une serviette blanche le pain doré, puis les assiettes d’étain garnies de hors d’œuvre qu’il bénit tour à tour les mains étendues, les gobelets enfin pareillement remplis de vin et d’eau, que le serveur allait ensuite déposer devant chacun des convives en murmurant : « De la part de Dieu. » Tous pendant ce temps, demeuraient immobiles, les mains en croix sur la poitrine.
La bénédiction achevée, chacun prit un morceau de pain dans la corbeille, s’en signa, répondit dans la même langue incompréhensible pour nous et s’assit.
– Vous devez, Madame, vous demander quel étrange idiome nous employons dans nos prières, prononça le maître des Rites voisin de ma femme : c’est la langue celtique ancienne, l’une des plus vieilles du monde, dont le breton et l’irlandais modernes diffèrent autant que le grec moderne d’avec la langue d’Homère.
– J’ignorais que le celte antique fut encore employé de nos jours, fut-ce comme langue liturgique, mais ce que j’ai trouvé de plus émouvant, mon Père, c’est votre bénédiction des aliments si expressive que mon mari et moi pensions revivre la Cène.
– C’est elle-même, ma chère dame, et l’oraison qu’a prononcée notre Révérend Prieur est tout simplement l’oraison dominicale.
– Mais alors, s’inquiéta Lucienne, nous venons de communier, là, comme ça !
D’un même cri, les assistants protestèrent :
– Mais pas du tout ! ceci n’est que la bénédiction des aliments, et non point la Communion réservée au Saint Sacrifice !
– Ah bien ! fit-elle sans plus insister.
Mais le Père Jean, devinant que nous n’osions point poser les questions qu’ils attendaient :
– Je crois que vous n’êtes pas très versés l’un et l’autre en théologie ni en liturgie.
– Je vous avouerai, mon Père, que nous ne sommes l’un et l’autre que des catholiques... assez... nominatifs !
Avec des expressions diverses, les visages des cinq « Pères » se tournèrent vers notre oncle qui mastiquait difficilement.
Un silence se fit pendant que l’aïeul s’efforçait d’avaler la bouchée de pain que lui avait préparée sa petite fille.
C’était évidemment de ses lèvres que devait tomber notre arrêt...
– Des catholiques nominatifs... répéta-t-il, nous scrutant de ses yeux gris, mais nous n’avons pas été autre chose ici pendant onze cents ans !
– Mais alors, qu’étiez-vous donc ?
– Des Druides, prononça gravement le Père André. Et si notre collège a dans son ensemble adopté le Christianisme dès le premier siècle, jamais ceux qui ont soutenu Vercingétorix contre César n’ont accepté de se plier devant Rome.
– Et pendant dix-huit siècles vous avez réussi à vivre ainsi repliés sur vous-mêmes, à recruter des adeptes, former et initier les maîtres, et conserver intacts vos rites et vos traditions ?
– Ne vous ai-je pas dit tout à l’heure que jusqu’à Louis XIV tous les rois de France ont connu notre existence et nous ont soutenus comme nous les avons soutenus dans leurs luttes contre l’immixtion étrangère, qu’elle fût d’ordre spirituel ou matériel, depuis les Romains, les Huns, les Arabes, les Anglais, jusqu’aux Allemands d’aujourd’hui.
– Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! Mais si nous avons pu maintenir presque intacts pendant près de deux millénaires nos croyances, nos rites et nos traditions, c’est grâce à ce faisceau de courants telluriques qui se rejoignent ici et que nous savons encore utiliser pour nous isoler et nous défendre.
Seuls sont venus ici ceux qui pouvaient ou devaient y venir, dans les artères desquels coule notre sang et qui adoptent notre foi.
– Mais comment pouviez-vous, mon Père, concilier le Druidisme avec la règle de Saint-Benoît, et faire admettre votre communauté à la fois par l’Église et la Monarchie française de rois très chrétiens ?
– Je ne puis entrer ici dans l’histoire de l’adhésion du collège druidique à l’évangile du Christ apporté en Gaule par Saint Jacques, frère de Jésus, cela nous entraînerait beaucoup trop loin.
– Je me réserve d’ailleurs d’informer mon neveu de la question, interrompit l’oncle Louis.
– Parfait ! Vous apprendrez donc comment nos très anciens prédécesseurs ont su trouver dans le Christianisme naissant une arme efficace pour abattre la puissance romaine, qui, au nom du dogme de l’Empereur-dieu, opprimait les antiques religions basées sur la connaissance des phénomènes naturels, que d’aucuns appellent Magie, s’ans savoir exactement ce que c’est.
L’Empire romain abattu en 476, c’est vers Clovis que se tournèrent nos espoirs de reconstitution d’un grand empire unissant en son sein : Gaulois, Francs, Burgondes et autres peuples de parenté celtique, capable de défendre notre sol du Rhin aux Alpes. Mais une fois encore des dissensions intestines firent s’écrouler le royaume de Clovis, et avec lui l’unité doctrinale du Druidisme. Trois siècles d’anarchie s’en suivirent au cours desquels s’opposèrent confusément rois et soldats d’aventure soutenus ou combattus par l’Église.
En fait, les communautés religieuses étaient assez indépendantes puisqu’il n’existait plus de centre initiatique capable de former des prêtres dans le sens que nous attachons à ce mot : c’est-à-dire des hommes instruits des mystères de la nature et capables d’en manœuvrer les forces invisibles comme de reconnaître et d’instruire les jeunes gens dignes de recevoir l’enseignement.
– La nécessité, coupa le Père André, de se grouper dans le silence et la paix fut à l’origine de la création des ordres monastiques, dont les cloîtres s’élevèrent sur les lieux mêmes de nos anciens temples.
L’unité fut une fois encore scellée en face du danger de l’Invasion arabe, et toutes les forces invisibles furent mises au service de Pépin qui, avec une petite armée, mit en déroute Abd el Rahman près des lieux saints de Poitiers, l’un des centres nerveux de la Celtique comme l’est Perrière.
Mais son fils Carloman, poussé au pouvoir suprême, se laissa prendre au piège du pontife romain qui lui donna l’investiture en échange de son appui, et réussit à créer un éphémère empire. Cela aboutit à la création, à nos frontières, de ce monstre : le Saint Empire Romain Germanique, qui succéda à Charlemagne.
Comme nous écoutions le curieux exposé du savant père Charles, mon voisin, le malicieux père Jean, crut devoir observer :
– Je ne sais pas si ce sont les histoires de mon ami Charles qui vous coupent l’appétit ou si c’est ce poulet qui ne vous dit rien, mais il me semble que vous ne suivez guère l’exemple de notre orateur qui, malgré son âge, n’en perd ni le boire ni le manger !
– Je m’émerveille en revanche, ma cousine, de l’excellence des volailles de Perrière !
– Leur chair a une saveur et un grain... s’empressa d’ajouter Lucienne, et il faut que mon mari, un peu gourmand, soit bien captivé par l’intéressant exposé du père Charles pour n’y avoir pas encore touché !
– Les poulets ici sont nourris à la farine de glands, et quand vous me ferez le plaisir de m’accompagner dans ma basse-cour, je vous ferai soupeser quelques-uns de mes élèves ; vous constaterez qu’ils pèsent, à taille égale, une livre de plus que les volailles élevées aux grains. Maintenant, pour le goût, vous pouvez mieux en juger que nous qui ne mangeons ici que poules et cochons nourris de glands.
– C’est fameux ! crus-je devoir observer.
– Eh bien, mes enfants, vous en emporterez, Car la nourriture du celte, du gaulois, avait pour base le blé et le gland, comme les orientaux ont conservé le riz. Manger et boire les produits naturels du sol sur lequel nous sommes nés, voilà le secret de la santé et de la longévité que compromet l’ingestion d’aliments inadaptables à notre climat et à notre race...
– Et, reprit le père Charles... vous en arrivez au point où tout à l’heure mon ami Jean m’a coupé la parole sous prétexte que mes discours empêchaient nos hôtes de manger le poulet de notre excellente Hortense !
– Voilà donc un poulet qui nous aura fait faire du chemin, conclut le père André tandis que Philippe, sur un signe de mon oncle, débouchait d’honorables flacons couverts d’une vétuste poussière.
– Goûtez ce vin, ma chère nièce, il provient de chez nos frères de Bourgogne – où se trouve un groupement de fidèles analogue à celui-ci. Ce sera pour moi la dernière fois que j’en boirai en cette vie, mes chers amis. Je me réjouis de le faire en votre compagnie, espérant qu’à mon retour ici-bas je retrouverai notre bon vin de France, et des adeptes plus nombreux de nos antiques traditions, avec lesquels je choquerai mon verre avec beaucoup de plaisir.
J’aurais voulu par politesse protester contre cette affirmation de mon oncle touchant sa fin prochaine, mais je constatai que personne ne le fit. Tous semblaient accepter cette annonce comme celle d’un voyage décidé avec espoir de retour à plus ou moins lointaine échéance. Chacun donc levant son verre plein du liquide vermeil rendit raison au moribond, sans que nul ne se départît de la même gaîté paisible qui était celle de « Leurs Sérénités ».
Philippe découvrit alors le pâté en croûte doré, orné de motifs imprimés dans la pâte et, sur l’invitation de notre oncle, ce fut ma femme qui la première y porta le couteau.
– Servez-vous, ma chère Lucienne, et soyez assez aimable pour faire passer... Oui, c’est la coutume ancienne : chacun se sert à son appétit : c’est l’affaire de l’hôte de prévoir que le dernier n’eût point à manger que les miettes...
Le pâté était de belle taille, mais quoique encore vigoureux pour leur âge, l’appétit des vieillards de Perrière s’en contenta d’une moitié.
Déshabitués depuis deux ans de pareilles agapes, ma femme et moi n’eûmes cette fois pas besoin d’être rappelés à l’ordre pour faire honneur à ce mets dont jamais je ne pus deviner la composition... gibier de poil ou de plume. Je n’osai point le demander... mais c’était bon.
– Puis-je vous prier, mon père, de bien vouloir nous continuer l’intéressant exposé que vous aviez entrepris de nous faire tout à l’heure sur une question historique qui nous est totalement inconnue ?
– Je veux bien, moi mais je n’aime pas être interrompu, bougonna l’historien à l’adresse de son vis-à-vis.
– Je n’ouvre plus la bouche qu’en l’honneur du repas, si artistement cuisiné par notre sœur Hermance !
Les autres vieillards ayant opiné favorablement, le père Charles poursuivit :
– Notre réorganisation, qui devait durer intacte jusqu’en 1792 et se poursuivre sans grandes modifications jusqu’à nos jours, date de 1088, quand Pierre de Brueys (grand druide des Gaules) s’éleva contre la prétention du pape Grégoire VII de faire élire le souverain pontife de la chrétienté parmi le seul clergé romain et de soumettre à son obéissance tous les princes chrétiens. Le Césarisme, contre lequel nos pères avaient lutté mille ans auparavant, ressuscitait au moment même où Byzance, fort de sa tradition apostolique, se séparait de Rome (1054).
Pierre de Brueys souleva la Savoie, le Languedoc en prêchant un christianisme apostolique conforme à nos traditions mais pauvre, heurtant les intérêts des riches abbayes, des évêques, des seigneurs ; il devait bientôt succomber dans la lutte inégale [2]. Dans le même temps Henri de Lausanne, puis Pierre de Vaux, répandirent avec le plus grand succès l’évangile ascétique en Lorraine, et dans tout le Sud-Ouest, où leur mouvement se confondit avec une autre doctrine prêchée en Bulgarie, puis dans les Balkans, celle des Cathares.
– C’est ainsi, interrompit mon oncle, que le fondateur de notre famille est venu du Bouchet en Savoie porter la réforme dans le Poitou où il fit souche.
– Les collèges druidiques du Centre et du Nord de la France surent heureusement tenir leur activité secrète et se dissimuler sous la robe de bure des Bénédictins, dont ils utilisent l’organisation, grâce à Benoît d’Aniane. C’est ce Benoît là que nous révérons comme le Saint fondateur de l’ordre, et non le Benoît italien fondateur de l’abbaye du Mont Cassin.
Notre centre initiatique principal passa au cours des siècles de Cîteaux à Clairvaux, puis enfin à Lagny, grâce à l’appui du Cardinal de Guise en 1612, et connut sous Richelieu son apogée. À ce moment nous pûmes penser que l’Église Gallicane allait enfin triompher et sceller définitivement la paix entre catholiques et protestants parmi lesquels se trouvaient partagés nos derniers fidèles. L’un des nôtres, Auger Ferrier, instruit de nos mystères, fut le médecin et astrologue de Marie de Médicis [3]. Le premier, il osa consigner ces clefs dans un livre paru en 1582 à Lyon, et dont nous possédons ici l’édition originale avec le texte complet.
Pierre de Brueys proscrivait le culte des images, et en particulier l’adoration de la Croix, estimant que cet instrument de supplice sur lequel fut sacrifié Jésus ne pouvait être qu’un symbole d’infamie ; tandis que la Croix Celtique recèle, d’après ses chiffres de construction, la clef de tout un enseignement ésotérique.
– N’était-il pas contemporain du fameux Nostradamus ?
– Si, et je vois où vous voulez en venir ; mais je ne pense pas à rapprocher leurs œuvres. Michel Nostradamus n’était pas des nôtres et disposait d’autres procédés, au moyen desquels il écrivit les fameuses et incompréhensibles Centuries ; et il mourut en 1566.
– Quelle mémoire, mon père ! Peut-être qu’en étudiant les dates, suivant le procédé de Ferrier, redécouvrirait-on la clef des prophéties ?
– C’est fort possible !
– En tout cas les Valois peuvent se flatter d’avoir été bien renseignés !
– Ils l’ont été... Et ce furent les plus belles années de la grandeur française. Malheureusement, nos rois devenaient étrangers... Des mariages politiques avaient altéré la pureté de leur sang : Henri IV épousa une Italienne : Marie de Médicis, mère de Louis XIII, et celui-ci Anne d’Autriche. Que restait-il de sang français dans les veines de Louis XV qu’il pût transmettre au fils né de son mariage avec Marie Leczinska, une Polonaise ?
Aussi Louis XV fut-il le premier roi de France qui ne fut point initié aux mystères de Perrière.
Sous le règne de Louis XV, l’un des neuf grands druides fut nommé, par bulle spéciale du pape, de l’abbaye de la Trappe (ordre de Cîteaux) à la dignité de prieur de l’abbaye de Lagny, en 1763.
– Comment cela, puisque le pape...
– N’en demandez pas trop... un de nos amis, dont vous connaissez les œuvres, n’a-t-il pas dit qu’il est avec le Ciel des accommodements ?
Don Bonaventure Guyon put donc, dans ce couvent proche de Paris, recevoir et renseigner les personnalités les plus influentes de la Cour grâce aux clefs des destins qu’il possédait et surtout grâce à ses dons de divination et d’interprétation.
À plusieurs reprises il informa le Roi de la gravité du Destin qui menaçait la royauté, s’il persistait dans son genre de vie et dans sa politique.
Une première fois les bavardages indiscrets de Mgr de Bossuejouls de Roquelaure, évêque de Senlis, éveillèrent envers le prieur de Lagny le ressentiment de Madame Dubarry, contre laquelle il tentait de mettre le Roi en garde.
Ce fut Mgr de Rohan, un mécréant d’ailleurs, qui fut chargé de l’enquête. Il vint à Lagny, interrogea don Bonaventure avec mission de le relever immédiatement de sa charge et de le faire interdire sous la terrible inculpation de Satanisme et de Magie.
Le prieur des Bénédictins put démontrer à l’inquisiteur royal qu’il n’y avait rien dans ses procédés d’investigation du Destin qui sentît le Diable, puisqu’aussi bien nous n’y croyons pas ; et c’est en amis qu’ils se séparèrent.
L’année suivante, 1774, les prédictions de notre père Guyon étaient réalisées : le roi était mort et Louis XVI montait sur le trône. Mgr de Rohan, devenu premier aumônier du Roi et conseiller d’État, revint consulter le prieur de Lagny sur l’avenir du nouveau règne.
– « Le Roi se garde d’être mis à mort par sentence judiciaire avant quarante ans. »
– Mais, s’indigna le premier aumônier, on ne condamne pas les souverains à mort ?
– Souvenez-vous de Charles Stuart ! Du reste, Monseigneur, voici l’horoscope de Mgr le Dauphin tel que je l’ai établi l’an dernier après votre visite. Et point par point, dom Guyon expliqua au prélat le principe de l’horoscope d’après les règles immuables des mathématiques célestes dont il consentit à lui dévoiler le mécanisme.
Atterré, le Cardinal de Rohan demanda :
« Mais comment le Roi pourrait-il échapper à cet affreux destin ? »
– Nous allons essayer d’un autre procédé pour vérifier le sinistre présage : Voulez-vous, Monseigneur, écrire sur cette feuille de papier les noms et qualificatifs de Sa Majesté ?
Le conseiller d’État écrivit :
LOUIS SEIZE AUGUSTE DUC DE BERRI, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.
Le prieur contempla ce texte, puis, biffant les lettres, il les retranscrivait au-dessous en un ordre différent. Il contempla son œuvre et, la plaçant sous les yeux du cardinal :
« – Regardez ces lettres, Monseigneur, elles traduisent elles-mêmes le sort du prince :
DE LOUIS « SEIZE » NAVRERA ET DÉCIDERA DE FUNESTE AUGURE.
Ce qui veut dire que le nombre 16 indique son sort, et XVI est l’arcane du Tarot qui s’exprime par « TOUR décapitée » !
Mais il reste quatre lettres inemployées, je les traduis :
DONC CONDAMNATION BOURBON ROI.
Certains de nos pères préféraient employer le latin, plus concis, pour ces lettres isolées... mais je n’ose...
« – Parlez, je vous en conjure :
– DAMNATUR CAPITE BELLI REUS [4]. Faut-il vous traduire ?...
– Mais comment sauver le Roi ?
– En le persuadant d’abdiquer. Le présage concerne davantage le Roi Louis XVI que l’homme.
– Vous êtes fou !
– Puisque vous me parlez ainsi, souffrez que je considère cet entretien comme terminé, répliqua sèchement le prieur.
– Vous savez quelles accusations ont l’an dernier pesé sur vous, Monsieur le prieur ? voulez-vous que s’y ajoute celle de comploter contre le Roi ?
– Je n’ai rien à ajouter, Monseigneur, nous sommes entre les mains de Dieu. Craignez plutôt pour vous qui refusez d’en écouter les avis... votre destin à vous aussi est en jeu...
Furieux, le cardinal remonta en voiture... Quelques jours plus tard, un officier de la maison du Roi, muni d’une lettre de cachet, venait arrêter dom Guyon pour le conduire à la Bastille, où pendant quinze ans il eut tout le loisir de méditer sur le danger d’avertir les puissants de la terre des coups que leur réserve le sort.
Enfermé dans la Tour de la Bertanderie, au secret, le prieur des Bénédictins n’en sortit que délivré par l’émeute du 14 Juillet 1789.
Philippe profita de l’intermède pour desservir et passer la salade qu’il avait préparée pendant que nous écoutions l’intarissable historien.
– Vous serez peut-être surprise du goût de notre huile, ma cousine, celle-ci provient des fruits qui vous ont intrigués hier sur notre plateau... ils ne poussent d’ailleurs que là.
– En effet, je n’ai jamais vu de plantes semblables.
– Et vous n’en trouverez mention dans aucun livre de botanique.
– Ce serait pourtant intéressant de cultiver – en ce moment surtout – une plante oléagineuse qui fournit déjà des fruits utilisables sans aucune espèce de soins ? observa Lucienne.
– Elle a en revanche d’autres propriétés que nous estimons pouvoir être nuisibles...
– Ah !
– ... Voyez-vous, chère Madame, reprit le père Jean, nous qui vivons en dehors du siècle – je dirais presque en dehors du temps – nous avons toujours soigneusement observé les propriétés de chaque plante, de chaque minéral, avant d’en préconiser l’emploi... et bien souvent nous nous sommes abstenus de répandre telle ou telle découverte, jugeant que la peine qu’elle causerait aux hommes dépasserait pour eux les avantages qu’ils en retireraient.
– Par exemple, mon Père ?
– L’or, puis le diamant. Le charbon naguère, le pétrole aujourd’hui, pour l’extraction desquels des millions d’hommes subissent l’esclavage, peinent, ou luttent et meurent pour les conquérir, les arracher de la terre où les dieux bienfaisants les avaient cachés. Leur possession est à l’origine des grandes agglomérations industrielles génératrices de misères, de haines, et en fin de compte des carnages perfectionnés de ce siècle que les parties en présence s’essaient à justifier par des noms sonores et vides. Pauvres hommes, pauvres enfants qui jouez avec le Feu, pauvres fous !
– Les guerres de la Révolution et de l’Empire qui ensanglantèrent l’Europe pendant 25 ans ne furent pourtant pas des luttes d’intérêts économiques ?
– En êtes-vous bien sûrs ? Pour nous, qui avons suivi avec attention le processus de l’enchaînement de ces conflits depuis la guerre de 7 ans qui opposa l’Angleterre à la France dans l’Inde jusqu’à Waterloo, en passant par la campagne d’Égypte, nous en sommes beaucoup moins certains ! Savez-vous que ce fut cette expédition qui détermina Bonaparte à briguer la couronne Impériale ?
Stupéfait, je considérai le père Jean, dont les argumentations imprévues, tant en leur exposé qu’en leur dénouement, ne laissaient pas que de me prendre au dépourvu.
– Très curieux... enchaîna notre savant historien, l’on a beau par des digressions variées s’éloigner de l’histoire de Perrière que je vous racontais, on y revient toujours...
– Quel rapport peut-il donc y avoir, mon père, entre l’Expédition d’Égypte, Perrière, et Napoléon ?
– Ne vous ai-je pas dit tout à l’heure comment le dernier prieur de Lagny fut embastillé 15 ans pour avoir tenté de mettre en garde le roi contre le Destin qui menaçait sa couronne ?
– En effet...
– Dom Guyon, libéré par la révolte du 14 Juillet, s’empressa de se soustraire aux manifestations tumultueuses organisées de toutes parts envers les quelques prisonniers délivrés – espions ou faussaires pour la plupart – et s’en fut ici même respirer l’air libre à l’ombre de nos vieux chênes.
Il avait alors 70 ans, et l’Abbaye de Lagny s’était dispersée. Il aurait pu terminer tranquillement ses jours parmi nous, faisant bénéficier ses confrères du fruit de ses longues méditations, dont il consigna de sa main les termes.
Il nous laissa les clefs de la Loi des Nombres qui permet de comprendre l’enchaînement hermétique des faits et des dates.
Ayant rétabli sa santé, dom Guyon, effrayé par les torrents de sang que faisait couler cette Révolution, voulut se rendre à Paris pour mettre en garde les dirigeants de la France contre les périls qu’il voyait s’accumuler. Sa qualité d’ancien prisonnier de la Bastille, son grand âge, lui étaient sûrs garants pour se faire admettre en audience auprès des autorités... Mais, considéré comme fou par les gens de l’époque incrédules ou ne voulant pas paraître accorder un semblant de créance à des méthodes suspectes d’obscurantisme et de superstition, il fut partout éconduit. Confiant dans le rôle qu’il se croyait attribué par la Providence, dom Guyon s’obstina à rester à Paris, où il loua un sordide logement 15 rue de l’Estrapade, y donnant à des prix misérables des consultations aux boutiquiers.
Le mercredi 12 Août 1795, un jeune homme assez pauvrement vêtu vint le consulter sur son avenir :
« Dans cinq ans, vous serez le maître de la France – et avant dix ans toute l’Europe sera à vos pieds », lui prédit dom Guyon, après avoir dévoilé à son interlocuteur stupéfait les règles fondamentales des mathématiques célestes sur lesquelles il basait son horoscope.
Incrédule, le jeune homme partit sans avoir voulu révéler son nom ; mais le père Bonaventure crut devoir informer notre communauté de la découverte qu’il venait de faire : celle de l’Homme qui relèverait l’Empire gaulois.
La même année, la victoire remportée le 13 Vendémiaire par les républicains sur les royalistes révélait la personnalité de l’officier inconnu.
– Mais que fait l’Égypte dans tout ceci ?...
– Nous y venons. Trois ans plus tard, Bonaparte, qui avait sans doute oublié le devin consulté dans une heure de détresse, était en Égypte, général victorieux assiégé dans sa conquête, et se demandait comment sortir du tragique guêpier où il s’était fourré.
Ce fut l’un des membres de l’Institut d’Égypte, créé pour étudier sur place les vestiges de l’antique civilisation des pharaons, qui osa proposer au général en chef de s’entretenir avec l’un des prêtres d’Osiris découvert par lui dans les ruines d’un temple où officiaient encore en secret – devant de rares adeptes –, les hiérophantes de l’ancienne religion.
Point par point le mystagogue confirma la prédiction du prieur de Lagny.
– Un vieillard de mon pays m’a dit la même chose, à Paris en 1795 alors que, disgracié, sans emploi ni solde, je vendais mes livres pour manger.
– Retourne en ton pays, noble étranger, et retrouve l’Initié qui t’a fait ces révélations ; elles ne peuvent émaner que d’un tenant de votre antique religion, parente de la nôtre.
D’ailleurs je vais tenter d’entrer en communication avec vos prêtres. Le Lotus et le Gland sont symboles équivalents.
– Et cet hiérophante a pu...
– Tous les initiés aux vérités éternelles peuvent converser entre eux à travers le temps et l’espace.
De Perrière à Memphis, sur les ondes invisibles, les pensées s’échangèrent. Bonaparte fut mis au courant de la situation lamentable où se trouvait la France, mais, sceptique, il se refusait à croire les renseignements que cet obscur survivant d’un culte périmé pouvait lui transmettre.
Pourtant, les nouvelles qu’il reçut de France, le 15 thermidor An VII (2 Août 99) par des journaux apportés par un aviso anglais, lui confirmèrent entièrement les dires du prêtre d’Osiris.
Convaincu alors, Bonaparte n’hésita plus. Le lendemain, en grand secret, il donnait ses instructions, partait pour le Caire, transmettait le commandement à Kléber, et, profitant du vent favorable qui éloignait les vaisseaux de blocus anglais, quittait l’Égypte le 7 Fructidor (24 Août 99), débarquait à Fréjus le 17 Vendémiaire (9 Octobre), arrivait à Paris le 17 Octobre, voyait les membres du directoire, recevait ses amis, ses partisans, et, décidé à renverser ce gouvernement incapable, se présentait le 16 Brumaire (7 Novembre) chez dom Guyon, qui l’attendait dans le même galetas de la rue de l’Estrapade.
Devant le général stupéfait, mais encore à demi incrédule, dom Bonaventure démontra le mécanisme des règles mathématiques dont il possédait la clef.
– Demain, 9 Novembre (18 Brumaire), vous connaîtrez le triomphe si une volonté obstinée vient à votre secours.
(Et vous savez comment il le dut à l’intervention de son frère Lucien.)
Puis il lui prédit l’attentat qui le menaçait (rue St-Nicaise), l’accession au trône en 1804, sommet de son horoscope, et fixa en 1808 l’année du Destin ; celle qui devait préjuger de l’avenir.
– C’est bon..., coupa Bonaparte avec sa brusquerie habituelle pour masquer son trouble. Il y a quatre ans j’étais trop pauvre pour honorer convenablement votre consultation, permettez-moi de m’acquitter aujourd’hui. Si vous avez encore dit vrai, votre fortune suivra la mienne. Puis il déposa une bourse d’or sur la table du savant.
– Je vous remercie, général, et pour vous témoigner ma gratitude, je vous prie de me poser par écrit telle question qu’il vous plaira. Veuillez écrire votre question sur ces cartons, ne mettant qu’une seule lettre sur chacun. Rapidement Bonaparte griffonna sur 113 cartons :
« Que deviendra le Corse Napoléon Bonaparte, Général par suite du coup d’État risqué par lui le dix-huit Brumaire mil sept-cent nonante neuf. »
– Vous y êtes... brouillez-les maintenant..., merci.
Voyez-vous, je place devant moi vos cartons en cercle et laisse errer mon regard sur eux. Dieu aidant, le sens s’en dégage.
Pendant quelques minutes, le père Bonaventure contempla ces lettres éparses, en modifia la disposition, et lut :
« En mil huit cent quatre il montera sur le Trône à Pique coupé en dix et un. Sera renversé par la canonnade du soldat d’Angleterre. »
– Que signifie ce trône à pique et coupé en 10 et 1 ?
– Les oracles ont ceci de particulier que leur sens demeure souvent obscur jusqu’à leur réalisation, mais je devine dans ce trône à pique quelque ascension due à l’année ; quant au 10 et 1, j’envisage une date : 11, par exemple... 1811, ou 11 ajouté à 1804, sommet de votre horoscope, nous renverrait en 1815, dont la dont la somme + 15, ou 1+8+1+5, exprime l’arcane de la Terrible Fatalité.
D’ailleurs il reste de votre phrase 13 lettres demeurées muettes qui, d’après les anciens augures, doivent former les initiales de treize mots qui éclairent l’oracle ; ce sont, voyez-vous, les cartons portant les lettres :
B O P P I A I B I P A U F.
– Que vous traduisez, Monsieur l’Abbé ?
– Bonaparte Offense le Pape Par Imperial Affront. Il Butte, Il Plie. Angleterre Use France.
– Nous verrons bien ! répliqua sèchement Bonaparte. Mais puisque vous êtes capable de traduire une pensée, je voudrais une contre-épreuve. Permettez-moi une seconde et courte expérience.
Sur 69 cartons, il écrivit : « Joséphine Marie Rose de Tascher de la Pagerie, femme du général Napoléon Bonaparte. »
Dom Guyon se recueillit longuement, et traduisit enfin avec consternation :
– Trop âgée ; le diadème impérial porté en son second mariage ne fera pas le bonheur.
– C’est stupide ! vos petits cartons sont d’une bêtise plus lourde que les Pyramides...
– Ils n’y sont pour rien, général, le destin emploie pour s’exprimer les moyens les plus humbles aussi bien que les astres du Ciel.
– En tout cas, je vous l’ai promis, si vous avez dit vrai pour le 18 Brumaire, je m’incline devant votre science et je ferai votre fortune.
Et toujours aussi brusquement, Bonaparte s’en alla.
Le prieur resté seul jeta un coup d’œil sur les 3 cartons demeurés sur la table et portant les lettres H. E. A.
Héros Empire Abdique
lut-il presque malgré lui.
Le premier consul devait tenir parole, et ce que vous savez déjà explique pourquoi le Moniteur du 31-12-1799 publie la nomination de M. l’Abbé Bonaventure au titre de Membre de l’Institut d’Égypte et le nomme aux fonctions de bibliothécaire des Tuileries, où il fut installé le soir même pour être constamment en mesure de renseigner le premier consul.
Les liens traditionnels entre le collège druidique de Perrière et la nouvelle monarchie impériale étaient renoués. Le Concordat signé le 15 Juillet 1801 rétablissait la liberté des cultes, et nous pouvions espérer, notre représentant le plus distingué étant devenu le conseiller secret du nouveau régime, voir nos traditions présider à la Renaissance de l’Empire celtique.
Auprès de dom Guyon, dont l’âge obscurcissait maintenant les merveilleuses qualités de devin, notre communauté désigna le meilleur des disciples de dom Bonaventure pour l’assister et continuer son œuvre. Il fut connu sous le pseudonyme de Pierre Le Clerc.
Un mois à peine après le couronnement que Napoléon voulut sanctionné par la présence du Souverain Pontife, mais non imposé par lui, dom Guyon, sortant un soir dans le jardin des Tuileries vêtu du manteau rouge dont il assurait que les rayons aidaient à ses facultés divinatoires, fut pris par une sentinelle pour un suspect et invité à circuler.
Le vieux prieur n’ayant pas obtempéré assez vite, et pour cause, – il atteignait alors 85 ans –, le soldat tira, blessa notre vénéré père Bonaventure, qui s’enfuit abandonnant sur place son manteau rouge.
À l’Empereur accouru il demanda d’être transporté ici où il mourut et fut enseveli selon nos rites.
De la découverte du manteau taché de sang, dont le propriétaire demeura introuvable, naquit la légende de l’« Homme rouge des Tuileries », génie familier de l’Empereur, qui persista longtemps encore après la chute de Napoléon.
Pierre Le Clerc, installé à St-Cloud par l’Empereur, nous tint par courriers réguliers au courant des évènements pendant ces années de gloire. Bien souvent il mit l’Empereur en garde contre ses ennemis, et plus souvent, hélas, contre ceux qui se flattaient de le servir. Mais Napoléon ne faisait plus à St-Cloud que de rares apparitions. Trop confiant en lui-même, en cette étoile (l’Étoile Royale du Lion) que dom Guyon lui avait montrée en 1795 comme présidant à sa naissance, il ne songeait plus, des quatre coins de l’Europe où l’entraînaient ses victoires, à consulter le bénédictin.
Près de s’éteindre, à 79 ans, Pierre Le Clerc envoya à l’Empereur comme un testament, une longue lettre dont le double figure ici dans nos archives. Et lui, le dépositaire des antiques secrets écrits en lettres de Pierre par nos ancêtres sur notre sol gaulois, prit la peine de mettre en garde son souverain, sur lequel se fondaient tant d’espoirs, celui qui aurait pu être le Messie humain de notre race, contre l’imminence des dangers qui menaçaient d’engloutir avec lui sa dynastie et l’avènement de notre 3e Empire.
– Le 3e empire ?
– Oui ! le premier fut fondé par Hû Gadarn 700 ans avant l’ère chrétienne et succomba sous l’invasion des Cimbres et des Teutons.
Le deuxième, fondé par Charlemagne, s’écroula au traité de Verdun !
– C’est vrai !
Philippe, prompt à saisir l’occasion de desservir sans interrompre la conférence de sa Sérénité le Père Charles, se hâta de changer d’assiettes et de présenter le fromage et les fruits, sans omettre l’apport de deux estimables flacons d’un très vieux vin sans étiquette qui me parut être d’Anjou...
– Mais alors, mon père, questionna Lucienne, Napoléon n’a pas écouté les ultimes avertissements du Père Le Clerc.
– Pour autant que nous le sachions, ce testament ne lui a jamais été remis. Peut-être fallait-il que les destins s’accomplissent ! Notre vénéré confrère suppliait l’Empereur de limiter ses conquêtes à nos frontières naturelles ethniques, qu’aucun conquérant ne peut dépasser sans heurt ni malheur ; il reprenait – ce qu’il y a de plus curieux – les prophéties formulées par dom Guyon 10 ans auparavant au moyen des cartons que l’ancien prieur de Lagny avait soigneusement rangés en deux paquets.
Soumettant les mêmes questions à une nouvelle étude, écrivait Pierre Le Clerc, je vois s’en dégager une nouvelle réponse plus sinistre encore que la première :
« Napoléon empereur vaincu en Europe, abattu, exilé, captif des Anglais par trop dur destin, ira mourir dans Sainte-Hélène, île de l’Océan. »
Les 10 lettres muettes :
Q U B R P T Q U U T
signifient selon la méthode augurale :
Qu’un Beau Règne Pacifique Triomphe Qu’Une Ultime Tempête.
Effrayé, Pierre Le Clerc, soumettant à notre chapitre l’oracle terrible, demanda des instructions pour régler sa conduite vis-à-vis du Condamné.
– Faites votre devoir jusqu’au bout vis-à-vis de l’Empereur. Notre rôle n’est pas d’empêcher les imprudents de tomber dans le précipice, mais de les prévenir du danger. Où serait donc la Liberté si chacun n’était responsable de ses actes ? Dieu ne consent qu’à nous éclairer sur leurs conséquences.
Pierre Le Clerc mourut, mais notre prieur – le Grand Druide – si vous le préférez, ne jugea pas opportun d’envoyer un nouveau messager en permanence auprès de la cour Impériale. Par une lettre personnelle il avertit seulement Napoléon Ier du danger qu’il y avait à s’attaquer au Pape lorsqu’il fit enlever le pontife pour le conduire à Fontainebleau. Nul ne porte la main sur un initié sans heurt ni malheur, lui écrivit-il de sa propre main.
– Je croyais, mon Père, que vous refusiez de reconnaître l’autorité du Pape ?
– C’est exact, mais il demeure un fait constant que tous les pontifes d’une religion : papes, grands-rabbin, dalaï-lamas, sont des initiés dont la personne est sacrée. Peu importe les rites qu’ils professent à leurs disciples. Nous vous l’avons dit, ce ne sont que des modes d’adaptation des vérités éternelles aux tempéraments des peuples, suivant les contrées qu’ils habitent.
C’est là même le symbole de la pyramide ; partis des quatre points cardinaux, les quatre plans se rejoignent au sommet et cette construction ne forme pas d’ombre sur le sol.
Cet extraordinaire déjeuner se terminait lorsque soudain l’oncle Louis, qui somnolait depuis quelque temps déjà, s’affaissa, pris d’une syncope.
En hâte les convives se levèrent. Le Père Mathieu, médecin de la communauté, fit signe à Philippe, ma femme et moi, pour que nous l’aidions à porter le malade sur son lit. Il revint à lui, mais, sentant ses forces l’abandonner, demanda qu’on lui donne quelques gouttes de cet élixir conservé dans le flacon vert. Après avoir avalé un fond de verre du breuvage, un peu de force revint au vieillard, qui put ensuite s’endormir calmement [5].
CHAPITRE V
– Comment va notre ami ? Y a-t-il quelque espoir ?
Entourés dès notre retour dans la salle, harcelés de questions, nous n’osions donner, aux quatre pères anxieux, de bien rassurantes nouvelles.
– Il est tiré d’affaire pour l’instant, grâce à une énergique médication du père Mathieu qui, je crois, réveillerait un mort..., mais notre oncle a été secoué... il va reposer un peu...
– Ah oui ! la fameuse drogue verte... le remède préféré de notre vieil ami Mathieu.
– Raillez, raillez tant que vous voudrez, gronda le médecin, il n’empêche que sans ma tisane notre hôte nous aurait faussé compagnie avant l’heure qu’il a choisie – et vous, mon frère Jean, pouvez-vous rappeler que sans elle, il y a quelques années déjà que nous serions privés du plaisir de votre société...
Maintenant, mes amis, je vais vous prier de bien vouloir vous retirer. Louis va dormir trois heures – pas plus – car le Grand Sablier file, et j’entends qu’il soit en état de terminer la conférence qu’il veut avoir avec ses neveux. D’ailleurs, je demeurerai ici pour parer à toute éventualité et, ajouta-t-il en s’inclinant vers le père André, avertir, le moment venu, votre Parfaite Sérénité.
Nous sortîmes alors, accompagnant les vieillards qui, lentement se dirigeaient vers l’antique abbaye dont les vieilles pierres avaient, sous le soleil radieux, pris une teinte dorée nouvelle. Autour du clocher muet, des nuées d’oiseaux voltigeaient, s’élevaient plongeaient, dans un joyeux vacarme.
On eut dit que toute la gent ailée s’y donnait rendez-vous. Ma femme, le voyant, ne put s’empêcher de fredonner : « Tous les oiseaux du monde, y viennent faire leur nid... »
– Évidemment, répondit le père André, les animaux, et en particulier ceux dont une domesticité séculaire n’a point obnubilé leurs facultés de perception, ressentent avec intensité les courants d’énergie qui parcourent le monde invisible, celui que nos antiques légendes peuplaient de fées, de gnomes, de lutins, et dont l’ésotérisme échappe complètement aujourd’hui à des humains de plus en plus vains d’une science physique dont les bases leur échapperont tant qu’ils s’obstineront à chercher au fond des cornues ou dans le microscope les forces véritables qui mènent le monde.
– Sur ce point, je crois, mon père, que votre Sérénité retarde un peu, car parmi la nouvelle génération de savants, beaucoup admettent la présence invisible de cet Inconnu insaisissable qui renverse toutes les hypothèses scientifiques et qu’on nomme Miracle.
– Ce serait heureux, répliqua le père Jacques, que l’on comprenne enfin, que l’on veuille enfin comprendre que le « Miracle » n’est en somme que le violent coup de barre donné par une des Intelligences créatrices sous l’impulsion d’une Foi faisant en somme office de conducteur pour remédier à un état de choses vicieux qui compromet injustement la divine harmonie.
– Ce sera difficile à faire admettre.
– C’est le rôle de notre religion celtique de mettre les hommes de ce pays en communion avec les Forces naturelles qui en régissent l’activité visible et invisible. Nous n’avons pas, nous, successeurs des Druides, le désir de propager nos croyances hors des limites de la Celtique – autrement dit de l’Europe Occidentale, que nos ancêtres ont imprégnée de leur Présence sous la forme de ces monuments mégalithiques, relais ou transformateurs d’énergie.
– La sagesse est pourtant la même pour tous, puisque inspirée par Dieu !
– Voilà, mes chers amis, intervint le père Jean, où nous différons d’opinion. Que la Sagesse, la Loi divine, soit identique pour Tous, oui, puisqu’elle procède à l’Unité qui préside aux destins de l’Univers : Elle ne saurait cependant être interprétée de façon identique par les habitants des autres planètes, déjà si différents de nous que notre esprit ne parvient pas à les concevoir.
– Soit.
– Pourquoi voulez-vous qu’il en soit autrement sur cette Terre où vivent, en des conditions d’habitat très différentes, des races étrangères les unes aux autres par la pigmentation de leur peau, leur structure physique et psychique ? poursuivit le père Charles...
... Et nous, qui nous maintenons en rapport avec leurs centres initiatiques, lointains et secrets, pouvons affirmer que tels prodiges accomplis par les initiés de l’Inde, de la Chine, de l’Amérique ou de l’Afrique, ne sauraient être réalisés ici.
En Occident, c’est le Druidisme qui a charge de maintenir ce contact entre les hommes et le sol de notre Patrie dans l’acceptation la plus profonde, mais aussi la plus large de ce mot. Les invasions que notre pays a subies depuis 2000 ans ont complètement modifié l’Ethnie de ses habitants. Aussi les seuls qui soient restés fidèles à nos croyances sont des campagnards qui n’ont jamais rompu les liens naturels avec la Terre Celtique.
Aussi travaillons-nous dans le silence de Perrière à découvrir une présentation nouvelle de notre système philosophique, adapté à la vie moderne, qui a rebrassé en Occident plus qu’ailleurs les Êtres et les choses, créé ici des agglomérations qu’elle dispersait là.
L’heure est venue de divulguer certains de nos secrets touchant l’utilisation des forces rayonnant sur cette partie du globe pour éviter les cataclysmes auxquels nous courons, du fait d’apprentis sorciers qui, depuis 100 ans, s’efforcent de les manipuler et les contrarient à plaisir, comme des ignorants le feraient dans une centrale électrique, bouleversant fréquences et intensités, embrouillant les fils et tripotant au hasard boutons et leviers, jusqu’au court-circuit et à la catastrophe inévitable [6]...
– La guerre actuelle ?
Les quatre druides – puisque telle était leur véritable fonction – s’entre-regardèrent et ce fut Sa Parfaite Sérénité le Père André qui répondit en me fixant de ses yeux gris si pénétrants :
– La guerre actuelle... comme la précédente et bien d’autres calamités qui se sont abattues sur le monde...
Mais, mon ami, s’il était permis d’écrire l’histoire occulte de la Guerre actuelle et d’en révéler les conséquences, les hommes, épouvantés, détruiraient leurs machines et quitteraient leurs villes pour se réfugier dans les campagnes.
– À moins... conclut le père Jean de sa voix douce, qu’ils n’enferment comme fous les auteurs de ce terrible ouvrage !
Ou que les « libres » gouvernements des peuples « libres » ne les fassent disparaître...
– Comme le père Guyon, sous Louis XVI ?
– Par exemple... car, voyez-vous, mon ami, la faute impardonnable aux yeux des hommes de tous les temps, comme de tous les pays, fut d’avoir raison contre eux trop tôt.
Socrate, comme Jésus, Galilée comme Jouffroy et son premier bateau à vapeur – détruit par une foule stupide –, comme le fut la machine de Jacquard, en ont fait la douloureuse expérience.
– Votre Sérénité pense donc que dans X années l’astrologie et la radiesthésie, pour ne parler que de celles-là entre autres sciences encore contestées, seront devenues vérités officielles ?... et enseignées par les disciples de ceux-là même qui les nient aujourd’hui encore... enfonçant avec fracas devant toutes les académies réunies des portes ouvertes depuis des millénaires ?
– Parfaitement... Mais nous nous en voudrions, mes amis, de vous priver par nos discours de visiter un peu les alentours de notre abbaye, sans vous éloigner beaucoup, afin d’être dans trois heures auprès de votre oncle. Il y a près d’ici quelques vieilles pierres qui ne manqueront pas de vous intéresser.
– Vous voudrez bien nous excuser, Madame, mais nous avons à cette heure nos offices à réciter, expliqua le maître des rites. Mais vous trouverez à cinq cents mètres d’ici, dans le prolongement de l’abside, un rocher qui vous rappellera la Pierre aux Fées d’hier et une fois-là vous prendrez le sentier de gauche.
À tantôt, et bonne promenade.
Ainsi poliment congédiés, ma femme et moi contournâmes l’antique chapelle, passant à travers les ruines de constructions écroulées et, bientôt, nous étant engagés dans une laie ombragée par l’épaisse ramure des chênes, nous arrivâmes devant une grosse pierre affectant approximativement la forme d’un tambour et presque aussi haute que moi. Elle était située au milieu d’une sorte de rond-point d’où partaient en étoile un certain nombre de sentiers.
Lucienne et moi, qui avions jusque-là cheminé en silence absorbés par nos pensées, examinâmes curieusement le rocher qui, effectivement, ressemblait assez à la Pierre aux Fées. Rien apparemment n’y apparaissait digne d’attention.
Ce fut ma femme qui la première formula une remarque :
– Regarde donc, il n’y a pas un brin d’herbe autour de cette roche, la terre est sèche et dure, comme piétinée ou battue... C’est curieux, car on ne voit point de traces de pas...
Intrigués, nous tournions autour de la pierre, cherchant à en deviner le mystère, car si rien ne permettait de supposer qu’elle eut été apportée là de main d’homme, aucun indice géologique n’indiquait la provenance naturelle d’un bloc semblable...
Je sortis de ma poche ma boussole, et constatai aussitôt le complet affolement de l’aiguille aimantée qui tournait inexplicablement en tous sens.
L’appareil, posé alors sur la pierre, s’y comportait en revanche correctement, et, ainsi qu’une boussole bien élevée, indiquait une direction que rien ne put me justifier, puisque le soleil, caché par l’épais feuillage, ne pouvait nous fournir aucun repère géographique de contrôle.
Lucienne tout à coup poussa un cri de surprise : un lapin étourdi, traversant soudain la minuscule clairière, venait de la frôler et maintenant, assis au pied d’un arbre, à quelques mètres, semblait nous contempler avec intérêt. Comme, amusés, nous regardions la bestiole impavide, notre attention fut attirée par des bruissements de branches dans les buissons fort touffus déjà à quelques mètres du rocher, et, restant immobiles, nous vîmes bientôt deux, puis d’autres lapins encore montrer leurs oreilles, s’avancer même hors du couvert, puis, pas assez rassurés pour se risquer davantage, éclipser dans la futaie les lunes blanches de leurs petits derrières.
Là-haut, dans les chênes, la gent ailée menait grand tapage.
– Si nous ne voyons pas ici de traces de pas humains, la présence des lapins ne suffirait-elle pas à expliquer le piétinement du sol ?
– Il y a bien paraît-il, assure Kipling, des salles de bal pour éléphants... pourquoi n’y en aurait-il pas pour les lapins ? répondit ma compagne.
– Le Père André nous expliquera cela ; ce n’est évidemment pas pour rien qu’il nous a envoyés promener jusqu’ici... En tous cas voyons donc ce que fait le pendule en présence de cette pierre ?...
Tenant tour à tour l’objet en mains, nous constations que le pendule tournait à une vitesse folle, presque horizontalement, au bout de son fil, dans le sens positif, celui des aiguilles d’une montre, indiquant au-dessus de la pierre la présence d’un foyer de radiations intense.
S’en éloignant de quelques pas, ma femme ne put que constater une diminution de cette fréquence, et la clairière était trop petite pour qu’il nous fût possible d’y déterminer la longueur de son rayon d’action.
Pour le mesurer il fallait s’engager dans l’un des sentiers y aboutissant.
– Tu sais, Lucienne, que le Père Jean nous a dit de tourner à gauche !
– Eh bien, je tourne à gauche !
– Oui, mais le sentier de gauche par rapport à notre arrivée ! et nous sommes venus par celui-ci !
– Mais non, tu te trompes, le nôtre aboutissait en face de la pierre, entre deux chênes – et l’on en voyait un en face...
– Tu as raison, c’est pourquoi je te dis que nous sommes venus par là... et j’allai me planter à l’entrée du layon que je préconisais être le bon !
Ma femme se retourna dans celui où elle s’était engagée... Tous les deux aboutissaient en face de la Pierre aux lapins, entre deux chênes, vis-à-vis d’un troisième !
N’ayant pas observé les caractéristiques de ces arbres, il nous fut impossible de savoir entre lesquels nous étions arrivés, d’autant que quatre sur les cinq sentiers rayonnant autour de la roche mystérieuse présentaient les mêmes caractéristiques.
Perplexe, je cherchais à retrouver quelques indices de repérage tandis que ma femme, pendule en main, s’essayait à découvrir une orientation.
Mais dans n’importe lequel des cinq sentiers l’oscillation pendulaire ramenait toujours à ce foyer magnétique qu’était la Pierre aux lapins.
– Chérie, passe-moi donc le pendule, veux-tu ? demandai-je assez inquiet maintenant, voyant le temps passer sans pouvoir arriver à m’orienter.
Je pris l’objet sans trop savoir par quel procédé il me serait possible de lui arracher une réponse. Je fis quelques pas autour du roc :
– Ah ! ça par exemple c’est curieux !... vois donc, IL TOURNE EN SENS INVERSE !
– Mais toi aussi, tu tournes dans le sens opposé au mien !
– Alors les ondes ici changent de sens suivant qu’on tourne à droite ou à gauche ?
– Comme autour d’une lampe électrique [7] !
– Curieux ! de plus en plus curieux, observai-je. Mais ne nous voilà pas plus avancés sur le chemin à prendre !
– Puisque cette roche rayonne comme une lampe électrique, tâche donc de trouver la source du courant !
– Tu as vu toi-même qu’il n’y en a pas, car le foyer, la centrale, si tu préfères, est ici !
Comme nous nous regardions perplexes, hésitant sur la direction à prendre pour sortir du cercle magique, deux lapins se poursuivant traversèrent la clairière, et, rapides, filèrent dans l’un des sentiers.
– On suit celui-là ?
– Oui, car, remarque-le, Paul, c’est celui qui est le plus près à notre gauche... alors...
L’un suivant l’autre, nous pénétrâmes dans l’étroit chemin, mais bientôt rien ne nous permit plus de reconnaître l’existence d’une piste utilisée ; une épaisse couche de feuilles mortes recouvrait le sol comme un tapis spongieux que jamais les rayons du soleil ne parvenaient seulement à caresser.
Ces sentiers pourraient bien n’être que des passées de bêtes sauvages, dis-je, apercevant une harde de biches se couler sous les halliers, sans se presser, comme des animaux qui savent ne rien avoir à redouter de l’homme... La boussole consultée m’indiquait toujours l’Ouest-Nord-Ouest.
– Quand allons-nous arriver auprès de notre oncle ? Voilà près d’une heure et demie que nous avons quitté Perrière. Nous n’avons guère marché que depuis la Pierre magnétique, mais nous ne pouvons savoir si nous nous en éloignons ou non !
– Que dit la boussole ?
– Ouest-Nord-Ouest, mais la piste que nous suivons zigzague, et... je me méfie ici des indications de l’aiguille aimantée !
– Ah ! s’écria ma femme joyeuse, je retrouve un vrai sentier ; il y a même un tas de bois coupé... nous arrivons !
Nous arrivions, en effet... exactement à notre point de départ, à la Pierre aux lapins !
Découragée, ma femme se laissa choir par terre.
– Tu n’as pas idée que les Pères se fichent de nous, dit-elle, ou nous donnent une leçon pratique sur le terrain ?
– Repose-toi un peu, puis nous repartirons par le sentier de gauche ; celui-là ! fis-je en posant une branche à l’orée pour ne pas risquer de l’oublier.
– Nous repartons tout de suite ! décida mon intrépide épouse. Il faut sortir d’ici ! et ne pas arriver trop tard là-bas.
La laie dans laquelle nous nous engageâmes paraissait plus large que celles naguère suivies, bien que la futaie fût de chaque côté plus serrée et, partant, si obscure que l’aiguille phosphorescente de ma boussole toujours consultée brillait comme dans l’obscurité.
Près de vingt minutes nous marchâmes ainsi, presque en ligne droite, en direction Ouest, comme entraînés par d’invisibles puissances.
Inquiets toutefois, nous n’osions guère nous parler. La forêt en cet endroit était silencieuse comme une cathédrale, de mystérieux bruissements dans les fourrés indiquaient seuls une vie animale intense.
– Enfin une clairière ! cria ma femme joyeuse. Puis, aussitôt craintive : j’aperçois une pierre... pourvu que !
Mais cette fois nous débouchions bien sur une clairière, une vraie ! De forme circulaire, elle pouvait bien avoir 100 m. de diamètre. Au centre, sur un tertre, s’élevait un gigantesque dolmen.
La lumière dorée du Soleil, que nous n’avions pas vue depuis notre entrée dans cette obscure forêt, nimbait le mégalithe comme une auréole. La table, de forme circulaire, reposait à hauteur d’homme sur quatre pieds massifs.
Malgré sa rusticité, la fruste masse compacte de ce monument millénaire ne donnait pas une impression de lourdeur, mais d’une réelle et impressionnante majesté comme l’Arc de Triomphe.
À ses pieds, sur toute la place baignée de clarté, s’épanouissaient en un chatoyant tapis blanches collerettes de marguerites, boutons d’or, coquelicots, mauves, gentianes, liserons roses, qui apportaient à la pesante masse du Temple antique l’hommage de leur grâce vivante.
Tout autour de la clairière lumineuse, la sombre et grave ronde des chênes au brillant feuillage vert intense étendait ses branches noueuses vers le Dolmen, et toutes balançaient en son honneur, semblait-il, la touffe de gui rarissime, ainsi que de gigantesques encensoirs.
La clairière tout entière bruissait des mille chants d’insectes, tapis sous l’odorante verdure ou voltigeant de fleur en fleur, crissements d’élytres, bourdonnements, friselis d’ailes, qu’en savons-nous, humains, qui, de nos oreilles infirmes ne pouvons distinguer les partitions des millions d’exécutants chantant dans l’herbe l’hymne reconnaissant des génies de la Terre.
Impressionnés par cette beauté, nous nous étions arrêtés, émerveillés et timides, à la limite de l’ombre, comme indignes, n’osant fouler le parvis sacré.
Après quelques minutes de muette admiration, nous osâmes enfin, nous tenant par la main, nous hasarder dans le cercle lumineux, et lentement, comme avec précaution pour ne point troubler les invisibles choristes, nous montâmes vers le prestigieux monolithe qui dominait cette polychrome clairière.
Le dolmen était plus haut que nous, et nous pouvions, sans nous baisser, passer sous la gigantesque table ; mais, retenus par un obscur sentiment de crainte religieuse, nous n’osions pénétrer sous son ombre millénaire.
Machinalement, j’étendis la main, et touchai un des pieds énormes du vénérable monument. La pierre était chaude !
Lucienne, lisant ma surprise, fit le même geste et observa :
– Elle est chaude... comme une personne vivante. Et, s’asseyant par terre, adossée contre le dur granit, elle murmura : ... On y est bien.
– Alors, mes amis, vous avez fini par trouver notre Grand Autel ! prononça une voix sympathique, bizarrement amplifiée par la curieuse résonnance de ce temple ouvert à tous vents !
Stupéfaits, nous cherchâmes des yeux d’où sortait cet interpellateur invisible, qui poursuivit :
– Vous y avez mis le temps ; je vous avais pourtant bien dit, en partant, de tourner à gauche !
– Vous, père Jean ! s’écria ma femme, apercevant enfin le vieillard assis comme elle dans le clair-obscur du monument. Ah, tant mieux ! nous étions perdus ! Si vous saviez ce qui nous est arrivé !
– Mais je le sais, ma chère dame, vous avez tourné autour du « Tambour des Dieux », avez perdu la direction, et pris ensuite n’importe quel chemin, sauf le bon, le premier à gauche – et vous êtes revenus à votre point de départ, puis avez recommencé – deux ou trois fois – pour trouver enfin la bonne piste !
– C’est-à-dire, mon Père, que cela nous est arrivé une fois. Nous avons ensuite trouvé le bon sentier.
– Ah ! d’après le temps que vous avez mis, j’aurais gagé que vous aviez fait deux fois au moins la marche en rond autour du tambour.
– Non, une fois seulement, mais nous avons beaucoup observé cette pierre, ce « Tambour des Dieux », comme vous dites, que nous avions surnommée la Pierre aux lapins... et fait avec la boussole et le pendule des remarques bien intéressantes.
– Je n’en doute point, fit le maître des rites, nous observant de ses bons yeux gris, mais cela ne vous a pas empêchés de vous égarer !
– J’avoue que j’ai eu le sentiment désagréable d’être perdue, entraînée dans une ronde infernale...
– Par des Korrigans... suggéra le vieillard avec un sourire. Non, car ayant pris tout autre chemin que le premier à gauche, vous deviez fatalement revenir à votre point de départ jusqu’à retrouver celui-ci, le bon, le seul !
– Mais pourquoi cela ?
– Parce que cette pierre que nous surnommons le Tambour des Dieux est un nœud, un pôle, d’ondes telluriques qui tourbillonnent autour de cette pierre – pendant les heures solaires – troublant non seulement les boussoles, mais la baguette, le pendule, et le sixième sens des animaux : le sens de la perception qui leur fait retrouver leur chemin ; c’est pourquoi ils sont constamment ramenés à la pierre dont le phénomène de radiation est encore un mystère – même pour nous qui nous en servons.
Vous ne pouviez donc manquer d’être conduits fatalement ici, après avoir seulement peut-être été entraînés à faire trois voyages inutiles au Tambour des Dieux.
– Mais pardonnez-moi. Pourquoi ce sentier-ci échappe-t-il au tourbillon et conduit-il à ce beau Dolmen ?
– Parce que, mon fils, prononça le druide d’une voix grave, parce que ce dolmen est placé, lui, sur la ligne solsticiale (l’une des plus puissantes), à son intersection avec plusieurs de ces courants telluriques dont je vous ai parlé.
Vous êtes ici à ce centre de la Gaule dont parle César dans ses commentaires, où se faisaient, dans la forêt chartraine qui s’étendait alors jusqu’ici, l’élection de l’Archidruide, et la consécration des chefs suprêmes.
– C’est ici donc, mon père, fis-je avec respect, que Vercingétorix...
– C’est ici, mon fils, et c’est ici que de la Celtique naquit la Gaule ; c’est ici que Hû Gadarn, l’ancêtre des Gaulois, offrit son peuple à la Celtique ravagée, c’est sous cette pierre qu’IL repose !
Respectueux, nous admirions tous deux, recueillis, ce berceau inconnu de notre Patrie, gardé par quelques vieillards possesseurs des plus antiques secrets.
Puis, ma femme, songeant au vieux mourant qui attendait peut-être notre venue pour partir à son tour, posa sa main sur le bras du prêtre chenu :
– Pardonnez-moi, souffla-t-elle, mais il doit bien y avoir trois heures que nous avons quitté l’oncle Louis, et...
– Nous y allons de ce pas, seulement, j’avais voulu vous attendre ici, répondit le père Jean.
– Ce n’est donc pas loin ?
Le vieillard sourit encore, passa familièrement ses bras sous les nôtres, et marcha vers les chênes.
– Loin, non ! Ce n’est pas bien grand, Perrière, et pourtant ! fit-il, se retournant vers le Tombeau de Hû Gadarn massif et solitaire, et pourtant, c’est immense !
Dix minutes, un quart d’heure après au plus tard, nous étions tous au chevet de l’Oncle Louis.
CHAPITRE VI
Ce fut le cœur serré que nous frappâmes à la porte de l’oncle Louis. Nous étions en retard, et ni Hermance, ni Philippe ne paraissaient dans le jardin ni aux fenêtres closes de la vieille demeure.
Dans notre inquiétude, nous avions hâté le pas et quelque peu dépassé le Père Jean dont l’âge retardait la marche.
Maintenant, ayant heurté l’huis, nous attendions anxieux qu’on vînt nous ouvrir et nous rassurer sur l’état du vieil homme. Mais le silence le plus complet régnait dans la maison comme aux alentours... un silence de... le mot qui nous venait à l’esprit n’osait passer nos lèvres tandis que Lucienne et moi nous nous regardions émus.
Déjà le père Jean nous avait rejoints et, sans mot dire, passant entre nous, tourna le heurtoir, comme un bec de cane, poussa la porte, s’effaça devant ma femme, et, à notre mine devinant les sentiments qui nous agitaient, expliqua :
– Mais voyons, s’IL était parti, la porte serait ouverte !
Dans la pénombre de sa chambre lambrissée, le centenaire somnolait encore. Sa petite fille et le Père Mathieu, assis de chaque côté du lit, guettaient sur son visage de cire les premiers symptômes du réveil attendu.
Ni l’un ni l’autre ne tourna la tête à notre entrée. Le père Jean, qui, cette fois, nous précédait, esquissa de deux doigts un signe de croix en direction du mourant, prit un siège et s’assit en soufflant un peu, sans mot dire. Nous restions debout aux pieds du lit, contemplant l’étrange scène :
Trois personnages regardaient avec une parfaite sérénité un moribond, leur grand-père ou leur ami. Ils en attendaient, non point le dernier soupir, mais le réveil, comme une chose toute naturelle, prévue à ce point que déjà la bouteille contenant la boisson favorite de l’aïeul était prête. Ils ne semblaient douter que ce patriarche de cent-vingt ans, qui venait d’avoir une attaque et dont la mort était attendue, allait tout à l’heure réclamer un verre de vin, afin d’y puiser la force d’achever, avant le Grand Départ, la tâche qu’il s’était assignée.
Sentant peut-être notre regard peser sur son front, l’Oncle Louis ouvrit alors les yeux. Il porta son regard à droite et à gauche, sans presque bouger la tête, vit sa petite-fille, ses deux amis à son chevet, nous aperçut, dut juger que tout était bien ainsi, et sourit.
Quelques instants plus tard, le vieillard ayant bu son élixir, rafraîchi de quelques gouttes d’alcool sur les tempes, témoignait de son désir de poursuivre ses confidences.
Discrets, Hermance et les deux Pères feignirent d’être appelés ailleurs, et sortirent.
L’oncle aussitôt, comme un écolier débarrassé de ses maîtres, s’agita, se releva un peu, toussota et prononça à l’adresse de ma femme :
– Ouvrez-moi les volets... ils me priveraient de Soleil, pour mon dernier jour !
Puis à moi, avec un clin d’œil d’enfant gourmand :
– Donne-moi encore un verre !
Comme je le servais aussitôt, il regarda avec intérêt la lumière jouer dans le bloc liquide, et demanda :
– Combien en reste-t-il ?
Ma femme, connaissant le secret du placard, fit glisser le panneau de chêne, découvrit la cachette, et révéla :
– Plus que deux !
L’oncle, tout en dégustant son vin, parut faire un pénible calcul – puis décida :
– C’est plus qu’il n’en faut ; trinquez avec moi !
Il n’y avait pas à discuter. Je remplis deux autres verres tirés du placard, et nous en touchâmes celui du « grand-père », n’osant dire, en cette conjoncture : « À votre bonne santé ! » Celui-ci ne parut y prendre garde :
– À la vôtre ! dit-il simplement. Je regrette de ne pas vous laisser une cave comme le père de Chamou m’en a légué. Car il y avait encore de son temps les caves et celliers de l’Abbaye pleins !
– Il y a longtemps qu’il est mort ?
– Il nous a quittés en 71. C’est depuis cette année-là que je suis resté ici... Je vous ai raconté ce matin comment il m’était arrivé de tomber ici, et tomber fut effectivement le mot...
– Oui, mon oncle, crut devoir aider Lucienne, vous nous avez dit comment Mademoiselle de Chamou vous avait conduit ici auprès de son père.
Un moment le vieil homme baissa les paupières, revoyant ainsi sous leur abri ces lointaines années... puis il commença :
– Ce fut en bavardant joyeusement, telles de vieilles connaissances, que Mlle de Chamou et moi arrivâmes à l’entrée de l’avenue que vous connaissez, et qui représente à elle seule toute l’agglomération de Perrière.
– Attendez-moi là, me dit-elle en m’arrêtant à l’ombre des derniers arbres, je vais prévenir mon père.
Et elle s’envola.
Mes yeux étaient encore pleins d’elle que déjà la jeune fille reparaissait, accompagnée d’un grand et bel homme à peine grisonnant, portant la forte moustache et les pattes des soldats de l’Empire, la culotte et les guêtres d’un homme habitué à marcher en tous temps par les plus mauvais chemins. Une redingote à jupe à la mode ancienne, qu’il était en train de boutonner, témoignait à la fois du souci de correction avec lequel Monsieur de Chamou tenait à accueillir le visiteur inconnu que venait de lui annoncer sa fille.
Le père de Lysiane s’arrêta à quelques pas de moi, me dévisageant avec quelque surprise, me sembla-t-il, tandis que sa fille me présentait.
– Ainsi vous êtes, monsieur, l’ingénieur chargé de faire passer un chemin de fer par ici ? se décida-t-il à prononcer en me tendant enfin sa dextre, fort étonné de voir un aussi jeune personnage en face de lui, alors qu’il s’attendait évidemment par l’énoncé de cette qualité à la vue d’un homme mûr.
Je fis l’important.
– Je ne suis pas à vrai dire, Monsieur, chargé de l’exécution de ce travail, mais attaché à la commission d’études du tracé de la ligne Paris-Chartres-Le Mans. Je suis chargé d’étudier l’un des itinéraires possibles, qui passerait donc près d’ici.
M. de Chamou, tirant sa moustache, parut réfléchir profondément.
– Vous dites, Monsieur, que l’un des itinéraires possibles pourrait traverser... mes propriétés ?
– J’ai précisément là, dis-je, tapant sur ma sacoche, la carte, les relevés topographiques et les cotes que j’ai déjà établis.
– Ce travail d’études n’est pas encore bien avancé, et je suppose que les autres projets ne le sont pas davantage !
– Je vous demande pardon, mais c’est précisément à cause de certaines difficultés techniques qu’une modification en est envisagée. Elle ferait passer la ligne par ici, et, fis-je, me gonflant un peu, c’est de l’étude de ce nouveau tracé dont j’ai été chargé.
M. de Chamou, me fixant intensément, demanda :
– Puis-je vous demander sans indiscrétion si vous y voyez quelque avantage ?
– Très certainement, lui répondis-je avec aplomb en songeant que l’avantage était là, tangible, sous la forme la plus gracieuse, et que le tracé de la ligne Paris-Chartres pourrait fort bien traverser la carte du Tendre.
Mon interlocuteur paraissait fort troublé par des sentiments incompréhensibles pour moi, et nerveusement tirait sur sa longue moustache, comme pour en traire une inspiration.
– Êtes-vous seul, ou suivi d’une équipe d’arpenteurs ? dit-il enfin.
– Je suis seul ; notre équipe avec l’ingénieur topographe est à trois lieues d’ici. Je ne puis les rejoindre que demain pour rendre compte de ma mission.
Le père de Lysiane parut soulagé d’un grand poids. Rasséréné, il poursuivit d’un ton plus amène :
– Je m’excuse, Monsieur, de vous retenir ainsi debout, alors que j’habite à deux pas. Vous plairait-il de venir chez moi vous reposer un peu, et vous rafraîchir, nous causerions plus à l’aise ?
S’il me plaisait ! Grands Dieux ! Quelle magnifique occasion d’approcher davantage cette jolie fille à qui je ne semblais pas faire peur.
Quelques minutes plus tard nous étions attablés autour d’un de ces flacons de vin auquel vous voyez que je suis resté fidèle... depuis cent ans ! Lysiane, jeune personne discrète, s’était éclipsée.
– Vous me disiez tout à l’heure, monsieur, reprit mon hôte, que différents itinéraires étaient prévus pour la construction de cette nouvelle voie qui doit permettre de plus rapides liaisons entre Paris et Chartres, et que l’un de ceux-ci devrait passer par mes bois.
– C’est exact.
– Bien que n’étant pas grand clerc en matière de vos chemins de fer dont je n’ai encore qu’à peine ouï parler, puis-je sans indiscrétion, puisque en somme c’est vous, j’entends votre Compagnie, qui venez me relancer en ma retraite, vous prier de me montrer sur une carte quel est le trajet envisagé ?
– C’est trop juste, mais je dois à vrai dire vous révéler que celui-ci n’est qu’une modification du tracé à l’étude, dont l’exécution soulève, en ce moment même, quelques difficultés...
– Voyons donc, me coupa M. de Chamou, amenant à lui les deux cartes extraites de mon sac, et qui constituaient à vrai dire toute ma documentation.
Comme j’essayais de fournir quelques explications, mon interlocuteur m’arrêta du geste.
– Laissez, laissez, bien que celles-ci soient nouvelles pour moi, je sais lire une carte... J’étais chef d’escadrons sous l’Empereur... et dans l’état-major de Berthier...
De longues minutes s’écoulèrent.
– Ainsi donc, reprit l’ancien officier, votre trajet modifié passerait par ici et par là... me dit-il en montrant sur le plan le dernier point coté par moi, avant ma dégringolade dans le ravin boisé où j’avais rencontré Lysiane, et tel autre point dénommé où la voie aurait normalement dû aboutir.
– C’est exact, mon... commandant, dis-je, espérant lui être agréable, sachant combien les anciens militaires aiment tout ce qui leur rappelle leurs gloires passées.
D’un sec « Je vous en prie ! », celui-ci me fit comprendre qu’il faisait exception à la règle.
– Évidemment, sur la carte, cette conception se défend... mais je sais par une vieille expérience qu’entre les tentations d’une carte et les réalités du terrain, il y un monde...
– Mais pourtant, Monsieur !
– Voyez-vous sur votre carte la faille de 10 mètres dans laquelle vous avez chu, et qui abrite ce bois-ci ?... Mesurez... à cette échelle huit cents mètres la séparent de l’autre bord... et vous ignorez ce qu’il y a dans ce bois...
– Des arbres ! me permis-je d’insinuer avec un sourire...
– Soit, répondit M. de Chamou de plus en plus sec – et ce groupe de maisons – où nous sommes – où est-il ?
– Je...
– Vous voyez donc qu’entre la carte d’état-major, expression officielle de la vérité topographique la plus récente, et la réalité, il y a parfois autre chose.
– Je le vois ; il y a eu omission grave que je signalerai.
– Je ne vous le conseille pas ; car, puisque le Destin a voulu conduire vos pas jusqu’ici, sachez que ces omissions-là, dans la langue des hommes, s’appellent mystères en celles des dieux. Vous venez d’en frôler un – faites comme ceux qui ont dessiné cette carte... et tant d’autres avant eux. Oubliez-le... Et comme vous n’êtes chargé que d’un travail d’études tout à fait préliminaire, concluez que la considérable dépense que représenterait la construction en ce point d’un viaduc ou d’une tranchée en plein roc rend cet itinéraire trop coûteux pour être préféré à celui-ci (le tracé primitif) plus au nord, qui passe à proximité de plusieurs localités...
Pour faire ma cour au père de Lysiane, je n’aurais pas demandé mieux que de bouleverser tous les projets de la Compagnie de l’Ouest... mais si la ligne passait plus au Nord, suivant le trajet à l’étude, moi, je ne reverrais plus Lysiane... et ça, je ne voulais, je ne pouvais absolument pas m’y résoudre.
– Vous ne vous rendez peut-être pas encore compte, Monsieur, des avantages qu’une ligne de chemin de fer donne aux propriétaires des localités desservies par ce nouveau mode de locomotion ? Au lieu d’être perdue dans les bois, votre propriété ne peut manquer d’acquérir une importante plus-value du fait des facilités d’exploitation forestière que vous donnera le réseau...
– Cela m’est égal !
– De plus, je ne puis cacher, malgré tout mon désir de vous être agréable, que la présence d’une forêt de chênes, capable de fournir les traverses à toute la ligne, intéressera au plus haut point nos ingénieurs.
– N’insistez pas !
– Mais enfin, Monsieur, vous ne pouvez tout de même pas penser que mes chefs abandonneront un projet sur le seul rapport du très modeste employé que je suis. – Ils voudront vérifier... et si leurs conclusions contredisent les miennes, leur confiance en moi sera ébranlée, ma situation compromise...
– Ne vous inquiétez point de tout cela, jeune homme, si vous faites le compte-rendu de votre voyage d’études dans le sens que je vous prie de lui donner, on n’ira pas y voir tout de suite – pendant ce temps, j’agirai auprès de certaines relations, et le projet sera classé sans plus. Et votre situation à vous, conclut-il en me regardant dans les yeux, se fera le mieux du monde...
Comme je ne répondais point, me demandant comment concilier la volonté de M. de Chamou, – de rester isolé en cette forêt vierge – et mon désir d’y retrouver certains cheveux blonds qui me paraissaient les plus beaux du monde, mon hôte, prenant mon mutisme pour une obstination, se leva, me prit par la main et, ouvrant la fenêtre, me montra l’avenue que vous connaissez, l’abbaye qui la ferme, le va-et-vient des habitants plus nombreux alors qu’aujourd’hui.
– Croyez-vous donc, jeune homme, qu’une agglomération comme celle-ci puisse être ignorée et rayée de la carte de France sans un certain de nombre de puissantes amitiés ?
– Mais enfin, j’y suis venu, moi, par hasard ; d’autres peuvent y venir et, en cette époque où le progrès ouvre de nouvelles routes, votre village ne pourra longtemps encore rester ignoré !
L’ancien officier sourit – pour la première fois.
– Le Hasard ! que voilà donc un mot amusant ! Il n’y a pas de hasard – au sens où vous l’entendez – il y a des évènements qui ne se produisent que dans un ensemble de conjonctures plus ou moins surprenantes, – mais qui devaient arriver nonobstant toutes mathématiques. Or, si vous êtes venu jusqu’ici, conduit par ma fille, c’est que tel était votre destin, sinon jamais, vous m’entendez, jamais vous n’auriez réussi à découvrir Perrière !
Comme je paraissais assez sceptique, puisque étant venu là où j’étais parvenu, je pensais que même si je n’avais pas découvert cette thébaïde aujourd’hui elle n’eût pu manquer de l’être par notre équipe de topographes, M. de Chamou poursuivit :
– Lorsque je quittai cette maison où je suis né pour entrer avec l’autorisation de mon père dans l’Armée, une amie de ma mère, lisant dans ma main, me prédit qu’une balle me ramènerait ici. Recevoir une balle quand on embrasse la carrière militaire en 1805, cela n’a rien d’extraordinaire, mais qu’elle vous ramène au logis, c’est plus curieux !
J’ai assisté à 20 batailles, en Allemagne, en Autriche, fait la guerre d’Espagne ; j’ai vu mon shako emporté par un boulet à Esling, mon habit percé de balles à Wagram, mon cheval tué sous moi, sans jamais recevoir une écorchure ; enfin j’étais, je vous l’ai dit, à l’État Major de Berthier en 1812, quelque part en Pologne. La Grande Armée se préparait à envahir la Russie. Un matin, descendant l’escalier d’une maison où j’avais mon logement, je trébuchai sur quelque chose de rond – glissai sur les marches cirées, dégringolai jusqu’en bas, si malencontreusement que mon éperon s’accrocha aux barreaux de l’escalier. Je me brisai la cheville. Cela me valut un long séjour à l’hôpital, où, mal soigné par des chirurgiens ignorants, mon pied resta raide. C’est ainsi que j’évitai de justesse la campagne de Russie. Je fus donc renvoyé en France, grâce à une balle trouvée par un petit polonais qui, s’en était amusé comme d’une bille, l’oublia sur une marche d’escalier.
– C’est curieux, dis-je, cherchant quelque « Sésame » mystérieux pour revenir à Perrière, mais cela ne m’explique pas comment vous pouvez m’affirmer que jamais je n’aurais su découvrir votre village sans Mademoiselle votre fille, alors que j’en avais trouvé le chemin. Je ne vois pas non plus pourquoi mon Destin m’y envoie.
Sur ce second point cependant je commençais à avoir une opinion personnelle car, fait extraordinaire, tout en parlant au père de Lysiane, c’était elle que je voyais devant moi : son gracieux visage qui vivait devant mes yeux, sa voix même que j’entendais.
L’ancien officier d’état major me dévisagea quelques instants, puis, se levant :
– Vous ne vous expliquez pas, dites-vous, comment une fois sur cette piste vous auriez pu ne pas découvrir Perrière ? Vous plairait-il de venir avec moi jusqu’au point où vous êtes descendu dans le taillis et de reprendre la ligne que vous vous étiez tracée ?
Assez penaud je me levai, repris mes cartes, ma sacoche, ne sachant comment interpréter les paroles de ce bizarre personnage autrement que par une forme de congé. Mais qu’aurai-je pu imaginer d’autre – et à quoi aurai-je pu prétendre ?
Je descendis donc sans souffler mot l’escalier derrière M. de Chamou, lorsqu’en bas j’eus la joie de voir Lysiane s’accrocher au bras de son père et lui parler bas. Discrètement j’attendis sur une marche que l’entretien eût pris fin. Je vis le père de ma petite fée acquiescer d’un signe de tête, et celle-ci, se tournant vers moi, me dit de sa voix fraîche :
– Il sera trop tard aujourd’hui pour gagner le prochain village avant 7 heures. Si vous le voulez bien, Monsieur, vous souperez avec nous, mon père y consent.
– Je vous offre même de passer la nuit sous mon toit, car il sera vraiment trop tard pour repartir ensuite. Demain, nous vous remettrons sur la bonne route – car vous vous perdriez !
J’étais si heureux, si heureux, que je ne trouvais pas un mot pour remercier mes hôtes, mais je devais avoir l’air tellement transporté de joie que la charmante fille, troublée, baissa les yeux.
J’eus d’abord quelque peine à retrouver l’endroit de ma rencontre avec Lysiane, et pour peu que vous ayez circulé en forêt, vous devez savoir combien il est difficile de retrouver un endroit sans point de repère, quand on n’a pas le sens de la direction qu’ont seuls les gens habitués aux forêts, aux déserts ou à la mer. Heureusement mon compagnon me mit sur la bonne piste.
– Vous y voilà donc, Monsieur Futaies, me dit-il. Mission vous est donnée de reconnaître l’itinéraire de la nouvelle voie en direction O.-S.-O. – si j’ai bonne mémoire – que faites-vous ?
Bien entendu, je sortis ma boussole de son étui, pris l’azimut de marche, m’engageai sous les taillis.
M. de Chamou me suivait sans mot dire...
Je ne vous raconterai pas, mes chers neveux, les péripéties de cette exploration, vous en savez assez sur les particularités magnétiques de certaines roches entourant Perrière pour imaginer les erreurs formidables que je pus commettre. Je m’énervais, sentant derrière moi un homme aussi impénétrable que le mystère de cette forêt enchantée dans laquelle je me débattais, qui s’arrêtait avec moi, repartait en même temps, ne répondant que par geste ou monosyllabes à mes questions, tant et si bien que je crus devenir enragé en repassant pour la 3e fois...
– Devant la Pierre aux lapins ?... enfin, le Tambour des Dieux ? Nous y avons été pris tantôt !
– Ah bon ! cela vous explique mieux mon aventure. Seulement moi, au lieu d’être parti par le chemin qui s’ouvre derrière l’abside de l’Abbaye, j’avais commencé par la « Descente des fées », qui est à peu près l’endroit par lequel Philippe vous amena hier soir, et c’est tout le tour de Perrière que j’avais fait par trois fois – sans seulement en apercevoir le clocher !
J’étais éreinté, vexé, furieux contre l’ancien officier qui, évidemment fatigué lui aussi, me considérait d’un air maintenant narquois.
Comme je m’étais laissé tomber au pied d’un arbre pour souffler un peu, M. de Chamoun, voyant mon air à la fois désolé et furieux, se décida à parler. Déjà la nuit tombait ; sous les voûtes de verdure c’était presque l’obscurité.
– Vous savez vous servir d’une boussole et d’une carte, jeune homme ! c’est fort bien. Mais vous ne savez pas les raisonner quand elles se trompent, ni les corriger lorsqu’elles mentent... Oui, vous n’avez donc pas compris que des champs magnétiques inconnus de vous émanaient de quelques-uns de ces gros cailloux-là... et d’ailleurs. Il y a ici, en cette forêt, des forces puissantes contre lesquelles vous ne pouvez rien. Vous avez tourné en rond ; je vous ai laissé faire pour que vous compreniez pourquoi Perrière, au cœur de la France, est resté hors du temps.
En troubler la solitude séculaire serait un crime ! Près d’ici, je vous montrerai le plus antique, le plus vénérable monument de notre Histoire, et vous constaterez que, seul, vous n’avez pu le découvrir bien qu’ayant erré quatre heures dans un bois de 1.500 m. de large que vous n’avez même pas traversé.
– Venez avec moi maintenant !
Subjugué, je suivis le maître du mystère qui, par le sentier que vous avez pris, me conduisit...
– Au Grand Tombeau ?
– Non pas. Celui-là, je ne fus pas encore digne sans doute d’y être conduit, mais à l’Abbaye, dont l’histoire me fut sommairement contée, puis ici même, où la table déjà servie nous attendait.
Le plus joli sourire du monde me fit aussitôt oublier les mésaventures de mon après-midi et, pendant tout le souper qui fut long comme entre gens pour qui la venue d’un étranger est une distraction, c’est moi qui eus à faire face à l’assaut des questions de mes hôtes touchant les inventions nouvelles, le monde extérieur – Paris surtout, dont je ne connaissais rien. Il me fallait cependant renseigner ma nouvelle amie, tant et si bien que l’heure du bougeoir venue il ne paraissait plus que j’avais été tantôt un importun auquel une leçon avait été infligée.
En me confiant le chandelier au pied de l’escalier, Lysiane me demanda un peu anxieuse :
– Ferez-vous ce que Papa vous a demandé ?
– Oui, Mademoiselle, mais alors... comment vous reverrai-je ?
– Demandez-le à Papa ! répondit Lysiane en me tendant la main.
Un long moment notre oncle se tut, paupières closes, vivant encore le roman de ses vingt ans.
Sa respiration, fatiguée par ce long monologue pour lequel il dépensait ses dernières forces, devenait oppressée. Ma femme, pensant aller prévenir le père Mathieu, se levait déjà...
– C’est cela, ma nièce, c’est une bonne idée, émit l’oncle d’une voix faible mais nette, donnez-moi donc à boire...
Le breuvage favori de l’Oncle Louis devait avoir de bien puissantes vertus toniques, car bientôt le vieillard ayant pris quelques instants de repos, reprit avec plus de facilité son récit interrompu :
– Bien que fatigué par cette journée mouvementée, je ne parvins que tard à m’endormir ce soir-là : le soir de mes vingt ans ! Trop de pensées, trop d’images tournoyaient en ma tête comme un kaléidoscope et ce furent les bruits de la maison qui me réveillèrent le lendemain matin d’un rêve encore occupé par une confuse histoire de chemins de fer tournant sans fin en des bois peuplés de nymphes aux cheveux d’or.
La première personne que j’aperçus en descendant fut Lysiane qui m’accueillit de son joli sourire et m’invita à m’asseoir devant un confortable déjeuner « en attendant mon père déjà sorti conférer avec quelques amis », voulut-elle bien me confier.
Un peu gauche, je m’excusai d’abord de descendre si tard (il était plus de sept heures) et de donner un surcroît de travail à mes hôtes.
– Pour ça, vous pouvez dire que vous nous en avez donné du souci avec vos chemins de fer ! observa la jeune fille en me servant un grand bol de lait. Papa n’en a pas fermé l’œil et dès l’aurore il est allé voir les Pères pour en parler avec eux.
– Vous m’en voyez tout désolé, Mademoiselle, mais, est-ce de ma faute si ma Société envisage de faire passer une ligne par ici et m’a désigné pour une reconnaissance préalable du terrain ?
– Non... fit-elle avec une moue – mais Papa m’assurait tout à l’heure encore qu’il ne dépendait que de vous que cette mission n’ait pas de suite !
– Il m’en a touché en effet quelques mots ; mais de cela je ne suis pas aussi certain que lui...
– Ça, c’est une autre histoire... il n’empêche que si vous ne m’aviez pas rencontrée, vous auriez pu tourner dans les bois jusqu’à la nuit. Papa vous l’a démontré... Alors, pour nous faire plaisir, vous pourriez bien faire ce qu’il vous demande... pour éviter de bouleverser Perrière en troublant la vie studieuse de ceux qui l’habitent depuis des siècles !
– Mais pourquoi tenez-vous à rester isolés dans vos bois, alors qu’il y a tellement de choses à voir de par le monde ?
– Ce n’est pas moi qui tiens à rester isolée, bien que j’aime mon Perrière, mais... c’est la vie de Perrière qui ne doit pas être troublée !
Que m’importait alors la vie mystérieuse de Perrière. Je ne retins que l’aveu de la jeune fille. Aussi j’affirmai :
– Mais les deux choses se tiennent : si Perrière reste isolé, vous le serez également. Tandis que le chemin de fer vous permettrait d’en sortir... je reviendrais vous voir... et si vous le vouliez bien, Lysiane... je vous emmènerais... à Paris...
Timide, n’osant pas formuler les mots éternels qui depuis la veille se pressaient à mes lèvres, j’avais parlé sans regarder ma petite fée.
N’en recevant aucune réponse, je me permis de lever les yeux sur elle, et la vis toute pâle, s’appuyant à la table sans mot dire.
Ces premiers mots-là ne furent jamais prononcés. D’un seul geste, je me levai, lui tendis les mains. Elle y mit simplement les siennes, et, face à face, les yeux dans les yeux, sans parole, nous nous confiâmes notre amour.
– C’est beau ! dit ma femme.
– Oui, répondit le vieillard ; et chaque jour encore je remercie le Ciel de m’avoir ainsi comblé du premier coup – il y a 100 ans. Vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cette histoire alors que le temps m’est strictement mesuré, j’y ai bien réfléchi : croyez que ce récit est absolument indispensable.
Ce fut Lysiane qui rompit le silence, traduisant malgré elle l’inquiétude qu’elle m’avait exprimée :
– Louis, vous ferez ce que mon père vous demande ?
J’allais répondre lorsque la porte s’ouvrit devant M. de Chamou qui, nous voyant les mains dans les mains, s’arrêta net, interdit, fronçant le sourcil.
Moi je ne savais quelle contenance prendre, mais les jeunes filles ont parfois de ces audaces... Sans me lâcher la main, Lysiane m’amena devant son père, s’écriant, joyeuse :
– Papa, Louis est des nôtres, il fera tout ce que tu voudras !
Quatre vieux messieurs, qui accompagnaient le père de ma fiancée, reçurent en même temps la nouvelle.
L’ancien chef d’escadrons me considéra du haut en bas comme il l’eut fait d’une nouvelle recrue, sans que son visage témoignât d’un quelconque sentiment d’approbation ou de désapprobation, ni même qu’il eût compris, dans la simple phrase de sa fille, autre chose que le sens strict, textuel, des mots employés par elle. Simplement il pénétra dans la salle et, me serrant la main, prononça :
– Je suis charmé que ma fille ait réussi à vous convaincre de la nécessité de respecter notre isolement ; cela nous fera gagner bien du temps. Et puisque vous voulez être des nôtres, souffrez que je vous présente :
– Messieurs, le jeune ingénieur topographe, Louis Futaies, dont je vous ai parlé,
Monsieur Pierre..., notre Maire, en quelque sorte,
Monsieur Joseph, Monsieur Eusèbe, Monsieur Geoffroy.
Je m’inclinai respectueusement devant les personnages ainsi dénommés, qui me tendirent la main – avec plus d’amabilité que ne m’en témoignait le père de Lysiane.
Quant à moi, je ne laissais pas d’être surpris de la forme cérémonieuse avec laquelle M. de Chamou m’introduisait auprès de ces bonshommes barbus, et, me parut-il, assez négligés tant dans leur aspect que dans leurs vêtements.
Lysiane s’était empressée de leur offrir des sièges, et ce fut autour de la table, débarrassée en un tournemain, que nous nous assîmes. Quant à elle, sans paraître s’apercevoir du froncement de sourcils par lequel son père essayait de lui faire comprendre qu’il jugeait sa présence inutile, elle se tint debout derrière moi pour bien marquer qu’elle entendait qu’il lui fût tenu compte de mon adhésion et qu’elle revendiquait l’objet de cette victoire.
Monsieur Pierre, un petit vieillard chenu encore abondamment chevelu, prit la parole.
– Nous avons été charmés d’apprendre, par la bouche de notre petite Lysiane, que vous désiriez être des nôtres et acceptiez d’en respecter la formelle discipline, celle du silence ?
Du ton où cette simple phrase était dite, il me fallait comprendre que le mystère soigneusement combiné et entretenu qui régnait autour de Perrière était entre les mains des cinq hommes assis à cette table et que d’eux, plus encore que de M. de Chamou, dépendait mon bonheur.
D’une légère pression sur mon épaule, Lysiane me signala d’avoir à acquiescer sans discussion, ce que je fis.
– Bien, continua celui qu’on m’avait présenté comme le maire de cette localité. Nous avons votre parole ; nous estimons qu’entre français cela suffit comme garant de votre silence. Mais puisque vous souhaitez votre admission dans notre groupement, je me vois dans la nécessité de vous demander quelques renseignements sur votre état et sur votre famille. Vous plairait-il de les communiquer à ces Messieurs ?...
Assez inquiet d’un semblable interrogatoire en ce lieu, je m’empressai d’obtempérer à l’invite :
– Louis Futaies, né le 20 Avril 1823 à Châteaudun.
Monsieur Eusèbe griffonna cette indication sur un carnet extrait de sa poche et se mit à opérer divers calculs.
– Vous êtes ici, Louis, me dit sans autres formules, M. Joseph, dans le plus antique sanctuaire de la France. C’est dans cette forêt que s’élève le monument vénéré sur lequel nos druides consacraient le premier d’entre eux au jour de la Modra Necht ou fête du Gui – au solstice d’hiver. C’est là que tous nos rois depuis les temps immémoriaux jusqu’à Louis XIV, en passant par Vercingétorix, Clovis et Charlemagne, ont reçu secrètement l’Investiture suprême.
Lorsque le Christianisme supplanta notre antique religion, les plus fidèles gardiens de nos traditions secrètes ont construit ici, à l’instigation de notre grand Benoît d’Aniane, cette abbaye dissimulée à tous les regards indiscrets. D’où l’origine des légendes comme la Belle au Bois Dormant, Riquet à la Houppe, et autres contes, dont le sens véritable n’est compréhensible que pour les initiés.
Voilà ce que Jeanne révéla au Dauphin Charles pour le convaincre de sa mission et le décider à la suivre ici, avant de remporter sa première victoire à Patay.
Un jour viendra où les temps prédits seront écoulés ; la forêt enchantée s’ouvrira alors devant le Prince qui emmènera la Belle, tandis que se réveillera le Château.
M. Eusèbe témoigna alors d’une certaine agitation et, se levant, passa à l’orateur le carnet sur lequel il avait consigné ses notes. Celui-ci me regarda avec étonnement, passa les chiffres qui venaient de lui être confiés à chacun des assistants.
Le dernier, M. de Chamou, en eut la communication, les lut attentivement et, les rendant à leur auteur, observa :
– J’aurais mauvaise grâce à m’opposer à la demande de ce jeune homme, puisque les augures s’y montrent favorables. Cette mission, elle me semble tout indiquée puisque de lui dépend provisoirement le respect de notre retraite. Qu’il rejoigne au plus tôt son poste où il pourra nous être fort utile. Nous avons besoin d’observateurs en ce milieu de constructeurs de chemins de fer où nous n’avions pas encore des nôtres.
D’ailleurs, ajouta-t-il en se tournant vers moi, à dater de ce jour, nous nous chargerons de vous pousser et d’assurer votre avenir ; nos amis de Paris recevront toutes instructions à cet égard...
– Je vous remercie, Monsieur, mais... osai-je demander... Pourrai-je revenir ici, puisque vous m’acceptez parmi les vôtres ?
– Nous verrons quand vous aurez rempli quelques-unes des missions confiées et que vous pourrez être initié à notre foi... éluda le père de Lysiane.
Celle-ci me pinça l’épaule et, des pouces, me faisait comprendre d’aller de l’avant... Or, j’étais terriblement intimidé.
Ce fut M. Eusèbe qui intervint :
– Mon Cher Évariste, dit-il s’adressant à M. de Chamou, je vous ai communiqué la réponse de l’Horoscope sommaire tiré du nom de ce jeune homme.
Ce n’est pas une vaine curiosité, ni une fatalité ennemie, qui l’a conduit ici. Tout, y compris la rencontre de votre fille qui eut la bonne pensée de vous l’amener, tout concourt à favoriser la demande qu’il nous fait – avec toute la sincérité de son cœur – et il appuya sur ces mots – d’être désormais des nôtres.
Je m’explique. J’ai, selon les règles anciennes, chiffré la valeur de son nom : 132, de son prénom – en français d’abord : 66, le degré correspondant au jour de sa naissance : 20 Avril = 1er degré, le 1er degré du 2e mois zodiacal. Additionnons les chiffres composant cet horoscope à l’année de sa naissance : 1823, nous obtenons 1823 + 1 + 2 + 6 + 6 + 1 + 3 + 2 = 1844, sommet de l’horoscope qui, additionné de la même façon, donne la traduction suivante = 1 + 8 + 4 + 4 = XVII, arcane qui s’exprime par le précepte suivant : « Dépouille-toi de tes passions et de tes erreurs pour étudier les mystères de la véritable science, et leur clef te sera donnée. »
– Alors, poursuivit de mémoire M. Pierre, « Un rayon de la divine lumière jaillira du Sanctuaire occulte pour éclairer ton avenir et te montrer la voie du bonheur ! »
– C’est exact, approuva le devin, en s’inclinant devant celui qui était de toute évidence le chef de cette communauté. Mais que vos Sérénités veuillent bien le constater, je n’ai pas voulu me borner à cette seule réponse. J’ai traduit en celte les noms et prénoms de l’impétrant : Louis par Ludovigh, et Futaies par Bod Koad (ou sa signification originelle : Bouquet d’Arbres). J’obtins : 1823 + 1 + 2 + 1 + 6 + 6 (Ludovigh = 166) + 1 + 1 + 1 (Bod Koad) = 111 soit 1842, l’année qui détermina votre destin.
Voilà, jeune homme, la réponse que fait la divine mathématique à votre demande d’admission. Elle est favorable, très favorable même. Il vous reste à subir les épreuves de l’initiation druidique. Vous avez vingt ans, je crois ?
– Depuis hier, osai-je avouer devant ces ancêtres souvent peu indulgents aux trop jeunes gens !
– Depuis hier... c’est inouï ! le jour de votre arrivée ici !
Derechef, Eusèbe griffonna quelques chiffres. Tous attendirent son oracle dans le plus respectueux silence.
– Voici donc la réponse du Destin à l’anniversaire de Louis ici présent. Oyez plutôt :
À 1843, date de cet anniversaire, j’ajoute les mêmes chiffres du degré, du signe, du nom et du prénom, soit 21, le total : 1864 additionné à son tout (1 + 8 + 6 + 4) exprime l’arcane XIX. Vous en connaissez le sens :
« Tu seras heureux, et contre tous, conserveras ton bonheur si tu sais le placer dans l’amour conjugal et dans le secret de ton cœur » traduisit Sa Sérénité Pierre, qui savait apparemment de mémoire tous les symboles que j’ignorais totalement.
– Qu’en pensez-vous, mon cher Évariste ? poursuivit le Grand druide voyant que seul M. de Chamou conservait l’air réservé dont il ne s’était jamais départi à mon égard.
– Devant ces réponses favorables, et me rangeant à votre avis à tous, je pense que nous pouvons envisager l’admission du jeune homme ici présent...
D’un bond je me levai, électrisé pourrai-je dire, et je « m’entendis » prononcer ces mots avec une telle netteté que j’aurais pu m’en croire auditeur plutôt que l’orateur :
– Je vous en suis profondément reconnais-sont, Monsieur, aussi, puisque vous m’acceptez parmi les vôtres, permettez-moi de vous demander la main de Mademoiselle Lysiane votre fille ; c’est elle que j’aimerai toute ma vie.
Sur les visages souriants des quatre anciens de Perrière je lisais leur approbation et sentais leur appui.
Pas un trait ne bougea sur le visage hermétique de l’ancien officier qui me toisa et, sans repousser ma demande hardie, répondit enfin :
– L’usage antique des Celtes voulait que le père d’une jeune fille sollicité par un jeune homme de la lui accorder en mariage lui imposât trois épreuves pour s’assurer à la fois de la sincérité de ses sentiments, de leur profondeur, et de la valeur morale de celui à qui il allait confier son enfant.
Vous n’avez que 20 ans bien justes, ma fille à peine 17, vous ne vous connaissez pas encore et êtes bien jeunes pour fonder un foyer. En ces conditions, Louis Futaies, je vous le demande en présence de leurs Sérénités ici présentes : acceptez-vous de vous soumettre aux obligations que je jugerai devoir vous imposer tant dans l’intérêt de ma fille que dans celle de notre foi, et de ne recevoir votre fiancée pour épouse que de mon consentement ?
Sans plus réfléchir, je criai plutôt que je ne répondis :
– Je vous le promets !
– Tu as entendu, Lysiane ? Acceptes-tu de devenir l’épouse de Louis Futaies aux conditions énoncées ?
– Oui, répondit-elle en me tendant la main.
De deux doigts le père traça en l’air au-dessus de nos dextres jointes le signe sacré de la Croix Celtique, dont je ne compris pas le sens magnifique à cette époque. Puis il ajouta : « Que les âmes des Celtes entendent et reçoivent votre serment. »
D’une même voix les assistants répondirent :
– « Et que soit anathème celui de vous qui trahira sa foi. »
Et ce fut alors que nous échangeâmes notre premier baiser – en face de ces cinq vieux bonshommes.
Lysiane n’avait plus de maman ; mes parents ignoraient, bien entendu, tout de cette aventure.
Eh bien, mes enfants, je ne sais comment se passèrent vos fiançailles, mais je vous jure que des accordailles sans présences féminines, ça fait plutôt sec... comme un acte notarié... oui, ça fait sec ! répéta l’oncle en évoquant la vision centenaire de ses amours... – Aussi, donnez-moi donc à boire,... plus haut, s’il vous plaît, ma nièce ; je n’ai pas fini mon histoire.
CHAPITRE VII
Ayant achevé son verre de vin, l’oncle s’était quelque peu assoupi. Dans la vaste chambre où nous n’osions bouger, seule la danse de millions d’atomes dans un rayon de Soleil couchant entretenait quelque animation.
Derrière les volets mi-clos on entendait les chants des oiseaux de la forêt soutenus par le caquet des volailles éclatant de toutes parts et témoignant de la vie intense cachée dans ce hameau ignoré.
Écoutant cette agreste symphonie, nous ne ressentions pas, auprès de ce vieillard, ce pénible sentiment d’inquiétude, d’oppression habituellement éprouvé auprès de ceux que va quitter la vie, même s’ils vous sont indifférents.
Doucement, derrière moi, la porte s’entrebâilla. Me retournant, j’entrevis la tête de la cousine Hermance nous faisant signe.
Sur la pointe des pieds nous sortîmes. À la muette interrogation de la vieille dame, Lucienne répondit tout bas :
– Votre grand-père nous racontait son histoire ; il a demandé à boire, puis il s’est endormi. Il n’est pas plus mal !
– Il a toute sa mémoire, et sait fort bien ce qu’il dit ! crus-je devoir ajouter.
– Son histoire ! mais nous la connaissons tous, et s’il n’a pas quelque idée de derrière la tête à vous sortir, je pourrai vous la raconter moi-même d’un bout à l’autre. Pensez si ma mère ou lui... Je suis venue parce que le chat ne faisait que monter, gratter pour qu’on lui ouvre et descendre pour me chercher... j’avais beau vous savoir avec le père, j’ai été inquiète tout à coup. Avec les animaux on ne sait jamais... ils flairent comme ça des choses...
Je vais rester un moment avec le Père. Si vous voulez goûter, la collation est servie en bas. Ces Messieurs sont dans la salle ; je vous appellerai...
Sans nous donner le loisir de répondre, la vieille dame pénétra dans la chambre du vieillard, précédée du matou portant sa queue rousse en panache.
______
En bas, dans la salle aux poutres apparentes où accédait directement l’escalier de chêne ciré, une dizaine de personnes de tous âges étaient réunies pour une collation autour de la vaste table. En son milieu, bien qu’on fût en jour, brûlait une bougie dans un haut chandelier de cuivre. Le père Jean nous présenta.
Sauf le père Mathieu et Philippe faisant office de maître de maison, il n’y avait là que des femmes, d’âge mûr pour la plupart, sauf deux jeunes, toutes coiffées d’un fichu blanc noué derrière la nuque. Chacune avait disposé sur la table une bougie, longue ou courte selon son état d’usure. Aucune n’était neuve.
– Vous assistez en ce moment à la veillée du départ, nous expliqua le maître des Rites. L’usage veut que chaque voisin ou ami de celui ou celle qui va nous quitter apporte sa chandelle. Celle qui est en service chez lui en l’état où elle se trouve, et l’apporte chez le mourant.
Le premier arrivé allume son lumignon en face du foyer, pour marquer la place de celui ou de celle qui va nous quitter. Quand la mèche chavire, on y allume la seconde chandelle, et ainsi de suite jusqu’à la dernière... Cela dure... autant qu’il y en a... plus ou moins longtemps selon le nombre des amis, la longueur de leur luminaire. Lorsque la dernière s’est éteinte, on ouvre la porte de la maison.
L’Esprit du Mort va retrouver ses ancêtres.
– Votre coutume est très émouvante, mais, permettez-nous une question, mon Père... La mort coïncide-t-elle réellement avec l’extinction de la dernière flamme ?
– Il faudrait nous entendre sur les mots : La Mort... qu’est-ce que c’est ?
– L’état d’un corps qui ne respire plus : dont le cœur a cessé de battre...
– Vous en êtes encore à la conception matérielle de la Mort. Pour nous c’est l’instant où cesse la cohabitation de l’Âme immortelle dans une enveloppe charnelle.
– Si vous voulez !
– Seulement nous n’avons jamais pensé que cette séparation coïncidât obligatoirement avec la cessation matérielle de la vie animale.
Je m’explique : un être vient d’être tué par accident ou même par une brusque maladie qui en arrête le mouvement moteur ; pendant un laps de temps plus ou moins prolongé, l’Esprit de notre « mort » restera attaché à son habitation corporelle... et pendant de longs jours, si son évolution psychique n’est pas avancée, il ne comprendra pas le pourquoi de cette incapacité fonctionnelle et ressentira même la douleur de l’outrage fait à ce corps qu’il anima...
– Donc, comme un mutilé souffre dans son membre coupé... dit ma femme.
– Très exactement.
– D’autre part chez un malade, un vieillard, qui accepte le départ, cette séparation a souvent lieu avant l’arrêt du moteur vital, qui continue encore sa course comme une voiture lancée.
Pouvez-vous me dire quand s’est produite la Mort ?
– Nous admettons très volontiers votre manière de voir, mais n’en voyons pas le rapport avec les bougies – allumées chez le mourant. C’est habituellement... après qu’on en met au chevet du défunt...
Le Père Jean se tourna légèrement vers l’une des jeunes dames.
– Jeanne, voulez-vous expliquer ce symbole à notre amie ?
Selon le désir de leur oncle, nous répondrons à toutes les questions de Monsieur et de Madame, certains qu’ils n’en feront aucun usage fâcheux contre Perrière !
L’interpellée nous considéra un instant, souriant davantage de ses yeux couleur de mer que des lèvres, puis, écartant d’une main soignée le fichu immaculé qui devait la gêner comme une coiffure inhabituelle, dégagea une mèche ondulée de cheveux châtains. Elle commença d’une voix claire, habituée à s’exprimer et à exposer :
– Il faut bien se pénétrer, avant de commencer toute étude de symbolisme, que celui-ci procède à son origine d’une croyance fondamentale en un animisme qui prend son origine dans le sentiment ressenti par les aborigènes d’une contrée quelconque de participer conjointement aux règnes : végétal, minéral et animal, à la Vie universelle, et d’accorder avec Elle ses actes comme ses pensées. Cet accord, cette harmonie latente, a besoin pour s’élever vers les plans supérieurs d’une synchronisation de toutes ces composantes matérielles, comme en un orchestre le développement euphonique de la partition ne saurait se faire sans la discipline de tous les exécutants – ou dans un tableau sans respecter les règles de la perspective, des valeurs et des volumes. Faute de cette observance en l’un quelconque de ses éléments constituants, la musique orchestrale ou picturale sera troublée et le motif principal lui-même, si considérable soit-il, en subira l’atteinte.
Tout élément étranger, apporté dans cette composition naturelle qu’est un paysage géographique complet, avec sa géologie, sa végétation, son ciel, devra s’exercer plus ou moins longtemps à y participer. Certains s’y adapteront, un mimétisme fréquent les assimilera bientôt aux instrumentistes plus anciens de cet ensemble ; d’autres y joueront faux, et devront en être exclus !
Dans la croyance celtique, ce sont les génies du sol, les Sylphes de l’Air, qui transformeront cet élément allogène en indigène. Il y aura bientôt adaptation puis fusion. Ainsi des arbres comme l’olivier, le marronnier, l’acacia, l’eucalyptus, des plantes comme la pomme de terre, le tabac, s’y sont adaptés et sont aujourd’hui « naturalisés ». Des espèces animales ou humaines en ont fait autant. Les Gaulois, les Francs, les Nordiques, ont pris racine dans la terre celtique et participent aujourd’hui à son rythme vital.
N’a-t-on pas assisté de nos jours au même phénomène en Amérique et en Australie, plus difficilement en Algérie, tandis que l’Afrique noire et l’Asie jaune repoussaient les hommes blancs ?
– C’est exact.
– Aussi, voyez-vous, il est considéré par les celtes qu’une parenté existe entre l’esprit des hommes de ce pays et les manifestations visibles ou invisibles de son sol.
La flamme du foyer, petite divinité dansante et propice, participe à la vie de la Maison ; elle en est l’âme vivante. Cette lumière qui guide nos actions, vit avec notre pensée, s’endort pendant son sommeil, porte en sa lueur un peu de notre vie.
En l’apportant sous le toit de l’ami dont l’Âme va partir, comme nous l’espérons pour chacun vers la Grande Lumière, c’est un peu de la nôtre que nous lui apportons pour l’accompagner en un monde qu’il a connu et oublié. Petite flamme, messagère de nos foyers terrestres, elle fait à l’ami qui nous quitte le « bout de conduite » que l’on fait au visiteur sur son départ jusqu’au seuil de la maison.
– C’est absolument touchant, cette coutume, fit Lucienne émue.
– Comprenez-vous la différence fondamentale qui existe entre la foi celtique en la vertu divine du sol natal, véritable jardin d’acclimatation des espèces animales ou végétales, et le racisme qui donne à la Race en Soi une orgueilleuse vertu souveraine qu’elle prétend emporter avec soi sous d’autres cieux ?
Pour comprendre les symboles, il faut que l’âme participe à leur élaboration, qu’il y ait entre l’image créée ou la coutume antique une transmission de pensée.
L’art chrétien – tant qu’il fut dans les siècles passés un acte de foi – s’est ainsi adapté aux Génies du Sol occidental. Il a fait mauvais ménage en Orient et n’a pu se développer en Extrême-Orient, pas plus que les figurations noires et jaunes, si évocatrices pourtant de magies merveilleuses, ne peuvent ici trouver de résonnance. Tant et si bien que – je l’ai constaté moi-même – des mages ou fakirs d’une culture aussi profonde qu’étendue, initiés aux secrets les plus intimes de leurs cultes exotiques, ne peuvent souvent, sur notre sol, obtenir les merveilleux résultats qu’ils obtiennent dans un milieu dont les Intelligences sont harmonieuses avec leurs rites.
– C’est tout à fait cela, ma petite Jeanne ; vous avez, mieux que je ne l’aurais fait, exposé à nos amis le sens profond de notre philosophie – ésotérique comme exotérique.
– Puisque telle est votre fonction sociale, vous devez réussir à la propager par votre enseignement.
– Madame est dans l’enseignement ?
– Mademoiselle, rectifia le père Jean, est agrégée et professeur de philosophie. Ma petite fille Geneviève, ici présente, est docteur ès sciences et l’assistante d’un de nos plus illustres physiciens, du reste de nos adeptes secrets... (ici il me cita le nom d’une des sommités de la science française dont les ouvrages tant scientifiques que philosophiques font autorité).
– Très honorés, Mesdemoiselles, nous ne nous attendions vraiment pas à rencontrer ici...
Le rire des jeunes femmes fusa.
– Oui, vous pouviez nous prendre pour des paysannes – ce que nous sommes restées – et c’est pour maintenir ce contact avec la vie profonde du pays que nous y revenons en vacances.
– Nous-mêmes, ajouta une autre femme d’aspect austère, n’avons pas passé toute notre vie ici. J’ai voyagé, perdu mon mari, et suis comme d’autres revenue à Perrière y retrouver la vie simple, et me désintoxiquer des miasmes qui empoisonnent les grandes villes de France.
Le père Mathieu, qui avait gardé le silence jusque-là, sortit de son mutisme :
– Cher Monsieur, vous devez savoir que c’est lorsque l’organisme est atteint par des toxines que se développent les maladies. Pour guérir, le malade doit aider le médecin à éliminer, non pas seulement le Mal extérieur – qui n’est en somme qu’une manifestation apparente d’un état pathologique –, mais à purifier le sang du malade...
– Et pour cela, voyez-vous, ajouta Mademoiselle Geneviève, il n’y a rien de tel pour nous que l’atmosphère calme et fortifiante d’une forêt de grands chênes celtes...
La cousine Hermance descendait l’escalier, lourdement, comme écrasée par un fardeau.
Le départ du Grand Père lui causait évidemment un profond chagrin, mais, confiante en sa Foi, elle refoulait en son cœur la douleur de la prochaine séparation. Son sourire ne dépassa pas ses lèvres pour nous annoncer :
– Le Père est réveillé ; il va bien et voudrait vous revoir !
Nous nous levâmes aussitôt et, ayant salué les amis de notre oncle, remontâmes l’escalier.
Hermance recueillait une autre bougie et guettait la chute prochaine de la mèche vacillante pour la remplacer dans le chandelier de cuivre rouge.
Bien calé dans une pile d’oreillers, les yeux dessinant deux taches d’ombre dans la blanche symphonie de son visage cireux entouré des flocons d’une barbe neigeuse sur la toile bleutée, l’oncle Louis sourit à notre entrée...
– Je vous ai laissé le temps de goûter au moins ? J’ai dû dormir un petit peu... comme si je n’allais pas en avoir bientôt tout le temps... Où en étais-je donc ?
– Vous veniez de nous conter vos fiançailles, mon Oncle.
– Ah oui, je m’en souviens. Mais avant de continuer, ouvrez-moi donc les volets tout grands. Hermance s’obstine toujours à les fermer – et j’aime la lumière, moi !
Ayant toussoté, le vieillard reprit :
– Après avoir reçu les compliments et les vœux des quatre anciens, le père Pierre nous convia à visiter avec lui l’abbaye : « Je vous invite tous à déjeuner à la maison ; vous n’allez pas obliger Lysiane à cuisiner elle-même son déjeuner de fiançailles, mon cher Évariste. J’ai moi aussi des choses à expliquer à ce jeune homme ; alors, à 11 heures chez moi ! » dit-il en nous poussant vers la porte.
Éberlué, M. de Chamou restait là, aux prises avec MM. Geoffroy et Eusèbe qui, ne semblant pas vouloir s’en aller, empêchaient le père de ma fiancée de nous suivre.
Nous fîmes dehors quelques pas en silence. J’avais à droite, à mon bras, ma fiancée, le père Pierre marchait à ma gauche.
– Maintenant, mon ami, dit ce dernier, je vais vous montrer notre abbaye ; elle n’est pas loin ni bien grande, mais cependant elle contient un monde.
Voyez, nous y sommes. Passez devant, mes enfants. Lysiane, ma petite, tu en expliqueras toi-même la beauté à ton fiancé... Vous devez avoir aussi des tas de choses à vous dire... Il faut que je prévienne chez moi pour le déjeuner – n’oubliez pas l’heure...
Et le brave homme, me frappant paternellement sur le bras, ajouta : Il fallait bien que je vous fasse évader, sinon comme je connais mon ami Évariste, vous n’auriez jamais pu passer une heure ensemble.
Le vieillard se recueillit un moment les yeux clos ; il souriait à quelque rêve heureux.
– Voyez-vous, mes enfants, dans toute ma longue vie, j’ai connu, comme chacun, des jours de bonheur ou de tristesse, voire des moments de désespérance, mais cette courte matinée passée avec ma toute nouvelle fiancée demeure encore vivante en moi comme un souvenir d’hier... une heure de paradis !
Ce fut Lysiane qui, la première, me tutoya :
– « Parle-moi de ta maman !... Je l’aimerai bien, tu sais, parce que je n’en ai pas, moi ! »
Telles furent ses premières paroles – les seules dont je me souvienne... car le temps passa vite parmi ces mille riens coupés de baisers que peuvent échanger deux amoureux..., qui, s’ignorant la veille, viennent de se jurer solennellement d’être l’un à l’autre « pour le meilleur et pour le pire » et ne savent ni quand ils se retrouveront, ni quand sera béni leur amour.
Peut-être Lysiane me fit-elle voir l’abbaye, le dolmen... ni l’un ni l’autre n’avons par la suite jamais eu à éclaircir ce mystère-là !
Il était près de quatre heures quand, ma nouvelle famille m’ayant quitté, je me retrouvai seul sur le plateau près de la Pierre aux Fées.
Je marchai jusque-là, montai même dessus pour revoir encore le sylvestre vallon où j’avais vécu cette inoubliable journée – mais, happé par le sol, Perrière avait disparu.
Dans mon esprit, c’est à peine si je pouvais reconstituer les éléments de mon incroyable aventure : l’antique abbaye bénédictine, ses étranges coutumes, ses desservants mystérieux, et ma blonde fiancée dont je portais sur ma poitrine, dans un sachet brodé d’une croix, une boucle de cheveux : seul témoignage qui me restât pour m’assurer que je n’avais pas rêvé.
Je mis plus de trois heures pour rejoindre le village et l’auberge où devait m’attendre M. Guéroult.
En vain tout ce temps avais-je tenté de mettre de l’ordre dans mes idées – de classer les enseignements que j’avais reçus, trier les paroles prononcées par les cénobites de ce couvent sans cloître, ouvert au Ciel de Dieu et cependant fermé. « Ne perdez jamais confiance, nous vous voyons, nous vous suivons, nous vous retrouverons », avaient-ils dit.
– « Et vous reviendrez ! » m’avait ajouté Lysiane.
De tout ce que j’avais entendu, c’était à peu près les seules paroles qui me fussent demeurées intactes dans l’esprit.
– Revenir, revenir, me répétais-je tout haut en marchant.
Je cherchais inutilement quelle fable j’allais conter à mon patron pour justifier l’affirmation que d’impraticables difficultés empêcheraient la construction d’une voie ferrée sur le trajet indiqué.
J’étais arrivé à la porte de l’auberge sans avoir trouvé encore une raison transcendante à exposer, quand je vis M. Guéroult converser encore avec les mêmes personnes que la veille.
– Ah, dit-il me montrant, voilà mon homme qui revient de son exploration... vous voudrez bien m’excuser, Messieurs, mais nous avons ensemble de graves questions à étudier.
Les visiteurs prirent congé, me regardant sans aménité aucune et, d’une tape, mon chef me poussa vers la table sur laquelle s’étalaient cartes et croquis.
– Alors, mon garçon, te voilà tout de même revenu de cette promenade !
– C’est-à-dire, Monsieur, que le terrain que j’ai parcouru sur le trajet que... est particulièrement difficile, coupé de failles nécessitant d’importants terrassements... des ouvrages d’art...
– Mais, je m’en fous ! répondit tranquillement mon patron.
Et comme éberlué je le regardais sans comprendre, il me posa les mains sur les épaules, me forçant à m’asseoir :
– Crois-tu donc, Louis, qu’il dépende de moi de faire passer la ligne ici ou là... Voyant que ces croquants n’émettaient des objections au passage du chemin de fer sur leurs terres que pour en exagérer le prix, je leur ai fait croire, en t’envoyant reconnaître un autre itinéraire, que nous abandonnions le projet primitif, et j’ai prévenu l’ingénieur en chef des difficultés rencontrées.
Ce soir les propriétaires affolés sont revenus pour repêcher la situation. Tu es arrivé au bon moment pour me permettre de les lanterner un peu. Demain arrivera M. Dunaud, l’ingénieur qui, à son tour, leur fera baisser leurs prétentions. Et voilà, conclut-il en voyant mon air abasourdi ! Maintenant, mon petit gars, tant pis pour toi si tu as acheté du terrain ou fait quelque conquête par ici. Nous partons dans deux jours et ne reviendrons plus !
CHAPITRE VIII
LA PREMIÈRE ÉPREUVE
– Deux mois s’étaient écoulés depuis ces évènements, reprit l’Oncle Louis, soixante longues journées apportant chacune un nouvel espoir et chacune emportant le soir une désillusion nouvelle avec le lot de soucis, de petits ennuis, de menues joies assaisonnant le travail quotidien.
J’avais passé les premiers jours comme en un rêve, me remémorant tous les visages, tous les gestes vus, toutes les paroles entendues en ce mystérieux village. Puis j’avais connu le doute de moi-même, de la réalité de mes souvenirs, et enfin la torture d’une attente anxieuse de nouvelles, attente trompée chaque jour, chaque jour avivée d’un espoir renaissant.
Ce qu’il y avait de cruel pour moi, c’était d’ignorer comment, et par qui, me viendraient ces nouvelles tant espérées de mon amour.
Par la poste ? C’était peu probable.
Par quelque messager ? Oui, mais lequel ?
Serait-ce ce paysan qui s’avançait vers moi ? Cet inconnu qui entrait à l’auberge et me regardait en mangeant ?
Mais le facteur n’avait rien apporté, le paysan était passé, et le voyageur reparti sans me remettre le moindre billet.
Je me rongeais littéralement, ne m’intéressant plus à mon travail. M. Guéroult me reprocha d’abord mes étourderies, puis s’inquiéta de mes absences mentales, de mon attitude renfermée, et tenta de me confesser.
Or, malgré tout mon désir de parler à quelqu’un de ma petite fiancée, de prononcer son nom, j’étais contraint de me taire, lié par un serment qui englobait avec Perrière le mystère de tous ses habitants.
C’était là, je m’en suis bien rendu compte depuis lors, ce qui me fut le plus dur en cette épreuve.
Par deux fois notre équipe s’était transportée plus à l’Ouest. Nous opérions maintenant entre Épernon et Chartres. De l’aube à la nuit, quand il faisait beau, nous arpentions la campagne au sens le plus strict du mot, car notre chef exigeait un travail intensif pour les opérations extérieures, réservant autant que possible les jours de pluie pour la mise au point des croquis.
Je me tourmentais de plus en plus du silence de Lysiane, car, sans douter d’elle, je me demandais comment pourraient me parvenir de ses nouvelles puisque je n’avais pas d’adresse fixe et n’avais pu donner aux ermites de Perrière que l’adresse de mes parents et celle du bureau de M. Guéroult, à Paris.
Or, ce samedi 24 Juin (1843), notre patron fit arrêter le travail plus tôt que d’habitude. Il faisait une lourde chaleur déprimante.
– « Ça suffit pour aujourd’hui, déclara-t-il. On danse ce soir au village aux feux de la St-Jean ; je ne veux pas que mes hommes soient trop aplatis. Que diraient les filles du pays si les Parisiens manquaient à les faire danser ?... On rentre... et toi, gamin, ajouta-t-il en me bourrant, je veux te voir gambiller cette nuit et sauter par-dessus le bûcher une petite dans les bras ; ça te changera les idées – poète ! » ce qui était de la part de cet homme robuste et bon vivant l’expression d’un profond mépris. N’oubliez pas que la mode à cette époque était de jouer au sentimental mélancolique, à l’imitation des poètes du siècle.
Avec mes collègues, tous plus âgés que moi, je rentrai donc à l’auberge, heureux malgré tout de cette journée de travail écourtée, et fis toilette pour la fête du soir.
Après tout, si j’avais promis mon amour à Lysiane, personne ne m’avait imposé de ne danser ni de rire avec d’autres, elle absente.
Je ne me suis jamais embarrassé de casuistique, laquelle ne saurait à mon sens émaner d’un esprit de chez nous. Je jugeai cependant plus convenable en l’occurrence d’aller inviter la fille du forgeron-quincaillier-serrurier du village, et rebouteux par surcroît, que je savais fiancée à un garçon faisant pour l’heure son service militaire.
– Puisque vous n’avez pas votre cavalier ce soir, mademoiselle Hélène, voulez-vous me permettre de vous conduire à l’assemblée ? dis-je à la jeune fille en jugeant extrêmement diplomatique cette façon d’offrir mes services en manière de remplaçant provisoire, en ménageant sa susceptibilité.
La jeune fille me regarda, apprécia sans doute la pureté de mes intentions.
– « Je veux bien, dit-elle sans se faire prier autrement, mais je dois vous prévenir, vous qui n’êtes pas d’ici : ce n’est pas au bal qui a lieu autour du bûcher allumé sur la place que je veux aller. Selon nos vieilles coutumes, nous allumons un grand feu sur la colline, un feu qui se voit à sept lieues à la ronde. C’est mon père qui installe le bûcher avec les bois qu’il faut. Vous verrez la belle flamme haute, qui n’enfume pas !
– C’est entendu, Mademoiselle Hélène. Avec votre permission, je viendrai vous prendre après souper.
Le forgeron pénétrait sur ses entrefaites dans le magasin. Nous nous connaissions un peu ; il me serra la main.
– Père, dit la jeune fille, Monsieur Louis m’a demandé à venir ce soir avec nous à la Flambée. J’ai accepté.
L’artisan du feu me considéra de haut en bas. Ai-je dit que c’était un colosse ? – et abattit sa main sur mon épaule qu’il serra.
– Tu me plais, mon gars, si tu veux être de chez nous, viens avec moi, m’aider à dresser le tas de bois. C’est l’usage que tous les garçons apportent eux-mêmes leur bûche. Tu souperas là-haut avec nous – après la danse... C’est vrai, tu ne sais pas, toi !
Voyant mon geste d’excuse : « Mais on ne mange pas ce soir avant d’avoir allumé le feu au coucher du soleil. En somme, ajouta-t-il, c’est comme pour la communion à la messe de minuit ; mais le curé ne viendra pas jeter de l’eau bénite sur notre Feu, à nous ! »
J’accompagnai donc le forgeron vers la colline où, déjà réunis, une douzaine d’hommes s’affairaient à trier les bûches pour en former quelques piles, chacune d’essence variée, me sembla-t-il. Je reconnaissais le bouleau clair, le hêtre au tronc net, le chêne rugueux et des fagots de bois sec composés comme des bouquets avec des bois de tons différents et mélangés de branches de sapin pour activer la combustion.
– « Ah, voilà maître Thibaud qui nous amène un compagnon » cria l’un des bûcherons nous voyant déboucher du raidillon bordé de taillis et de fourrés qui escaladaient le sommet chauve de cette butte.
– « Bonsoir à tous », répondit-il les bras levés faisant le geste de serrer toutes les mains. Et, en guise de présentation, il ajouta : « Ce garçon-là est un de ceux qui sont venus pour les chemins de fer. Il s’appelle Louis ; c’est un bon homme ! »
Puis, sans autre explication, Maître Thibaud, faisant face au Soleil, du bout de sa canne ferrée et tournant sur lui-même, traça sur le sol un cercle qu’il coupa d’une croix dont les branches indiquaient ainsi les quatre points cardinaux. Sans qu’il fût besoin d’autres indications, chacun apporta les rondins préparés que le forgeron empilait en forme de tour pyramidale dont chaque angle correspondait à l’un des bras de la croix.
– « Tu vas m’aider, Louis », me dit-il, « tu me passeras les bois. »
Comme j’empoignais au hasard la première bûche venue, il me réprimanda : « Sacré Parisien, tu n’y connais rien ; le chêne d’abord, maintenant du frêne. Pas celle-là, c’est du noyer. Maintenant, passe-moi du hêtre... du bouleau... de l’orme... mais non, ça c’est du charme – le frère du chêne... »
Rapidement la tour s’élevait à claire-voie, puisque deux billes seulement formaient chaque assise. Bientôt l’homme en eut jusqu’aux épaules. S’élevant d’un rétablissement, il se fit passer des fagots qu’il disposa à l’intérieur de la construction dont l’achèvement se poursuivit jusqu’au 21e rang. L’ensemble formait ce curieux aspect : celui d’une tour dont le corps s’effilait vers le haut jusqu’à ne plus y atteindre que deux pieds de large, tandis que les angles se hérissaient de la longueur des bûches demeurées en porte-à-faux.
Une cinquantaine de personnes étaient maintenant assemblées sur le tertre, aux lueurs du soleil couchant. Toutes avaient apporté des paniers d’où on voyait miches dorées et goulots cachetés soulever la serviette qui les recouvrait.
Les rouges, les violets, les oranges d’un ciel nuageux magnifiquement éclairé par l’Astre du Jour chatoyaient dans l’immensité d’un ciel émouvant. Hélène était venue retrouver son père. Elle aussi portait un panier au bras.
Le constructeur de cet étrange bûcher contemplait son œuvre se profiler à contre-jour dans l’axe même du Soleil couchant. Les rayons, filtrant au travers des branches qui en dépassaient les angles, accrochaient sur ces bois d’essences diverses des paillettes de lumière et sur le sol dessinaient, de part et d’autre de l’ombre grandissante, d’imprévues figures géométriques. Maître Thibaud semblait y lire comme en un livre car ses lèvres remuaient en les regardant.
Derrière lui, ouvriers et assistants demeuraient silencieux.
Déjà le bord du disque flamboyant approchait de l’horizon. Dans le silence du soir monta tout à coup la clameur des villageois qui en bas venaient d’allumer le feu de la Saint-Jean.
Ici, le Soleil rejoignait la Terre dans la rougeoyante lumière d’un ciel empanaché de nuages dorés.
– C’est beau, dis-je, impressionné, serrant le bras d’Hélène.
– Il va pleuvoir, me répondit-elle, et, comme je ne pouvais dissimuler un mouvement d’impatience, elle ajouta :
– Il y aura sept orages qui causeront de gros dégâts !
Maître Thibaud pendant ce temps avait battu le briquet et enflammé une mèche d’étoupe et de résine.
Seul, il s’avança vers le bûcher, glissa cette torche à l’intérieur ; puis, de sa main aux deux premiers doigts levés, il traça dans l’air le signe que j’avais déjà vu exécuter deux mois plus tôt à Perrière.
Derrière lui les enfants, puis les jeunes filles, puis tous, vinrent attiser le Feu qui éclatait dans cette tour de bois et dont les premières volutes de fumée montaient dans le ciel pâli d’où le Flambeau divin avait disparu.
Sitôt après avoir soufflé, communié ainsi avec le pur élément qui déjà léchait de ses langues rouges les aliments offerts à sa voracité, chacun se relevait, allait prendre la main de celui ou de celle qui l’avait précédé, et, suivant le violoneux jouant un air grave, commençait la ronde dont le forgeron noua de ses mains les deux extrémités.
Lentement d’abord, la chaîne humaine tournait autour du bûcher. Puis, comme dans tout l’intérieur crépitaient les flammes, enragées, le mouvement s’accéléra et, des poitrines des danseurs, un chant s’éleva...
– Seulement, voilà, je ne me rappelle plus les paroles, ajouta mon oncle, vous pensez, mes enfants, depuis le temps...
– C’est vraiment dommage, déplora Lucienne, ce devait être beau ! Je croyais voir la cérémonie que vous décrivez !
– Oh, vous savez, les paroles de nos vieilles chansons sont toujours assez simples : c’était quelque chose comme :
« Feu de bois, Feu de Roi
« Tu es le même sous chaque toit
« En tous lieux
« Feu de Dieu,
« Feu de Dieu, Feu des Cieux
« Allumé en ce lieu. »
En peu de temps l’incendie allumé par l’intérieur de cette tour de bois l’avait embrasée tout entière. C’était maintenant une immense torche verticale qui crépitait et flambait dans la nuit opaque, sans que la fumée se rabattît sur les danseurs.
La chaleur devenait trop intense pour continuer la ronde autour de ce brasier. Le père Thibaud rompit la chaîne des mains, qu’il avait naguère fermée.
Puis chacun s’égayant, les paniers livrèrent leur mystère aux appétits déchaînés.
Invité par la famille Thibaud, je leur avais roulé deux billes de bois pour servir de sièges. Assis entre sa femme et sa fille, je me voyais comblé de plus de jambon, de pâté, de poulet que je n’en pouvais manger pour tenir tête à ce terrible forgeron, qui me forçait de surcroît à lui rendre raison chaque fois qu’il buvait.
Une grosse goutte étoila soudain la nappe blanche où reposait encore dans toute sa gloire intacte une magnifique tarte... une seconde chut dans mon verre avec un léger floc comme une grenouille sautant dans une mare.
Comme, surpris, nous levions la tête, un lointain grondement annonça l’orage imminent.
Maître Thibaud se leva aussitôt, frappa dans ses mains en criant : « Debout, mes amis ; il va pleuvoir, et nous ne pouvons partir avant la Danse ! »
En hâte, les reliefs du festin furent ramassés dans les paniers et ceux-ci abrités tant bien que mal. Le bal commença : danses anciennes, paysannes, tenant plus de la promenade que du tourbillon de vos danses modernes.
Précédés du violoneux, les couples, jeunes ou vieux, tournaient autour du bûcher étincelant, se saluaient, tapaient du pied, se frappaient dans les mains, ou faisaient exécuter sur place avec de grands rires quelques voltes à leurs danseuses.
Guidé par Hélène plutôt que je ne la conduisais moi-même puisque je ne connaissais point ces danses, je suivais le mouvement tant bien que mal.
L’orage se rapprochait, et comme pour obéir à un coup de tonnerre plus violent, la tour de bois s’écroulait d’une seule pièce dans une gerbe d’étincelles, soulignée par le fracas du tonnerre et l’éblouissement d’un éclair.
Les danseurs accueillirent cette étincelante débauche de feu. Les cris d’admiration des hommes, de frayeur des femmes saluaient cet effrayant mariage du feu allumé par les hommes avec l’explosion formidable accompagnant le Feu du Ciel tombant sur la Terre.
Une pluie diluvienne accompagna ces gerbes de feu. Un nuage de vapeur couronnait le brasier ardent au milieu duquel était tombé tout l’échafaudage en flammes. Lutte prodigieuse de l’Eau et du Feu devant laquelle je demeurais pensif sans me soucier des cataractes qui m’inondaient. Ne pouvant fuir sous l’averse que pour se réfugier sous les arbres – abri dangereux pendant l’orage – les assistants, se resserrant autour du Feu, avaient reformé une ronde, et, rôtis par devant, trempés par derrière, nous avons, dans un nuage de fumée, de vapeur, comme des dieux, dansé dans le fracas du tonnerre et la lumière des éclairs, jusqu’à ce qu’ensemble l’orage s’éloignât et le bûcher fût près de s’éteindre.
Alors, à la suite du Forgeron, véritable prêtre de cette fête du Feu, les garçons sautèrent par-dessus les dernières flammes, les fiancés aidant leur promise à passer le tas de bois rougeoyant, peut-être pour faire passer cette épreuve à leur amour.
La tempête céleste s’éloignait. Les plus vieux, ceux qui n’avait pas sauté, cherchaient dans les cendres les extrémités des bûches éteintes et non calcinées, pour les emporter en leurs foyers.
Hélène passa son bras sous le mien : « Rentrons maintenant. Vous prendrez quelque chose de chaud à la maison, en vous séchant. Vous êtes trempé ! »
– Mais vous-même ?
– Moi ? dit-elle en riant ; mais je me séchais au Feu au lieu de rester comme vous à le regarder.
Courant sous la pluie qui reprenait, nous arrivâmes au village.
Malgré les vêtements secs qui me furent prêtés, l’alcool brûlant que m’administra Madame Thibaud, je frissonnais et claquais des dents.
– Voyons, mon gars ! me dit le Forgeron, tu ne voudrais tout de même pas tomber malade pour une fois que tu sors avec nous !... Que diraient les amis qui m’ont parlé de toi ?
– Tu ne le sais pas... que tu as des amis dans le pays... là-bas chez les anciens... à Perrière !
Sidéré, malgré la fièvre qui déjà m’agitait, je réagis aussitôt.
– Vous avez des nouvelles... pour moi... de Perrière ?
– Mais oui – c’est le Grand-père lui-même qui m’a fait dire de t’emmener avec nous... Il paraît qu’on t’aime bien là-bas...
– On ne vous a rien... remis pour moi... pas une lettre ?
– Non !
Que se passa-t-il alors, je l’ignore encore aujourd’hui. Il me sembla entendre, dans un bruit de cloches, tourbillonner dans les flammes des visages de femmes : Lysiane, Hélène, la mère Thibaud, maman, puis je me suis senti bousculé – fourré en berline. Je perçus enfin la présence de M. Guéroult près de moi, et me réveillai en somme huit jours après, dans ma chambre, à Châteaudun, pour voir, en tournant la tête, assise près de mon lit et cousant...
Lysiane !, enfin Mlle de Chamou ! ?
Mais non, maman !
Les Thibaud, inquiets de la fièvre qui montait, montait, et déjà m’avait fait perdre connaissance, avaient d’urgence prévenu M. Guéroult qui estima que, gratifié en cette saison d’une pneumonie probable, il était préférable de me faire transporter à Chartres afin d’y être soigné. Le conducteur d’une berline qui venait de s’arrêter chez le maréchal allait justement à Châteaudun ; il voulut bien me prendre dans sa voiture avec mon patron qui tint lui-même à m’accompagner chez mes parents.
– Gentil de sa part !
– Oh, vous savez, c’était fréquent à mon époque. Le patron était souvent un père – sévère – mais gardant, soignant à son foyer l’employé malade comme il le nourrissait à sa table !
En tournant un peu la tête, je regardais ma mère penchant sur son ouvrage sa tête coiffée d’un bonnet tuyauté d’où s’échappaient deux boucles châtain clair. J’essayai de reconstituer en ma mémoire confuse les évènements de ces deux mois : Perrière, Lysiane, la forêt magique, l’abbaye secrète, puis nos déplacements, le feu de la Saint-Jean. Je revoyais les bons visages de Maître Thibaud, de sa femme, d’Hélène, l’orage. Je n’arrivais pas à me représenter comment j’avais pu venir ici... chez mes parents...
Maman cousait toujours sans s’apercevoir que j’étais réveillé... cela m’agaçait... Du reste, étais-je réveillé ?... n’était-ce pas toujours mon rêve qui continuait ?
Je voulus soulever la tête – cela me fit mal. Parler... – Je m’aperçus que ma langue était râpeuse – et tout ce que je sus dire – on me taquina souvent depuis – fut : « Maman ! à boire !... »
Je ne vous ennuierai pas à vous raconter ces instants-là. Mais cela ne t’empêche pas, mon neveu, de répondre à la demande que j’adressais à ma mère... c’est ça... J’ai soif depuis le temps que je vous parle ! Merci !
Remonté avec notre aide sur ses oreillers, l’oncle Louis huma son verre de son grand nez, le sécha à petit coups sans reprendre la parole, puis, tranquillement, continua son récit...
Considéré hors de danger, gâté par mon père, médecin lui-même, comme vous savez, qui m’apportait des livres, cajolé par ma mère, je n’en reprenais pourtant pas mon caractère naturellement gai. Sans la distraction forcée d’un travail obligatoire, mon esprit s’évadait vers les grands chênes sous lesquels m’était apparue ma petite fée blonde. De longs jours encore s’étaient écoulés sans que j’en eusse obtenu de nouvelles... On savait pourtant ce que je devenais... là-bas, à Perrière, puisque le Grand-Père lui-même avait daigné me faire recommander à Maître Thibaud... mais par qui ?
Le moindre mot de Lysiane eût mieux valu pour ma guérison que toutes les chatteries de ma chère maman... que les recommandations de ces vieux hiboux des bois... Bref, bien que guéri de ma pneumonie, je ne reprenais pas de couleurs, n’avais goût à rien. Je me rongeais... Et, comme un soir, assis sur mon lit, je demeurais les yeux perdus dans l’espace, ma mère me prit par le cou, attira mon visage contre le sien, et me dit ces simples mots : « Puisque tu l’aimes tant, parle-moi d’elle ! Comment s’appelle-t-elle ? »
Que Dieu me pardonne si j’ai ce jour-là failli à mon serment de silence, mais j’éclatai en sanglots, et tout ce que je vous ai dit – tout ce que j’avais cru sceller à jamais au fond de mon cœur, je le dis ce soir-là à maman, puisqu’elle avait deviné à moitié mon secret.
Nous aussi étions émus d’entendre un vieillard de 120 ans, près de mourir, dire maman, s’excuser encore de lui avoir confié son amour secret. Ma femme regardait obstinément ses souliers : je me mouchai. L’oncle n’y prit garde. Il continua :
– Attends donc, me dit-elle, on a apporté ce matin une enveloppe pour toi. Ton père n’a pas voulu qu’elle te fût remise encore, craignant un ennui pour ta santé...
– Comment, une enveloppe !... et tu ne me l’as pas donnée !
Déjà ma mère était sortie et revenait avec un large pli cacheté à en-tête de la Cie de l’Ouest : Ah ! fis-je, déçu.
J’ouvris cependant, faisant sauter les cachets.
Cette lettre m’informait que j’étais admis à suivre les cours de l’École des Ponts et Chaussées avec une bourse d’études offerte par la Compagnie.
Jamais je n’avais adressé semblable demande et considérais avec étonnement cette lettre que mon père avait prise pour un ordre de rappel ! Je ne comprenais pas !
« On dirait que tu n’es pas encore content ! » s’écria ma mère qui lisait par-dessus mon épaule.
– Si !... mais tu comprends, maman... j’avais pensé...
– Regarde donc quelle drôle de signature il a, ce Monsieur... trois bâtons comme paraphes...
– C’est vrai, dis-je intéressé, reconnaissant le signe des initiés à la Religion celtique... Trois rayons, dont le père Eusèbe m’avait expliqué le sens.
– Maman, on pense à moi là-bas... ce sont eux...
« Et ça, mon petit... ce doit être Elle !... » ajouta ma mère en détachant une petite feuille pliée en quatre, collée au dos de la lettre officielle par un pain à cacheter.
« Je ne cesse de penser à vous.
Ayez confiance Louis ; à bientôt, je l’espère. Je vous aime.
Lysiane »
Huit jours après, plein de force et de joie, je repartis pour Paris.
CHAPITRE IX
Pendant les deux ans que durèrent mes études à l’École des Ponts, je n’eus que bien rarement des nouvelles de ma fiancée, transmises par mon professeur de géologie qui voulut bien m’accorder gracieusement ses précieuses leçons.
Cet homme dans ses cours publics ne s’écartait en rien de l’enseignement officiel de l’époque. Celui-ci, entre nous soit dit, bien que basé sur d’autres théories que celui prôné aujourd’hui, n’émettait pas moins ses aphorismes infaillibles. – Mais mon professeur n’hésitait pas à battre en brèche les données du cours qu’il professait publiquement pour m’initier aux lois inconnues qui régissent la vie de la planète, considérée comme un être vivant.
Lorsque je m’en étonnais, il répondait simplement : « On a toujours tort d’avoir raison contre son temps ! Celui qui s’y risque ne sera jamais que la voix clamant dans le désert. » Peut-être dans un siècle ou deux lui élèvera-t-on des statues ; mais s’il a charge de famille, il aura rendu les siens malheureux ! Ma science, celle qui, dans les siècles passés, n’était transmise qu’à un tout petit nombre d’initiés de valeur morale éprouvée, ne peut être confiée à tous ; pas plus qu’on a le droit de laisser la clef sur la porte de l’armoire aux poisons. Je t’en livre quelques-uns des secrets, mon cher Louis, mais songe donc quels cataclysmes déclencherait la folie des hommes si le mystère des ondes telluriques leur était dévoilé ? »
Je me permis d’interrompre mon oncle :
– Savez-vous qu’actuellement on peut, grâce aux ondes hertziennes, diriger des avions sans pilote, et que l’on parle de leur faire propulser des fusées dans l’atmosphère !
– C’est possible... mais ne parlant que de géologie, nous voulions exprimer le risque beaucoup plus grave que courrait l’humanité si quelque apprenti sorcier s’avisait d’agir sur le système circulatoire ou nerveux de la Terre – en somme analogue au nôtre.
– Que s’ensuivrait-il ?
L’oncle Louis me considéra avec quelque pitié :
– Des volcans pourraient surgir, amener une nouvelle répartition géographique des terres et des mers, telle qu’il y en eut dans les millénaires passés, causer l’effondrement d’un continent tout entier, comme ont disparu jadis le Gondwana et l’Atlantide.
Supposez que, pour anéantir un pays comme l’Allemagne aujourd’hui, l’on ressuscite les cratères de la Bohème et de la chaîne Hercynienne. Toute l’Europe du Nord, de la Mer Blanche à l’Irlande, s’anéantiraient sous les flots ! tandis que remonterait la Méditerranée. Le Gulf Stream, chassé par un contre-courant, retournerait vers le Groenland, dont il n’a pas il y a longtemps abandonné les rivages, puisqu’on se souvient, dans les légendes nordiques, de l’ancien pays vert et du Vinland ou Terre de la Vigne au Labrador !
– L’homme peut donc causer de telles perturbations géographiques ? questionna Lucienne.
Le vieillard hésita un moment avant de répondre.
– Oui, dit-il, les Égyptiens l’ont fait en connaissance de cause – mais cette digression nous amène beaucoup trop loin de mon histoire, et n’oubliez pas que le temps m’est compté !
Bref, je ne vis en ces deux ans ma fiancée que trois fois. À deux reprises je fus admis à venir aux vacances passer une quinzaine à Perrière. Une fois, au printemps 1844, M. de Chamou vint avec sa fille pousser une pointe audacieuse à Paris, où ils descendirent chez des parents, dans le quartier des Batignolles alors excentrique et fort éloigné de celui des Écoles où je logeais nécessairement. Comme il n’était pas admis alors qu’une jeune fille sortît seule – encore moins avec un jeune homme – je ne vis guère Lysiane hors de la présence d’une tierce personne.
Ayant rendu visite à mon maître en compagnie de ma fiancée et de son père, celui-ci parut satisfait de me savoir bien noté, et nous emmena au théâtre Français où je constatai à ma grande surprise qu’il rencontra des relations pendant l’entracte. Les derniers soirs il nous conduisit, Lysiane et moi, chez diverses personnes appartenant toutes aux milieux bonapartistes.
Ce fut pendant ces quelques jours qu’il me présenta à un certain Moquard qui passait pour le représentant officieux du prétendant malheureux enfermé depuis quatre ans au fort de Ham.
Je n’avais jusque-là jamais eu d’opinions politiques bien déterminées, contrairement à la plupart de mes camarades, tous férus de tel ou tel personnage, ou de tel ou tel régime, comme on peut l’être à vingt ans.
Tout de suite je compris qu’il me faudrait désormais batailler en faveur du neveu de Napoléon si je voulais entrer dans les bonnes grâces de M. de Chamou.
Il m’en coûtait peu : mon père, ancien médecin de la Grande Armée, avait conservé le culte de l’Empereur, dont il ne parlait qu’avec vénération.
Lorsque je le dis à mon futur beau-père, je vis celui-ci me sourire pour la première fois : « Je suis heureux, Louis, que vous partagiez mes convictions. Les rois nous ont reniés en perdant leur sang français par des mariages étrangers. La dynastie Bonaparte relèvera la France et par cela refera l’Empire Celte. Le prince Louis Napoléon sera notre homme.
– Oui, mais ses tentatives de Strasbourg et de Boulogne ont échoué et, condamné à la prison perpétuelle, il est actuellement enfermé au fort de Ham !
– Il en sortira, ceindra la couronne impériale. Cela je l’ai lu, je le sais ! et vous m’aiderez, Louis, pour qu’il nous écoute et qu’il ne lui arrive pas... comme à l’Autre !
– Je veux bien », dis-je.
Lysiane alors me prit les mains et, me regardant dans les yeux comme pour me communiquer sa foi profonde :
– Vous le voudrez ! Si ce n’est pour Lui et pour notre Foi ce sera par amour !
– Je vous le promets, Lysiane.
Et, cette fois, en présence de son père, ma fiancée me tendit ses lèvres pour recevoir mon serment.
Ce fut donc en Mai 1844 qu’emmené par M. de Chamou dans l’un de ces salons où l’élite bonapartiste conspirait en faveur du prisonnier que j’eus pour la première fois la révélation des facultés extraordinaires de sa fille.
Quelqu’un s’étant permis d’élever un doute sur les possibilités du prince, M. de Chamou interrompit sèchement le tiède partisan : « Il ne saurait y avoir d’incertitude, Monsieur. La destinée du prince est écrite là-haut et son étoile, comme celle de l’Empereur, nous ramènera les aigles sur les hampes de nos drapeaux. »
– « Je le souhaite comme vous, Monsieur, mais votre affirmation n’ajoute aucune certitude à notre anxiété. Le prince est prisonnier, et nous-mêmes sommes surveillés par la police royale. Quant au Destin, il est peut-être écrit là-haut, mais hors de portée de nos yeux ! »
– « Le croyez-vous bien ? »
Et comme son interlocuteur le considérait avec un sourire, le père de Lysiane s’échauffant raconta l’histoire du prieur de Lagny que je vous ai rapportée, cita les exemples, et assura :
« Cette fois, instruit par l’expérience de son oncle, le Prince, averti par nos soins des embûches qui se dressent devant lui, saura les éviter et mieux asseoir la Dynastie que fonda Napoléon. »
– « Je le souhaite, Monsieur, mais encore faudrait-il que son Altesse fût informée qu’il existe parmi ses amis des personnes capables de l’éclairer, comme le fit dom Guyon pour l’Empereur... et le Révérend père est mort... C’est à cela que sont dus sans doute les pénibles échecs qu’a subis le prince Louis ! »
– « S’en est-il inquiété ? riposta mon futur beau-père, sans paraître remarquer l’ironie du propos ! Or, voulez-vous que ma fille qui, bien que fort jeune, témoigne de remarquables dons de divination, tire pour nous les présages qui ressortiront des évènements ? »
Au bruit de la discussion d’un ton plus élevé que ne le sont les habituelles controverses de salon, les conversations s’étaient arrêtées, et chacun suivait d’un air plus ou moins sérieux le duel rapide des répliques, l’anecdote du bénédictin conseiller du Premier Consul, puis de l’Empereur, se demandant où menait cette histoire.
« Voyons, monsieur, voulez-vous nous énoncer les derniers évènements qui ont marqué la vie de Monseigneur le prince Louis ? – Tiens, Lysiane, ajouta-t-il en tirant de ses poches un carnet et un crayon, veux-tu prendre note de ce que dira Monsieur ? »
En fille bien élevée, ma fiancée, fort ennuyée d’être ainsi mise à l’improviste sur la sellette, s’empara des deux objets et s’assit à un guéridon, en face de moi :
« Nous vous écoutons, Monsieur ? »
« Que voulez-vous que je vous dise ? je ne comprends pas le moins du monde où vous voulez en venir ? »
« À ceci que, du simple énoncé succinct et complet d’un fait, d’un nom, ressort, par le jeu mystérieux des transpositions de lettres, une phrase relatant les conséquences de l’évènement dans le temps et l’espace – ainsi que le fit le vieux prieur de Lagny. »
Un mouvement de curiosité sceptique anima l’assemblée, dont les regards se portaient tour à tour sur les deux hommes et sur Lysiane, qui allait en somme subir à elle seule la rude épreuve imprudemment exigée par son père.
« J’ai compris, répondit M. X... qui dicta : Le trente octobre mil huit cent trente-six à Strasbourg, le prince Louis Charles Napoléon Bonaparte tente une révolution contre Louis-Philippe premier, roi des Français ! »
« C’est parfait ! Attendez-donc la réponse du sort. »
Quelques instants Lysiane considéra le texte qu’elle venait d’écrire. Toutes les conversations s’étaient tues, vingt paires d’yeux braqués sur elle ne paraissaient pas troubler cette fille, pourtant élevée dans la solitude d’un village ignoré.
S’étant recueillie, elle biffa quelques lettres, écrivit des mots, ratura d’autres lettres, reprenant sans cesse la phrase à son début pour en extraire quelques mots nouveaux, tant et si bien qu’une sentence nouvelle en sortit, au bas de laquelle elle ajouta six lettres, demeurées inemployées.
Sans mot dire, elle tendit le carnet à son père – qui lut à haute voix :
« TENTATIVE INUTILE CONTRE LE ROI LOUIS PHILIPPE, ELLE ÉCHOUE TÔT, LE PRINCE NAPOLÉON LOUIS, EMPRISONNÉ, CHAGRIN, SORT FRANC ET SERA TRANSPORTÉ AUX ÉTATS-UNIS. »
Un murmure d’étonnement jaillit de toutes les lèvres. Avec admiration les femmes surtout considéraient Lysiane qui, la tête reposant dans la main gauche, semblait poursuivre encore son mystérieux travail.
« Et voilà les 141 lettres de votre énoncé : vous pouvez le vérifier, 135 ont formé la réponse, quant aux six autres, les lettres B. R. B. O. R. T., ma fille va vous en donner le sens.
« BIENTÔT REVENU, BIENTÔT OUBLIÉ, RETOUR TRAHI ! » traduisit-elle comme parlant à elle-même !
« Voulez-vous continuer l’expérience ? »
Abasourdi, M. de... balbutia :
« ... Si cela ne doit pas trop fatiguer Mademoiselle ? »
« Pas encore ! fit Lysiane en souriant. »
« Avec votre permission, je continue donc. »
« LE SIX AOÛT MIL HUIT CENT QUARANTE À BOULOGNE SUR MER, LE PRINCE LOUIS CHARLES NAPOLÉON BONAPARTE TENTE UNE RÉVOLUTION CONTRE LOUIS PHILIPPE PREMIER, ROI DES FRANÇAIS. »
Déjà les yeux de ma fiancée erraient sur la phrase énonçant le fait historique, tandis qu’un cercle de curieux observait la répétition du précédent exercice.
Nerveusement, elle biffa de son crayon quelques lettres, parut s’absorber en la contemplation de certains mots clefs, et brusquement, comme inspirée par le sens dévoilé de la phrase qu’elle avait sous les yeux, Lysiane écrivit :
« ESSAI RATÉ À BOULOGNE CONTRE LE ROI MET LE PRINCE EN PRISON POUR SIX ANS. RÉVOLUTION MIL HUIT CENT QUARANTE HUIT, NAPOLÉON ÉLU, LOUIS PHILIPPE SORT DE FRANCE AMER. »
Sans se soucier du brouhaha des exclamations stupéfaites de l’assistance, M. de Chamou s’était penché sur l’épaule de sa fille, notait dans l’ordre où elles apparaissaient les 9 lettres inemployées, les considérant en silence.
« Merveilleux, mon cher, jubila Mocquard. Je ne sais encore trop ce qu’il faut penser de ces prédictions, mais elles donnent un nouvel espoir aux partisans du Prince... même aux plus inquiets, ajouta-t-il en lorgnant vers le responsable de cette expérience. »
« Bien plus encore que vous ne pouvez le penser, Monsieur, prononça mon terrible beau-père, car savez-vous ce que signifient les lettres inemployées dans cette sentence du Destin lue par la fille : A. R. L. U. C. A. E. B. R. T. E. »
« Ma foi, cela ne me dit rien du tout. »
« Eh bien, moi je lis cette promesse magnifique :
« À RÉPUBLIQUE LIBRE, UN CHOIX A ÉLU BONAPARTE REVENU TRIOMPHANT EMPEREUR. »
« Ce fut alors du délire parmi ces bonapartistes acharnés. Lysiane fut félicitée, embrassée, promise aux plus hautes dignités de la future cour impériale – et moi, faut-il vous l’avouer, je n’en étais pas très content. Mais pouvais-je le manifester dans la joie générale ? »
Les premiers transports passés, notre pessimiste, qui ne désarmait pas pour autant, observa :
« Tout cela est fort beau et je prie le Ciel qu’il sanctionne les encourageantes prophéties de Mademoiselle, mais si chacun se dépense pour faire sortir de Ham son Altesse Impériale, qu’adviendra-t-il de ses amis emprisonnés ? Mon ami le docteur Conneau, condamné aussi après l’échec de Boulogne, sera-t-il délivré ou subira-t-il une aggravation de sa peine ? »
« Énoncez les noms et titres de la personne dont vous voulez parler ? interrogea Lysiane. Peut-être cela nous révélera-t-il quelque chose ? »
« HENRI CONNEAU, DOCTEUR MÉDECIN, ANCIEN SECRÉTAIRE DE LOUIS BONAPARTE, ROI DE HOLLANDE. »
Rapidement Lysiane écrivit ces mots sur le carnet, et – les ayant à peine considérés – traduisit :
« AIDERA LOUIS NAPOLÉON CERNÉ ET BIEN DÉCIDÉ À SORTIR DE HAM ET À DEVENIR COURONNÉ. »
« Cette fois, Mademoiselle, je m’avoue battu. Trois oracles concordants sur trois phrases banales, c’est plus qu’une coïncidence... c’est... »
« Il reste 5 lettres H. C. L. N. C. ; Louis, voulez-vous traduire vous-même cette fois ? »
– « Moi, m’écriai-je, mais jamais je... »
– « Regardez, voulez-vous... pour me faire plaisir... Il le faut », ajouta tout bas ma fiancée en me prenant la main...
– Alors, mes enfants, j’ai regardé, ces 5 lettres H. C. L. N. C. Il me semble les voir encore devant mes yeux... grossir, tourbillonner s’écartant l’une de l’autre pour ouvrir le passage à des mots que je lus réellement :
« HEURE CHOISIE LIBÉRERA NAPOLÉON CAPTIF. »
« C’est bien, Louis, je suis content de toi ! » prononça la voix grave de M. de Chamou dont la main s’appesantit sur mon épaule.
Chacun prétendit alors obtenir de ma fiancée un oracle personnel. Assaillie de questions, de promesses, la pauvre petite ne savait comment se dépêtrer de ces curieux. Mais son père, prétextant de la fatigue cérébrale extrême que donnait ce travail, prit congé et nous emmena.
Quelques minutes s’écoulèrent en silence. Les yeux clos, le vieil homme devait revivre cette mémorable soirée, éprouvant sans doute le besoin de reprendre des forces après ce long monologue.
À tout hasard je lui remplis son verre.
Au glouglou du blond liquide, l’oncle ouvrit un œil, tenta un geste de la main, et simplement prononça : Donne !
– J’ai été profondément surprise, mon oncle, par ce procédé divinatoire dont jamais je n’avais entendu parler – et auquel Lys..., pardon, Mademoiselle de Chamou était si experte... Permettez-moi de vous le demander. Y a-t-il là un phénomène de voyance dû aux qualités spéciales de la sibylle ou une présence constante de réponse dans toute question ?
L’oncle ayant fini de boire s’agita ; une roseur parut même sur son visage de cire...
– Je suis particulièrement heureux, ma chère Lucienne, que vous-même me posiez cette question que je formulai à peu près dans les mêmes termes en sortant de chez Mocquard.
Dès la plus haute antiquité, les mages avaient déjà observé les rapports qui régissent les lettres-idées avec les mots et bâti là-dessus tout le système des écritures idéographiques : hiéroglyphes égyptiens ou caractères chinois – qui, disposés dans un sens, expriment telle ou telle phrase, mais dont un signe secret avertit l’initié de disposer autrement les figures pour obtenir un sens ésotérique totalement différent.
– À peu près comme le jeu de cubes de nos enfants ?
– Si vous voulez. C’est ainsi que la prière, la louange gravée sur tel monument, que nos modernes égyptologues s’efforcent de déchiffrer, a presque toujours une autre signification et permettait ainsi aux prêtres de trouver tel passage ignoré du temple, ou de comprendre l’ésotérisme d’un enseignement.
Plus tard, les écritures alphabétiques grecque et phénicienne, basées sur des correspondances numérales, permirent aux sages de correspondre avec des étrangers parlant une autre langue que la leur. Grâce à ces clefs, les fameuses tables de Pythagore – qui, ne l’oubliez pas, avait été initié aussi par les Druides – avaient comme principal but de coordonner ces moyens de traduction. La conquête romaine, dans ce domaine encore, ruina cette merveilleuse découverte de la civilisation hellénique.
– C’est extraordinaire !
– Mais dans le cas dont vous nous avez entretenus ce soir, mon oncle, y eut-il divination ou calcul ?
– À peine voyance ! Faites l’expérience vous-même quand vous le voudrez, après vous être mise en état de réceptivité – comme le médium spirite. Écrivez devant vous l’énoncé d’un fait, les qualifications d’une personne : le mieux est, paraît-il, – car si ma chère femme y était experte, je fus toujours assez faible en onomancie divinatoire – d’écrire en cercle la phrase proposée à votre examen. Recueillez-vous, invoquez l’Esprit qui la suggéra. Des lettres, des mots surgiront que vous retirerez, regrouperez toujours en laissant errer vos yeux sur les lettres ainsi disposées ; dans l’ordre où elles furent écrites. Le sens caché en sortira ; et si quelques lettres restent inemployées, considérez-les comme initiales de mots qui compléteront l’oracle, parfois encore assez obscur.
– C’est prodigieux...
– Mais non, mon pauvre ami – il suffit de songer que tout ici-bas a plusieurs aspects : celui que vous voyez aujourd’hui n’est que la forme présente de votre vérité. Un daltoniste ne verra pas ce paysage comme vous, un peintre chinois le rendra d’une façon bien différente d’un occidental. Je les suppose tous sincères – alors, qui aura la vérité ?
Soyez tranquilles, vous n’en verrez jamais qu’un aspect, et je meurs à 120 ans, heureux d’aller vérifier l’écart qui existe entre la Vérité à laquelle j’ai dévoué ma vie et Celle que je pourrai entrevoir demain.
Alors, mes enfants, comprenez bien que lire les mots d’une phrase, c’est seulement saisir l’aspect extérieur de la pensée, et n’en jugeant que cet aspect, c’est, par exemple, affirmer que le Soleil tourne autour de la Terre.
En recomposant cette phrase avec les mêmes éléments, mais aussi avec d’autres yeux, vous apercevez le sens caché de cette pensée, et entrevoyez une réponse différente de l’apparence, qui montre en somme que la Terre peut tourner autour du Soleil.
Et les lettres restant inemployées vous suggérant une nouvelle réponse, sibylline peut-être, qui, en coiffant l’autre, démontrera une nouvelle version. Vous auriez peut-être alors la comparaison du Soleil et de la Terre tournant respectivement l’un autour de l’autre, en un mouvement que seuls les êtres hors de cette double rotation peuvent comprendre. En d’autres termes, vous auriez le « point de vue de Sirius » qui hors du cercle planétaire solaire estime peut-être que Terre et Soleil poursuivent un mouvement parallèle vers un Infini que lui-même ignore.
M. de Chamou, pour la première fois, m’avait pris affectueusement par le bras pour m’exprimer cette théorie que je viens de vous exposer. Lysiane, à ma droite, se serrait contre moi tandis que nous remontions à pied vers les Batignolles par une claire nuit endiamantée.
Comme devant la porte je prenais congé de ma fiancée et de son père, celui-ci, décidément en veine d’amabilité, me tira l’oreille (à l’imitation de l’Empereur) et me dit :
– « Louis, je vous accorde ce soir que vous avez gagné la première épreuve. » Et me referma la porte au nez.
CHAPITRE X
Doucement la cousine Hermance poussa la porte et parut précédée d’un plateau sur lequel fumait un bol plein d’un odorant potage.
Sans mot dire, elle déposa le tout sur la table de chevet, tapota la courtepointe, releva les oreillers, témoignant quelque humeur à notre égard, car nous absorbions ainsi, à notre seul monopole, les dernières heures de son grand-père.
– Si ça a du bon sens, grommela-t-elle, voilà plus de deux heures que vous retenez nos cousins pour leur raconter votre histoire. Il est 6 h. 1/2 ; vous allez prendre votre bouillon et vous reposer...
– Hermance, je sais ce que je fais... demain...
– Demain – ce ne sera pas aujourd’hui ! Voilà vingt-cinq ans que vous durez comme ça jusqu’au lendemain, mais vous ne jacassiez pas, comme aujourd’hui, plus de deux heures de rang ! Ah oui, vous vous êtes fait donner une bouteille !
Il ne faut pas le laisser boire ainsi ; ça l’énerve et il ne peut plus dormir – aussi j’emporte cette bouteille !
– Non ! Laisse ça tranquille ! ordonna l’oncle, l’œil soudain allumé de colère. Tu sais très bien que je n’en ai plus pour longtemps – alors, fiche-moi la paix !... puisqu’aussi bien vous avez commencé la veillée, en bas, dans la salle !
Et, voyant l’air effaré de sa petite fille qui déjà nous considérait l’œil soupçonneux, il ajouta :
– Oh, nos cousins n’ont rien dit, mais j’ai encore l’oreille fine... et puis, je sais !
Mâtée, Hermance, aidée par ma femme, cala le patriarche dans ses oreillers et tenta de lui faire avaler son bouillon :
– « Buvez, grand-père, c’est de la vraie poule au pot, à l’ancienne, comme vous l’aimez. Après vous dormirez tranquille ! Vous ne devez pas vous fatiguer ainsi. Pourquoi faire, puisque vous avez écrit tout ça pour vos neveux ? »
Un moment, l’oncle considéra en silence les multiples œils qui, sur la surface du liquide, s’entrechoquaient, dessinant des figures imprévues.
Ayant peut-être lu là quelque mystérieuse réponse, il releva le front, et, nous regardant les uns après les autres :
– C’est exact, tout ce que je vous raconte est écrit par moi dans quelques cahiers qui vous seront remis... à votre départ. Mais... auriez-vous cru tout ceci sans être venu à Perrière ?
– Franchement, mon oncle, je dois vous avouer que non !
– C’est bien ce que j’ai pensé. Et voilà pourquoi, après avoir consulté mes amis et obtenu leur assentiment, je vous ai priés de venir ici – pour que, ayant vu, vous croyiez, et que, croyant, vous repreniez, après 72 ans, la mission que j’ai abandonnée après le désastre de 1871.
Et, sans plus discuter, le vieil homme approcha son grand nez du bol de bouillon et, lentement, le mit à sec.
– Maintenant, dit-il, puisque vous avez encore une bonne demi-heure avant le souper, je veux en profiter pour vous dire certain épisode fort important – et ce sera tout pour ce soir –, ajouta le vieillard, coupant à la protestation d’Hermance – avec nos neveux tout au moins... car après..., vous m’enverrez le père André...
– Si ça a du bon sens ! veiller ainsi pendant des heures – dans votre état ! grommela Hermance, nous enveloppant du regard dans la même réprobation.
– Quand, dans deux ou trois jours, le père André dira sur ma tombe : « Qu’il repose en paix ! » ça t’embêtera joliment, ma pauvre fille, d’être forcée de répondre Amen !
Nous ne pûmes empêcher de sourire à cet argument imprévu, tandis qu’ulcérée notre cousine quittait la chambre, emportant le bol vide.
Le grand-père l’écouta descendre, puis, de son œil où brilla un éclair de malice, me fit signe de chercher sa bouteille. Lui obéissant, je lui versai les quelques gouttes qui restaient dans le grand verre de cristal :
– C’est tout ? tant pis ! Pendant que j’y pense, voyez-vous sur la planchette du bas un cahier relié et une petite boîte ?
– Oui, mon oncle.
– Vous les prendrez demain. C’est l’héritage que je vous ai promis.
– Nous n’avons rien fait, mon oncle, pour mériter votre générosité...
– Ne vous excusez pas, ne me remerciez pas, ce petit paquet n’a d’autre valeur que celle dont vous pourrez tirer usage... Ce peut être un trésor – ou rien du tout !
Ayant regardé jouer la lumière dans son verre, et nous le tendant :
– Pour tout à l’heure, dit-il. Il faut que je finisse. Maintenant, écoutez-moi bien.
Nous étions en Août 1845. Sorti dans un bon rang de l’École, j’avais été admis pour les vacances à venir passer une quinzaine à Perrière, auprès de ma fiancée, et j’espérais bien obtenir du père de Chamou qu’il consentît à fixer la date de notre mariage ; mais, chaque fois que j’essayais d’aborder le thème, il trouvait moyen de rompre ou de dévier l’entretien vers le seul sujet qui parût lui tenir à cœur : la restauration impériale. On en profitait pour me poser des colles sur certains procédés mathématiques de divination hérités de nos ancêtres et par lesquels vous vous souvenez que dom Bonaventure Guyon avait acquis la faveur impériale.
De sa thébaïde ignorée, M. de Chamou entretenait par émissaires des relations suivies avec les milieux politiques amis du prétendant, et complotait l’évasion du Prince, toujours détenu dans la forteresse de Ham. Ce sont ces méthodes, jusqu’à lui transmises oralement, que je me suis attaché à codifier sous forme de tableaux, que je vous transmets dans ce cahier relié et qui permettent presque instantanément de tirer des présages infaillibles d’une simple date et d’un nom.
Pour exercer ma mémoire, le père de Lysiane m’obligeait à faire mentalement, suivant la méthode ancienne, tous les calculs exigés ainsi que le faisait sa fille avec une virtuosité remarquable.
Mais, allez donc parler chiffres, divination, politique, à un jeune homme amoureux, impatient de voir se réaliser son bonheur ?
Le pis est que ma fiancée elle-même se montrait élusive chaque fois que je la pressais de décider son père, d’arrêter la date du mariage, puisque j’avais obtenu mon diplôme d’ingénieur et allais me voir nanti d’un poste à la Compagnie.
De remise en atermoiement, nous étions arrivés à la veille de mon départ sans qu’une décision eût été prise. Cette fois, je résolus de me montrer énergique, de balayer tous les faux-fuyants de mon futur beau-père, et, au risque d’une rebuffade, de lui arracher la fixation d’une prochaine date.
Dès l’aurore, il m’avait échappé, et le déjeuner avait passé sans qu’il y eut moyen d’entamer la conversation définitive.
Absorbé par d’insondables pensées, il mangeait sans m’écouter, ne répondant que par des oui et non distribués un peu au hasard. Lysiane, dûment avertie de mon offensive, semblait réticente, comme effrayée par la perspective d’une discussion avec son terrible père.
L’instant du dessert arriva sans que le sujet qui m’était à cœur eût été abordé. Ma fiancée déposa sur la table une grande assiette remplie de prunelles et en soupirant leva les yeux vers moi pour me supplier d’éviter un esclandre.
Je m’étais assigné ce moment pour ultime limite à mon hésitation et je n’entendais plus lambiner davantage.
– Nous avons chez nous des pruniers magnifiques, commençai-je, et mes parents seront heureux de vous en faire goûter les fruits dans une quinzaine, si vous voulez bien accepter l’invitation que j’ai l’honneur de vous transmettre à tous deux en leur nom... Comme ils ne pourraient sans doute venir à Perrière, j’ai pensé qu’il serait préférable de vous voir descendre chez nous, à Châteaudun, afin que ma mère pût enfin faire connaissance de Lysiane, et celle-ci de mes sœurs...
Le mariage de l’aînée, Blanche, est envisagé pour l’automne – nous pourrions donc envisager de célébrer le nôtre en même temps...
M. de Chamou, sans répondre, picorait tranquillement des prunelles, aussi indifférent en apparence que si je lui avais parlé du Grand Mogol.
Lysiane, les yeux baissés, nous surveillait à travers ses cils. Je la sentais prête à pleurer.
Je m’énervais :
– Je ne pense pas, Monsieur, que vous vous opposiez à un mariage religieux – catholique ?
M. de Chamou leva enfin vers moi ses yeux gris, impénétrables :
– Vous avez donc déjà parlé de ce projet à vos parents, Louis ?
Déferré du coup, je bafouillai :
– Non... pas encore ?... mais maman sait que j’ai quelque chose en tête et c’est elle qui m’a suggéré de lui présenter ma fiancée – pour faire les deux mariages ensemble. – Alors je crois pouvoir vous prier à passer quelque temps chez nous – avant la fin de mon congé – pour y régler tout cela !
– Croyez, mon cher garçon, que j’en suis désolé, mais ce mariage avec ma fille ne pourra se faire encore cette année !
– Mais enfin pourquoi ? Vous m’avez imposé un délai ; j’ai passé le concours des Mines, terminé mon stage ; je vais avoir un poste qui me permettra d’assurer une vie décente à votre fille. À mon tour de vous le demander : tenez votre promesse !
– Oh pardon ! en fait de promesse, il me semble que vous n’avez pas à réclamer que je tienne la mienne avant que vous ne remplissiez les vôtres ?
– Les miennes ?
– Ne vous êtes-vous pas engagé à ne tenir votre femme que de mon consentement, lorsque vous aurez satisfait aux trois épreuves que j’avais, suivant nos traditions, le droit de vous imposer ?
– Si fait, mais quand donc, Monsieur, me les avez-vous formulées ? Pour que je satisfasse à trois de vos conditions, il me faudrait d’abord les connaître – sinon le contrat devient nul en droit comme en fait... Deux ans ont passé au cours desquels vous m’avez seulement signifié une fois que vous m’accordiez le bénéfice de la première. Je pense qu’avoir satisfait à mes examens doit passer pour la deuxième, et la troisième est l’obtention d’un poste d’ingénieur à la Compagnie ?
– Vous le pensiez – eh bien, mon ami, vous vous êtes trompé ! Les deux autres épreuves ne sont pas remportées ! et le mariage ne peut se faire ! quelque regret que je puisse avoir, croyez bien, de vous peiner l’un et l’autre. (Mais Lysiane sait bien pourquoi !)
Exaspéré, je m’emportai :
- C’est de la mauvaise foi de votre part que d’abuser ainsi d’un serment que je vous ai prêté, pour ne point tenir le vôtre ! Que vous imposiez trois conditions, soit, j’y ai souscrit – avec l’innocence de mes vingt ans, mais vous aviez à me faire connaître lesquelles – et qu’elles ne fussent pas irréalisables !
Lysiane maintenant sanglotait doucement, la tête dans le creux de son bras. Je comprenais son attitude bizarre de ces derniers jours ; elle savait quelles inhumaines décisions avait prises son père pour la garder prisonnière auprès de lui dans ce Perrière ensorcelé – et n’en apercevait pas l’évasion possible.
Debout, les bras croisés, j’apostrophai le vieil officier :
– Oui, je comprends, vous voulez garder pour vous seul votre fille, et pour votre satisfaction égoïste vous la condamnez à jouer ici la Belle au Bois dormant. Perdu dans vos rêves d’un autre âge, vous prétendez m’asservir moi aussi !
Eh bien, non ! vous ne jouerez pas ainsi de mon imprudent serment. Il est nul, je vous ai dit pourquoi ! Et si vous ne tenez pas le vôtre, Monsieur, je vous jure, cette fois en pleine connaissance de cause, que je dévoilerai partout le mystère de Perrière !
Toujours aussi calme, M. de Chamou avait entendu sans broncher ma violente apostrophe.
– Vous en avez fini ! dit-il glacial. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous, répéta-t-il comme je résistais.
Je n’ai pu vous faire connaître il y a deux ans les conditions auxquelles je subordonnais ce mariage. Tout au plus aurais-je pu le faire ce printemps à Paris. Mais, étant donné le genre d’épreuve subi par vous pour lequel je vous donnai mon premier « quitus », vous auriez pu les deviner. Voici donc ce que j’attends de vous :
1o – que vous nous aidiez à libérer par n’importe quel moyen le Prince Louis Napoléon,
2o – que vous luttiez avec nous pour lui faciliter l’accès au pouvoir.
Alors, de grand cœur, je vous donnerai ma fille !
Assommé, je contemplai le fanatique bonapartiste qui, de sang froid osait, perdu dans un hameau ignoré, imposer à un jeune homme que l’amour avait mis à sa merci d’aussi extravagantes conditions – en 1845... ne l’oubliez pas !
Faire évader un prisonnier politique de cette envergure à la barbe de toutes les polices du royaume, c’était téméraire. Mais faire monter sur le trône ce personnage une fois libéré – n’était-ce pas de l’aberration ?
Lysiane devait si bien s’en rendre compte qu’elle sanglotait maintenant, et, effondrée sur le bord de la table, hoquetait : pauvre petite chose écrasée par la folie d’un père inhumain que je regardais avec horreur.
Seul un rayon de soleil compatissant venait caresser ses boucles blondes, agitées par les soubresauts du gros chagrin qui la secouait toute et que trop longtemps elle avait comprimé en son cœur.
Indigné d’abord, je me contins cependant, et m’essayai à raisonner celui que j’appelais : le fou !
– Voyons, Monsieur, vous n’y songez pas ! Il vaudrait presque autant me vouloir imposer d’attraper la Lune et de l’enfermer dans l’abbaye ! tant le but – dont je reconnais la généreuse noblesse – est hors de proportion avec nos moyens ! Que vous désiriez voir votre gendre partager vos convictions, vos espoirs et vos luttes, soit ! Mais ne subordonnez pas notre mariage à l’imprévisible date d’une réussite aléatoire – cela, vous ne pouvez l’exiger ! Quel rapport voyez-vous entre l’avènement du Prince et le mariage de votre fille avec moi ? Il n’y en a aucun ; il ne peut y en avoir... alors, ne tentez pas de lier ces deux projets l’un à l’autre !
– Si !
– Cela n’a pas le sens commun !
– Si, vous dis-je... et je ne suis pas fou, comme vous semblez le croire. Il y a corrélation entre les évènements ! Parce que Lysiane, née à Perrière en 1827, n’a pas d’état civil ! Et, n’existant légalement point, ne peut se marier sans qu’une enquête ne risque de dévoiler le secret de notre retraite !
– Diable !... Mais enfin, cela peut sans doute s’arranger – on pourrait lui trouver des papiers !...
– J’y ai pensé... Mais avec des papiers quelconques, elle ne serait pas légalement ma fille – tandis que Louis Philippe chassé, et le Prince Louis Napoléon accédant au pouvoir grâce à nos efforts, il nous serait facile d’obtenir par lui les indispensables papiers nécessaires à votre mariage !
Vous avez compris maintenant, pourquoi vous DEVEZ nous aider, et Pourquoi, Dieu aidant, vous DEVEZ RÉUSSIR !
Le vieil homme se tut. Empoignés par son récit fantastique, nous-mêmes n’y prîmes garde tout d’abord, reportés à cent ans en arrière, au seuil des évènements qui devaient avoir une aussi formidable résonnance dans l’Europe entière... Une évasion, la chute d’un trône, une restauration impériale... pour permettre à une petite fille d’épouser le vieillard qui aujourd’hui vivait ses dernières heures... Inconsciemment la phrase célèbre de Pascal me vint aux lèvres :
« Le nez de Cléopâtre, s’il eut été plus court, la face du monde aurait été changée... »
Le son de ma voix, si basse qu’elle fût, me parut à moi-même comme une incongruité. Ma femme me regarda de travers, et, de dessous la courtepointe du lit surgit le chat blanc et roux qui, nous considérant l’œil inquiet, sauta à terre, s’étira, et alla s’asseoir devant la porte, qu’il fixa, attendant qu’elle s’ouvrît.
– Ah, c’est donc l’heure, observa l’oncle Louis : Va ouvrir à Miroux... Je vais vous rendre la liberté, ma nièce... Demain nous finirons cette histoire. Maintenant, je vous prierai de faire monter le père André... Il doit être en bas... Bonsoir, mes enfants !
CHAPITRE XI
Dans la salle commune, trois hommes et deux femmes devisaient tranquillement autour de la table de chêne, au milieu de laquelle se consumait une bougie.
À notre arrivée, le père Jean se leva et, comme pour une chose convenue, sans attendre que nous l’en priions de la part de notre oncle, il monta vers sa chambre.
Dans le faux jour de cette pièce aux ombres durement accentuées par les raies obliques d’une lumière dorée découpant sur le dallage deux longs rectangles devant chaque fenêtre, nous distinguions mal les visages peu connus, sur lesquels la petite flamme accrochait de-ci de-là un accent de clarté sur un front, un nez, une pommette ou un menton, sans jamais en éclairer un tout entier.
– Comment va notre ami ? prononça une voix.
– Pas mal, semble-t-il, docteur, répondit Lucienne reconnaissant la voix du médecin. Il est faible, bien entendu, mais garde toute sa lucidité, et une mémoire infaillible... On ne croirait jamais que...
– Je le sais bien... La Faculté y perdrait son latin, car il n’y a aucune raison physiologique pour que Louis, malgré son grand âge, ne vive point encore six semaines, ou six mois !
Le père Mathieu se gratta la tête... fit un geste de doute :
– Physiologique, peut-être... et encore ! Mais nous avons, vous le savez, d’autres procédés pour apprécier l’influence des dates sur la vie des hommes. Votre oncle a déjà dû vous en dire long à ce sujet.
– Il nous a surtout parlé de son roman d’amour, et par incidences de certaines révélations faites à Napoléon Ier...
– Allons donc, nous connaissons, vous le pensez bien, toute cette histoire depuis longtemps... le rôle que joua M. de Chamou dans la Restauration Impériale... analogue à celui de dom Bonaventure Guyon auprès de Bonaparte...
– Oui, en effet, admit Lucienne, sans vouloir se risquer à dévoiler quoi que ce fût de la confession de notre vieux parent.
Le père Mathieu nous regarda bien droit dans les yeux :
– Je vous ai dit que nous connaissions tous l’histoire de sa vie qu’il est en train de vous conter, d’accord en cela avec les membres du collège Suprême. Il vous a parlé de son admission, n’est-ce pas ?
– C’est-à-dire... tentai-je de biaiser... de la réception qui lui fut faite lors de son arrivée imprévue à Perrière – car pour ce qui est de son admission, nous ignorons encore quels grades ou quels titres sont les siens dans votre hiérarchie !
– Il est archiviste et maître des Arcanes, l’un des neuf membres du Grand Collège druidique des Gaules.
Et voyant notre respectueuse stupéfaction, le médecin ajouta :
– Vous voyez donc qu’il Sait et parle en toute connaissance de cause. Il a cru bon de faire de vous ses héritiers et les confidents d’un Secret attaché à ces lieux depuis des millénaires.
– Mais il nous connaît si peu !
– Puisque je vous dis qu’il Sait ! et tous ici connaissons suffisamment la mathématique divinatoire pour baser nos actions sur elle... puisqu’elle nous donne... exactement, le diagramme, dirai-je, d’une vie humaine, depuis sa naissance, à sa mort...
– Excusez-moi de vous déranger, fit Hermance. Il est l’heure de souper.
Sans vouloir accepter aucune autre aide que celle de Philippe, elle posa le couvert en face de chaque personne présente, à même la table de chêne ciré, au milieu de laquelle clignotait la petite flamme de l’inquiétante bougie.
Au haut bout de la table, en face d’elle, Hermance déposa une vaste soupière fumante, et, très simplement, avant de servir, prononça la prière.
Désorientés par ce mélange de pratiques religieuses et de simplicité, comme s’il n’existait aucune frontière entre les actes les plus humbles de la vie quotidienne et les pratiques sacrées, puisque sans aucun cérémonial on côtoyait les plus angoissants mystères de la Vie et de la Mort invisible et présente, mesurée là, devant nous, à la longueur de bouts de chandelle, ma femme et moi n’osions plus dire un mot.
Tous les yeux, toutes les oreilles des personnes présentes se tendaient vers le médecin, attendant respectueusement qu’il poursuivît son exposé. Mais, tranquillement, sans lever le nez, le père Mathieu, indifférent, mangeait sa soupe.
Ayant vidé son assiette, le vieillard parut enfin s’apercevoir de l’intensité de tous ces regards fixés sur lui, et, comme une lampe électrique qu’on allume sur une prise de courant, continua son exposé là où il l’avait laissé :
– Vous savez tous, n’est-ce pas, que la valeur numérique d’un nom se calcule d’après celle des lettres qui le composent, chiffres immuables datant d’avant la création de signes spéciaux pour exprimer les nombres. Ainsi les lettres A. I. J. Q. = 1 ; B. C. K. R. = 2 ; G. L. S. = 3 ; D. M. T. = 4 ; E. N. valent 5 ; U. V. X. = 6 ; O. et Z. = 7 ; F. P. H. = 8.
Le nom de Louis FUTAIES se voit ainsi attribuer un chiffre à chacune de ses lettres, mais celles-ci recevront un coefficient inverse de la place prise par la lettre dans le nom. Je m’explique : la dernière lettre, S, aura le plus faible coefficient, soit 1, l’avant-dernière aura 2, et ainsi de suite, de sorte que la première, l’Initiale, celle qui donne sa marque au nom, verra sa valeur numérique multipliée par le nombre de lettres composant le nom ou le prénom.
– N’est-ce pas ce qu’on appelle l’Astrologie Onomantique ?
– À peu près, car notre système en diffère quelque peu.
– Et vous, un médecin, ajoutez foi aux résultats donnés par un procédé antiscientifique au premier chef ? demanda ma femme, avec un sourire.
– Je constate qu’un système aussi apparemment anti-scientifique que l’Onomancie, ou divination par les noms, corrobore tous les résultats obtenus par d’autres procédés de divination : tels l’Astrologie scientifique et la radiesthésie, déclara le médecin, mais ouvre surtout, sur la destinée de l’individu, des horizons insoupçonnables.
Votre oncle y était de première force et, s’il avait été écouté, je le dis avec la plus profonde conviction, les destins de la France eussent été différents, et les Allemands n’occuperaient pas aujourd’hui les deux tiers de notre patrie !
– Pardon, mon père, fis-je, lui donnant à mon tour ce titre patriarcal, je ne comprends pas du tout, car nous voici enfermés dans un dilemme sans issue. Ou le destin d’un individu est fixé de façon immuable et révélé dans toute sa rigueur aux Initiés capables d’en lire l’évolution par le seul énoncé d’un patronyme et d’une date... Alors, rien ne sert d’en connaître le déroulement prévu, puisqu’on n’y peut rien changer, et vous tombez dans le fataliste « Mektoub » (c’était écrit) des musulmans ; ou, connaissant les grandes lignes d’une existence, vous pouvez en écarter les périls, utiliser au maximum les chances heureuses. En ce cas, vous faussez le jeu du destin dès le premier péril évité, et votre édifice construit avec une rigueur mathématique s’écroule. Votre horoscope onomantique érigé pour le seul individu d’après le nom qu’il reçut à sa naissance ne tient aucun compte des positions sidérales étudiées pour ce jour-là par un astrologue et qui sont, elles, un aspect d’un univers auquel participent non seulement tous les humains, mais encore les habitants des autres mondes.
L’apparition d’une gigantesque omelette au lard dorée, gonflée, relevée de fines herbes, servie directement par Philippe de l’énorme poêle à frire dans les assiettes, nous priva de la réponse du vieux médecin, qui décidément n’aimait point à parler en mangeant.
Ce fut Denise, ce docteur ès-sciences que le père Jean nous avait tantôt présenté comme sa petite-fille, qui répondit à la place du père Mathieu.
– Si le dilemme dans lequel vous prétendez nous enfermer existait, il ne devrait pas y avoir non plus de catastrophes maritimes, à notre époque !
– Comment cela ?
– Le commandant d’un navire ne dispose-t-il pas de cartes marines indiquant, non seulement avec précision le tracé des côtes, mais encore la hauteur et la nature des fonds ; le livre des instructions nautiques vient par surcroît lui apporter les renseignements les plus complets sur la direction et la vitesse des courants, la hauteur des marées, la nature des vents aux différentes époques de l’année, les symptômes d’après lesquels on peut attendre tornades ou orages, les moussons, les alizés... n’est-ce point là l’équivalent d’un horoscope ?
De plus, ledit commandant possède les instruments de précision, boussoles, sextants, lui permettant de placer exactement sa position.
Des bulletins météorologiques le renseignent sur les perturbations causées par des agents extérieurs. En somme, seul l’examen comparé des horoscopes de toutes les personnes à qui nous avons affaire nous permettrait d’avoir l’équivalence de tous ces renseignements.
– Mais dans certains cas nous pouvons les avoir en connaissant la date de naissance de ces personnes, objecta Lucienne.
– Bien certainement... encore, pour l’établir – ce qui est un gros travail, vous devez le savoir – il faut connaître, en Astrologie scientifique, le lieu et l’heure exacts de la naissance, et ceci une fois connu, établir la révolution solaire de cet individu pour l’année présente – comme pour celles qui suivront. L’Horoscopie onomantique additionne simplement à l’année natale les nombres représentatifs des noms et prénoms, du degré du signe zodiacal qui vit la naissance et le numéro de ce signe : le Bélier étant le premier, puis le Taureau, ainsi de suite. Vous me suivez ?
– Parfaitement, mais je ne vois toujours pas...
– Vous verrez tout à l’heure. Le total obtenu vous donne une date qui représente le sommet de l’horoscope ; c’est-a-dire celle qui détermine le destin et dont la somme des chiffres la composant nous renvoie à l’arcane du Tarot qui en donne le sens – puisque Tarot signifie Clef. Cette année 1943, par exemple, s’additionne : 1+9+4+3 = 17, l’Étoile des Sages ; entourée de sept autres étoiles elle est le symbole de l’Immortalité et de la survivance de l’âme qui puise en cet espoir le courage nécessaire pour dominer les épreuves.
– Mais 1943 donc, synthétisée par l’arcane 17, vaudrait donc pour toute la planète ?
– En un sens, oui. C’est pourquoi cette année est significatrice d’espoir. Mais sa signification, divine, spirituelle ou matérielle, s’attache plus intensément à ceux qui la retrouvent dans leur horoscope.
Connaissant donc la date de nativité de deux êtres, leurs noms et prénoms, vous pouvez en tirer jour par jour, comme d’année en année, les symboles du succès ou de l’échec que leur réserve le Destin ce jour-là.
Si donc les présages qui vous guettent sont défavorables ou simplement inférieurs à ceux de la personne que vous affronterez, vous serez tout naturellement surclassé, comme vous en triompherez dans le cas inverse. Ainsi le commandant du navire ayant pris connaissance des bulletins météorologiques appréciera s’il doit, étant donnée la puissance de son navire, affronter la tempête ou mettre à la cape et fuir devant elle, si la hauteur d’eau lui permet le passage par tel chenal ou le met en danger de talonner, voire même d’échouer son bateau.
– Et pourtant les naufrages se produisent tout de même...
– Parce que... intervint le père Mathieu qui, ayant fini son assiette, reprenait la parole, l’Incréé a voulu que le Destin ne puisse régir en son absolue rigueur qu’un tiers des évènements, et encore nous a-t-il permis d’en calculer les effets. À l’Homme il donna la Liberté de disposer du second, de se mouvoir à son gré sur la Route de la Vie, mais Il se réserva le troisième tiers qu’Il maintint impénétrable. Ainsi la science de l’horoscope permet de connaître ou d’influencer les 2/3 des évènements. C’est déjà beau !
– Je le pense bien ! Mais ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est qu’utilisant simplement une date et la valeur numérale d’un nom dont les correspondances sont arbitraires, il vous soit possible d’en tirer des présages valables !
– Qui vous dit que ces correspondances soient arbitraires ? Les 78 figures du Tarot, ou, si vous le préférez, d’un code chiffré établi il y a des milliers d’années, sont toujours valables. Il suffit de tenir compte des différences formelles existant entre les alphabets utilisés : Égyptien, Hébraïque, Chinois, Celtique, et l’Astronomie. Les variations des latitudes, donc de constellations correspondantes, sont aussi appréciables que les différences horaires.
– Je l’admets !
– Vous admettrez donc que notre tarot, ou code celtique, donc occidental, ne puisse être absolument identique à l’égyptien, à l’hébraïque, voire au slave ou au chinois. À plus forte raison, à ceux de l’hémisphère austral qui est encore à faire, où les langues parlées, sauf les indigènes, sont toutes occidentales, mais ne sauraient plus correspondre avec la même influence planétaire s’exerçant dans la même saison !
– Ce me semble évident ! dit ma femme ; mais il demeure que ces lettres et leur valeur numérale, voire astrologique, est arbitraire, puisque le même signe alphabétique n’a pas la même prononciation en français qu’en hébreu, ou plus simplement en anglais ou en polonais, dont l’orthographe des mots devient imprononçable pour nous.
– Et voilà, chère Madame, la confirmation de ce que je vous disais tout à l’heure touchant la nécessité d’accorder le Tarot antique avec nos oreilles et avec notre latitude, comme vous transposez telle page musicale en un autre ton selon vos possibilités vocales.
C’est ce que nous avons fait il y a des siècles ; mais ce secret-là, nous l’avons gardé.
– Nous ne voulons nullement être indiscrets, et soyez bien certain, mon père, que, partis d’ici, nous ne révélerons rien de ce que vous avez bien voulu nous montrer et nous apprendre...
Le vieillard me fixa intensément :
– Et si c’était précisément pour vous charger d’une mission que vous aviez été convoqués ici ?
– Moi ?
– Vous deux. Croyez-vous donc que ce soit pour vous conter uniquement l’histoire de ses amours que Louis vous retient si longtemps auprès de lui à l’heure où il se dispose à faire le Grand voyage ?
– Que veut-il de nous ? questionna Lucienne, surprise.
– Ça, il vous le dira sûrement lui-même demain, parce que, après...
– Oui, c’est vrai, cela nous ramène à cette prévision d’une date fatale dont nous parlions tout à l’heure.
– Tenez, la voici noir sur blanc, triompha le vieux médecin en tirant de sa poche un carnet qu’il ouvrit devant nous. Ce que vous ne comprendrez pas, Denise vous l’expliquera.
Et là-dessus, fidèle à ses principes de silence pendant qu’il mangeait, le père Mathieu s’absorba dans la consommation de fraises des bois à la crème, dont la cousine Hermance venait de déposer sur la table deux pleins saladiers de fruits embaumés et de crème onctueuse.
À la page ouverte s’étalaient en majuscules les mots et chiffres suivants :
LOUIS = 66 FUTAIES = 132 20 Avril 1823
1823 = épacte XVIII, soit : 18 + 20 + 1 = 39 – 29 = 10e jour de la Lune.
L’entrée de la Lune dans le Lion signifie : longue vie.
Toutes nos méthodes de divination de l’avenir tiennent dans ce petit cahier. Votre oncle a passé presque toute sa vie à les mettre au point, en vue de remplir la mission qu’il s’était assignée.
Je crois que son désir est que vous continuiez son œuvre en passant à l’application des méthodes qu’il a patiemment élaborées.
– Mais nous n’y connaissons rien ; ce n’est pas du tout notre travail !
– Quand vous aurez lu et médité sur les documents contenus dans ces pages, vous comprendrez le mécanisme du Grand Horloger, et arriverez à savoir lire les arrêts du Destin.
Vous pourrez éclairer vos amis non seulement en ce qui concerne leur existence propre – ce qui est peu, et ne nécessiterait pas votre présence ici...
Ce que nous avons surtout désiré, dans notre Collège de Perrière, c’est retrouver dans le monde extérieur un « correspondant » capable d’utiliser nos méthodes afin d’éclairer nos contemporains, et forcer les milieux les plus hostiles à s’incliner devant la somme prodigieuse de connaissances accumulées par des siècles de méditation silencieuse.
Vous annoncerez ainsi les évènements les plus graves, pour éviter que, pareils à ceux qui ont méprisé les avertissements donnés à la France, les Français ne succombent sous de nouvelles catastrophes.
– Mais nous n’avons aucun moyen de faire cela, dit ma femme.
– Si, vous l’aurez, parce que vous assoirez ces prévisions parfois lointaines sur des observations journalières qui pourront être contrôlées par les évènements les plus tangibles aux yeux les plus avertis.
– Je ne vois pas du tout quelles prévisions ?
– La prévision du temps !
Tout se tient. L’orage influe sur vos nerfs : vos nerfs surexcités régissent votre comportement. Parfois des mots, des gestes brutaux en sont la conséquence. Et cet orage, transposé sur le plan politique, peut causer des troubles sociaux aussi bien que des guerres.
Tout, voyez-vous, mes enfants, Tout est dans Tout ! Et l’éclipse qui affecte la vie du nouveau-né marque aussi le terme d’une existence. Ce phénomène influe sur les perturbations atmosphériques et sismiques. La connaissance du moindre de ces phénomènes a des conséquences infinies, et lorsque, utilisant les données que vous recevrez ici, vous aurez annoncé journellement des périodes de chaleur ou de froid, des pluies torrentielles entraînant des inondations, et mille autres faits journellement vérifiables et dont les conséquences logiques apparaîtront, alors on croira réellement à la science druidique fidèlement transmise, et sans cesse perfectionnée dans le mystère de Perrière !
Le père Jean venait d’apparaître en haut de l’escalier. Nous le regardâmes descendre les marches, lentement, pesamment, en s’appuyant à la rampe.
– Mathieu, va donc voir là-haut... Louis aura besoin de toi pour tenir jusqu’à demain soir !
Comme le vieux médecin se hâtait, suivi d’Hermance inquiète, le maître des Études Sacrées, d’un geste, nous invita à nous asseoir.
Sortant de sa poche une bougie à peine entamée, il l’alluma à la flamme vacillante qui brûlait maintenant au ras du chandelier, la fixa dans la cire fondue du lumignon près de s’éteindre, et, contemplant la petite vie du Feu rallumé, s’assit à la place quittée par le médecin et soupira :
– Demain soir, c’est moi qui serai le doyen de Perrière.
CHAPITRE XII
Réveillés dès l’aurore par le joyeux vacarme des oiseaux chantant leur prière matinale à l’Astre du jour, Lucienne et moi écoutions, dans une demi-somnolence ce discordant tapage auquel nul bruit humain ne faisait écho.
– Tu dors ?
– Non. Y a-t-il moyen avec le raffut que font ces bestioles !
– Alors, bonjour Toi !
– Bonjour toi... Il paraît que ce doit être le Grand jour pour l’oncle Louis, d’après les augures ! Tu ne trouves pas ça effrayant cette possibilité de calculer les dates de notre vie et de déterminer ainsi le cours du Destin ?
– Au contraire ! La route est ainsi balisée. Si nous avons bien compris les explications du père Mathieu, les dates dont il tire des présages, à tout le moins curieux, n’impliquent que rarement une fatalité absolue, mais donnent l’indication d’une possibilité – de danger ou de succès, comme les feux placés sur les routes maritimes, ou les signaux sur les lignes de chemin de fer préviennent des accidents possibles.
– Attention, « Croisement dangereux ! »
– Et aujourd’hui, pour l’oncle Louis ?
– Terminus !
– L’admirable en tout ceci est la parfaite Sérénité avec laquelle le principal intéressé comme ses proches envisagent le terme fatal, sans inquiétude et sans crainte. Profondément religieux, les prières et autres manifestations du culte ne tiennent pas grand-place dans la vie de ces prêtres d’un culte oublié !
– C’est en effet curieux ! Je te dirai que cette forme de la vie mystique me plaît beaucoup.
– À moi aussi ! Mais ce que je n’ai pas encore compris, c’est le motif pour lequel cet oncle inconnu s’avise de faire de toi son héritier ?
– Il y a Philippe, son arrière-petit-fils – et d’autres peut-être que nous ignorons !
– Enfin, nous ne tarderons pas à le savoir... Si la vie à Perrière n’est pas très gaie, du moins l’on y mange bien ! et l’on y oublie la guerre et ses misères !
– La guerre ! ma foi oui, c’est vrai, ici l’on n’y pense plus !...
La clarté du jour pénétrait maintenant en rais obliques au travers des rideaux. Je consultai ma montre : elle marquait cinq heures moins le quart.
– Si nous nous levions ? Nous sortirions sans faire de bruit pour faire un tour dans la forêt. Ce doit être délicieux à cette heure, proposa ma femme facilement matinale.
J’acceptai sans enthousiasme... n’ayant jamais été fervent adorateur de l’aurore...
Il était à peine 5 h. 1/2 que, poussant doucement la porte, nous nous trouvâmes sur le palier.
Le chat Miroux, dont le fauve pelage semblait dorer au soleil, couché devant la chambre de notre oncle, se leva, et vint se frotter contre nos jambes, semblant quêter une caresse, puis, se levant sur ses pattes de derrière, gratta à la porte de son maître, nous regardant pour qu’on lui ouvrît...
– Il est trop tôt, Miroux, grand-père n’est pas réveillé ! Va faire dodo, mon beau chat !
– Rrrouin ! fit le matou en nous barrant le passage.
– Allons, Miroux, on le sait, tu es un bon minet ; mais laisse-nous descendre...
– Mi...aou ! insista l’intelligent animal en nous considérant de ses yeux d’or, la patte droite levée et ramenée sous lui.
– Qu’est-ce qu’il y a, Miroux ? tu veux dire quelque chose ?
– Rroû ! poursuivit le chat dressé à nouveau contre la porte close qu’il griffait avec impatience.
Lucienne et moi nous nous regardâmes...
– Est-ce que... déjà ?... les animaux ont de ces perceptions !... chuchota mon épouse.
– Mi... a, accentua le chat.
L’oreille tendue nous écoutions si quelque bruit, quelque plainte ne nous parvenait point de la chambre silencieuse...
– Il faudrait peut-être voir ?...
– Si l’on prévenait Hermance ?
– Miaoû !... et la petite voix du félin clamait avec autorité.
Le cœur battant, Lucienne souleva doucement le loquet, et entrebâilla l’huis par où se faufila le chat.
À la porte voisine apparaissait en même temps la tête de la cousine coiffée d’un bonnet de nuit...
– Que se passe-t-il ?
– ... C’est Miroux qui miaulait pour entrer... ça nous a inquiétés...
– Il n’y a pas de quoi ! prononça du fond de sa chambre la voix de l’oncle Louis ; Hermance lui ouvre ainsi tous les matins quand elle se lève... Mais vous êtes bien matineuse aujourd’hui, ma nièce, pour une Parisienne !
– Mon Dieu ; nous avons été réveillés par les oiseaux, et avons envie d’aller faire un tour dans les bois... Mais vous ne dormez donc pas, mon oncle ?
– À mon âge on n’a plus guère besoin de dormir pour rêver...
– Si ça a du bon sens ! grognait Hermance, sans que l’on sût auquel des trois put s’adresser cette observation... tandis qu’elle nous écartait du seuil pour pénétrer chez l’aïeul.
– Eh bien, mes enfants, allez donc respirer la rosée... et une fois de retour, montez donc jusqu’ici. J’en ai encore à vous dire... et plus tôt j’en aurai fini... je vous ficherai la paix à tous !
– Oh ! mon oncle !
– Allez donc, jeunes gens, à tout à l’heure !
Quelques instants plus tard, nous nous trouvions dehors... un peu vexés !
– Jamais encore il ne nous était arrivé de nous promener aussi tôt dans une forêt ! s’écria Lucienne, joyeuse comme une enfant de fouler dans la fraîcheur du sous-bois l’épais tapis de feuilles et de plantes qui couvrait le sol à l’ombre des vieux chênes.
Nous n’avions pas fait cent pas que déjà les calmes demeures de nos hôtes avaient disparu, happées par le feuillage, comme dans un conte de fées.
– Si tôt en forêt ?... Non en effet... À moi cela n’est jamais arrivé que pendant la guerre – dans la forêt de Villers-Cotterêts en 18... puis en 40... et l’occasion n’était vraiment pas favorable pour en apprécier le charme... alors !
– Où allons-nous ?... Tu sais comme on s’égare facilement ici... même avec une boussole...
– Cette fois, je t’en prie, laisse ta boussole dans ta poche. Nous nous retrouverons ou nous perdrons bien sans elle. Suivons le sentier ; il nous mènera bien quelque part... J’aimerais revoir le tombeau de Hû Gadarn !
– On verra peut-être autre chose ?
L’un suivant l’autre dans la fraîche pénombre de cette laie bordée de fougères dans laquelle il était impossible de marcher de front, nous descendions une pente que l’humidité rendait souvent glissante, d’autant plus que le sol était insensiblement devenu rocheux et que de ci de là de grandes dalles de grès, souvent recouvertes de mousse, perçaient la couche d’humus.
– Ça ressemble à la forêt de Fontainebleau, observa ma femme en considérant un éboulis de roches grises dressé en face de nous, obligeant le sentier à tourner presque à angle droit.
– Oh ! Ne fais pas de bruit, regarde ! fit-elle en m’arrêtant du geste.
Au milieu d’un cirque de rochers s’étendait une petite mare délicieusement ourlée d’iris aux bords de laquelle s’abreuvait une harde de cerfs et de biches.
Bien que nous nous fussions abstenus de faire le moindre bruit, ces jolis animaux levèrent anxieusement la tête à notre approche, mais ne parurent nullement intimidés.
– Quelle magnifique photo à prendre nous aurions là ! observa ma femme. Comme on voit que personne n’a jamais inquiété ces bêtes-là ! Ma parole, elles semblent apprivoisées !
Cueillant une touffe d’herbes, je m’approchai par jeu d’un grand cerf à l’abondante ramure, pour voir s’il daignerait agréer ce présent de bienvenue. Mais le mâle méfiant, sinon effrayé, s’avança dans la mare, et les biches s’écartèrent suivies de leurs faons. Une nouvelle tentative auprès d’elles n’eut pas plus de succès. Sans toutefois s’enfuir, la harde s’écartait délibérément de moi.
Jugeant inutile d’insister, je fis demi-tour, et remarquai un vieux bonhomme dont le visage étonnamment barbu ne semblait qu’une boule de poils surmontée d’un informe chapeau.
De toute évidence, le personnage devait être le berger de cet étrange troupeau.
Je me dirigeai vers lui :
– Êtes-vous le neveu du Commandant ? me demanda le vieux sans préambule.
– Du commandant ?... Oui, c’est moi, fis-je après une certaine hésitation, étant fort loin de penser à ce moment que l’oncle Louis avait été jadis chef de bataillon en 1870.
– Il n’est pas encore passé au moins ?
– Non pas ; il nous a même parlé ce matin.
– Je pensais bien aussi. Les bêtes n’ont pas bramé.
– Comment cela ? questionna ma femme qui s’était approchée, les cerfs brament... comme les chiens hurlent à la mort ?...
– Dame oui ! toutes les bêtes savent ça... Et moi il faut que je lui porte ma bougie an’huy !
– Votre bougie ?... ah oui ! Vous pensez donc que notre oncle nous quittera ce soir ?
– Mon commandant me l’a promis... Il ne s’en va point sans que je lui apporte la dernière... Y me doit ben ça ! conclut le bonhomme d’un ton pénétré.
– Ah !
– Dites-moi donc pourquoi vous appelez le père... – notre oncle, veux-je dire – « mon commandant ». Il n’est pas militaire, que je sache ! demanda ma femme.
– Pas militaire... ma foi non. N’empêche qu’il était mon commandant en 70, et moi son ordonnance. Il vous a point dit que c’était moi qui l’avait rapporté ici quasi mort depuis Châteaudun ?
– Mais si ! mais si ! ajouta-t-elle précipitamment, sentant que le vieux serait atrocement vexé qu’elle parût ignorer cet exploit.
– Eh bien, si mon commandant a vécu encore un bon bout de temps depuis, c’est bien grâce à moi, car à ce moment il ne valait pas cher, et aujourd’hui, il me ferait pas l’affront de partir sans moi !
– C’est juste ; mais, dites-moi, vous connaissiez donc Perrière en 70, pour pouvoir y ramener ?...
– Perrière ? mais j’y suis né ! Même que Madame Lysiane était ma marraine... Nous étions quatre gars d’ici dans le bataillon de mon commandant !
– Alors que s’est-il passé ?
– Ben, comme à c’t’heure ! Les Prussiens sont venus par ici... Alors M. de Chamou et les anciens ont décidé de payer l’équipement d’un bataillon dont M. Futaies, déjà capitaine de mobiles, serait le commandant.
– Ah ! quel beau bataillon, Monsieur ! Rien que des gars du pays et beaucoup de parents ou alliés de ceux de Perrière – que personne ne s’en doutait – mais nous, comme de juste, dès les premiers mots on se reconnaissait, on se faisait les signes, et tout de suite l’on savait sur qui on pouvait compter.
Lorsqu’on sut que les Pruscos prétendaient venir par ici et allaient marcher sur Châteaudun, on fit le Grand Serment de se faire tous tuer plutôt que de les laisser venir à Perrière.
– Alors, suggéra ma femme, vous pourrez nous parler, vous qui vous y êtes battu, de cette belle défense de Châteaudun, l’un des faits d’armes de cette malheureuse guerre de 70...
Le vieux fourragea un moment dans sa barbe inculte :
– Je sais bien que les journaux ont imprimé des tas de choses là-dessus... nous, on s’est battu... Le pays, on le connaissait, hein ! et mon commandant plus que tous, puisqu’il en avait fait les cartes.
Comme on savait toujours par l’un, par l’antre, où ils devaient passer, les Pruscos trouvaient devant eux des gars pour les recevoir.
À 5, à 10, rarement davantage, on arrêtait les casques à pointe devant un méchant taillis – on enlevait leurs convois. Mais pour se battre il fallait se servir des fusils allemands qu’on ne connaissait point ! Dame, on ne recevait jamais de cartouches pour nos chassepots !
Le 15 Octobre, c’est tout un régiment prussien qui nous attaqua. J’m’en rappelle comme si c’était hier !... Eux, ils avaient du canon ; nous pas ! et pas l’habitude non plus de manœuvrer comme eux !
Aux premiers d’entre nous qui tombèrent, mon commandant nous vit sur le point de flancher peut-être : Les veinards ! qu’il dit, y n’auront pas à payer leur terme ! ça fit rire... c’est pourtant pas drôle !... et le bataillon tint le coup.
Le soir nous étions toujours là, mais les casques à pointe avaient reculé... au petit jour la bataille reprit. D’autres régiments ennemis arrivaient ; on se battit dans les faubourgs de Châteaudun. De toute la journée, personne n’eut le temps de manger un morceau. Des civils nous apportaient des bouteilles ; plusieurs firent le coup de feu contre les Allemands. Mais leur artillerie démolissait les maisons ; il nous fallait reculer vers le centre. À la nuit, les prussiens cessèrent le feu pour emporter leurs blessés qu’on entendait gueuler dans les jardins.
Les nôtres étaient tout de suite emportés et soignés dans les caves par les dames de la ville.
L’Hôpital... n’avait plus de toit où accrocher le drapeau à croix rouge... Ces cochons-là tiraient dessus tout exprès.
– Ça n’a pas beaucoup changé, vous savez ! Mais dites-nous quand... le commandant... notre oncle a-t-il été blessé ?
– Au petit matin : une balle dans le bras comme il s’était montré pour donner des ordres à un officier. Pendant toute la matinée, le bras cassé, il continua de commander le bataillon. Le major voulait le faire tenir tranquille... mais il se fit drôlement rabrouer et, le bras en écharpe, le commandant continua comme s’il n’avait qu’une égratignure... Vers midi, cela devint mauvais ; les prussiens tenaient sous leurs feux de file presque toutes les rues, nous acculant à la Grand-Place... Plus on leur tuait du monde, plus il en venait... mais nos hommes, eux, n’étaient pas remplacés.
Le commandant voulut reprendre à la baïonnette le malheureux canon que nous avions et dont tous les servants étaient tombés. Un éclat d’obus le frappa à la poitrine ; je le tirai derrière la barricade :
– Capitaine Leducq, prenez le commandement ! je suis foutu, dit-il, puis il s’évanouit.
Alors, comme on voyait bien que ç’allait être fini, puisque les renforts ne nous arrivaient pas, un gars d’ici, Henri Courier et moi on a chargé le commandant et deux autres blessés sur une voiture à bras avec de la paille, et, à pied, on les a conduits à Perrière, pour pas qu’ils tombent, même morts, aux mains des Pruscos !
– Et vous avez fait, à pied, tout le trajet avec un homme à moitié mort dans la voiture ? s’exclama Lucienne.
– Dame ! on pouvait pas donner l’adresse de Perrière à un cocher tout de même !
On lui a fait un pansement d’herbes, comme on sait, et de temps en temps, on prenait un coup de marc.
– Vous avez mis combien de temps ?
– Une nuit et un jour. Quand on l’a déposé chez lui, on croyait qu’il en ressortirait bientôt les pieds les premiers : il avait quasiment plus de sang...
– Ce sont les Pères qui l’ont si bien remis debout ?
– Dame, ils s’y connaissent pour faire reculer la Mort... et puis l’air de Perrière... et puis Madame Lysiane qui ne le quittait pas...
Eusèbe et moi, on a dormi 24 heures... et puis nous sommes repartis à la guerre. On a fait Coulmiers, repris Orléans aux Bavarois, et quand les Prussiens y sont revenus, nous avons continué en francs-tireurs, dans la région. À l’armistice on a retrouvé ici mon commandant – pas bien faraud, mais vivant quand même.
– Ma tante Lysiane l’avait bien soigné !
– Ouais... émit le bonhomme... En tout cas, dès qu’il m’a revu : « Henri, qu’y m’a dit, je te dois d’être encore vivant... mais si tu veux que je le reste, apporte-moi du vin... du bon ! Avec leurs sacrées drogues et tisanes, ils me feront crever ! Voilà dix napoléons ; débrouille-toi... et ça entre nous !
Eh bien, monsieur, personne n’en a jamais rien su ; j’ai acheté sur ses conseils une petite pièce de vigne, par là, et j’ai fourni la table des Pères et la petite cave de mon commandant jusqu’à présent... La gelée de ces derniers hivers a fait mourir mes plants : « Nous n’avons plus qu’à en faire autant, mon pauvre Henri, m’a dit mon commandant, quand je lui appris la nouvelle... comme je suis déjà mort officiellement depuis 70 ans, ce sera une occasion de régler mes comptes ! »
– Ah oui, c’est vrai ! il a été porté tué par l’ennemi à Châteaudun ! Mais pourquoi diable n’a-t-il pas fait rectifier...
– Une idée comme ça... pour rester tranquille peut-être... on dit qu’il n’y a rien de tel pour vivre longtemps... Puisque la Mort vous a pris une fois, c’est une nouvelle vie qui recommence...
– Ça peut se défendre !
– Et puis... M. de Chamou était mort... Les Pères tenaient à lui offrir le même poste... et sa femme le poussait à accepter... Il s’est laissé faire... Mais tenez, je vous retiens, et il est l’heure de porter le lait à Mme Hermance...
Très doucement le bonhomme modula une sorte de sifflement... l’une des biches leva la tête – s’approcha.
– Tenez, fit le vieux, suivez-la, elle y va toute seule... comme ça vous ne vous perdrez pas !
Comme nous regardions, interdits, le curieux personnage entouré de ses charmants animaux...
– Oui... c’est comme ça tous les jours, Eugénie a l’habitude, elle connaît le chemin. Madame Hermance la traira elle-même.
Depuis notre arrivée dans ce mystérieux Perrière, nous avions vu et entendu bien des choses extraordinaires, mais celle-ci nous ébahit complètement.
– Ces biches... Ce sont donc pour vous comme un troupeau de vaches... ou de chèvres ? Ce sont elles qui vous fournissent le lait ?
– Dame ! vous ne nous verriez pas élever des vaches en forêt ?... Ici, ça toujours été comme ça. Personne ne leur a jamais fait de mal. Vous voyez maintenant qu’elles ne vous craignent plus ?
– C’est merveilleux ! s’exclama Lucienne... Et ce lait est aussi bon que celui des vaches, ou a-t-il le goût de chèvre ?
– Ça, ma petite dame, je ne peux pas vous le dire ; voilà bien plus de soixante ans que je n’en ai point bu d’autre... y a pas plus fortifiant, ni plus sain. Madame Lysiane dans le temps venait le chercher ici, puis ce fut le tour de sa fille Eugénie, celle qu’épousa le fils Courier, la mère d’Hermance, quoi...
– Dites donc, vous qui avez bien connu notre oncle et sa femme... vous pourriez nous dire... Comment était-elle ? la tante Lysiane ? questionna ma femme.
Le vieux réfléchit un instant, puis, d’un ton pénétré :
– L’était un rude chameau !
– Oh ! s’indigna ma femme nettement choquée tandis que, retenant une folle envie de rire, je réclamais les attendus de ce jugement sommaire.
– Dame, si on l’avait écoutée, mon commandant n’aurait jamais bu que de l’eau... ou du lait... Mais heureusement que j’étais là... car sans ça, voyez-vous, sans notre bon vin blanc... eh bien, il n’aurait sûrement pas vécu jusqu’aujourd’hui !
Maintenant, messieurs Dames, sans vous commander, il serait temps que vous suiviez Eugénie... qui va se faire traire. Moi, je vas venir dans une couple d’heures... avec mes seaux de lait.
À tantôt !
Et, précédés de la biche Eugénie comme guide, nous reprîmes la direction de Perrière, tandis que ma femme observait :
– N’as-tu pas l’impression que nous vivons Blanche-Neige en ce moment ?
CHAPITRE XIII
Comme nous entrions sur la pointe des pieds dans la chambre de l’oncle, celui-ci nous accueillit avec son bon sourire et, sans préambule, comme suivant le fil d’un récit ininterrompu, il enchaîna :
– Et voilà, mes enfants, que j’en arrive au principal de mon histoire ; là où vous retrouverez un épisode historique bien connu dont tout ce que je vous ai conté jusqu’ici vous expliquera le mécanisme encore ignoré...
– Oui, l’obligation imposée par M. de Chamou de contribuer à la restauration impériale pour épouser sa fille.
– Tout juste. Or, je vous laisse à penser quels projets les milieux bonapartistes ne cessaient d’élaborer pour faire libérer le prince captif à Ham : recours en grâce auprès du roi, projets plus ou moins saugrenus, tels celui de lui faire rééditer l’histoire de la fameuse évasion de M. de Lavalette grâce à la complicité d’Éléonore Vergeot, liaison tolérée par les autorités, et qui se fut volontiers prêtée à un travestissement, que Louis Napoléon refusa par crainte du ridicule en cas d’échec.
– Les vieux trucs sont pourtant les meilleurs !
– Le prince avait sur ces entrefaites reçu le remarquable horoscope établi selon nos antiques méthodes, et que vous retrouverez dans les cahiers dont je vous laisserai la propriété. Il fut frappé par la promesse d’un empire, la menace d’écroulement et d’une seconde captivité. La première, qu’il subissait encore, étant prévue à l’âge de 32 ans, et cette prédiction-là se trouvait vérifiée.
Le Prince en parut fort affecté, mais quelques jours plus tard, toujours obsédé par le souvenir de son oncle, il faisait passer à Perrière, par l’intermédiaire de son ami le docteur Conneau, cette nouvelle question :
« LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE CAPTIF À HAM DEVIENDRAIT-IL UN GRAND EMPEREUR ? »
Le druide astrologue d’alors, le père Évariste, bougonna : « Que veut-il que je lui dise de plus ? Il a son thème, les astres sont formels. Il peut régner... mais il faudrait qu’il passât la mer d’abord... »
Mis au courant, M. de Chamou s’insurgea :
– Les astres, les planètes et autres étoiles nous imposent-elles donc leur volonté ?... Et la Liberté alors !
– La Liberté ! riposta Évariste ; elle consiste précisément à accorder nos gestes avec nos possibilités – et telle chose qui paraît impossible peut être rendue faisable par une autre méthode...
– Alors... quoi ?
– Ça, mon ami, c’est l’affaire du Prince et non la mienne !...
Lysiane, sur ces entrefaites, était entrée dans la pièce où son père discutait avec Évariste :
– Tiens, petite, lis ça... La question te concerne aussi, je pense – tu sais pourquoi ?
Ma fiancée se saisit du billet, le lut, le relut, puis, saisie d’une inspiration, saisit une feuille de papier, un crayon, recopia la question en lettres majuscules sur un large cercle :
« LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE CAPTIF À HAM DEVIENDRAIT-IL UN GRAND EMPEREUR ? »
Longtemps ses yeux errèrent sur les lettres, et parfois un soupir s’exhalait de sa poitrine en apercevant l’inéluctable arrêt qu’elle y lisait malgré son envie d’y trouver une réponse favorable à nos désirs.
Souvent par la suite ma chère femme m’a évoqué les sentiments qui l’agitaient alors. Voyante, elle cherchait à dépasser sa voyance et, dans la réponse du Destin, à lire les indices du remède que toujours la Providence met à notre portée...
– Évidemment, interrompis-je... il y en avait un pour Louis Napoléon... renoncer !
– C’était bien l’idée du Prince, mais encore une fois il voulait savoir si, avant un nouvel échec, une nouvelle captivité, il serait, comme son oncle « un Grand Empereur » !
Et pour Lysiane comme pour moi, il y avait dans son avènement la solution possible à notre mariage.
La mort dans l’âme, elle se décida enfin à transcrire ce qu’elle lisait en cette phrase :
(Au fur et à mesure que les nouveaux mots se formaient à ses yeux, elle rayait les lettres de ce cercle infernal.)
Penchés sur elle, son père et Évariste lisaient :
« NON, BONAPARTE AU DESTIN IMPÉRIAL NE GARDE UN EMPIRE TRAHI. »
Il paraît qu’à cette traduction mon futur beau-père retrouva dans son désappointement de bonapartiste fervent un mot, historique, depuis Waterloo.
– Et le rabiot... gronda-t-il... toutes ces lettres.
Lysiane, patiemment, les releva dans l’ordre : L.O.U.O.C.P.F.A.V.D.A.L...
– Il y a peut-être la contrepartie... suggéra le père Évariste.
Lysiane intensément regardait ces douze lettres de qui peut-être dépendait un empire, puis, subitement inspirée, forma de ces initiales l’oracle suivant :
« LOUIS OUTREMER UNIT OCÉANS CÔTES PACIFIQUE FRANCE ATLANTIQUE VOIS... »
Quelque temps elle s’arrêta... le mot Dynastie au bout des doigts puis, malgré elle, elle acheva :
« DESTIN ARRÊTÉ LÀ. »
– Que je sois changé en cosaque si j’y comprends goutte...
– On ne comprend jamais... d’abord, formula le père Évariste, sentencieux... Le reste n’est plus de notre ressort... Seulement, ce qui nous concerne, c’est de rapporter cette réponse au Prince... et dame, je n’aimerais pas me voir chargé de cette corvée-là !
– Ne vous en inquiétez pas, mon père, interrompit Lysiane tout à coup décidée ; cette corvée-là, ce sera Louis qui l’exécutera – et j’ai idée que si Dieu permet une solution, c’est lui qui, avec le Prince, la trouvera.
– Amen ! répondit le vieil astrologue.
Précédée de Miroux dont la queue rousse flamboyait dans un rayon de soleil, Hermance, porteuse d’un bol de lait de poule, pénétrait dans la pièce et, nous considérant d’un air réprobateur, questionna :
– N’êtes-vous point trop fatigué depuis une heure que vous parlez, Grand-père ?
– Ça va tout doucettement, Hermance, mais j’arriverai au bout... et se laissant installer pour boire son lait, le vieillard ajouta cette réflexion ambiguë :
– J’en ai du reste plus pour longtemps !
Soutenu par sa petite-fille qui, d’un geste, écarta l’aide que ma femme voulait lui apporter, l’oncle but un peu, puis écarta le bol :
– J’en ai assez !... Tiens, mon gros, tu seras bien servi... aujourd’hui !
Heureux de l’aubaine, le matou, qui avait déjà sauté sur le lit, approcha son nez rose et, sans paraître se soucier du mécontentement de sa maîtresse, commença de laper l’onctueux breuvage.
– Jean est-il là ? demanda l’oncle.
– Non, pas encore... il n’y a qu’Henri, venu avec Eugénie... pour le lait...
– Lucienne, voulez-vous aller lui dire que je voudrais le voir... quand vous m’aurez fait un brin de toilette... J’aurai des visites aujourd’hui.
Comme ma femme descendait dans la grande salle, j’aidai l’ancêtre à recevoir les soins que lui prodigua Hermance, et j’admirai comment, sans bruit, presque sans gestes, la vieille femme arrangeait le moribond, le lavait, le peignait, m’indiquant d’un geste comment le soulever sans presque le remuer...
Fatigué néanmoins par ces préparatifs, le centenaire, une fois calé dans la blancheur des oreillers, parmi le floconnement de ses favoris, s’assoupit un moment.
D’un œil inquiet je regardai ce visage de cire, ces mains diaphanes étendues sur les draps sans qu’aucun souffle de vie parût encore subsister.
Le nez pincé, l’air attentif, Hermance observait, silencieuse.
Miroux se leva, et, précautionneusement, vint flairer la main de son maître ; sous ce léger souffle, celle-ci s’anima pour caresser l’animal qui, rassuré sans doute, ronronna.
Au bout de quelques instants, l’oncle Louis entrouvrit un œil, puis, faiblement, proféra :
– Henri !... et plus bas encore murmura : « Merci, Hermance ! »
Avec un gros soupir, celle-ci se pencha sur le front de l’aïeul et le baisa. Du coin de son mouchoir je la vis essuyer les lèvres du mourant, d’où coulait un peu de salive. Puis, de son même pas tranquille, comme indifférent, elle sortit appeler le bonhomme Henri. Mais furtivement, je la vis s’essuyer les yeux en franchissant la porte.
Bientôt on entendit un pas lourd dans l’escalier, puis apparut la massive silhouette de l’ancien ordonnance qui, me sembla-t-il, esquissa un claquement de talons.
L’oncle ouvrit l’autre œil, et sourit.
– Henri ! souffla-t-il, ouvre le placard que tu sais !
Pesamment, l’homme se dirigea vers un des panneaux de bois sculpté entourant la pièce, manœuvra quelques moulures, poussa un panneau qui pivota découvrant une niche... puis, se tournant vers son ancien chef, parut attendre les ordres :
– C’est à moi qu’ils furent donnés.
– Paul, proféra mon oncle, prends là dedans un paquet de cahiers ficelés, et apporte-les.
L’ordre exécuté et les cahiers déposés sur le drap, le vieillard parut se ranimer ; sa voix même prit de l’autorité.
– Maintenant, Henri, prends la boîte... Il n’y a plus rien ?
– Non, mon commandant.
– Alors referme, et viens ici...
Comme la respiration du vieillard semblait devenir difficile, Henri, qui ne concevait sans doute point d’autre remède, s’avisa de la bouteille entamée la veille et en servit un demi-verre au mourant qui, buvant avec une évidente satisfaction, s’en trouva sans doute ragaillardi, puisqu’il proféra :
– Paul, c’est à toi que je vais remettre ces feuillets... Ils contiennent toute notre science, telle que moi, j’ai pu, en de longues années, la reconstituer.
Les clés antiques pour lire l’avenir, prévoir le temps, les évènements... Tu vas me promettre, devant Dieu qui me recevra tout à l’heure, de te conformer aux indications que je te donne... Ne t’en sers jamais que pour le Bien des hommes, et pour la grandeur de ton pays.
– Tu ne révéleras ces secrets qu’à ceux-là seuls qui en seront dignes – à ton fils... ou à d’autres. Ce sera à toi seul d’en juger, selon ta conscience ; maintenant, je pourrai mourir... le secret de Perrière... sera gardé, n’est-ce pas ?
– Je vous l’ai promis, mon oncle ; moi vivant, nul ne l’aura.
– Pour toi, mon brave Henri, voici quelques napoléons qui t’aideront à finir tes jours tranquille... Je te dois bien ça... et mon neveu aussi – parce que, sans toi, coupa l’oncle pour prévoir une protestation du vieux, jamais le travail que voici n’eut été rédigé. Et, ajouta-t-il à mon adresse, à quoi servirait toute science péniblement acquise si ce n’était pour venir en aide aux hommes ? Mais, vois-tu, s’ils doivent toujours, comme le pensent les vieux d’ici, s’en servir pour se détruire, mieux vaut la tenir secrète.
À toi de juger qui a raison ; ceux qui veulent conserver ici les sciences antiques, ou moi qui désire qu’elles servent à quelque chose... en te confiant le soin de soulever un pan du Mystère de Perrière.
Maintenant, Henri, embrasse-moi... Tu viendras tout à l’heure.
Paul ! prie le père André de monter ! j’ai des petits détails à régler... avec lui... avant de partir...
– Mon oncle...
– J’ai mal calculé... mes forces... alors, lis pendant ce temps-là... le chapitre 9... dans le 2e cahier. Ça t’expliquera bien des choses, et puis tu monteras avec ta femme... et les pères. Je veux vous voir tous ! Va !
Le vieil homme paraissait réellement à bout, et, comme une lampe qui s’éteint et grésille encore un peu en jetant par saccades des lueurs inégales, il semblait prêt à tout instant à fermer définitivement les yeux.
Je me hâtai de descendre.
Dans la grande salle, assis autour de la longue table de chêne ciré ou debout çà et là dans la pénombre, tout Perrière regardait la dernière bougie dont la flamme haute et claire ne dominait plus que dix centimètres de cire.
Henri, qui l’avait apportée, semblait hypnotisé par cette petite vie à laquelle toute une longue existence était, croyait-il, attachée.
Le père André, qui avait revêtu la robe de lin blanc avec étole brodée de deux croix celtiques, comprit immédiatement et, sans que je lui en eusse dit un mot, quitta sa place à ma vue et se dirigea vers l’escalier.
Tous se levèrent tandis que Sa Parfaite Sérénité, portant sous son étole quelque objet sacré qu’il me parut être les saintes espèces, montait lourdement l’escalier.
Au mouvement que firent les assistants, la flamme vacilla et Henri, d’un geste paternel, la protégea de ses mains, de crainte que le léger déplacement d’air ne la fît se consumer plus vite.
J’allai m’isoler près de la fenêtre d’où l’on voyait le portail massif de l’antique abbaye reluire au Soleil, et commençai de lire le chapitre désigné, du 2e cahier de l’Oncle Louis.
CHAPITRE XIV
« CHAPITRE 9 DES CAHIERS DE LOUIS FUTAIES »
Ce fut à l’occasion de son anniversaire, le 20 Avril 1846, que je fus autorisé par le commandant Demarle, gouverneur du Fort de Ham, à rendre visite au Prince pour lui présenter les vœux de ses partisans.
Les instructions qui m’avaient été données par M. de Chamou et les anciens de Perrière étaient précises.
Il fallait, en commentant à l’illustre prisonnier la Révolution solaire de sa 39e année, lui démontrer que les conjonctures astrales étaient favorables à une évasion ; il fallait qu’il acceptât d’en assumer le risque dans les conditions minutieusement étudiées pour mettre toutes chances de son côté, non seulement dans l’immédiat la sortie de Ham –, mais aussi dans l’avenir, pour s’assurer la couronne impériale.
Grâce à quels appuis inconnus ai-je obtenu sans difficultés le permis de communiquer sollicité du gouvernement royal, je ne l’ai jamais su, le prince n’étant du reste nullement au secret dans sa prison. Chacun, il faut le dire, à commencer par le commandant Demarle, gouverneur du fort, s’efforçait de lui rendre la captivité aussi douce et agréable que possible. Même les visites féminines les moins protocolaires lui étaient autorisées, et sa liaison avec une fille, Éléonore Vergeot, dite la belle Sabotière, n’était un mystère pour personne.
Le docteur Conneau son ami, et son valet de chambre Thélin, étaient autorisés à partager la captivité de Louis Napoléon, sans pour cela être soumis à la condition de prisonniers.
Ma visite était donc attendue, et, m’ayant à peine laissé le temps de lui présenter mes respects :
– Alors, mon bon ami, quelles précieuses nouvelles m’apportez-vous ? me demanda le prince en me désignant un siège auprès du sien devant la grande table bureau surchargée de papiers et de livres.
– Nos amis m’ont chargé d’informer votre Altesse impériale que ce trône auquel Elle aspire comme son héritage serait en France extrêmement menacé.
– Un trône n’est pas une bergère dans laquelle on puisse somnoler, répliqua Louis Napoléon, et je suis disposé à tout tenter pour le gagner.
– Tout tenter... oui... mais il y a une puissance que l’on ne peut tenter : c’est celle du Destin.
– Que voulez-vous dire ?
– Ceci, et je prie respectueusement Votre Altesse de croire que l’avis que je me permets de Lui apporter émane de ceux de ses fidèles amis qui souhaitent de tout cœur la réussite de Ses projets.
– Ouais !
M’enhardissant, conscient de la haute Mission qui m’avait été confiée, je poursuivis :
– L’Horoscope qui fut fait de votre Altesse lui promet bien un trône, et si Elle me le permet, je Lui montrerai que Sa chance Royale est prochaine. La voici, dis-je en sortant de ma serviette le tracé ci-contre du thème impérial :
Chance Royale en VIIe Maison, jointe à Vénus maîtresse de l’année natale 1808 en Scorpion et Mars, c’est-à-dire pour votre 43e année – 1852 – année de Mars précisément...
– Et j’entre aujourd’hui dans ma 39e !... Je suis prisonnier à l’âge où mon oncle commandait à l’Europe !
– Il vaut mieux commencer plus tard et ne pas finir comme lui... Or, voyez, cette Chance Royale est dans le Scorpion en carré du Lion, signe qui régit la France et de votre chance de voyage sur mer en Xe dans le Verseau... en Trigone d’Uranus maître du signe...
– Je veux bien, mais comme je n’entends rien à tout cela, voulez-vous me dire où vous voulez en venir ?
– À ceci, Altesse : c’est que ce Trône ne vous attend pas en France mais outre mer – en Verseau – signe opposé, et complémentaire, au Lion.
– En Amérique ?
– Précisément !
– Nos illustres amis m’en avaient déjà informé il y a quatre ans, et j’ai pris leurs conseils à ce point au sérieux que j’ai cherché le moyen de m’y conformer... et tenez... voici la réponse...
Se retournant, le captif attrapa derrière lui un volumineux dossier qu’il ouvrit, et, me montrant les pièces une à une :
– Ceci est un projet de canal transocéanique proposé en 1844 au Gouvernement du Nicaragua en vue de l’aménagement du Rio San Juan qui fait communiquer le lac de Nicaragua avec la Mer des Antilles, et le percement de l’étroite cordillère séparant le grand lac – de faible altitude – du Pacifique.
– Génial ! m’écriai-je.
– Après de longues correspondances, le président de cette république, assuré de pouvoir trouver des appuis financiers, adressa au roi Louis Philippe une demande d’élargissement en ma faveur, pour que je puisse, en personne, diriger les travaux.
Voici la copie de la lettre... mon ami – et voilà celle du gouvernement français.
Enrobée des plus protocolaires formules de regrets, c’était une fin de non-recevoir pure et simple, arguée par la raison d’État qui ne saurait admettre la mise en liberté d’un prétendant ayant à deux reprises tenté un soulèvement contre le gouvernement royal.
Comme je paraissais assez déferré, le prince me frappa amicalement sur l’épaule et me dit :
– Alors,... puisque Louis Philippe ne veut pas m’ouvrir la porte, il va falloir sortir par la fenêtre !
– C’est bien le projet que j’étais venu soumettre à votre Altesse Impériale !
– Dites-moi ça ?
– Le stratagème qui a réussi au comte de Lavalette,... une dame, de nos amies, qui a la même taille que vous... et qui obtient une audience... Vous changez de vêtements, on vous maquille, elle s’affuble de fausses moustaches, d’une perruque taillée à la mode de votre coiffure et joue votre rôle jusqu’à ce que vous ayez passé la frontière !
– Non, si ça rate je me ridiculise à jamais !
– Nous avons aussi préparé un autre truc, également basé sur une substitution de personnage, mais il sera plus difficile à réaliser... parce que les hommes qui entrent et sortent d’ici sont en général connus, sinon examinés, dévisagés... par une garde sévère... j’y ai passé avant d’être admis auprès de votre Altesse.
Un long moment le prince demeura rêveur... puis :
– Qu’en pensent nos augures ?... Je leur avais posé une question précise.
Un peu gêné, je sortis de mon portefeuille la réponse tirée par Lysiane à la question « LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE CAPTIF À HAM DEVIENDRAIT-IL UN GRAND EMPEREUR ? »
« NON. BONAPARTE AU DESTIN IMPÉRIAL NE GARDE UN EMPIRE TRAHI. »
Pas un muscle du visage du prince ne décela la moindre émotion devant cet arrêt brutal du Destin.
– Et ça ? fit-il en me désignant les dernières lettres.
– Ça, ce sont les lettres inemployées de votre question, après que notre devineresse eut tiré la sentence que voilà... dans l’ordre même où elles demeuraient dans la phrase.
L. O. U. O. C. P. F. A. V. D. A. L.
– Il fut déjà expliqué à votre Altesse comment ces lettres deviennent – par voyance – les initiales de mots qui expliquent l’oracle...
– Je sais, l’exemple de mon oncle l’Empereur m’est connu. C’est pourquoi j’ai foi dans les Lumières des Anciens de Perrière !... et... que dit la... druidesse ?
– Pas encore,... Altesse... pour l’instant elle n’est que ma fiancée – qui attend un état-civil... de Sa Majesté l’Empereur.
– Il faut donc que je me dépêche de le devenir, fit le Prince en souriant.
Il ne quittait pourtant pas des yeux la traduction des mystérieuses lettres.
Louis Outremer Unit Océans Côtes Pacifique France Atlantique Destin Arrêté Là.
– L’embêtant, c’est que le refus de Louis Philippe l’arrête précisément là ! murmura le prisonnier.
Tout en réfléchissant devant les mots sibyllins, Louis Napoléon s’était saisi d’un crayon et, comme machinalement, ayant recopié la question, biffait l’une après l’autre les lettres dans l’ordre où Lysiane les avait prises, il transcrivait verticalement au-dessous
Bonaparte restent L
Au O
Destin U
Impérial O
Ne C
Garde P
Un F
Empire A
Trahi V
D
A
L
Je regardais en silence cet homme qui, là devant moi, aussi calme que s’il s’agissait d’une réussite, épluchait les mots sévères qui le condamnaient plus sûrement que les juges du roi.
Puis il s’avisa de prendre à son tour les premières lettres de la phrase et les écrivit en majuscules :
B A D I N G U E T
– Ça ne veut rien dire... murmurai-je.
Le prince me considéra de ce regard étrange – comme absent – qu’il avait souvent, et, de sa voix unie :
– Le reste non plus ne veut rien dire, à ce compte-là... et pourtant, Futaies, mon ami, ajouta-t-il dans un sourire... ce mot-là veut dire pour moi : Liberté...
– Je ne comprends pas !
– Mais si, fit Louis Napoléon en se levant pour marquer la fin de l’audience : le Destin Impérial trahi qui menace Bonaparte épargnera Badinguet, qui s’évadera... grâce à vous, mes amis... et c’est ce monsieur Badinguet que vous accueillerez bientôt... Vous êtes ingénieur des chemins de fer, Futaies ?
– Oui, Altesse.
– Alors quand vous recevrez un télégramme signé de ce nom – venez me chercher... là où Conneau vous le dira !
En me serrant la main, le Prince me congédia avec un : « Toute ma gratitude à nos amis. »
Ce que j’ignorais alors, c’est que depuis le 15 Mars l’évasion du prince avait été décidée entre Montholon, le Docteur Conneau et le valet de chambre Thélin.
Des travaux de réfection avaient été entrepris dans les vétustes bâtiments du fort et, presque chaque jour, le prince, vêtu d’une capote bleue, coiffé d’un bonnet de police, allait, sous couleur de se distraire, regarder travailler les maçons.
Le 15 Mai, un billet me parvint, ainsi conçu :
« PRENDRAI LE TRAIN À ST-QUENTIN – RÉSERVEZ PLACES – LETTRE SUIT.
BADINGUET. »
Dès lors, je trouvai indispensable d’effectuer certaines vérifications sur la ligne, et m’établis à l’hôtel de la Gare, en attendant, anxieux, le signal définitif.
Le Jeudi 23, Thélin vint me porter le mot décisif, ainsi conçu :
« ATTENDEZ BADINGUET GARE VALENCIENNES SAMEDI. »
Heureusement que j’avais organisé, en prévision de l’évasion, tout un programme de visites de matériel entre St-Quentin et la frontière belge... Le valet de chambre acheta en ville une blouse et un pantalon de maçon, des sabots, une casquette et, sous ma garantie, loua un cabriolet qu’il devait garer à Ham... en vue de l’évasion, fixée au Samedi 25....
À son départ, Thélin me remit deux passeports anglais que je remettrais moi-même au prince et à son dévoué domestique une fois seulement sous ma sauvegarde, dans la gare de Valenciennes.
Je ne dormis guère cette nuit-là. Dès le Vendredi, j’étais au dépôt de Valenciennes à vérifier des stocks de charbon, pour ne pas manquer l’arrivée de mes « clients ».
Il y a bien 30 lieues de Ham à Valenciennes et, partis dès l’aube en cabriolet, ceux-ci ne pouvaient guère arriver que pour le train du soir dans la ville des dentelles. En admettant qu’ils y soient à 4 h., c’était un minimum. S’ils manquaient le train de 6 h. 1/2 pour Bruxelles, je les ferai coucher dans ma propre chambre, car l’alarme une fois donnée à la frontière, les voitures seraient sévèrement visitées.
Bien m’en prit. À 4 h. 20 mes deux voyageurs descendaient de la chaise de poste à l’Hôtel des Messageries, et je m’empressai de les conduire à la gare où je savais comment les dissimuler jusqu’au départ du train.
Le prince avait rasé moustaches et barbiche, son teint mat avait été rougi et deux favoris postiches encadraient ses joues – pour le rendre d’aspect plus conforme au type d’anglais conventionnel décrit sur le passeport qui m’avait été remis.
Louis Napoléon, du reste, ne cessait de me parler anglais, et je lui répondais par des « very well » et des « yes indeed », les seuls mots que je sache de la langue de Shakespeare – ceci à l’intention d’éventuelles oreilles indiscrètes.
Tout se passait donc le mieux du monde lorsqu’en arrivant à la gare, Thélin, portant la valise du prince, se vit interpellé par un employé.
– Ah ça, par exemple !... si je m’attendais ! Tu n’es donc plus à Ham ?
– Comme tu le vois... Et toi, tu as quitté la gendarmerie pour les chemins de fer ?
– J’en avais assez, j’ai demandé ma retraite pour être embauché ici comme surveillant... on est tout de même plus libre... et j’ai ma famille ici.
– Eh bien, tant mieux... tenta de couper le valet de chambre. Mais l’ex-gendarme ne le lâchait pas...
– Ainsi, il n’y a pas longtemps que tu as quitté ton Napoléon... il voit toujours la « belle Sabotière ?... »
– Je le suppose... J’en avais assez moi aussi de moisir en prison, même à titre volontaire... J’ai fait comme toi, donné ma démission – et me voici au service d’un milord... c’est plus agréable... on voyage...
– C’est un vrai milord ?...
– Probable !... coupa sec Thélin pour venir nous rejoindre...
Il était blême ; et nous ne devions guère avoir meilleure mine... car tous trois ignorions encore les noms portés sur ces passeports qui devaient faire de Thélin – comme du prince – des sujets britanniques !
En sécurité, toute relative, dans le wagon qui me servait de bureau ambulant, le prince me raconta alors les péripéties de son évasion. Je répète ici ce récit historique tel que je le tiens de la bouche même de son héros.
« Mon évasion avait été fixée à ce samedi dans l’espoir qu’elle pourrait être cachée jusqu’à demain et... m’assurer ainsi plus de liberté de manœuvre, m’expliqua Louis Napoléon.
« Dès l’aube je me suis levé, j’ai rasé moustaches et barbe. Grimé par Madame de Montholon, je revêtis par-dessus mes vêtements le pantalon de toile et la blouse de maçon achetés par Thélin, artistement salis à l’avance. Puis j’attendis, caché au petit endroit, que Conneau me fît signe.
« Dans mon lit, un mannequin coiffé d’un bonnet de coton me remplaçait.
« Il était entendu que j’étais malade et que mon médecin veillerait à ce qu’on ne troublât point mon repos.
« À 6 h. 1/2 les maçons chargés de refaire les murs de mon logis se présentèrent avec leur matériel d’échafaudage. Thélin leur fit signe de ne point faire de bruit, et les fit même entrer dans mon bureau pour leur offrir un verre d’eau-de-vie – histoire de les faire patienter jusqu’à ce que le « malade se réveillât ».
– Je leur ai même montré, en entrebâillant la porte, votre Altesse endormie, avec Monsieur le Docteur à son chevet ! compléta Thélin.
« Pendant ce temps-là, poursuivit le prince, je sortis de mon réduit, m’emparai d’une planche d’échafaudage et, la pipe au bec, me dirigeai vers la porte du fort.
« L’officier de garde – occupé à lire – ne fit pas même attention à moi, mais le sergent s’approcha pour reconnaître ce maçon qui sortait emportant une planche, alors que les ouvriers arrivaient au travail, et apportaient au contraire des matériaux... Ma planche lui cachait ma figure. Néanmoins, comme il était prudent d’écarter cet importun, je dirigeai – par négligence – le bout de ce fardeau vers lui, ce qui lui fit faire un bond en arrière afin d’en éviter le contact brutal par la figure.
« Cependant les hommes de garde me dévisageaient dangereusement, le tambour même, méfiant peut-être, s’approcha de moi. Je laissai alors tomber ma pipe de terre et me baissai, la planche toujours en équilibre sur l’épaule, pour ramasser en jurant les morceaux de ma bouffarde.
« – Ah ! c’est toi, Berthoud ? fit-il...
« – Non, Badinguet ! répondis-je en me relevant et, sans plus de difficultés, je franchis la poterne, puis d’un pas normal gagnai le proche estaminet où mon fidèle Thélin vint me rejoindre avec le cabriolet loué, par vos soins, à St-Quentin !
« Bon train et sans encombre, nous arrivons en ville.
« Je me défis alors de mon costume de maçon que je jetai dans un fossé, descendis au Faubourg Nord, tandis que Thélin allait rendre notre équipage à son propriétaire et retenir deux places dans la chaise de poste pour Valenciennes. »
– Il eut été préférable de nous en tenir à notre projet initial, fis-je remarquer. À la gare de St-Quentin j’aurais installé votre Altesse dans le compartiment réservé aux agents supérieurs de la Cie, et, en ma société, nul contrôle indiscret n’aurait risqué de vous importuner.
J’avais même pris des dispositions pour vous transformer tous deux en cheminots, et vous avais préparé un ordre de service pour convoyer du matériel jusqu’à la frontière, si l’alarme avait été donnée à la gendarmerie.
– En effet, admit l’évadé, c’eut été préférable, car la chaise de poste étant en retard, moi, qui l’attendais à la sortie de St-Quentin au-delà du poste de police, me morfondais en redoutant l’avoir manquée.
« C’est alors que, par ma faute, j’ai couru le plus gros risque, poursuivit le prince.
« Ne voyant rien venir, j’avisai un cabriolet se dirigeant vers la ville pour demander au conducteur s’il n’avait pas croisé la chaise...
« L’homme s’arrêta sur mon signe... et je me sentis défaillir en reconnaissant... je vous le donne en mille... : le Procureur du Roi qui, à maintes reprises, était venu me voir en ma prison, notamment pour m’apporter le refus opposé à la demande d’élargissement présentée par le gouvernement du Nicaragua.
« – Nom d’un chien !
« Il me fallait payer d’audace, et, saisi d’une inspiration subite, je demandai en patois picard : Pardon, Monsieû, Vs’auro pas rencontré c’ chaise ed poste por Valenciennes ? J’ons peur d’lavoir minquée !
« – Non, mon ami, je ne l’ai pas vue, me répondit le magistrat qui, d’un claquement de langue, remit son cheval en route...
« Je m’épongeai le front ; j’avais eu une de ces frousses ! » conclut Louis Napoléon.
– Votre Altesse a eu du reste la chance de tomber sur un homme étranger au pays, car un vrai « chti mi » n’aurait pas prononcé ainsi... et cela eut éveillé les soupçons du procureur ! observa Thélin.
« La chaise arrivait cependant au galop de ses chevaux. Je fis signe... Comme mon brave Thélin avait averti le postillon d’avoir à charger là un voyageur... il ralentit... empocha la pièce de cent sous que je lui tendis... Ce qui ne l’empêcha pas de grogner : « Allons, fais vite et ne nous emmerde pas ! » pour m’inciter à grimper en vitesse dans la voiture avant même qu’elle s’arrêtât tout à fait. (Historique.)
« Le reste du voyage s’effectua sans histoire... et me voilà... »
– Plaise au ciel que la fin s’achève de même, Monseigneur !
L’heure du train approchait... je passai sur le quai pour aller donner quelques instructions au chef du matériel et prendre congé.
Des gendarmes doublaient les agents de la compagnie aux portillons, deux autres déambulaient sur le quai... Nul doute, l’alerte avait été donnée par télégramme et les postes frontières devaient être renforcés... Le chef de gare auquel je fis mes adieux me renseigna : « Il paraît que le prince Napoléon s’est sauvé de Ham... Toutes les gendarmeries, les polices, sont alertées... le commandant de place ordonne l’installation de postes de police à toutes les sorties de la ville... Je rirais bien s’ils étaient bredouilles et que leur prisonnier leur glisse entre les doigts... »
– Vous êtes bonapartiste ? fis-je avec un clin d’œil complice.
– Moi ? je suis républicain... et pour la liberté !... Alors quand un gars qui n’est pas un voleur se sauve de prison... ça me plaît !
Le train était annoncé. En compagnie du chef de gare, je me dirigeai vers le bureau où j’avais laissé mes deux évadés :
– J’ai rencontré ces Messieurs, ingénieurs des chemins de fer anglais...
– Enchanté, messieurs !
– Very glad to meet you ! répondit le prince.
Déjà le train stoppait le long du quai. En hâte je fis monter dans un compartiment de première mes « ingénieurs anglais » et me tins devant la portière, conversant encore avec le chef, sans que bien entendu les gendarmes eussent l’idée d’interpeller des voyageurs qui semblaient en aussi bons termes avec les autorités ferroviaires, puis, sans autre incident, nous partîmes et franchîmes la frontière, moi avec ma carte du réseau, ces messieurs avec leurs passeports.
La police vérifiait les papiers. Les nôtres étaient plus qu’en règle, et ma présence couvrait les compagnons, avec lesquels je bavardais d’autant plus cordialement que je ne comprenais pas un mot de ce que me disait le prince. – Je lui répondais : « Aoh Yes, good night, very well, five o’ dock !... » qui sont les seuls mots que je sache de l’idiome d’outre-Manche.
La frontière franchie, je descendis à la première station pour rentrer en France ; tandis que mes « anglais » poursuivaient sans risque leur route vers Bruxelles.
*
* *
Comme nous en arrivions à ce point de notre lecture du cahier, Philippe vint nous avertir :
– Cousins... Je crois que l’on va bientôt vous appeler... Le père Jean vient de faire entrer le père Mathieu, le meilleur ami du « Grand-Père » et... en bas... la dernière bougie, celle du vieil Henri, vous savez !...
– Oui, Philippe, c’est lui-même qui m’a raconté l’affaire de Châteaudun...
– Alors... quand vous voudrez !...
Doucement le jeune homme referma la porte de notre chambre et... rapidement, nous lûmes les dernières phrases de ce fameux chapitre IX.
« Le lendemain Dimanche, par le premier train, je débarquai gare du Nord et me fis conduire rue Boursault, aux Batignolles, où je savais que se réunissaient nos amis !
« Je devais leur rendre compte de ma mission... et je comptais bien, maintenant que le succès avait couronné l’évasion du Prince – condition primordiale mise par M. de Chamou à mon mariage – soulever aussi cette question-là !
« Une dizaine de personnes étaient réunies dans cette petite maison d’un quartier excentrique.
« À ma mine, un Ah ! de satisfaction s’épanouit. Tous, bien entendu, étaient au courant de l’évasion dont les journaux du matin avaient fait grand état.
« Le Constitutionnel l’affichait en manchette.
« Sans omettre un détail du récit fait par le Prince lui-même, je racontai les péripéties de l’évasion, tandis que j’apprenais l’arrestation de Messieurs Conneau et de Montholon, et la comédie qu’ils avaient jouée au gouverneur jusqu’à midi... Celui-ci, alors de plus en plus soupçonneux en face de ce malade prétendument « dérangé », mais obstinément enfoui immobile sous ses couvertures, se décida à soulever le drap et constata avec fureur qu’une paire de polochons avaient remplacé le prétendant au trône impérial !
« Toutes les personnes réunies rue Boursault, bonapartistes ferventes et adeptes du groupe druidique, exultaient de joie ! On me cajolait, me complimentait...
« Je n’attendais que cet instant pour exposer mon point de vue personnel, en public, à M. de Chamou !
« – ... En somme, l’un des atouts maîtres dont nous avons disposé consistait en deux faux passeports anglais... si bien imités que la police alertée, et la douane, n’y ont vu que du feu... Alors, comment se fait-il que l’on puisse fournir des papiers anglais ressemblant comme jumeaux à des vrais à deux hommes dont l’un est connu et fiché, et qu’une jeune fille ne puisse se marier faute d’une pièce d’état-civil, parce que, Lysiane – et cette fois je lâchai tout à trac le nom de Mlle de Chamou –, née à Perrière, n’existe légalement point ?
« – Ma fille ? s’exclama d’un air ironique M. de Chamou... mais voici huit mois qu’elle s’appelle légitimement Madame Louis Futaies !
« Et à mes yeux stupéfaits, le terrible homme, sortant son portefeuille, exhibait l’acte de naissance de Lysiane et le certificat de mariage célébré le 28 Octobre 1845 – pièces apparemment authentiques et timbrées de la mairie de Leffrinckoucke (Arrondissement de Dunkerque) Nord !
« Comme, ahuri, je considérais ces documents qui faisaient de moi, à mon insu, l’époux de sa fille, mon « beau-père », avec son sourire de coin, voulut bien m’informer :
« – La Mairie et l’Église de Leffrinckoucke ont été anéanties par une tempête qui les a ensevelies sous le sable des dunes... Ne m’en demandez pas davantage... Pas plus que vous, Lysiane et moi n’avons jamais mis les pieds dans ce coin de Flandre ! »
On frappait à la porte :
– Cousins... si vous le voulez bien... invita Philippe.
CHAPITRE XV
Lorsque, précédés de Philippe, nous entrâmes dans la chambre de l’oncle Louis, nous la trouvâmes pleine de monde. Hermance était assise à la droite du lit où reposait le mourant.
La figure de celui-ci avait déjà pris cette sérénité dont la majesté s’inscrit sur le visage de ceux qui sont partis, l’âme tranquille, se présenter devant le Souverain Juge.
Ses yeux cependant demeuraient vivants, et se tournaient vers la fenêtre toute lumineuse d’un beau jour d’été.
Autour de lui, sans ordre apparent, les Pères, en robe blanche.
Tout le collège druidique au grand complet, auquel, je ne le sus que plus tard, l’aïeul venait de faire sa confession. Il avait reçu de chacun l’absolution suprême.
Derrière nous, le vieil Henri lui aussi était entré, pieds nus, estimant sans doute que ses gros brodequins sales étaient indécents.
L’atmosphère était curieuse... l’on n’eut pu dire funèbre, grave tout au plus, voire recueillie, comme à l’église au moment solennel du Pater.
On sentait plutôt le désir d’honorer un vieil ami que l’angoisse de le voir partir pour toujours.
Ma femme me dit plus tard qu’elle avait compris à ce moment la valeur du titre de « Sérénité » que portaient les druides de Perrière.
Le regard du vieillard se porta sur nous trois, les derniers entrés, constata que tous ceux qu’il avait voulus présents à ses derniers instants humains étaient là, et, estimant que c’était bien ainsi, un sourire heureux s’épanouit sur son visage de cire.
– Henri, dit-il,... viens là...
Nous nous écartâmes pour laisser approcher l’humble compagnon de l’oncle.
Sur un signe, il se pencha... tout près... tout près... et reçut, de bouche à oreille, quelque suprême confession sans doute, car, en se relevant, il fit à son tour, au-dessus de son cher « commandant », le signe sacré du Pardon, à la manière druidique : la Croix et les Trois Cercles. Puis il se tint immobile à la tête du lit.
Invité d’un regard, je m’approchai à mon tour. L’oncle Louis me demanda :
– Tu as lu ?
– Oui, mon oncle ! Je suis très sensible, croyez-le, à l’honneur que vous me faites en me confiant ce secret historique.
– Celui-là et bien d’autres, contenus dans les cahiers – que tu emporteras – ... Maintenant, j’ai une prière à t’adresser... à vous adresser à tous deux... Vous allez travailler les données que j’ai rassemblées en soixante ans de méditation sur notre science millénaire. Jamais elles n’ont été écrites – et jamais elles ne devront tomber entre des mains étrangères... aux Nôtres !
– Je vous le promets, mon oncle.
– Je n’en doute pas, mon garçon, mais ce travail pour lequel je me suis retranché du monde depuis 1871 ne doit pas demeurer inutilisé... Tu y trouveras les clés permettant de prévoir longtemps d’avance les évènements, le Temps qu’il fera... Il faut que la connaissance que tu en tireras serve aux hommes de notre Patrie...
– Mais comment voulez-vous, mon Oncle ?
– Je t’en laisse juge... Paul ; ma volonté est que cette divulgation – par tes soins – protège nos frères... Tu dois te pénétrer de cette méthode... pour épargner à la France des malheurs comme ceux qu’elle a subis... annoncer les intempéries – les dangers de toute sorte, comme les prospérités. Nous avons tenté de le faire auprès de ceux qui gouvernèrent ce pays... Ils ne nous ont pas écoutés... même les empereurs que nous avions aidés...
Tu t’adresseras à la foule, aux petits, aux paysans, à tous ceux qui travaillent pour arracher à notre Sol ce qui nous fait vivre... C’est leur confiance qu’il faut gagner...
Nous nous étions trompés... la Gaule, ce n’est pas ceux qui gouvernent, ce sont tous ceux qui peinent de leurs mains ou de leur cerveau... Ils ne sont pas plus bêtes... mais ils ont plus de cœur...
Voilà, j’ai fini ! Je vous prie, tous deux, de remplir la mission que le Temps et mon isolement ne me permettent plus de terminer moi-même...
– Nous l’acceptons, mon oncle, fit Lucienne, tandis que j’hésitais devant l’énormité de la charge confiée par ce parent inconnu quelques jours avant, et qui, à sa dernière heure, faisait de nous ses exécuteurs testamentaires.
– La promesse faite à un mourant est entendue de Dieu ! observa le père Jean.
Le regard du vieillard, à la fois volontaire et implorant, s’était vrillé dans mes yeux.
– Nous vous aiderons... mon frère ! insista le père Jean...
– Je vous le promets, mon oncle !
Le vieil homme parut rasséréné, mais insista encore :
– Tu jures de ne rien révéler de ces secrets dont il puisse être fait mauvais usage selon ta conscience ?
Je sentais peser sur moi tous les regards de ces vieux hommes attentifs à ma réponse – comme des juges.
– Je le jure ! fis-je en levant la main face au mourant.
L’oncle ferma les yeux, et ses lèvres parurent prononcer quelques paroles... qui n’étaient plus à l’usage des humains.
Un pieux silence régnait dans la pièce. Inquiet peut-être, Miroux sauta sur le lit. Précautionneusement il vint flairer les mains ivoirines de son maître, et s’assit contre elles, les effleurant de ses moustaches.
La respiration du vieillard se faisait peu à peu plus saccadée, non pas haletante, car on l’entendait à peine, mais l’oppression devenait sensible.
À voix basse, presque dans un souffle, il appela...
– Ma nièce ?
– Je suis là... vous désirez, mon oncle ?
– Chantez-moi quelque chose !
Lucienne ouvrit de grands yeux, tellement surprise de cette requête inattendue qu’elle pensa à une manifestation de délire.
Le père Mathieu s’approcha... prit le pouls du centenaire, qui protesta faiblement :
– Laisse... je suis en règle, n’est-ce pas... alors, avant de partir... je voudrais entendre... de la musique. Ma nièce, s’il vous plaît, une chanson !
Ces mots étaient à peine perceptibles... mais chacun les devina, et ma femme interrogea du regard le père Jean, Hermance, dont maintenant de grosses larmes sillonnaient les joues, quêtant à la fois leur approbation, et une inspiration. Prise au dépourvu, elle ne savait réellement pas quelle chanson pourrait n’être point choquante en pareille circonstance.
Une mélodie de Raynaldo Hahn lui vint aux lèvres. Elle commença, mezzo voce :
À deux pas de la mer, qu’on entend murmurer
Il est un coin perdu de la terre bretonne
Où j’aurais tant aimé, pendant les jours d’automne...
Les yeux clos, l’oncle Louis paraissait s’assoupir... La respiration était si faible qu’à peine son menton se soulevait, faisant trembloter ses longs favoris blancs...
En face de ma femme, le chat la contemplait avec intérêt, comme si cette audition lui avait été spécialement dédiée.
Pensant que le vieillard s’était assoupi, Lucienne se tut... n’osant poursuivre.
L’oncle pourtant écoutait, comme écoutent les mourants dont il semble que tout ce qui peut leur rester de sensibilité se réfugie dans leurs facultés auditives.
Le soleil haut dans le ciel dorait le pelage de Miroux et accrochait un rayon sur la neige des favoris mousseux, dessinait la dure arête du long nez de l’aïeul, accentuant le cerne des yeux clos... Et moi, qui vis mourir bien des hommes au cours de ces deux guerres, regardais cette fin-là avec étonnement et enregistrais tous les visages, leurs expressions, ainsi que l’atmosphère de cette scène extraordinaire :
Des gens liés par l’amitié ou par l’affection familiale à ce moribond assistaient, religieusement mais sereinement, à sa lente désincarnation, comme ils auraient assisté en l’observant à une expérience de physique dont le processus leur eût été connu.
Le sentiment de gravité l’emportait sur celui de tristesse.
Alors, dans un silence, on perçut nettement le désir suprême, à peine murmuré :
– Encore, ... je voudrais... une chanson d’amour !
Lucienne ne s’étonnait plus de rien, et, à voix retenue cependant, commença son air favori : celui du « Pays du Sourire ».
Je t’ai donné mon cœur,
Tu tiens en toi, tout mon bonheur,
Sans ton baiser il meurt,
Car sans soleil, meurent les fleurs,
À toi mon beau chant d’amour...
Un pâle sourire parut s’esquisser aux lèvres du vieillard... il avait l’air heureux !
Une dernière fois sa bouche s’entrouvrit sur un mot, le seul qui eût rempli sa longue vie : Lysiane !
Une crispation des doigts... ce fut tout. L’âme du mourant s’était envolée dans la lumière dorée de ce beau jour d’été !
D’un geste large, le père André traça au-dessus du lit le signe sacré...
Philippe ouvrit la fenêtre. Le chant des oiseaux pénétra dans la pièce, apportant son hommage au suprême désir du mort : ne pas partir sans un peu de musique.
Et nous deux, seuls, parents quasi inconnus, ne pûmes retenir de grosses larmes.
Miroux se coucha en travers du corps de son maître chéri, et demeura là.
C’était le 20 Juillet 1943, 4 heures après-midi.
La journée du lendemain avait passé dans les préparatifs de funérailles, dont les rites nous paraissaient insolites.
En effet, dans la grande salle du rez-de-chaussée, vêtu de sa robe blanche, assis droit, hiératique dans le fauteuil à haut dossier, maintenu par d’invisibles liens, était assis le druide BOD KOAD, nom qui, – je l’appris alors – signifie en celte : Bouquet d’arbres (traduction de Futaies).
Autour de lui s’amoncelaient les branches de chêne que chaque visiteur venait déposer à ses pieds, tandis qu’une touffe de gui, suspendue à la maîtresse poutre, se balançait au-dessus de sa tête.
Assis à la droite du mort se tenait, pareillement vêtu de la robe de lin blanc, l’un des cénobites de Perrière, et à sa gauche un membre de la famille, se relayant à tour de rôle pour recevoir les nombreux visiteurs venus saluer l’ancêtre avant le Grand Départ.
L’impression était celle d’un suzerain recevant l’hommage de ses vassaux.
Aucune bougie, aucun luminaire quelconque, n’apparaissait à cette funèbre veillée.
Le feu, même, du foyer, était éteint. Comme ma femme s’en étonnait, Hermance lui expliqua que le mort étant parti vers la Lumière, aucun feu ne devait plus brûler en sa présence ici-bas.
Sur la table demeurait en face de lui le chandelier encrassé des restes de cire des ultimes bougies consumées durant la veillée.
Ce mort, assis entre ses amis, comme en réception, l’absence de cierges, d’eau bénite, le rite observé par les arrivants qui s’agenouillaient devant le défunt le priant de leur accorder une bénédiction – donnée par les deux assistants en son nom – tout ce cérémonial, ces rites inconnus de nous déroutaient notre conception d’une veillée funèbre, mais paraissaient tellement logiques que bientôt nous les vivions comme si leur symbolisme nous avait été expliqué depuis l’enfance.
Ce dimanche passa rapidement, parmi toutes les occupations préliminaires aux funérailles : l’office célébré en plein air par le père André, avec la communion sous les espèces du pain et du vin donnée à tous ceux qui venaient de s’incliner sous le geste absolutoire, comme dans la primitive Église.
Les Prières rituelles étaient dites en vieux français, mais selon un cérémonial inconnu de nous. Les répons étaient donnés par toute l’assistance sans que l’officiant eût recours à un desservant.
Un desservant... Non, si l’on entend par là le rôle joué par l’enfant de chœur dans le culte catholique, mais une jeune fille se tenait près d’un petit bûcher, et l’alluma, dès l’arrivée de l’officiant. Elle lui offrit l’eau, le pain, le sel, et le vin, mais sa participation se borna à l’entretien du Feu sacré durant le service divin.
Quelques personnes étrangères à ce curieux village de Perrière assistaient à la cérémonie : je reconnus Courier et sa femme, et l’un des voyageurs du car, parmi une douzaine de visages encore inconnus.
Après la messe, nous déjeunâmes chez le Père Mathieu. Une partie de l’après-midi fut employée à notre instruction de ces mystères auxquels nous étions admis.
– C’est vous qui porterez maintenant ce nom de BOD KOAD, mon cher ami, décida l’ancêtre, Jean. Il vous vient de droit, par votre nom, d’abord !
– Que voulez-vous dire ?
– Louis vous a expliqué, n’est-ce pas, que Futaies se traduisait en chiffres par le nombre 132 ?
– Oui, mon Père ; il m’a même laissé cette clé numérale des lettres, et la façon de les coter en attribuant à l’initiale le coefficient le plus élevé.
– Voulez-vous, de cette façon, chiffrer votre nom ?
– Volontiers, mais je n’ai pas encore ces correspondances en tête.
– Je vais vous les souffler... Écrivez :
Docilement, sur mon carnet, j’inscrivis à côté des lettres de mon nom les chiffres dictés par le vieillard, et les affectai de leur coefficient.
B = 2 x 7 = 14 F = 8 x 7 = 56
O 7 x 6 = 42 U 6 x 6 = 36
U 6 x 5 = 30 T 4 x 5 = 20
C 2 x 4 = 8 A 1 x 4 = 4
H 8 x 3 = 24 I 1 x 3 = 3
E 5 x 2 = 10 E 5 x 2 = 10
T 4 x 1 = 4 S 3 x 1 = 3
____ ____
132 132
– Le même nombre que FUTAIES ! s’exclama Lucienne.
– Et que signifie votre nom ?
– Bouchet, ou bosquet, ou bouquet (d’arbres) ; certains lieux sont appelés encore « Le Bouchet ».
– C’est tout ce que je voulais vous faire dire. Vous voyez que Futaies et Bouchet peuvent se traduire par Bod Koad ou Bouquet d’arbres, comme leurs lettres se traduisent par le même nombre de 132.
Demain, donc, c’est vous qui « répondrez » aux obsèques de votre grand oncle.
Maintenant allons lui tenir compagnie !
CHAPITRE XVI
Le ciel, magnifiquement bleu jusqu’ici, s’était obscurci de lourds nuages, en ce lundi, jour choisi pour les obsèques de notre grand oncle.
Le Père Jean, maître des rites, avait décidé que la cérémonie aurait lieu le matin, à 9 h., afin d’éviter la pluie menaçante pour ce jour-là.
Dans la salle obscure, où la tache blanche du corps rigide du défunt, assis en son fauteuil, prenait un aspect fantomatique, pénétrèrent un à un, vêtus de blanc et la tête couverte d’un voile ramené sur les épaules, les Pères Jean, André, Mathieu, Charles et Jacques, puis Jeanne, Denise et Geneviève.
La cousine Hermance les accueillit.
Elle avait bien vieilli, en ces quelques jours, la pauvre femme, et pris une allure voûtée qui contrastait avec les façons un peu autoritaires que nous lui avions connues à notre arrivée.
Les huit membres du collège druidique : cinq vieillards et trois jeunes femmes, s’inclinèrent devant le défunt, comme pour lui demander la permission de l’emmener.
Sur un signe du père Jean, les femmes – les druidesses – couvrirent d’un voile blanc le visage du mort.
Philippe et Courier attachèrent deux bâtons aux bras du fauteuil et le cortège se forma : les huit membres du collège en tête, derrière le père André portant une sorte de crosse sculptée. Puis les porteurs auxquels je fus convié de me joindre, ainsi qu’un nouvel arrivé qui se présenta lui-même : Jean-Baptiste Champion, dit Francœur le Poitevin, maître couvreur.
Hermance et Lucienne suivaient cette funèbre chaise à porteurs. Derrière elles : l’assistance, plus nombreuse que je ne l’avais vue la veille à l’office.
Les huit druides et druidesses psalmodiaient en cinq notes une cantilène de langue apparemment celtique, car je n’en comprenais pas un mot.
Très lentement – au pas de vieillards octogénaires –, nous prîmes le fameux sentier contournant la « Pierre aux Lapins » vers le tombeau de Hû Gadarn, dont on fit le tour avant de s’arrêter devant la fosse profonde, maçonnée de pierres sèches, – par qui ? – en bordure de la clairière.
Les huit officiants s’arrêtèrent et se groupèrent pour prier sous le gigantesque dolmen, face à la tombe.
La résonnance des prières prononcées sous le fruste monument était formidable, et la faible voix du père Jean – émue quoiqu’il s’en défendît, en prenait un timbre extraordinaire.
L’assistance s’était formée en cercle autour du mort. Nous, les quatre hommes chargés des fonctions de fossoyeurs, nous tenions aux côtés du défunt.
Comme la prière commençait, je sentis un frôlement le long de ma jambe ; baissant les yeux, je reconnus Miroux qui avait lui aussi voulu accompagner son maître chéri... et j’en fus ému.
Le Grand Druide, paumes levées vers le Ciel, psalmodia alors :
Esprits bienfaisants et Âmes des Celtes
Veuillez accepter l’aide de nos bras et de nos Forces
Pour qu’Elles soient harmonieuses avec vos Intelligences.
Veuillez nous guider, nous aider, nous conseiller
Pour que de notre effort conjugué
Renaisse une Patrie plus belle,
Dans laquelle vivront éternellement les Âmes des Celtes
Dans un Ciel entièrement nôtre
Sous la lumière de l’Incréé [8].
Alors, sur un signe du maître des Rites, nous nous mîmes en devoir de descendre avec des cordes le défunt dans son ultime demeure...
Quand ce fut fait, le père Jacques m’invita à y descendre à mon tour... Et, comme je le regardais stupéfait... il ajouta :
– Ne vous a-t-on pas dit que c’est vous qui « répondriez » pour votre oncle ?
– Répondre... à quoi ?
– Oh ! Jean a oublié de vous le dire !... Mais c’est le rite : le parent ou héritier désigné descend dans la tombe et répond – pour le mort – aux dernières questions... Allez sans crainte, mon fils, vous répondrez selon votre cœur, et selon l’Inspiration qui vous sera donnée...
Je crois bien que j’aurais donné gros alors pour éviter cette corvée-là !... mais le pouvais-je sans scandale ?...
Avec leurs cordes, Courier et Philippe me descendirent dans la tombe... à côté du mort !
J’entendis l’officiant rappeler les faits de la vie du défunt, puis lire l’évangile de Lazare, parler des réincarnations qui doivent amener par étapes la plus humble créature à connaître la Lumière blanche de la Connaissance suprême...
C’est alors qu’il posa les questions rituelles auxquelles je devais répondre... dans la tombe, et pour le mort assis près de moi.
« Druide Bod Koad, as-tu quitté cette vie dans la paix ? »
Ma voix s’étranglait pour répondre, et c’est avec peine que j’articulai :
– Oui, j’ai fini mon existence comme je l’ai voulu – entouré de mes amis.
« Druide Bod Koad, as-tu quelques recommandations à nous laisser ? »
Cette fois, c’est poussé par un sentiment nettement extérieur à moi – l’inspiration dont m’avait parlé le père Jacques – que je m’entendis répondre :
– Je désire que l’œuvre que j’ai entreprise et n’ai pu achever soit accomplie par ceux que j’ai désignés.
« Druide Bod Koat, comptes-tu revenir quelque jour parmi nous ou as-tu trouvé la Lumière du Gwenwed ? »
Et ce fut un autre que moi, qui, par ma voix, s’écria :
– Je ne suis pas parvenu à la Parfaite connaissance de la Lumière. Un jour je reviendrai pour une suprême épreuve.
– Qu’il en soit ainsi ! que les Puissances célestes t’écoutent.
« Druide Bod Koad, sors du tombeau ! »
Courier, Philippe, l’inconnu, me hissèrent alors hors du sinistre trou... On me dit que j’étais aussi pâle que le mort auquel j’avais tenu compagnie !
Et tandis que les trois hommes roulaient des billes de bois sur le caveau, le Père Jean prononçait :
« Notre Père, qui êtes aux cieux,...
« Délivrez-nous de la Mort, car Vous êtes la Vérité, la Puissance et la Gloire, qui vivez et régnez dans les Siècles des Siècles », répondit l’assistance.
Chacun tour à tour vint bénir la tombe et jeter une pelletée de terre, autour d’un plant de chêne que maintenait la main tremblante du vieil Henri. Seul cet arbre symbolique marquerait désormais la sépulture de Louis Futaies, druide Bod Koad.
_________
Après le sobre repas pris dans la maison mortuaire, Leurs Sérénités nous expliquèrent longuement le sens de cette Croix Celtique, symbole sacré qui contient en son tracé, en chacune des dimensions des branches de la croix, dans celle des trois cercles, le résumé d’un enseignement à la fois philosophique et astronomique.
Ils nous montrèrent par maints exemples comment ce symbole avait servi de thème architectural à nos cathédrales, tant dans leur tracé régulateur que dans l’ornementation.
Le père Charles, l’érudit historien, poursuivit :
– Vous irez demain visiter la cathédrale de Chartres et, possédant maintenant la clé secrète du langage exprimé par les sculptures, vous lirez le magnifique poème de pierre écrit par nos maîtres d’œuvre, nos ymagiers, et que comprenait le plus humble des compagnons charpentiers, tailleurs de pierre et serruriers qui y travaillèrent avec foi et amour.
Bientôt, faute d’initiés, le sens de tout ce merveilleux travail sera lettre morte... Il faut recréer des groupements dans lesquels se perpétueront les traditions millénaires. C’est là le désir suprême de votre oncle. C’est pour vous confier cette mission qu’il vous a appelés.
– En somme, si je comprends bien, mon Père, chacune de nos cathédrales est un livre, et même autrement instructif que ne le sont les Pyramides au sujet desquelles M. Barbarin a écrit un ouvrage si documenté : « Le Secret de la Grande Pyramide » ?
– Effectivement ! Et il n’a pas étudié les deux autres, dont la structure, encore inconnue, complète l’enseignement de la Grande !
– C’est bien cela, conclut Lucienne, on va chercher bien loin, en Égypte, ce que nous avons en France, répété en maints exemplaires, d’Amiens à Toulouse et de Strasbourg à Rennes !
– N’en est-il pas toujours ainsi, ma chère fille, fit le père Jacques avec un sourire.
– Vous avez dit, mon père, que demain nous visiterions la cathédrale de Chartres... Mais comment nous y rendre... puisque nous ne pouvons quitter Perrière que ce soir...
– Nous savons maintenant pourquoi vous vous opposez à ce qu’on circule de jour aux environs de votre retraite... et s’il faut encore coucher chez M. Courier... prendre son tortillard demain... jusqu’à Dourdan !
– Tout est arrangé autrement, soyez sans crainte. Ce soir Philippe vous conduira vers un autre chemin...
Nous prîmes ainsi congé de nos hôtes comme le Soleil disparaissait déjà derrière la cime des grands chênes, empourprant le ciel nuageux.
Hermance tint à nous offrir un poulet, sachant à quelles restrictions sévères nous allions nous retrouver soumis en cette dure année 1943.
Miroux, qui nous avait pris en affection, ne cessait de nous prodiguer ses caresses... Pour ma part, j’aurais bien demandé à l’emporter... mais nous ignorions comment s’effectuerait ce voyage de retour... et Philippe nous annonçait une heure de marche à travers champs.
On se sépara donc sur un « au revoir » qui, chacun le savait, était un adieu.
Sous la conduite de Philippe, nous sortîmes de cette mystérieuse forêt de Perrière dont, une fois remontés sur la plaine beauceronne, on ne voyait plus que les sommets d’une verdoyante frondaison.
Cela semblait bizarre de se retrouver en rase campagne, après ces quelques jours passés sous le couvert des grands chênes. La nuit tombait lentement tandis que nous traversions une lande parsemée de ces curieuses plantes à larges feuilles et à gros fruits déjà remarquées autour de la pierre aux fées.
– Mange-t-on de ces sortes de melons ? demanda Lucienne à notre guide peu bavard.
– Non, mais on en fait de l’huile, car en manger cru fait perdre la mémoire, répondit-il.
– C’est peut-être pour cela qu’on ne retrouve pas le chemin de Perrière..., observa mon épouse qui, après avoir goûté un de ces fruits, l’avait rejeté comme trop fade.
– Peut-être bien !
– Le fait est, fit-elle en se retournant, qu’on ne voit plus rien... rien que la plaine... Perrière, les chênes, ont disparu dans la nature !...
– C’est exact... je ne saurais fichtre pas les retrouver... tout est plat... aucun point de repère à l’horizon.... ah si... la cathédrale de Chartres... là-bas... à part cela !
Philippe nous considéra attentivement :
– Qu’est-ce que ça peut faire ?... que vous ne retrouviez pas le chemin pour aller à Perrière, puisque, avec ce que vous a dit le Grand-père, Perrière, vous l’emportez avec vous – avec son secret... là... et là... fit-il en me touchant la tête et le cœur. – Tenez, voici la route de Chartres... Vous êtes arrivés !
Et comme nous allions protester, une voiture arrivait, roulant lentement.
Notre jeune cousin fit un signe. Le conducteur s’arrêta devant notre groupe.
Avec stupéfaction, je reconnus l’homme qui, ce matin, avait porté avec moi l’oncle Louis à sa dernière demeure.
– Montez, fit-il... Vous allez à Chartres, n’est-ce pas ?
– Mais... oui !
– Je vous montrerai la cathédrale, et vous l’expliquerai. Voilà 300 ans que, de père en fils, nous en sommes couvreurs.
Et, sans presque nous laisser le temps de faire nos adieux à Philippe, Francœur le Poitevin embraya.
F I N
NOTE
Jusqu’à une époque toute récente, la tradition druidique s’est transmise chez les Compagnons du Devoir du Père Soubise : charpentiers, maçons, couvreurs, serruriers, qui, dans leur rituel, emploient encore un certain nombre de formules initiatiques, telles que
Quart de cercle, demi-cercle,
Trois quarts de cercle, et cercle entier,
Voilà la reconnaissance des Compagnons.
Thème d’une chanson reprise en chœur lors de l’admission de nouveaux compagnons, et dont le symbolisme se réfère sans aucun doute à la CROIX CELTIQUE.
Leur signe professionnel se retrouve gravé dans les charpentes, sur les pierres de taille et aux pièces maîtresses des cathédrales.
Très peu nombreux sont ceux qui en connaissent encore le sens. C’est un de ces signes que nous fit voir Francœur le Poitevin dans le faîtage de la cathédrale de Chartres, et qu’il nous commenta.
Paul BOUCHET, Le mystère de Perrière les Chênes, 1955.
Couronné par l’Académie française.
Prix Montyon 1958.