L’ESPION DU KAISER
ROMAN DOCUMENTAIRE
par
Charles LUCIETO
Où, pour la première fois,
il est question de Hans Fuchs,
« l’espion du Kaiser ».
Quand il eut fini de dicter son courrier, James Nobody donna congé à son secrétaire ; puis, se tournant vers moi, un sourire malicieux au coin des lèvres, me dit :
– Maintenant que voici expédiées les affaires courantes, je suis tout à vous ; en quoi puis-je vous être utile, old fellow ?
Ce fut à mon tour de sourire...
Lui montrant d’un geste du menton ma serviette que, en entrant tout à l’heure, j’avais posée sur un coin de son bureau, je lui répondis :
– J’ai là des centaines de lettres qui, toutes, émanent de lecteurs qu’ont enthousiasmés le récit de vos exploits et qui tous, par ma bouche, vous somment de tenir la promesse que vous leur fîtes jadis.
– À savoir ?
– À savoir le récit de la lutte que le comte de Nys et vous entreprîtes contre Hans Fuchs, l’espion du Kaiser et qui se termina par la mort de ce redoutable aventurier.
Je vis, à l’énoncé de ce nom, la figure si expressive de James Nobody se contracter, ses traits se durcir...
Pendant un long moment, s’isolant avec ses pensées, il demeura silencieux... Soudain, il se mit à parler :
– Vous ne semblez pas vous douter, cher ami, me répondit-il, que vous me demandez de vous révéler un des plus grands secrets de la guerre ; un secret si bien gardé, que certaines chancelleries l’ignorent encore à l’heure actuelle.
– Diable ! Mais alors...
– Alors, si vous le voulez bien, ce secret, nous ne le divulguerons que dans la mesure où cette divulgation ne pourra nuire à la défense nationale.
– C’est entendu, répondis-je ; mais, est-il donc d’une importance telle...
– Vous allez en juger, interrompit James Nobody. À vrai dire, si le comte de Nys et moi n’avions pas repéré Hans Fuchs, si nous ne l’avions suivi pas à pas, déjouant aussitôt que formées ses entreprises, si, enfin, nous n’avions réussi à le mettre hors d’état de nuire, il est certain que cet homme – qui n’était pas seulement « l’espion du Kaiser », mais aussi, et surtout, son conseiller intime – aurait réussi à faire rebondir la guerre, partant, à empêcher l’abdication de son maître...
– Que m’apprenez-vous là ? m’écriai-je, stupéfait.
– La stricte vérité, répondit James Nobody. Sous des dehors frustes, vulgaires même, Hans Fuchs dissimulait une force d’âme, une connaissance approfondie de son métier, une habileté et une souplesse, qui le rendaient extrêmement dangereux. Encore que certains l’aient contesté, cet homme avait du génie.
« Au cours de ma carrière déjà longue et passablement mouvementée, il m’est arrivé de donner quelques preuves d’habileté ; d’autre part, on m’accorde quelque « cran » ; eh bien ! je l’avoue sans la moindre honte, et simplement parce que cela est vrai, Hans Fuchs me dépassait de cent coudées à ce double point de vue.
« Aujourd’hui encore, je ne puis m’empêcher de frémir quand il m’arrive de songer à certaines phases de la lutte, que le comte de Nys et moi soutînmes contre lui, car, – et cela, je l’affirme sur l’honneur – Hans Fuchs, soit qu’il sous-estimât nos qualités, soit qu’il dédaignât nos attaques, nous fit, à deux reprises différentes, grâce de la vie.
– Oh ! Oh ! À ce point-là ? m’exclamai-je.
– Oui, il était ainsi. Il possédait, en outre, une sorte de prescience, car j’ai pu constater que, dans bien des cas, il arriva à la parade avant que ne l’atteignit le coup que nous lui destinions.
« Beau joueur, par surcroît ; relevant avec crânerie, mais sans forfanterie aucune, les défis que nous lui lancions.
– Un caractère, somme toute.
– Vous l’avez dit : UN CARACTÈRE.
– Comment fîtes-vous pour le « repérer » ?
– Ce fut extrêmement difficile, car il changeait de personnalité avec la plus déconcertante rapidité. Il avait élevé le camouflage à la hauteur d’une institution. Comme, d’autre part, il n’intervenait que dans les cas désespérés et que, ensuite, il se terrait, nous mîmes pas mal de temps à l’identifier. Nous n’y parvînmes qu’en 1917, vers la fin de l’année. Depuis, nous ne le lâchâmes plus d’une semelle, jusqu’au jour, où, en désespoir de cause, se rendant compte qu’il ne le capturerait jamais, le comte de Nys fut contraint de l’abattre en pleine rue et en plein midi, à Charleville, devant l’hôtel Corneau où résidait le Kaiser.
– Il en dut résulter un beau tapage, fis-je, en souriant.
– Comme « raffut » – c’est ainsi que vous dites, n’est-il pas vrai ? – ce fut, en effet, assez réussi ; et cela d’autant plus que, au moment où le comte de Nys lui régla son compte, Hans Fuchs était déguisé en femme.
– En femme !
– Mais oui, en femme, répondit James Nobody, qui ajouta :
– Je dois d’ailleurs reconnaître qu’il portait le costume féminin avec la plus parfaite aisance, et que ce déguisement lui allait à ravir. Moi qui vous parle, je l’ai vu opérer dans l’un des hôpitaux de l’arrière-front, où, camouflé en diaconesse, il soignait indistinctement blessés français et blessés allemands.
– Non ?
– Mais si. D’ailleurs, cette fois, l’aventure faillit mal tourner, un juncker poméranien, le lieutenant van Ofstadt, du corps de la Garde, s’étant amouraché de lui et lui ayant offert sa main.
– Pas possible ! fis-je en riant.
– Il est certes permis de rire de cet incident, à l’heure actuelle, reprit James Nobody ; mais je vous assure que, au moment où il se produisit, le comte de Nys et moi, nous le prîmes au tragique.
– Bah ! Et en quoi cela vous regardait-il ?
– En ceci que, de Nys et moi, afin de ne pas perdre de vue Hans Fuchs – vous allez voir pourquoi – avions réussi à nous faire affecter en qualité d’infirmiers bénévoles à cet hôpital. Or, quand le drame se produisit...

HANS FUCHS
« L’Espion du Kaiser »
– Il y eut donc un drame ? m’écriai-je, vivement intéressé.
– On ne peut guère appeler autrement, répondit paisiblement James Nobody, un incident qui se termine par la mort d’un homme.
– Il y eut mort d’homme ?
– Mais oui ! Désespéré de voir ses avances repoussées, attribuant au dédain le refus que lui opposait la soi-disant diaconesse, van Ofstadt se fit sauter la cervelle.
– Diable !
– Comme bien vous pensez, van Ofstadt, appartenant à la plus haute noblesse de l’empire, il y eut enquête et, comme nous nous occupions spécialement de lui, la salle dans laquelle il se trouvait, constituant notre champ d’action, de Nys et moi fûmes soumis à un interrogatoire en règle. Des commissions rogatoires nous concernant furent envoyées un peu partout, mais plus spécialement dans les villes que nous avions indiquées comme étant nos lieux d’origine et, pendant toute une matinée, nous fûmes bel et bien placés sous la surveillance de la police de campagne, laquelle, vous le savez, est la mieux faite qui soit.
– Que vous reprochait-on, en somme ?
– D’avoir fourni à van Ofstadt l’arme avec laquelle il s’était suicidé.
– Comment cela ?
– Eh ! oui ; à première vue, l’accusation se pouvait soutenir. De même que les autres blessés, l’officier avait dû, en entrant à l’hôpital, remettre au gestionnaire, non seulement les armes et les munitions dont il était porteur, mais aussi son argent, ses bijoux et même ses papiers. Donc s’il s’était procuré une arme, ce ne pouvait être que par l’entremise et avec la complicité des gens avec lesquels il était en contact permanent, c’est-à-dire avec ses infirmiers.
– Évidemment ! Et comment vous tirâtes-vous d’affaire ?
– Au mieux ; cela grâce à Hans Fuchs qui, intervenant avec son énergie habituelle, donna à la police les apaisements nécessaires. Nous en fûmes quittes pour une semonce, après quoi on nous donna à entendre que nos services avaient cessé de plaire.
– Bigre ! Et que devint Hans Fuchs ?
– Il quitta l’hôpital en même temps que nous ; mais il ne s’en éloigna guère. Il s’installa en face, au « Kaiserhoff », l’un des principaux hôtels de la ville, de façon à pouvoir intervenir utilement, DÈS QUE L’HOMME QU’IL ÉTAIT VENU SURVEILLER AURAIT OBTENU SON « EXEAT ».
– Ah ! Ah ! Et... quel était cet homme ?
– Naldony, l’un des chefs de la « ROSTA », qui est, comme vous le savez sans doute, la centrale d’espionnage de Moscou.
– Comment ! Naldony était en Allemagne pendant la guerre ?
– C’est-à-dire qu’il ne l’a pour ainsi dire pas quittée.
– Voilà qui me renverse, m’exclamai-je...
– Que trouvez-vous de surprenant à cela ?
– Mais..., étant donné l’homme, lequel, si mes renseignements sont exacts, est l’un des plus redoutables bandits que la terre puisse porter, il me semble que le territoire allemand eût dû lui être interdit.
James Nobody me regarda en souriant, haussa les épaules, puis, paisiblement me répondit :
– Ne nous était-il pas également interdit, ce territoire ? Dieu sait cependant si nous l’avons parcouru en long, en large et en travers !
– C’est juste, fis-je ; mais, c’est égal, je donnerais gros pour savoir ce qu’était venu faire Naldony en Allemagne.
James Nobody eut un nouveau sourire et, tout en bourrant sa pipe, il me fit la stupéfiante réponse que voici :
– C’est par mon ordre, ET POUR Y MENER À BIEN UNE MISSION DONT JE L’AVAIS CHARGÉ, que Naldony se trouvait en Allemagne.
La phrase tomba sur moi comme un coup de massue et je ne pus dissimuler ma stupeur.....
– Je conçois votre surprise, reprit James Nobody, car – ÉTANT DONNÉ L’HOMME, COMME VOUS DITES – on serait surpris à moins. Il n’en est pas moins vrai que Naldony a joué, à la fin de la guerre, un rôle de tout premier plan ; un rôle d’une importance telle que, s’il était connu, ce rôle lui vaudrait d’entrer de plain-pied dans l’histoire...
Comme je le regardais bouche bée, n’en croyant pas le témoignage de mes sens, James Nobody, ayant allumé sa pipe, ajouta :
– Écoutez plutôt :
Où James Nobody
apprend un truc qui sort de l’ordinaire.
– À l’époque où se produisirent les évènements dont je vais faire état, la guerre sous-marine avait atteint son point culminant, et nombreux étaient en Angleterre les gens qui voyaient poindre à l’horizon l’aube de la défaite.
« Des ports, où elle avait pris naissance, l’inquiétude avait gagné l’intérieur du pays ; chacun se demandait avec angoisse si, un jour venant, l’Angleterre privée de vivres, manquant des matières premières nécessaires à la poursuite des hostilités, ne serait pas obligée de mettre bas les armes...
« Tous, nous avions l’impression – pour ne pas dire la certitude – que, sur notre sol, tapie dans l’ombre, fonctionnait une organisation d’espionnage, en rapports étroits avec les bases sous-marines allemandes installées à Zeebrugge, Ostende, Cuxhaven, Kiel et Brunsbüttel.
« Dès qu’ils se risquaient dans la zone interdite par l’amiral von Ingenohl, les navires marchands, qu’ils fussent alliés ou neutres, étaient impitoyablement coulés et, la plupart du temps, disparaissaient sans laisser de traces.
« Au vrai, l’Allemagne possédait la maîtrise de la mer, et, cette maîtrise s’affirmant chaque jour davantage, l’Amirauté résolut de mettre un terme à une situation qui n’avait que trop duré.
« Malheureusement pour nous, les meilleurs agents de « l’Intelligence Service britannique » étaient détachés en mission soit sur le front de combat, soit à l’étranger, tant et si bien que le « centre » de Londres, qui ne disposait que d’agents hors d’âge mobilisables, ou inaptes à faire campagne – ce qui les rendait impropres à tout service actif –, était, au sens propre du mot, désarmé.
« On rappela donc une vingtaine d’agents, que leurs succès antérieurs avaient plus spécialement désignés à l’attention de leurs chefs.
« J’étais du nombre ; mais j’avais sur mes collègues cet avantage que, engagé comme volontaire, je n’étais pas embrigadé et, partant, je jouissais d’une plus grande liberté de manœuvres.
« Dès mon arrivée à Londres, je me mis en rapport avec l’amiral Fischer, avec lequel ma famille et moi étions dans les meilleurs termes, et je pus me rendre compte, tant par les révélations qu’il me fit que par les rapports qu’il me communiqua, que, si la situation n’était pas désespérée, elle n’en était pas moins d’une réelle gravité.
« De l’entrevue que j’eus avec le grand amiral, je rapportai cette conviction que, s’il existait vraiment en Angleterre une organisation travaillant pour le compte de l’ennemi, son siège se trouvait, non pas à Londres, mais bien dans l’agglomération constituée par les villes de Plymouth, Stonehouse et Devonport, qui était, comme on sait, une de nos bases navales les plus importantes.
« Cette conviction, je parvins à la faire partager – non sans peine, il est vrai – à mes chefs et, le soir même, soigneusement camouflé en marin du commerce, mon « sac » jeté sur l’épaule, je partis pour Plymouth, nanti des pouvoirs nécessaires.

L’AMIRAL VON INGENOHL
qui commandait la flotte allemande à la fin des hostilités.
« Je connaissais fort bien Plymouth ; aussi, dès mon arrivée, me rendis-je à Exeter-Street, la rue principale du port de pêche, dans laquelle abondent les bars interlopes et les bouges à matelots.
« C’est là que j’avais décidé d’opérer...
« Avisant deux « bobbies » qui déambulaient paisiblement les mains derrière le dos, je leur demandai de m’indiquer un « hôtel tranquille » et « à bon marché ».
« Après m’avoir honoré d’un coup d’œil, le plus âgé des deux agents me répondit en riant :
– Autant vaudrait nous demander de résoudre la quadrature du cercle. Comment voulez-vous trouver un hôtel tranquille dans un quartier pareil ?
Puis, me jetant un second coup d’œil, il reprit :
– Êtes-vous « tectotaler 1 », au moins ?
– Jamais de la vie ! m’écriai-je, en riant à mon tour ; je suis de ceux qui pensent qu’un verre de stout n’a jamais fait de mal à un chrétien.
« Les deux agents, dont la trogne enluminée m’était un sûr garant qu’ils n’étaient pas accoutumés « à sucer de la glace » en guise d’apéritif, opinèrent gravement du bonnet. Après quoi, s’étant consultés, ils tombèrent d’accord pour me désigner, comme remplissant à peu de choses près les conditions fixées par moi, un abominable bouge situé à proximité et qui portait le nom de « The Royal Anchor ».
« Je m’y rendis d’un pied léger et, m’étant présenté à la patronne, une horrible vieille, aux yeux chassieux, à la bouche édentée, je reçus l’assurance que, pour le prix modique de cinq pounds, par semaine, je serais logé comme un roi et nourri comme un lord.
« Je fis donc marché avec elle et, déjà, elle se préparait à me conduire dans la chambre qu’elle me destinait, quand survint un « tec 2 », qui, après m’avoir longuement dévisagé, vint vers moi et me demanda mes papiers.
– Ma foi, lui répondis-je, mes papiers sont dans mon sac ; comme je ne puis le déballer ici, si vous voulez les voir, donnez-vous la peine de monter jusque dans ma chambre.
– Soit, répondit-il ; mais faisons vite, je n’ai pas de temps à perdre.
« Nous précédant, la tenancière du lieu nous conduisit à l’ignoble taudis qu’elle me destinait ; puis, ayant ouvert la porte, elle s’en fut.
« Lors, me tournant vers le détective qui, d’un œil curieux, examinait ma « chambre » et son contenu, je lui demandai en souriant :
– Quels papiers désirez-vous voir : les vrais ou les faux ?
– Comment cela ? fit-il ahuri...
Et, soupçonneux :
– Ah ! ça ; s’écria-t-il, auriez-vous l’intention de vous payer ma tête ?
« Je m’empressai de le rassurer et, plaçant sous ses yeux ma carte de « l’Intelligence Service », je lui dis qui j’étais et ce que j’étais venu faire à Plymouth.
« Le brave homme était sidéré...
– By Jove ! s’exclama-t-il, je veux bien que le diable m’emporte si jamais je me serais douté, en vous voyant, que je me trouvais en présence de James Nobody. Votre camouflage est à ce point réussi que moi, John Sheridan, une « vieille ficelle » pourtant, je m’y suis laissé prendre ! Dieu sait, cependant, qu’on ne me trompe pas aisément !
« Cela, je le savais de reste. En effet, bien que ne le connaissant pas de visu, j’avais, à maintes reprises, entendu citer le nom de John Sheridan comme étant celui d’un des meilleurs limiers du « Criminal service » de Scotland Yard. Il avait réussi de nombreuses affaires, parmi lesquelles venaient, en bonne place, l’arrestation du sinistre bandit qu’était Bob Sluice, l’étrangleur de Newport, et la capture mouvementée de la redoutable bande des « Devil’s Boys », laquelle avait à son actif dix-huit assassinats et une centaine de cambriolages.
« Aussi ne manquai-je pas de le complimenter, ce qui sembla le combler d’aise ; à la suite de quoi je lui dis combien j’étais heureux – sachant que je pourrais compter sur son concours, le cas échéant – de le savoir en activité de service à Plymouth.
– Le plaisir est partagé, croyez-le bien, me répondit le brave homme ; cela, d’autant plus que ce n’est pas le travail qui manque ici...
Puis, me regardant en souriant, il ajouta, en baissant la voix :
– Je suis même sur la piste d’une affaire qui vous intéressera d’autant plus qu’elle pourrait bien être en connexion étroite avec celle que vous êtes venu suivre ici.
– Ah ! bah ! de quoi s’agit-il donc ? demandai-je, surpris...
John Sheridan ne me répondit pas immédiatement. L’oreille tendue du côté de la porte, il me fit signe de me taire...
Au bout d’un instant, se tournant vers moi, il me dit à voix basse :
– J’ai bien cru qu’on nous écoutait, mais je n’en suis pas sûr. Du reste, nous allons mettre ordre à cela...
« Il s’en fut vers la porte, l’ouvrit, se pencha au dehors afin de voir si personne n’était aux aguets ; puis, sortant de sa poche une boîte de punaises, il en disposa une vingtaine sur le palier, LA POINTE EN L’AIR.
– Que diable faites-vous donc là ? fis-je, vivement intéressé par sa mimique...
« Il eut un sourire narquois ; puis, quand il eût terminé, il referma soigneusement la porte et, venant vers moi, l’index levé, il répondit du ton d’un professeur qui s’adresse à son élève :
– Le truc des punaises – il fut inventé par mon maître et ami William Strafford qui, en son temps, fut le roi des détectives anglais – est la meilleure précaution qu’on puisse prendre contre les indiscrets. En général, ces derniers, afin de n’être pas entendus de ceux qu’ils épient, s’approchent de la porte, les pieds nus, ou chaussés de pantoufles à semelles de feutre. Aussi leur arrive-t-il immanquablement de marcher sur les punaises, ce qui a pour premier résultat de leur causer une souffrance d’autant plus vive qu’elle est inattendue, et, pour second résultat, de leur faire pousser des cris de putois qu’on écorche.....
« En écoutant cette explication, je l’avoue humblement, je fus pris du fou rire.
« Mais déjà, imperturbable, John Sheridan reprenait :
– Vous comprenez que, dans ces conditions, il n’est pas d’indiscrétion possible. Dès qu’un indiscret est pris au piège, il n’y a qu’à sortir de la chambre et à le « cueillir »...
– C’est ce que nous ferons le cas échéant, déclarai-je ; en tout cas, le truc vaut d’être retenu.
– Damned my eyes ! Je pense bien ! s’écria-t-il ; il n’en est pas de meilleur !
Puis il ajouta :
– Avez-vous déjà entendu parler d’un certain Edward Berrydale ?
– Pas que je sache, répondis-je ; en tout cas, ce nom n’éveille en moi aucun souvenir...
– Well ! alors, écoutez, fit-il...
Où James Nobody apprend l’édifiante histoire
de lord Edward Berrydale.
– Il y a de cela une dizaine d’années, reprit John Sheridan, j’eus à m’occuper d’une affaire qui, littéralement, bouleversa la « Gentry », et faillit provoquer une crise ministérielle.
« Un malfaiteur, ayant réussi à s’introduire dans le propre bureau du ministre des Affaires étrangères de l’époque, à Downing Street, s’était emparé de plusieurs dossiers, dont l’un, entre autres choses, contenait des lettres autographes de S. M. la reine Victoria, relatives à l’attitude qu’il convenait de prendre au cas où une guerre eût éclaté entre la France et l’Allemagne.
« Parmi ces lettres, il s’en trouvait trois qui, si elles avaient été communiquées à l’empereur Guillaume II, auraient été de nature à amener une guerre entre l’Allemagne et nous.
« Quoique d’importance moindre, les autres dossiers n’en contenaient pas moins des pièces capitales ; tant et si bien que, de Buckingham-Palace et de Downing Street, nous parvint l’ordre de retrouver ces dossiers à tout prix.
« Dès l’abord, nous acquîmes la certitude que le vol n’avait pu être commis que par un individu connaissant à fond le milieu dans lequel il avait à évoluer, c’est-à-dire un individu appartenant à l’entourage immédiat du ministre.
« Nous procédâmes par élimination, et, bientôt, étant donnés sa façon de vivre, ses fréquentations et ses vices, en nous s’ancra la conviction que le coupable ne pouvait être que lord Edward Berrydale, le secrétaire particulier du ministre.
« Bien qu’étant apparenté aux plus nobles familles du Royaume-Uni, bien qu’étant le chef d’armes de sa maison – une des plus anciennes qui soient – il n’en fut pas moins arrêté, après une enquête qui dura deux mois et des « filatures » qui, personnellement, me mirent sur les boulets.
« Cuisiné de main de maître, s’il consentit à faire des aveux, il refusa, par contre, d’indiquer à qui il avait remis les dossiers subtilisés par lui et l’endroit où ils se trouvaient.
« Toutefois, il nous donna l’assurance que ces dossiers – qu’il considérait comme une poire pour la soif – n’avaient pas franchi, et ne franchiraient pas le détroit.
« Convaincu de vol de documents intéressant la sûreté de l’État, lord Edward Berrydale fut condamné à huis clos – l’essentiel étant de ne pas ébruiter l’affaire – à dix ans de « hard-labour », et on l’envoya purger sa peine à la prison des convicts de Princetown.
« Il y était encore il y a six mois.
– Depuis, qu’est-il devenu ? demandai-je, vivement intéressé par cette entrée en matière...
Pointant son index vers le plancher, John Sheridan répondit :
– Si je ne m’abuse, il habite la chambre qui se trouve exactement située au-dessous de la vôtre...
– Non ?
– Mais si, et c’est ce qui vous explique pourquoi je surveille aussi attentivement cette maison, et aussi pourquoi je suis intervenu dès votre arrivée céans.
– Soupçonneriez-vous donc lord Edward Berrydale de quelque nouvelle manigance ?
John Sheridan me lança un coup d’œil et, froidement, répondit :
– Aussi vrai que nous sommes deux loyaux serviteurs de Sa Majesté, Edward Berrydale se livre actuellement à une besogne qui, si elle n’est pas de l’espionnage, y ressemble terriblement.
– Vous avez la preuve de cela ? m’écriai-je.
– La preuve, non ! Mais les présomptions abondent. Vous allez d’ailleurs en juger.
« La semaine dernière, étant en surveillance devant une « pawn-shop 3 » que tient dans les « slums 4 » un certain Grigory Nikolsky, un Russe naturalisé anglais que je tiens pour le plus fieffé coquin du Royaume-Uni, je vis entrer chez lui un « skipper 5 » danois, du nom de Harald Hansen, dont le chalutier est amarré au Barbican, où se tiennent de préférence les bateaux de pêche, mais qui demeure – quand il est de passage à Plymouth – dans un hôtel louche de Treville-Street.
– Harald Hansen ! m’écriai-je ; mais il figure sur la « Black List » ! Comment se fait-il qu’il ait pu débarquer en Angleterre ?
– Cela, je l’ignore, répondit John Sheridan ; mais, ce que je n’ignore pas cependant, c’est que, chaque semaine, Harald Hansen, – qui, sans doute, est un « courrier » de l’ennemi, – a des entrevues secrètes avec des gens considérés comme suspects au point de vue national.
– Vous connaissez leurs noms ?
– Parbleu ! Il y a tout d’abord un Anglais du nom d’Arthur Bridget qui, bien qu’étant ancien convict, n’en occupe pas moins un poste en vue au syndicat extrémiste des ouvriers du port. Ce Bridget est un défaitiste à tous crins, dont les théories néfastes m’exaspèrent à un point que vous ne sauriez imaginer, mais que je n’ai pu encore « boucler », car il se garde bien de les émettre en public.
– Bien ; et après...
– Après, il a, pour second, un autre Anglais, Willy Jones, qui est un chenapan de la plus belle venue et qui habite dans une cabane en ruines, où se réunissent, tous les soirs, des bandits de son espèce.
– Où se trouve cette cabane ? demandai-je.
– Elle est située aux environs de Cremyll...
– C’est-à-dire, précisai-je, à proximité des batteries de côte, contre lesquelles, récemment, un attentat a été perpétré, et sous lesquelles s’abritent nos flottilles de sous-marins.
– C’est tout à fait cela, répondit John Sheridan.
– Voilà qui est on ne peut plus intéressant, fis-je, en notant soigneusement les noms et les adresses que venait de me donner le détective ; après quoi, j’ajoutai :
– Vous disiez donc qu’étant en surveillance dans les « slums », vous aviez vu entrer, chez Grigory Nikolsky, Harald Hansen. Savez-vous ce qu’il y venait faire ?
– Non ; mais, quelques instants plus tard, je vis arriver un individu que, de prime abord, je ne pus identifier, car un large chapeau dérobait ses traits à vue, mais que, à la façon dont il traînait la jambe gauche, je reconnus pour un convict.
 |
DOWNING-STREET
Résidence du premier ministre à Londres.
– Ah ! Ah !
– Sans manifester la moindre hésitation, il pénétra chez Grigory Nikolsky. Il en ressortit bientôt une liasse de bank-notes à la main et, avisant un cab...
– Dont vous notâtes le numéro, j’espère, interrompis-je...
– Cela va de soi, répondit en riant le détective, qui reprit :
– Avisant un cab, il se fit conduire dans un hôtel de Bedford street, où il était descendu depuis une huitaine de jours. Je le pris en surveillance et, le soir même, grâce à une cicatrice qu’il porte à la joue gauche, grâce aussi à un tic nerveux qu’il m’avait été donné de remarquer autrefois, je l’identifiai aisément.
– Qui était-ce ?
John Sheridan, en homme sûr de son effet, prit un temps puis, souriant, me répondit :
– C’était lord Edward Berrydale en chair et en os.
– Pas possible ! m’exclamai-je.
– C’est tellement possible, fit le détective, que voici la fiche établie par lui, lors de son arrivée à l’hôtel.
Je pris la fiche, et je lus :
Nom : Berrydale ;
Prénoms : Edward James ;
Lieu de naissance : Londres ;
Date de naissance : 4 janvier 1870 ;
Profession : propriétaire ;
Venant de : Londres ;
Allant à : Plymouth.
Bien que légèrement tremblée, l’écriture était très lisible. Aucun doute n’était possible. Restait à savoir ce qu’était venu faire à Plymouth ce dévoyé.
John Sheridan, à qui je posai la question, me répondit, en haussant les épaules :
– Pas grand chose de bon, sans doute. Toutefois, je dois reconnaître que jusqu’ici, son attitude a été des plus correctes. Il ne fréquente absolument personne ; ne reçoit ni ne fait aucune visite. Son courrier, que je fais saisir à la poste, et que je lis avec la plus extrême attention, ne contient rien de suspect. Je sais, cependant, qu’il attend une visite...
– Ah ! Ah !
– ... Celle d’un individu qui signe ses lettres des initiales J. H., et qui, si j’ai bien compris, doit venir prochainement à Plymouth pour y prendre livraison d’un colis.
– D’où proviennent ces lettres ? demandai-je.
– Il y en a eu trois. La première était datée de Rotterdam ; la seconde de Genève, et la troisième de Berne.
– Rien d’anormal dans l’écriture ?
– Non, parce que dactylographiées ; par contre, la construction des phrases, le style, semblent indiquer que leur auteur est un Allemand d’origine, ou tout au moins, qu’il a reçu une forte culture allemande.
– Bien, répondis-je et après avoir réfléchi un moment, je repris :
– Naturellement, vous n’avez aucun renseignement concernant le « colis » dont il est question dans ces lettres ?
– Je ne possède, en effet, aucun renseignement à cet égard, répondit John Sheridan ; mais comme deux de mes hommes surveillent lord Edward Berrydale, dès qu’un incident se produira, je serai prévenu.
Nous en étions là de notre conversation quand, soudain, de l’autre côté de la porte un effroyable hurlement retentit...
Où James Nobody
commence à se montrer.
– Bone deus ! que se passe-t-il ? m’écriai-je, en m’élançant vers la porte...
Plus leste que moi, John Sheridan m’y avait précédé et, avant que d’ouvrir, se tournant de mon côté, tout guilleret, il me dit :
– C’est, sans doute, quelqu’un qui n’a pu digérer « mon plat de punaises ». C’est qu’elles sont terriblement indigestes mes punaises, savez-vous !
Cela fut dit d’un tel ton que je ne pus réprimer un sourire...
Mais, déjà, ayant ouvert la porte toute grande, John Sheridan se penchait au dehors.
– Oh ! Oh ! s’exclama-t-il, la prise est bonne !
Puis, sans même me donner le temps d’intervenir, il se rua vers un homme qui, sur le palier, les pieds nus, effectuait une danse échevelée, tout en poussant d’horribles clameurs et, en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, il le « ceintura » en vitesse.
Après quoi, le jetant comme un paquet au milieu de « ma » chambre, il se pencha vers lui, et, en un tournemain, lui passa les menottes.

JOHN SHERIDAN
le grand détective anglais.
L’homme, les pieds ensanglantés, se tordait comme un ver coupé sur le sol...
Avec une légèreté de main que lui eut envié un chirurgien, John Sheridan extirpa l’une après l’autre les punaises qui s’étaient enfoncées dans les pieds de « notre » prisonnier puis, le regardant d’un air narquois, il lui dit :
– Je savais bien, old boy, que nous finirions par nous rencontrer tôt ou tard. Mais je veux bien être pendu – ce qui ne manquera pas de t’arriver – si je me doutais que l’évènement se produirait aussi vite et en de semblables circonstances.
Me désignant d’un geste du menton l’homme qui, maintenant, s’efforçait de se mettre sur son séant, le détective poursuivit :
– Permettez-moi, cher ami, de vous présenter Arthur Bridget, celui-là même dont je vous entretenais tout à l’heure...
– La prise est bonne, en effet, répondis-je ; car, sauf erreur, cet individu avait pour mission de nous épier.
– Cela, il faudra le prouver ! s’écria d’un ton rogue, Arthur Bridget.
– C’est ce que nous allons essayer de faire, répondit avec calme John Sheridan qui, sans plus attendre, se mit à inventorier le contenu des poches du suspect, ce qui eut pour premier résultat d’amener une véhémente protestation de sa part.
– Qui vous a donné le droit, s’écria-t-il, d’agir ainsi que vous le faites ? Je n’ai commis, que je sache, aucun délit, à moins que vous ne considériez comme tel, le fait d’écouter aux portes !
– Vous avouez donc, répondis-je, que vous nous espionniez. Dans quel but, et pour le compte de qui agissiez-vous de la sorte ?
Voyant qu’il s’était enferré, Arthur Bridget se garda bien de répondre.
– Voilà, fit, en me tendant un portefeuille bourré de papiers, John Sheridan, qui va, sans doute, répondre à la question que vous venez de poser à Bridget. Si je ne m’abuse, nous allons trouver dans ce fatras tout autre chose que des tracts émanant de la Ligue d’encouragement au bien...
Tandis que je mettais le portefeuille en lieu sûr, John Sheridan reprit, mais en s’adressant à Arthur Bridget, cette fois :
– Quoi qu’il en soit, tu peux, dès maintenant te considérer comme étant en état d’arrestation, car le fait pour un ancien convict d’avoir sur soi un joujou de ce calibre n’est pas pour prouver qu’il s’est amendé.
Et, tirant de la poche d’Arthur Bridget un énorme browning, le détective me le remit également.
L’ancien convict écumait et ne pouvait dissimuler sa rage.
Tout en le surveillant de très près, John Sheridan poursuivait ses investigations.
Ce que contenaient les poches du prisonnier est inimaginable. Il y avait de tout : un couteau à cran d’arrêt, des cordes, un sifflet, une trousse de cambrioleur, des chaussons de feutre ; sa ceinture était faite d’un nerf de bœuf flexible, et dans les poches de son gilet, nous trouvâmes une fiole de chloroforme et une boîte en fer-blanc contenant une poudre blanche, dont nous remîmes l’analyse à plus tard, mais qui, de prime abord, nous parut être du cyanure de potassium.
Comment ce misérable avait-il pu se procurer d’aussi dangereux produits ?
Les questions que nous lui posâmes à cet égard demeurèrent sans réponse. D’ailleurs, dès ce moment, il s’enferma dans un mutisme farouche.
Certain d’avoir exploré toutes les poches d’Arthur Bridget, John Sheridan se relevait déjà, quand, sur les lèvres du prisonnier, je surpris un sourire sardonique...
Le fait me frappa d’autant plus que je n’étais pas sans avoir remarqué que, si nous avions trouvé sur lui de quoi monter un bazar, par contre, l’argent semblait lui faire défaut.
Or, d’habitude, ces gens-là ont les poches fort bien garnies et il n’est pas rare de trouver de petites fortunes en leur possession.
– Vous êtes-vous assuré, demandai-je à John Sheridan, s’il n’existe pas, au pantalon de ce... monsieur, des poches à revolver ?
– Diable ! vous avez raison, s’écria le détective. Ah ! çà, où avais-je donc la tête pour avoir omis ce détail ?
Mon conseil avait du bon, car dans la poche à revolver d’Arthur Bridget, John Sheridan trouva un second portefeuille, copieusement garni de bank-notes, une fiole minuscule contenant un liquide blanchâtre et une seringue de Pravaz.
Rapidement, nous comptâmes les billets. Il y en avait pour une vingtaine de mille francs.
– D’où provient cet argent ? demanda John Sheridan à l’ancien convict.
– Si on te le demande, répondit ce dernier, narquois, tu diras que tu n’en sais rien.
– Well ! fit le détective qui ajouta :
– Bien entendu, tu ignores ce que contient cette fiole et à quoi était destinée cette seringue de Pravaz ?
– J’ai horreur des gens curieux ! répondit en ricanant Arthur Bridget.
– Alors, pourquoi vous permettez-vous d’écouter aux portes ! répondis-je du tac au tac.
Il me lança un coup d’œil haineux puis, haussant les épaules :
– Ça, c’est mon affaire ! fit il.
Voyant qu’il n’y avait rien à tirer de cette brute, nous décidâmes d’un commun accord de procéder à son incarcération, quitte à l’interroger à fond ultérieurement.
Ayant ouvert la fenêtre, John Sheridan se pencha au dehors et lança un coup de sifflet strident.
Immédiatement, quatre policemen arrivèrent, auxquels il fit signe de monter.
Quand ils furent arrivés, leur désignant Arthur Bridget, il leur dit :
– Vous allez conduire cet individu – que je considère comme extrêmement dangereux – au commissariat central, où il devra être mis au secret dans l’une des chambres de sûreté. Défense absolue à qui que ce soit d’entrer en communication avec lui.
– Bien ! répondit l’un des agents ; mais si le commissaire central nous demande pour quel motif il a été arrêté, que devrons-nous répondre ?
– Vous répondrez, fit John Sheridan, qu’il a été arrêté pour port d’armes prohibées...
– Et vous ajouterez, fis-je, en intervenant, que moi, James Nobody, agent de « l’Intelligence Service », je l’inculpe dès maintenant de haute trahison et de complot contre la sûreté de l’État.
Arthur Bridget se montra beau joueur. Il eut un sourire cynique et, me fixant dans les yeux :
– Goddam ! fit-il ; vous n’y allez pas de main morte ! C’est donc ma peau que vous voulez ?
Le fixant à mon tour, froidement, je répondis :
– Ta peau ! À l’heure qu’il est, je n’en donnerais pas dix pence ; mais quel qu’en soit le prix, tu peux être tranquille, je l’aurai !
Où James Nobody
fait une intéressante découverte.
Quand les détectives eurent emmené Arthur Bridget, lequel n’en menait pas large, ma réponse l’ayant sidéré, John Sheridan et moi procédâmes à l’examen des documents que contenait le portefeuille de l’ancien convict.
Dès l’abord, je tombai en arrêt devant une lettre qui, à première vue, ne contenait rien de suspect, mais dont le texte, tarabiscoté à souhait, me donna fort à penser.
Elle était ainsi conçue :
Mon cher ami,
Attendez-moi tout à l’heure, car je viendrai très certainement vous voir dans la soirée. On ne croit pas que John Armstrong cesse de nous fournir les blés commandés.
Dites-lui que Yale est surpris et inquiet de son silence. Peut-être a-t-il repris ses tractations avec Paddy.
En tous cas, répétez-lui que Yale et Meyer sont prêts, aujourd’hui comme demain, à lui acheter toute sa production.
En effet, quel que soit le prix demandé, il n’y a pas à hésiter. Sans son concours, nous ne pourrions rien faire d’utile. C’est malheureusement trop certain, ses produits étant les meilleurs.
Bien vôtre,
HARRY FREEMAN.
– Que pensez-vous de cela ? demandai-je, à John Sheridan, en lui tendant le document qui précède.
Il le prit, le lut et le relut, avec la plus extrême attention, puis, me regardant, il me répondit :
– Il s’agit là, évidemment, d’une lettre rédigée en termes conventionnels. N’est-ce point votre avis ?
– C’est tellement mon avis que je vais la placer, si vous le voulez bien, sous scellés.
Puis, songeur, j’ajoutai :
– Plaise aux dieux que nous puissions en découvrir le sens exact. Mais – ou cela me surprendrait beaucoup ; – on a dû, pour l’écrire, se servir d’une grille et, à défaut de cette grille, nous n’y parviendrons jamais.
– Une grille ! s’exclama John Sheridan, mais le portefeuille en contient une.
– Vous en êtes sûr ? m’écriai-je.
– J’en suis tellement sûr que la voici.
Et, tout en me disant ces mots, le vieux détective me tendait l’objet en question.
C’était bien une grille.
Composée d’un morceau de carton, elle était découpée de façon bizarre et affectait la forme du dessin reproduit ci-dessous.
– Voilà qui est parfait, fis-je, après avoir examiné la grille ; et, pour peu qu’elle s’applique au document, nous allons être immédiatement fixés.
Rien n’est plus facile, en effet, que de se servir d’une grille. Dès qu’elle est appliquée sur une lettre, elle livre, – si bien dissimulé soit-il, – le secret de cette dernière.
Comme elle ne comporte que quatre côtés, il est relativement aisé de déterminer comment il convient de l’employer.
Prenant la lettre, je la fixai sur la table au moyen de quatre punaises que j’empruntai à John Sheridan ; après quoi, j’appliquai la grille sur la lettre.
Mais, j’eus beau l’employer dans tous les sens, la lettre demeurait indéchiffrable, les caractères dévoilés par la grille ne formant pas des mots.
Sans me laisser décourager par cet échec, je poursuivis l’expérience, et j’en arrivai bientôt à cette conviction que, pour déchiffrer la lettre, il convenait d’abord de la transcrire, en se servant de CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, sur un papier AU FORMAT EXACT DE LA GRILLE.
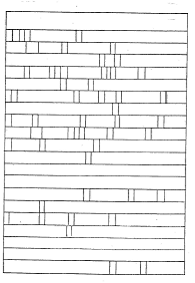 |
C’est ce que je fis aussitôt et, après quelques tâtonnements inévitables, j’obtins, enfin, le résultat.
En ne tenant compte que des caractères contenus dans les trous de la grille, j’obtins le message suivant, qui ne laissa pas de me surprendre quelque peu :
Attention ! James Nobody est parti pour Plymouth (h.).
HANS FUCHS.
Et pour authentifier la lettre, les deux initiales du nom de Hans Fuchs étaient répétées au bas du document...
Ainsi, malgré les précautions prises par moi, en dépit de mon camouflage, j’avais été repéré dès mon départ de Londres et signalé à l’attention d’Arthur Bridget, l’un des agents du mystérieux signataire de la lettre !
J’avoue que, sur le moment, mon amour-propre fut mis à une rude épreuve.
Être pris, alors qu’on croyait prendre, n’avait rien de particulièrement agréable...
Mais en y réfléchissant bien, je me rendis compte que notre siège central, à Londres, devant être spécialement surveillé par les agents de l’ennemi, le fait, en soi, n’avait rien de surprenant.
D’autres problèmes autrement intéressants s’imposant à mon attention, j’eus vite fait de me consoler.
La capture d’Arthur Bridget s’avérait, en effet, importante.
MON CHER AMI,
ATTENDEZ-MOI TOUT À L’HEURE, CAR JE VIENDRAI TRÈS CERTAINEMENT VOUS VOIR DANS LA SOIRÉE. ON NE CROIT PAS QUE JOHN ARMSTONG CESSE DE NOUS FOURNIR LES BLÉS COMMANDÉS.
DITES-LUI QUE YALE EST SURPRIS ET INQUIET DE SON SILENCE. PEUT-ÊTRE A-T-IL REPRIS SES TRACTATIONS AVEC PADDY.
EN TOUS CAS, RÉPÉTEZ LUI QUE YALE ET MEYER SONT PRÊTS, AUJOURD’HUI COMME DEMAIN, À LUI ACHETER TOUTE SA PRODUCTION.
EN EFFET, QUEL QUE SOIT LE PRIX DEMANDÉ, IL N’Y A PAS À HÉSITER. SANS SON CONCOURS, NOUS NE POURRIONS RIEN FAIRE D’UTILE. C’EST MALHEUREUSEMENT TROP CERTAIN, SES PRODUITS ÉTANT LES MEILLEURS.
BIEN VÔTRE,
HARRY FREEMAN.
D’ores et déjà – et cela du fait même de la lettre trouvée en sa possession – nous étions en droit de le considérer comme un espion à la solde de l’étranger.
Restait à savoir pour le compte de qui il travaillait ; la signature figurant au bas de la lettre pouvant fort bien être un pseudonyme.
Je rédigeai immédiatement, en langage chiffré, un rapport destiné à mes chefs, relatant succinctement les incidents qui venaient de se produire et leur signalant la présence à Londres d’un agent allemand du nom de Hans Fuchs, puis, après avoir mis sous scellés les objets saisis sur Arthur Bridget, me tournant vers John Sheridan, je lui dis :
– L’affaire semble se dessiner merveilleusement ; aussi vais-je me mettre immédiatement sur la piste des complices que doit avoir à Plymouth Arthur Bridget.
John Sheridan me lança un coup d’œil de coin, hocha la tête approbativement, puis, tout de go, me déclara :
– Ma foi, comme je n’ai rien d’autrement pressé à faire, je vais, si vous le voulez bien, vous « donner un coup de main ». Sans me vanter, je crois que je pourrai vous rendre quelques services...
Je m’empressai d’accepter sa proposition et, sans désemparer, après avoir examiné la situation sous toutes ses faces, nous élaborâmes un plan d’action.
Ce plan, on le verra par la suite, devait nous conduire au succès...

ARTHUR BRIDGET
au moment de son arrestation.
Où James Nobody fait la connaissance
de Willy Jones, et ce qui s’ensuit.
Le soir venu, John Sheridan, qui m’avait quitté pour aller se mettre « dans une tenue présentable », me rejoignit dans un bouge d’Exeter Street où, moyennant un shilling, on nous servit un repas dont le plat de résistance se composait « d’arlequins » de la plus belle venue.
Notre tenue et notre attitude ne se différenciant en rien de celles adoptées par les habitués du lieu, notre présence passa complètement inaperçue.
Willy Jones, le « solitaire de Cremyll », ainsi que l’avaient surnommé ses amis, et dont ce repaire était le quartier général, n’étant pas encore arrivé, nous en profitâmes pour étudier les gens qui se trouvaient là.
Je crois bien que jamais encore il ne m’avait été donné de souper en pareille société. Non seulement les forbans qui fréquentaient ce bouge portaient sur leur visage les stigmates de tous les vices ; mais, par surcroît, ils semblaient avoir été coulés dans le même moule.
N’utilisant que le « slang », que John Sheridan et moi parlions à la perfection, ils paraissaient appartenir à la plus basse classe de la société.
Habitant les « slums » voisins, leurs vêtements étaient imprégnés d’une insupportable odeur de suint et de moisissure et, de toute évidence, la plupart d’entre eux ignoraient tout des prescriptions les plus élémentaires de l’hygiène.
John Sheridan, qui semblait parfaitement à l’aise dans ce milieu quelque peu hétéroclite, repéra et me signala immédiatement quelques-uns de ses « clients » habituels.
Par là, il entendait les gens à l’arrestation desquels il avait procédé antérieurement et qui, tous – ou presque – étaient passés par le bagne.
Il est bien certain que s’il avait été reconnu, ni lui ni moi, ne serions sortis vivants de cette caverne.
Quand nous eûmes achevé notre repas, on nous servit, en guise de café, une mixture infecte, copieusement additionnée de whisky.
Soudain, la porte s’ouvrit et Willy Jones, qu’accompagnaient deux de ses amis, parut.
C’était un colosse roux, – au vrai, il devait être d’une force peu commune – dont le visage, en partie dissimulé par sa casquette, portait la trace de la plus basse bestialité.
Vêtu de loques sordides, la tête rentrée dans les épaules, le mufle projeté en avant, les mains profondément enfoncées dans les poches, il était effrayant à voir.
On le sentait prêt à tout, même au pire...
Il s’arrêta un instant sur le seuil de la porte, puis, après avoir toisé les uns après les autres les gens qui se trouvaient là, il les salua en ces termes :
– Salut les gars !
De divers côtés, on lui rendit son salut.
S’adressant alors au tenancier qui, solidement retranché derrière son comptoir, ne le quittait pas des yeux, il ajouta, mais de manière à ce que chacun entendit :
– J’ai une sale nouvelle à t’apprendre, mon vieux Sharper : Arthur Bridget vient d’être « fabriqué 6 ».
Du coup, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Pour ces gens-là, en effet, la nouvelle était d’importance, Bridget étant l’un des leurs.
Satisfait de l’effet que venait de produire sa déclaration, Willy Jones ferma la porte puis, apercevant à côté de celle que nous occupions une table libre, il vint y prendre place avec ses amis.
C’est alors qu’il nous aperçut...
Il nous dévisagea longuement, analysant nos gestes, scrutant notre attitude, inspectant notre « tenue ».
De toute évidence, cet examen nous fut favorable car, rassuré, le bandit reprit bientôt :
– Pour moi, y a pas d’erreur ; Bridget a dû être « donné » par quelqu’un ; son arrestation ne peut s’expliquer autrement.
– Sûrement, approuva l’un des amis de Willy Jones ; car dans tout Plymouth, il n’y avait pas un « tec » capable de « lui poser le grappin dessus ».

WILLY JONES
le « solitaire de Cremyll ».
Il était bien trop « mariolle » pour se laisser « accrocher ».
– Possible ! fit le tenancier ; mais il n’en est pas moins dans le « trou ».
– Pour ça, y a pas d’erreur possible, répondit Willy Jones ; je l’ai vu emmener par quatre « pèlerins ».
– Sait-on, au moins, pour quel motif il a été arrêté ? reprit le tenancier.
– Mais non ; fit Willy Jones, et c’est ce qu’il y a d’empoisonnant dans l’affaire. Tout ce que j’ai pu savoir, c’est qu’il a été arrêté par un type de la « grande équipe 7 ».
– By Jove ! s’exclama le tenancier ; alors ce doit être grave ! la « grande équipe » ne se dérange pas pour rien, d’habitude.
– Justement, répondit Willy Jones ; et je suis d’autant plus inquiet que j’avais rendez-vous ce soir, chez moi, avec Bridget. Il devait me communiquer une lettre qu’il avait reçue ce matin et qui était, paraît-il, de la plus haute importance. Or, si cette lettre a été saisie sur lui, j’ai bien peur d’être « enfoncé 8 » également.
L’aveu, comme bien on pense, ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd. À la vérité, il ne pouvait être plus net...
Arthur Bridget et Willy Jones étaient d’accord et « travaillaient » pour le compte de l’ennemi.
Restait à savoir quels étaient leurs complices...
Tout en servant aux nouveaux venus les consommations qu’ils lui avaient commandées, le tenancier, se penchant vers Willy Jones lui dit à voix basse :
– Si tu crains d’être arrêté, pourquoi ne te « planquerais-tu » pas, au lieu de rentrer chez toi ?
Willy Jones allait répondre, mais il n’en eut pas le temps...
Violemment poussée, la porte s’ouvrir toute grande et, à notre grande stupéfaction, vingt policemen, revolver au poing, firent irruption dans la salle...
– Hands up ! cria leur chef.
Automatiquement, toutes les mains se dressèrent. Aucun des bandits n’esquissa le moindre geste de résistance.
Bien entendu, nous les imitâmes...
Passant rapidement devant les tables qui toutes étaient occupées, le brigadier dévisageait chacun des consommateurs et, d’un geste bref, l’invitait à sortir.
Arrivé à la porte, il était prestement « cueilli » par deux policemen qui, sans aucun ménagement, l’invitaient à monter dans le « panier à salade » amené là à cette intention.
Bientôt le brigadier arriva à la table que nous occupions. Il nous toisa, et je l’entendis ronchonner :
– Tiens ! En voilà deux que je ne connaissais pas.
Puis s’adressant à nous directement :
– Qui êtes-vous ? demanda-t-il ; avez-vous des papiers sur vous ?
Le tenancier étant là, et afin de n’être pas « brûlé », je répondis :
– Ma foi, non ; je les ai laissés à la maison.
John Sheridan ayant fait une réponse identique, le brigadier nous mit bel et bien en état d’arrestation.
Comme les autres, il nous fallut prendre place dans le « panier à salade », qui nous attendait à l’extérieur.
La tête de John Sheridan était à peindre.
De toute évidence, le brave homme ne s’attendait pas à terminer sa nuit au poste.
En ce qui me concernait, la situation était tout autre et je compris aussitôt tout le parti que j’en pouvais tirer.
Au vrai, il n’en était guère de plus favorable...
Où James Nobody se distingue.
I.es cellules individuelles de la voiture étant garnies, on nous avait laissés tous deux dans le couloir central, ce qui me permit de communiquer à John Sheridan, de bouche à oreille, le nouveau plan que je venais de combiner.
– Étant donnée la situation, lui dis-je, voici ce qu’il faut faire. Dès notre arrivée au commissariat, vous vous ferez reconnaître. Après quoi, vous révélerez au commissaire ma véritable identité ; vous lui exposerez de façon succincte, mais précise, le but de ma mission ; et vous lui demanderez de m’incarcérer en compagnie de Willy Jones...
– Comment ! fit le détective ; vous voulez passer la nuit au poste !
– Mais oui ; et vous allez comprendre pourquoi, répondis-je. Me voyant soumis au même régime que lui, Willy Jones me prendra pour un coquin de son espèce. Donc, il ne se méfiera nullement de moi et...
– J’ai compris ! fit John Sheridan, enthousiasmé ; vous en profiterez pour le « cuisiner » de manière à obtenir un aveu formel et, si possible, des preuves.
– Tout juste ! répondis-je ; et il faudrait que je sois bien maladroit si je ne réussissais pas à « lui tirer les vers du nez ».
Ayant ainsi convenu de nos faits et gestes, nous attendîmes paisiblement que la voiture nous déposât au commissariat de police.
Quelques instants plus tard, je comparaissais devant le commissaire de police, lequel, suivant en cela la consigne que venait de lui donner John Sheridan, me mit plus bas que terre ; ce qui ne laissa pas de donner une très haute opinion de moi à Willy Jones qui, témoin muet, assistait à la scène.
Après quoi, on m’enferma dans une cellule de sûreté où, cinq minutes plus tard vint me rejoindre Willy Jones.
Dès les premiers mots qu’il prononça, je vis que je lui étais devenu extrêmement sympathique.
– Mon vieux, fit-il en venant vers moi la main tendue, je te dois des excuses.
– Des excuses, à moi ? répondis-je en simulant la surprise...
– Parfaitement ! reprit-il ; car, tout à l’heure, chez le « bistrot », ne te connaissant pas, je t’ai pris, pendant un moment, pour une « bourrique 9 ».
– Une « bourrique », moi ! Elle est bien bonne ! fis-je, en éclatant de rire.
– Dame ! Mets-toi à ma place, reprit le bandit ; traqués comme nous le sommes par la police dont les hommes, pour nous « avoir », revêtent tous les déguisements, il est normal que nous « tenions à l’œil » les nouveaux venus.
– Aussi, je ne t’en veux pas, répondis-je ; mais tout de même, moi, en te voyant pour la première fois, je ne me serais pas trompé. Rien qu’à te voir, on sent que tu es un « homme ».
– Ça, tu peux le dire, répondis-il, flatté ; mais, au fait, qui es-tu ?
Tout en m’installant pour passer la nuit de mon mieux, je lui répondis :
– Tu n’es jamais venu en Irlande ?
– Ma foi, non.
– Voilà qui explique pourquoi tu ne me connais pas ; sans quoi, tu aurais entendu parler de John Flannagan.
– Tu es donc célèbre dans ton pays ? fit-il, vivement intéressé par ce début.
– Autant que tu peux l’être dans le tien, répondis-je ; car il n’est guère d’affaires sérieuses auxquelles je n’ai pas participé depuis dix ans.
Et après un silence, j’ajoutai :
– C’est d’ailleurs pour cela que j’ai dû quitter l’Irlande, la police m’ayant repéré.
– Comment se fait-il qu’on ne t’aie pas mobilisé ?
Me penchant vers lui, je répondis tout bas :
– Je suis déserteur.
– By Jove ! s’écria-t-il ; mais alors ton compte est bon.
– Penses-tu ! Je ne suis pas de la dernière couvée, répondis-je ; j’ai de faux papiers.
– Alors, comme ça, ça va ! fit-il, en riant ; tu pourras peut-être t’en tirer.
– Tu crois ?
– J’en suis sûr ; et même, je voudrais être sûr de m’en tirer aussi facilement que toi. Malheureusement, il n’en est pas ainsi, et j’ai bien peur de rester dans la nasse.
– Non ?
– Mais si, affirma-t-il ; imagine-toi que, hier, on a arrêté un de mes copains, un nommé Arthur Bridget, avec lequel, je « travaillais » de compte à demi. Or, sur lui, il avait des papiers...
– Quel genre de « travail » faisiez-vous ? demandai-je.
– Ma foi, je n’en sais trop rien, répondit-il ; pour ma part, j’étais chargé de lui indiquer le nombre et la nature des navires qui quittaient chaque jour Plymouth.
– Y compris les navires de guerre ?
– Naturellement !
– Et que faisait Arthur Bridget de ces renseignements ?
– Je crois qu’il les envoyait à un courtier en grains de Londres, un nommé Hans Fuchs, qui habite dans Kings Road, au no 82.
– Hans Fuchs ! m’écriai-je ; mais c’est un nom allemand cela ! Ce doit être un Boche, ce type-là !
– Et après ? me répondit-il ; qu’est-ce que cela peut bien faire, pourvu qu’il paye ! L’argent n’a pas d’odeur.
– C’est entendu, fis-je ; mais, tout de même, si au lieu d’une affaire propre, il s’agissait d’une affaire d’espionnage...
– Une affaire d’espionnage ! s’exclama-t-il, en pâlissant affreusement.
– Le doute n’est guère possible, répondis-je. Que veux-tu, en effet, que fasse un Allemand, même s’il est courtier en grains, de la liste des navires qui quittent l’Angleterre, sinon pour les faire torpiller ?
Le coup porta et, de pâle qu’il était, Willy Jones devint livide...
– Mais alors, bégaya-t-il ; si cela était, je me trouverais dans une situation terrible !
– D’autant plus terrible, insistai-je, que tu ne sembles pas t’être rendu compte de ce que tu faisais. Le malheur est que les juges – les juges militaires surtout – ne s’embarrassent guère de détails pareils. Avec eux, il n’y a pas de rémission. Aussitôt pris, aussitôt fusillé !
– Eh ! bien, me voilà propre ! s’exclama Willy Jones, que la terrible perspective qui s’ouvrait devant lui semblait affoler...
– Il y aurait peut-être un moyen de t’en tirer, repris-je.
– Lequel ?
– Te « mettre à table » et « cracher le morceau ».
– Cela, jamais ! s’écria-t-il ; j’ai fauté, je payerai ! Mais, fut-ce pour sauver ma vie, jamais je ne dénoncerai les « copains ».
Ainsi qu’on le voit, ce bandit était honnête à sa manière...
– Pourvu, repris-je, que la police, au moment où elle perquisitionnera chez toi, ne trouve aucun document suspect.
– Je l’en défie bien ! répondit-il ; là où ils sont, elle ne les trouvera ramais.
– Tout de même, fis-je, si j’étais à ta place, je me méfierais ; il y a des « tecs » terriblement forts dans la « grande équipe ».
– En admettant même que cela soit vrai, comment veux-tu, maintenant que je suis pris, que je fasse disparaître ces papiers ?
– En effet, répondis-je ; je n’avais pas pensé à cela. Diable ! mais alors, la situation devient inextricable...
Et, après avoir fait semblant de réfléchir quelques instants, je repris, de l’air le plus innocent du monde :
– À moins que...
– À moins que quoi ? fit Willy Jones haletant.
– À moins qu’un de tes amis n’aille chez toi avant la police et ne fasse disparaître ces papiers.
– C’est très joli ce que tu dis là, me répondit-il ; mais comment veux-tu que je prévienne mes amis ?
– Rien de plus facile, répondis-je, si toutefois, comme tu me l’as fait espérer tout à l’heure, on me « relâche » demain. Dans ce cas, je me mettrais bien volontiers à ta disposition.
– Tu ferais cela ? s’exclama-t-il.
– Pourquoi pas ?
Willy Jones, pensif, me regarda longuement puis, ayant enfin pris une décision, il me dit :
– Écoute, j’ai en toi la plus entière confiance. Comme il est probable que – grâce aux papiers trouvés sur Arthur Bridget – la plupart de mes amis sont arrêtés à l’heure actuelle, je vais te dire où est caché le dossier en question. Tu iras chez moi et tu le détruiras.
– C’est entendu ! répondis-je sans broncher.
– J’habite, reprit le bandit, dans une maison isolée, en ruines, qui se trouve à Cremyll, sur la falaise. La clé de cette maison est cachée, à fleur de terre, sous un baquet renversé que tu apercevras à droite de la porte.
– Bien !
– Tu entreras dans la chambre de droite ; celle où se trouve mon lit. Ce lit, tu le déplaceras et, sous la cinquième dalle, – tu les compteras en partant du mur du fond, – tu trouveras une grande enveloppe jaune, cachetée à la cire. C’est cette enveloppe que je te charge de détruire.
– Tu peux être tranquille, ce sera fait, répondis-je.....
Le lendemain, ayant été extrait de ma cellule à la première heure, je me rendis en compagnie de John Sheridan à Cremyll où, conformément aux indications qui m’avaient été données par Willy Jones, je trouvai le dossier constitué par Arthur Bridget.
Le soir même, tous ses complices – sauf lord Edward Berrydale, contre lequel aucune inculpation n’avait pu être relevée – furent arrêtés.
Traduits devant une cour martiale et condamnés à mort, ils furent immédiatement fusillés.
Seul fut exempté de cette peine Willy Jones, dont je pus établir la bonne foi.
Il s’en tira avec vingt ans de hard labour.
Malheureusement, quand je me présentai le lendemain à Londres, dans Kings Road, pour arrêter Hans Fuchs, ce dernier avait disparu.
Je reçus l’ordre de le retrouver à tout prix, et cela MORT OU VIF !
Où James Nobody
entre en communication avec Hans Fuchs.
L’ordre qui venait de m’être donné ne laissa pas de me surprendre.
S’il est, en effet, de règle constante en matière de contre-espionnage, de tout mettre en œuvre pour démasquer un agent de l’ennemi, – surtout s’il opère sur le territoire national, – il est par contre sous-entendu que cet espion, dans l’intérêt même de l’information judiciaire consécutive à son arrestation, doit être – autant que possible – capturé vivant.
Or, cette fois, il n’en était pas de même. C’est mort ou vif qu’il me fallait capturer Hans Fuchs.
Ah ! ça ; que voulait dire cela ?
Quels crimes avait donc bien pu commettre cet homme ?
Après avoir longuement réfléchi à cette affaire, je décidai de me rendre au service de contre-espionnage afin de voir s’il n’existerait pas dans nos archives un dossier au nom de cet aventurier.
Dès l’abord, je fus fixé.
Non seulement Hans Fuchs possédait un dossier à l’« Intelligence Service » ; mais, par surcroît, ce dossier contenait contre lui de terribles accusations.
On lui reprochait trois meurtres ; deux tentatives d’assassinat ; cinq faux en écriture ; trois incendies volontaires ; une douzaine de cambriolages effectués à main armée, en bande, la nuit, dans des maisons habitées.....
Cela étant, comment cet homme qui, étant donné son passé, aurait dû être arrêté et fusillé dès son arrivée en Angleterre, avait-il pu s’installer et opérer tranquillement à Londres, et cela, SOUS SON NOM VÉRITABLE ?
C’était à n’y rien comprendre
Autour de cet homme le mystère s’épaississait...
Ayant pris copie des différentes pièces du dossier, je me rendis ensuite au service anthropométrique où, sur ma demande, on me remit, en même temps que la fiche relative à Hans Fuchs, une vingtaine de ses photographies.
Ces photographies, je les envoyai aux chefs des services secrets du littoral, leur enjoignant, en outre, d’arrêter immédiatement Hans Fuchs, s’il se présentait dans l’un de nos ports pour s’embarquer à destination du continent.
À vrai dire, – Hans Fuchs n’étant pas homme à se laisser capturer de la sorte, – je ne croyais nullement à l’efficacité de cette mesure ; mais en pareille matière, il est bon de tout prévoir et de ne négliger aucune précaution.
Ayant ainsi tendu ma souricière, je me rendis, en compagnie de trois inspecteurs, dans Kings Road, où étaient installés les bureaux du pseudo-courtier en grains.
Ainsi que je m’y attendais, ils étaient fermés. Mais le cas avait été prévu et l’un de mes hommes, aussi habile serrurier que détective adroit, eut tôt fait d’ouvrir la porte.
Nous entrâmes.
L’appartement était vide.
Il se composait de quatre pièces aménagées en bureaux, desservies par un couloir central, au bout duquel se trouvaient à droite un cabinet de débarras encombré de dossiers, et à gauche, le lavatory.
Les bureaux étaient simplement mais confortablement meublés, et ne se différenciaient en rien des installations du même genre.
Sur la porte de chaque bureau figurait une étiquette.
Celui réservé à Hans Fuchs était désigné par le mot Private. Sur les autres portes nous lûmes : Premier clerc ; Service des achats ; Service des ventes.
De l’ensemble se dégageait une impression d’ordre, de méthode et de propreté.
Ayant placé l’un de mes hommes en sentinelle près de la porte, mais à l’intérieur de l’appartement, je me mis immédiatement à l’ouvrage.
Mais ni dans le bureau de Hans Fuchs, ni dans ceux occupés par ses employés, je ne trouvai rien qui, de près ou de loin, parût se rapporter à l’affaire d’espionnage.
Cette constatation ne me surprit pas outre mesure, les papiers importants – si, toutefois, ils n’avaient pas été détruits – devant se trouver au domicile personnel de l’espion, situé dans Oxford Street, au no 24, et que, depuis la veille, plusieurs de mes hommes surveillaient attentivement.
Après avoir remis en place tous les dossiers, j’apposai les scellés sur toutes les portes et, ayant fait sortir mes hommes, je m’apprêtais à en faire autant quand, soudain, à l’intérieur du bureau de Hans Fuchs, la sonnerie du téléphone retentit...
Je me précipitai vers l’appareil et, après avoir porté le récepteur à mon oreille, j’attendis.
– Allô ! fit une voix.
– Allô ! répondis-je ; que désirez-vous ?
– Je désire, me répondit-on, être mis en communication avec M. James Nobody.
– C’est M. James Nobody lui-même qui est à l’appareil, répondis-je, fort surpris...
– Cela tombe à merveille, cher monsieur, fit mon interlocuteur ; car j’ai des excuses à vous faire. Ignorant qu’il entrait dans vos intentions de venir me rendre visite, je me suis absenté et...
– Allô ! Oui donc êtes-vous ? interrompis-je.
– Je suis M. Hans Fuchs ; celui-là même dans les bureaux duquel vous êtes en train de perquisitionner.
– Vous plaisantez, sans doute ? fis-je, ne pouvant en croire mes oreilles.
– Jamais je n’ai été aussi sérieux, au contraire. Ceci dit, permettez-moi de vous assurer que vous faites fausse route. Non seulement vous ne trouverez aucun document compromettant dans mes bureaux ou à mon domicile particulier ; mais, en outre, les petits papiers que vous avez cru bon d’envoyer ce tantôt dans tous les ports ne produiront aucun effet...
– C’est ce que vous verrons ! répondis-je, furieux.
– C’est tout vu, cher Monsieur ; et voici pourquoi : au moment précis où cessera cette communication, mon auto m’emmènera vers un point de la côte, – vous m’excuserez de ne pas préciser, – où m’attend un sous-marin allemand qui, dans douze heures au maximum, me déposera en lieu sûr... Allô ! Allô ! Vous m’entendez ?
– Fort bien ! répondis-je avec le plus grand calme ; veuillez poursuivre.
– Mon Dieu ! reprit Hans Fuchs ! c’est à peu près tout ce que j’avais à vous dire...
– Dans ce cas, à bientôt ! fis-je.
– Comment, à bientôt ?
– Mais oui, répondis-je ; j’ai le plus vif désir de faire votre connaissance, et soyez assuré que je vais tout mettre en œuvre pour réaliser ce désir.
– En ce cas, il vous faudra venir en Allemagne, ce qui, étant donnée la situation actuelle, pourrait comporter quelques risques.
– Bah ! Qui ne risque rien n’a rien !
– Mes compliments ! Vous avez du cran ! À bientôt, alors ?
– C’est dit ; à bientôt !
C’est sur ces derniers mots que la communication prit fin.
J’attendis quelques instants, puis je me mis en communication avec le central téléphonique.
– Allô ! demandai-je à l’employé ; pouvez-vous me dire de quel poste émane la communication que je viens de recevoir ?
– Rien de plus facile, me répondit-il ; elle provient du poste 1642 Grosvenor.
– Bien ; et où est situé ce poste ?
– Bolton Street no 162 ; quartier de Piccadilly.
– Je vous remercie, fis-je, en accrochant l’écouteur.
Ainsi, contrairement à ce qu’il venait de me dire, Hans Fuchs était encore à Londres...
Prenant l’annuaire du téléphone, je vérifiai la position du poste 1642 Grosvenor.
Ainsi que je m’y attendais, il était situé dans un café, c’est-à-dire dans un endroit où tout contrôle était impossible, car Hans Fuchs se serait bien gardé de téléphoner du café où il fréquentait habituellement.
Je n’en décidai pas moins de me rendre aussitôt dans Bolton Street.
En effet, si ténu que soit un fil, il n’en convient pas moins de le suivre.
C’est par lui que, toujours, on arrive là où il aboutit...
Où James Nobody
prend une grave résolution.
– Ce monsieur vient de partir il n’y a pas cinq minutes, me répondit le patron du café, auprès duquel je m’informai de ce qu’était venu faire Hans Fuchs chez lui.
– By Jove ! fis-je ; c’est bien regrettable, j’aurais été vraiment heureux de le rencontrer.
– Croyez bien que lui-même a beaucoup regretté de ne pouvoir vous attendre ; mais...
– Comment ! Il vous a dit qu’il m’attendait ? m’écriai-je.
Le patron du café me jeta un coup d’œil surpris...
– Pardon ! fit-il ; mais... ne seriez-vous pas M. James Nobody ?
– Tel est mon nom, en effet, répondis-je, ahuri...
– Alors, voici qui vous appartient, fit-il, en me tendant une lettre...
– Vous en êtes sûr ?
– Dame ! Voyez plutôt la suscription ; sauf erreur, cette lettre vous est bien destinée...
Je pris la lettre, et sur l’enveloppe je lus :
James Nobody, esq.
118 New Bond Street
London
Aucune erreur n’était possible. Cette lettre m’était bien destinée...
Je la décachetai aussitôt. Elle ne contenait que ces mots :
Rien ne sert de courir, il faut partir à temps.
H. F.
Décidément Hans Fuchs était un habile homme. Non seulement il avait prévu que je rechercherais le poste d’où il m’avait téléphoné, mais aussi, se doutant que j’y viendrais enquêter, avant que de partir, il m’avait lancé cette flèche du Parthe...
– Rira bien qui rira le dernier, pensai-je, tout en plaçant dans mon portefeuille l’autographe du bandit.
Après avoir remercié le patron du café de son obligeance, je lui demandai si, par hasard, il n’avait pas remarqué de quelle couleur était la carrosserie de l’auto appartenant à Hans Fuchs.
– Je l’ai d’autant mieux remarquée, me répondit le brave homme, que la voiture, par elle-même, est splendide. C’est une Rolls-Royce de toute beauté, peinte en gris clair, et portant le numéro 17253-W. E.
– Parfait, répondis-je, tout en notant soigneusement les indications qui venaient de m’être données, après quoi j’ajoutai :
– Ce... monsieur, était-il seul ?
– Point ! Deux personnes – un monsieur et une dame – l’accompagnent.
– Jeune, la femme ?
– Oui, et fort jolie.
– Brune ou blonde ?
– Ma foi, je n’ai pas remarqué. Quant à l’officier...
– Quel officier ? interrompis-je.
 |
PICCADILLY-CIRCUS, LA NUIT.
– Mais... celui qui accompagne monsieur votre ami.
– Ah ! bien ; j’ai compris. Le monsieur qui accompagne mon... ami, est un officier ? C’est bien cela, n’est-ce pas ?
– Tout à fait.
– Eh ! bien, qu’a-t-il de remarquable ? demandai-je.
– Rien..., sinon qu’il porte les insignes de l’État-major général.
– Vous êtes sûr de cela ?
– D’autant plus sûr que je suis un ancien secrétaire d’état-major.
– Bien ! Et... c’est tout ce que vous avez remarqué ?
– Ma foi, oui ; répondit le brave homme, que je quittai, non sans l’avoir remercié de nouveau, ce dont il parut tout confus...
Quelques instants plus tard, j’étais de retour à mon bureau de l’ « Intelligence Service », d’où, par notre poste spécial, j’alertai tous les services secrets du littoral et de l’intérieur.
En moins d’une heure, – et cela, dans un rayon de cent kilomètres, – toutes les routes partant de Londres furent barrées par des patrouilles de policiers motocyclistes et par des autos-mitrailleuses.
De son côté, le ministère de l’Intérieur mit sur pied, dans le même rayon, toutes les forces de Constabulary dont il disposait ; tant et si bien que, bientôt, un vaste réseau policier fonctionnant en profondeur fut tendu autour de Londres.
D’autre part, m’étant mis en communication avec l’amiral Fisher, je lui rendis compte des incidents qui venaient de se produire, lui demandant, en outre, de faire surveiller les côtes avec la plus grande attention.
– Parfait ! me répondit le grand chef ; je vais faire surveiller les côtes et le large par nos hydravions...
Ainsi qu’on le voit, les dispositions prises par moi étaient aussi complètes que possible et, quelle que fut son habileté, il me semblait difficile – pour ne pas dire impossible – que Hans Fuchs pût franchir un réseau de surveillance d’une telle amplitude.
Il y parvint cependant...
En effet, vers minuit, alors que, harassé de fatigue, je m’apprêtais à rentrer chez moi pour y prendre un repos bien gagné, un planton me remit le télégramme que voici :
Constabulary de Folkestone à Intelligence Service. Londres.
Auto grise 17253-W. E. trouvée abandonnée et mise hors service à proximité de Romney. Occupants disparus sans laisser traces. Prière indiquer suite à donner.
Je répondis aussitôt, par télégramme également :
Prière, en attendant mon arrivée, mettre auto grise en sûreté et respecter, si possible, empreintes digitales.
Dix minutes plus tard, je partais pour Croydon, d’où un avion rapide me transporta à Folkestone.
Aussitôt arrivé, je me rendis au garage où avait été remisée la voiture. Elle était en bien triste état, Hans Fuchs ayant essayé de l’incendier.
Néanmoins, je pus aisément relever quelques empreintes digitales, parmi lesquelles celles du bandit. Restait à identifier les autres.
Il fallait pour cela que le service anthropométrique intervînt, car il était seul qualifié pour mener à bien une telle opération.
Usant de mon pouvoir discrétionnaire, je réquisitionnai immédiatement un camion-auto sur lequel fut solidement amarrée la Rolls-Royce de Hans Fuchs ; après quoi, je l’expédiai à Londres sous bonne escorte.
L’enquête à laquelle je me livrai sur place ne m’ayant rien appris de nouveau, Hans Fuchs ayant soigneusement évité de se montrer en ville, je décidai de rentrer à Londres.
Mais, je n’en avais pas fini avec Hans Fuchs.
En effet, au moment précis où j’allais enjamber la carlingue de l’avion, je vis arriver un agent cycliste qui, de loin, nous faisait signe de l’attendre.
Mettant pied à terre, je me portai à sa rencontre.
– M. James Nobody, sans doute ? fit-il, en saluant correctement.
– En effet ; que désirez-vous, mon ami ?
– Je suis chargé par le commissaire de police de vous remettre ce pli.
Ce disant, il me tendait une enveloppe.
Je l’ouvris.
Elle contenait la carte de Hans Fuchs, au bas de laquelle figuraient ces trois lettres P. P. C. qui, chacun le sait, signifient : Pour prendre congé.
Ainsi, jusqu’au bout, le bandit avait tenu à me narguer.
J’encaissai sans mot dire ce nouvel affront ; mais, faisant mienne la consigne qui m’avait été donnée, je jurai à mon tour de m’emparer, MORT OU VIF, de Hans Fuchs...
Où James Nobody apprend une nouvelle
à laquelle il ne s’attendait pas.
Quand je lui eus rendu compte des efforts infructueux que j’avais tentés pour m’emparer de Hans Fuchs, mon chef, le général Sir Arthur Birdwell, me dit :
– Je vous connais assez pour savoir que vous ne resterez pas sur un pareil échec. Que comptez-vous faire ?
– Aucune hésitation ne me paraît possible, mon général, répondis-je ; de deux choses l’une : OU HANS FUCHS AURA MA PEAU, OU J’AURAI LA SIENNE.
– Diable ! Vous avez une façon de présenter les choses...
– Ne seriez-vous pas de mon avis ?
– Si ; mais encore convient-il de ne pas agir à la légère. Somme toute, si j’ai bien compris, vous me demandez l’autorisation d’aller combattre Hans Fuchs sur son propre terrain, c’est-à-dire en Allemagne.
– C’est cela même, mon général.
– Croyez-vous vraiment que le jeu en vaille la chandelle ?
– Si vous m’aviez permis de terminer mon exposé, mon général, vous...
– Ah ! ça, il y a donc autre chose ? s’écria sir Arthur Bridwell.
– Je pense bien ! Savez-vous de qui provenaient les empreintes digitales relevées dans la voiture de Hans Fuchs ?
– C’étaient les siennes, parbleu !
– Certes ; mais, avec les siennes, il y avait également celles de lord Edward Berrydale.
– Vous en êtes sûr ? s’écria le général en bondissant sur ses pieds.
– Les empreintes digitales ne trompent pas, mon général.
– Mais alors, le fait est d’une exceptionnelle gravité.
– Il y a quelque chose de beaucoup plus grave encore, mon général.
– Quoi donc ?
– À côté des empreintes digitales de Hans Fuchs et de lord Edward Berrydale, le service anthropométrique a relevé celles de Naldony.
– Le terroriste russe ?
– Lui-même.
– Oh ! Oh ! Voilà une association qui ne me dit rien qui vaille !
– D’autant plus qu’elle travaille à coup sûr, insistai-je.
– Que voulez-vous dire ? fit le général en venant vers moi et en me fixant dans les yeux.
– Je veux dire, mon général que, en toute cette affaire, il y a des choses que je m’explique mal.
– Lesquelles ?
– En premier lieu, je n’arrive pas à comprendre comment Hans Fuchs – étant donné son passé – n’a pas été repéré dès son arrivée à Londres. De toute évidence, le service du contrôle des étrangers n’a pas fait son devoir en cette affaire. Il faudra qu’on sache pourquoi.
– En effet, répondit le général, en prenant une note sur son carnet.
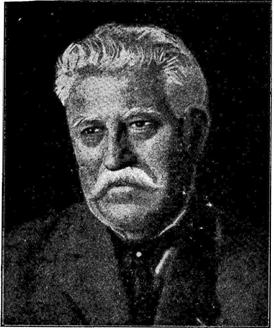
LE GÉNÉRAL SIR ARTHUR BIRDWELL,
chef de « l’intelligence service » britannique.
– Ensuite, repris-je, pouvez-vous m’expliquer comment il a pu se faire que Hans Fuchs – un Allemand, ne l’oublions pas – ait pu obtenir l’autorisation d’installer à Londres, en pleine guerre, un commerce de grains, lequel était en relations quotidiennes avec notre propre service de ravitaillement, DONT IL ÉTAIT LE FOURNISSEUR ?
– C’est inimaginable !
– Certes, MAIS CELA EST !
– Il faudra tirer cela au clair.
– Cela me paraît indispensable, mon général, repris-je ; de même qu’il me paraît indispensable de savoir comment a bien pu faire Hans Fuchs pour franchir le réseau policier que j’avais tendu entre la mer et lui.
– Il y a là, en effet, une énigme, fit sir Arthur Birdwell, tout songeur.
– Oui, mon général, il y a là une énigme. Et elle est d’autant plus cruelle qu’elle ne peut s’expliquer que par des défaillances ou des complicités.
– Je préfère croire à des défaillances qu’à des complicités.
– Si vous voulez, mon général ; mais, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre de ces hypothèses, j’estime que des sanctions doivent intervenir.
– Vous pouvez vous en rapporter à moi pour cela, répondit le général ; ce n’est pas au moment où nos soldats sont aux prises avec les Huns que je permettrai qu’on les poignarde dans le dos. La cause est entendue, et je vais faire procéder immédiatement à une enquête.
– Puis-je me permettre de vous demander, mon général, à qui vous comptez confier le soin de mener à bien cette enquête ?
– Ma foi, répondit le général, je ne vois pas trop à qui je pourrai faire appel.
– En ce cas, mon général, je crois avoir sous la main l’homme qu’il vous faut.
– Quel est cet homme ?
– John Sheridan, répondis-je ; un vieux détective de mes amis, que...
– John Sheridan ! s’écria le général, mais je ne connais que lui ! Il a servi sous mes ordres, et je le tiens, en effet, pour l’un de nos meilleurs policiers. Vous savez où le joindre ?
– Il est actuellement à Londres, mon général ; si vous le voulez bien, j’aurai l’honneur de vous le présenter tantôt.
– C’est entendu.
Puis, après avoir réfléchi quelques instants, il reprit :
– Votre intention est-elle toujours de partir pour le continent ?
– Oui, mon général.
– Soit, je vous y autorise ; mais à la condition formelle que vous me soumettrez votre plan d’action avant votre départ.
– Telle était mon intention, mon général...
C’est sur ces mots que prit fin notre entretien.
Somme toute, j’avais obtenu gain de cause sur toute la ligne. Non seulement j’étais autorisé à mener à bonne fin l’enquête entreprise contre Hans Fuchs, mais, par surcroît, j’avais réussi à faire affecter John Sheridan à l’« Intelligence Service ».
J’étais certain qu’il y ferait œuvre utile.
Aussi, dès que je fus rentré chez moi, lui téléphonai-je aussitôt, pour lui faire part de cette bonne nouvelle.
Il s’en montra d’autant plus ravi qu’il ne s’y attendait pas.
Nous convînmes d’un rendez-vous pour l’après-midi ; après quoi, ayant pris connaissance de mon courrier, je me rendis au café de Bolton Street, afin d’y vérifier un renseignement qui m’avait été donné par le patron.
On se souvient, en effet, que ce dernier m’avait affirmé que, parmi les occupants de la voiture de Hans Fuchs, se trouvait une femme.
Or, de cette femme, je n’avais trouvé trace nulle part.
Bien mieux, par l’examen des empreintes digitales, j’avais acquis la certitude que les occupants n’étaient autres que Hans Fuchs, lord Edward Berrydale et Naldony.
Je voulais en avoir le cœur net.
Dès qu’il m’aperçut, le patron du café leva les bras au ciel et s’écria :
– Décidément, vous n’avez pas de chance ; votre ami sort d’ici !
– Mon ami ! Quel ami ? répondis-je, stupéfait.
– Mais... celui qui est venu avant-hier matin, et qui a laissé une lettre à votre adresse.
– Ah ! ça, vous êtes fou ! m’écriai-je.
– Comment, je suis fou ! Tenez, son verre est encore là, sur la table.
Je me dirigeai vers la table et ayant pris le verre, je le regardai par transparence.
Il y avait bien des empreintes digitales...
Mais ce n’était pas celles de Hans Fuchs...
C’ÉTAIENT CELLES DE NALDONY...
Où James Nobody
commence à s’apercevoir qu’il a affaire
à forte partie.
J’avoue que, de prime abord, cette découverte m’ahurit quelque peu...
Mais, en y réfléchissant bien, je compris qu’il s’agissait là d’une nouvelle manœuvre de Hans Fuchs ; manœuvre ayant pour but évident de brouiller la piste sur laquelle je m’étais lancé, et qui devait me conduire jusqu’à lui.
Après avoir soigneusement mis de côté le verre dont s’était servi Naldony, je tirai de mon portefeuille la photographie de Hans Fuchs et, la plaçant sous les yeux du patron du café, je lui demandai :
– Vous souvenez-vous d’avoir déjà vu cet homme ?
Il prit la photographie, l’examina longuement puis, tout en me la rendant, il répondit :
– Je ne me souviens pas de l’avoir jamais vu.
– Ne figurait-il pas parmi les occupants de la voiture ? insistai-je.
Il eut une seconde d’hésitation puis, se tournant vers l’un de ses garçons de café :
– Dites-moi, John, fit-il, c’est bien vous, n’est-il pas vrai, qui avez porté dans la voiture, avant-hier, les deux bouteilles de stout commandées par l’ami de monsieur ?
Le garçon répondit par un signe de tête affirmatif.
– Dans ce cas, reprit son patron, vous devriez pouvoir reconnaître les personnes qui s’y trouvaient...
– Très aisément, répondit-il.
Je crus bon d’intervenir...
– Ce monsieur était-il du nombre ? fis-je, en lui tendant la photographie de Hans Fuchs.
– Ah ! ça, s’écria-t-il dès qu’il l’eut regardée, mais... je rêve, moi !
Puis, la désignant du doigt :
– Je veux bien être pendu, fit-il, si ce n’est là le portrait de la femme qui se trouvait dans la voiture avec l’officier.
– Vous en êtes sûr ? m’écriai-je à mon tour ; regardez bien...
Il jeta un nouveau coup d’œil sur la photographie et répondit avec assurance :
– Il ne saurait y avoir aucun doute, et je suis prêt à en témoigner.
M’adressant alors au patron, – mais de façon à être entendu par tout son personnel – je déclarai :
– L’homme que, jusqu’ici, vous avez cru être mon ami est, en réalité, un malfaiteur des plus dangereux. Plus dangereux encore sont ceux qui l’accompagnent, surtout celui qui est déguisé en femme. Je vous demande, – et au besoin je vous ordonne, – si jamais ils osaient se présenter de nouveau chez vous, de les faire arrêter immédiatement.
Ayant dit, j’attirai le patron dans un coin et, me penchant vers lui, j’ajoutai à voix basse :
– Non seulement ces gens-là sont des malfaiteurs, mais ce sont aussi des espions. Je fais appel à votre patriotisme et je vous demande d’agir en conséquence.

NALDONY
le fameux terroriste russe.
– Ah ! Ah ! C’est donc de cela qu’il retourne, me répondit le brave homme, en me donnant une énergique poignée de main ; hé ! bien, vous pouvez compter sur mon personnel et sur moi ; s’ils reviennent ici, je me charge de leur régler leur compte.
Fort de cette assurance, je pris congé de lui, et je me rendis aussitôt au rendez-vous que j’avais fixé à John Sheridan.
En quelques mots, je le mis au courant des incidents relatés ci-dessus ; après quoi, je lui traçai les grandes lignes de la mission dont il allait être chargé.
– Cette affaire me plaît infiniment, se borna-t-il à me répondre ; et cela d’autant plus que, comme vous, je demeure persuadé qu’il ne s’agit nullement de défaillances, mais bien de complicités effectives.
– Parbleu !
– C’est limpide ! ajouta-t-il ; cela saute aux yeux ! Au vrai, il n’est pas possible d’expliquer autrement la longue impunité dont ont bénéficié Hans Fuchs et ses complices.
Ce point de vue, il l’exposa et il le défendit avec énergie devant le général sir Arthur Birdwell, auquel je le présentai quelques instants plus tard.
Qu’il fût, ou non, convaincu par cet exposé, le général ne lui en accorda pas moins liberté de manœuvre et pleins pouvoirs d’enquête.
C’est tout ce que demandait John Sheridan que j’invitai, une fois l’audience terminée, à m’accompagner jusque chez moi.
Comptant partir pour le continent le plus tôt qu’il me serait possible de le faire, il importait, en effet, qu’un accord intervînt entre nous, de manière à ce que fût assurée la concomitance de notre action.
Tout d’abord, je donnai à John Sheridan l’assurance que le contact ne serait jamais perdu entre nous et que, quoi qu’il arrivât, sa correspondance me parviendrait sûrement, même si j’étais obligé par la suite de résider en Allemagne, à la stricte condition qu’il l’envoyât à une adresse que je lui indiquai à Dunkerque.
Ensuite, et afin de mieux assurer le secret de cette correspondance, nous convînmes d’un code, indéchiffrable pour tout autre que nous.
Tout ayant été réglé au mieux des intérêts dont nous avions la charge, nous prîmes affectueusement congé l’un de l’autre.
Je ne me doutais certes pas, au moment où, après l’avoir accompagné jusqu’au seuil de ma porte, je lui serrai la main, que quelques minutes plus tard, cet excellent homme allait être victime du plus lâche des attentats.
En effet, à peine venait-il de me quitter, que je perçus le bruit d’une chute qu’accompagna un grand cri...
Puis, le silence – UN SILENCE EFFRAYANT, LOURD D’ANGOISSE – se fit...
De même que les autres locataires de l’immeuble, je me précipitai dans l’escalier et, à l’étage au-dessous du mien, j’aperçus John Sheridan gisant de tout son long sur le palier et ne donnant plus signe de vie...
Me penchant par-dessus la rampe :
– Fermez immédiatement la porte ! criai-je au concierge.
Puis, m’adressant aux locataires qui, d’instinct, s’étaient figés sur place :
– Que personne ne bouge ! leur dis-je ; il y a danger de mort !
Descendant ensuite l’escalier avec précaution, marche par marche pour ainsi dire, j’arrivai bientôt auprès de John Sheridan, sur le corps duquel je me penchai.
Hélas ! mon malheureux ami avait cessé de vivre...
Mon sang ne fit qu’un tour...
Mais le sentiment du devoir aidant, je réagis avec énergie...
Et la première question que je me posai fut la suivante :
– Y a-t-il eu crime ou accident ?
Une constatation que je fis aussitôt me démontra que seule la première de ces hypothèses était la vraie.
En effet, dès l’abord, je constatai que la blessure ayant entraîné la mort se situait entre le frontal et le pariétal droits.
Une intumescence assez prononcée, de couleur violacée, la révélait...
Délicatement, je palpai la blessure...
Sous la pression de mes doigts, les os, disjoints, craquèrent...
De plus, le vomer, brisé, formait saillie hors de la protubérance nasale et le maxillaire inférieur était fracturé...
De toute évidence, John Sheridan, violemment projeté en avant par une force dont il restait à déterminer la nature, était venu s’écraser, la face la première, sur le sol...
Donc, il y avait eu crime...
Où James Nobody
se montre égal à lui-même.
Sur ces entrefaites, mon valet de chambre, Paddy Burns, vint me rejoindre.
Irlandais de naissance, Paddy Burns était depuis une vingtaine d’années à mon service ; c’est dire que j’avais en lui la plus entière confiance.
Très digne, il me déclara :
– Bien que monsieur n’ait pas sonné, je n’en viens pas moins me mettre à la disposition de monsieur.
Malgré tout ce que comportait de tragique la situation, je ne pus réprimer un sourire.
– Tu as fort bien fait, répondis-je.
Et, après avoir réfléchi une seconde, j’ajoutai :
– Téléphone de ma part au commissaire de police de service à Scotland Yard, et demande-lui de venir me rejoindre d’urgence. Spécifie qu’il s’agit d’un assassinat.
– Un assassinat ? Bah ! Croyez-vous ? fit quelqu’un derrière moi.
Vivement, je me retournai et j’aperçus, penché sur le corps de John Sheridan, un homme portant la tenue des médecins-majors de l’armée.
– Pardon, lui demandai-je poliment, pouvez-vous me dire à qui j’ai l’honneur de parler ?
Cérémonieusement, il se présenta :
– Médecin-major William Bradley-Sullivan, du 2e Life Guards.
Puis, négligemment il ajouta :
– Comme je passais devant la porte, j’ai entendu dire qu’un accident venait de se produire dans l’immeuble et alors, naturellement, je suis monté...
C’était là un mensonge flagrant, puisque mon premier geste, après que « l’accident » se fut produit, avait été de faire fermer la porte de l’immeuble.
Mis en éveil, je « détaillai » l’individu.
Comme la plupart des Anglais de ma classe et de mon époque, je connaissais de réputation le docteur William Bradley-Sullivan, que ses découvertes scientifiques et ses travaux de laboratoire avaient signalé à l’attention du grand public.
Je me souvins même que, récemment, les journaux avaient longuement parlé d’une invention dont il était l’auteur, et qui ne tendait à rien moins qu’à bouleverser toutes les idées que nous avions en matière de balistique.
Et, même, à cette occasion, ils avaient publié son portrait...
Or, l’homme que j’avais sous les yeux ne ressemblait en rien à ce portrait...
Le docteur William Bradley-Sullivan était entièrement rasé ; sa taille atteignait cinq pieds six pouces, et il était légèrement obèse.
Mon interlocuteur, au contraire, portait une moustache et une barbe grisonnantes, était de taille moyenne, et s’avérait « sec comme un coup de trique ».
Néanmoins, je ne « tiquai » pas et, m’inclinant à mon tour, je me présentai :
– James Nobody, publiciste.
Je le vis tressaillir puis, ses yeux se fixèrent sur moi, hagards...
– Comment ! s’écria-t-il, vous êtes M. James Nobody ! Mais..., on m’avait dit, au contraire, que c’est à M. James Nobody que ce... déplorable accident était arrivé !
– Il n’en est rien, vous le voyez, répondis-je en souriant ; mais je ne vous en sais pas moins gré de la rapidité avec laquelle vous êtes intervenu. Cela va nous permettre, en attendant l’arrivée du commissaire de police, de déterminer la cause exacte de la mort de ce malheureux.
– Il s’agit d’une fracture du crâne consécutive à une chute, répondit-il précipitamment.
– Je suis entièrement de votre avis, fis-je ; mais... à quoi attribuez-vous cette chute ?
– Mon Dieu, fit-il, je pense qu’il s’agit là d’un accident banal, d’un accident comme il s’en produit tous les jours, d’un accident qui...
– Et si au lieu d’un accident, interrompis-je, il s’agissait d’un crime, que diriez-vous ?
– Un crime ! s’écria-t-il ; vous voulez rire, sans doute.
– Trouvez-vous qu’il y ait vraiment de quoi rire en cette affaire ? repris-je.
– Non, certes ; mais, de là à conclure à un crime, c’est aller vite en besogne...
– Pas plus que de conclure à un accident, alors que tout démontre qu’il y a eu crime ! répondis-je du tac au tac.
– Seriez-vous donc médecin ? me demanda-t-il, narquois.
– Non, mais je suis policier ! Et je vais vous le démontrer.
Peu à peu, le ton de la discussion s’était haussé et, violant la consigne que je leur avais donnée, les locataires de l’immeuble s’étaient approchés et faisaient cercle autour de nous, ce qui parut déplaire souverainement à mon interlocuteur.
– Sans mettre en doute les brillantes qualités qui ont fait de vous l’un des princes de la science, permettez-moi, repris-je, d’être surpris du diagnostic que vous venez de formuler.
– Voilà une surprise que je ne m’explique guère, fit-il, goguenard.
– Vraiment ? Dans ce cas, souffrez que je poursuive.
– Je vous écoute.
– En admettant que votre hypothèse, – CELLE DE LA CHUTE, – soit la vraie, que se serait-il produit ? Ceci : au lieu d’être projeté en avant avec une force, une brutalité que suffisent à établir les horribles blessures que porte ce malheureux, il se serait effondré sur place et, insensiblement, aurait glissé jusqu’au palier.
– Insensiblement ?
– Admettons même, fis-je, que, en vertu de la vitesse acquise, il y soit parvenu avec violence. Croyez-vous vraiment que ce choc aurait suffi à entraîner la mort ?
– Mais...
– Je conçois que cette question vous gêne, repris-je ; mais il y a mieux.
– Quoi donc ? fit-il, visiblement inquiet cette fois.
Me penchant sur le cadavre de John Sheridan, je relevai à mi-hauteur les jambes de son pantalon et, du doigt, désignant deux ecchymoses longitudinales qui zébraient ses tibias, au « docteur », je demandai :
– Les ecchymoses étant ordinairement le résultat d’une contusion, pouvez-vous me dire d’où proviennent celles-ci ?
Tout décontenancé, il s’écria :
– Comment avez-vous découvert cela ? Je ne vous ai pas vu toucher au pantalon de ce malheureux.
Le fixant dans les yeux, je répondis :
– Ceci me permet de supposer que vous étiez là, AU MOMENT MÊME OU LE CRIME S’EST COMMIS, ET NON PAS APRÈS, ainsi que vous me l’avez affirmé tout à l’heure.

LORD EDWARD BERRYDALE
camouflé en médecin-major, au moment de son arrestation.
– Qu’osez-vous insinuer ? s’exclama-t-il, furieux.
– Je n’insinue pas, répondis-je avec calme ; je DÉDUIS, ce qui n’est pas la même chose. Mais, passons !... Vous m’avez fait l’honneur de me demander, je crois, comment, n’ayant pas touché au cadavre que voici, j’avais découvert cependant qu’il portait aux tibias deux ecchymoses ?
Tout simplement parce qu’il n’est pas d’effet sans cause.
OR LA CAUSE DE CES ECCHYMOSES, LA VOICI :
Écartant d’un geste les locataires groupés sur l’escalier, je leur montrai les deux bouts d’un fil d’acier, dont l’un était fixé à la rampe de l’escalier et dont l’autre pendait au bout d’un piton solidement vissé dans la cloison.
– Ainsi que vous le voyez, repris-je, le fil d’acier s’est rompu sous le choc. Mais ce choc lui-même n’aurait pas été assez violent pour provoquer la rupture du fil.
– Que s’est-il donc passé ? demanda quelqu’un.
– Ce qui s’est passé ? Je vais vous le dire :
– Au moment précis où mon ami, – CAR CET HOMME ÉTAIT MON AMI, ET CE N’ÉTAIT PAS LUI QUI ÉTAIT VISÉ, MAIS MOI, – a heurté le fil d’acier avec ses jambes, un homme, blotti dans l’ombre, s’est jeté sur lui, et d’une violente poussée l’a fait basculer en avant.
Une rumeur d’indignation s’éleva de l’assistance...
Quand le calme se fut rétabli, je repris :
– C’est ce qui vous explique la gravité des blessures reçues par ce malheureux ; blessures qui ne se seraient pas produites si la chute avait été normale.
Puis, me tournant vers le « docteur » :
– C’est bien ainsi, n’est-il pas vrai, lui demandai-je, que les choses se sont passées ?
Livide, flageolant sur ses jambes, il n’en tenta pas moins de « faire tête »...
– Comment voulez-vous que je le sache ? me répondit-il d’une voix à laquelle l’assurance faisait défaut.
– Prétendez-vous, vraiment, tout ignorer de cette affaire ? fis-je, en m’approchant de lui à le toucher.
– Mais..., naturellement ! répondit-il.
– Alors, peut-être, pourrez-vous me dire à qui vous destiniez ce que voici :
Et, du doigt, j’indiquai un morceau de fil d’acier, dont le bout sortait légèrement d’une de ses poches, et qui était identique à celui que j’avais découvert dans l’ escalier.
– Voilà une affaire prestement menée ! fit le commissaire de Scotland Yard qui, arrivé depuis quelques instants, avait observé la scène avec attention.
Se tournant ensuite vers ses hommes qui, déjà, avaient toutes les peines du monde à préserver le faux docteur des coups qui pleuvaient sur lui de toutes parts :
– Qu’on arrête cette crapule et qu’on lui mette les menottes ! ordonna-t-il.
Quand ce fut fait :
– Comment t’appelles-tu ? lui demanda-t-il.
Voyant que la réponse tardait à venir, j’intervins :
– Je crois, mon cher collègue, fis-je, en m’adressant au commissaire de police, que, sans crainte aucune, vous pouvez libeller le mandat d’arrêt au nom de... lord Edward Berrydale.
Ce dernier coup acheva le misérable qui s’effondra...
Puis, il se mit à pleurer...
Il était bien temps...
Où James Nobody
échappe à un nouvel attentat.
Somme toute, je venais de l’échapper belle...
C’est ce dont voulut bien convenir le général sir Arthur Birdwell, auquel j’étais venu immédiatement rendre compte de l’assassinat de John Sheridan et de l’arrestation de son meurtrier, et qui, après m’avoir complimenté pour l’importante capture que je venais d’effectuer, ajouta :
– Hans Fuchs et ses complices me paraissent aussi dangereux qu’admirablement organisés, et je crois que, dans votre propre intérêt, plus vite vous aurez quitté Londres, mieux cela vaudra.
Cela fut dit d’un tel ton que je ne pus réprimer un sourire.
– Pourquoi riez-vous ? me demanda le général, interloqué...
– Mais parce que vous voulez me faire jouer le rôle de Gribouille, répondis-je, en souriant de plus belle.
– Comment cela ? Je ne comprends pas !
– Gribouille, mon général, était un individu qui, alors qu’il se mettait à pleuvoir, se précipitait aussitôt dans une mare afin... de n’être pas mouillé...
– Eh ! bien ?
– Eh ! bien ; en me proposant de partir immédiatement pour le continent, vous me proposez tout simplement de fuir un danger pour aller vers un danger plus grand encore, car le continent, pour moi, c’est l’Allemagne.
– C’est, ma foi, vrai ! fit le général en souriant à son tour.
– Mais que ceci ne vous inquiète pas, mon général ; j’espère pouvoir partir prochainement, très prochainement même...
– C’est-à-dire ?
– C’est-à-dire, dès que j’aurai mis la main sur Naldony, répondis-je simplement.
– Diable ! s’exclama le général, voilà qui va demander du temps.
– Point, car Naldony a commis l’imprudence folle d’assister, – admirablement camouflé, d’ailleurs, – à l’enquête du Coroner d’Old Bailey, relative à l’assassinat de John Sheridan.
– Et alors ?
– Alors, depuis ce moment, il a été pris en filature par deux de mes hommes qui ne le lâchent pas d’une semelle, et qui ont déjà repéré son domicile.
– Ah ! Ah ! Et... où habite ce « monsieur » ?
– Dans un quartier impossible, Blackfriars ; et dans une rue plus impossible encore, qui s’appelle Old Barge house Steps.
– Parfait ! fit le général ; mais, dans ce cas, qu’attend-on pour l’arrêter ?
– Qu’il nous ait livré ses complices, répondis-je avec calme.
– Qu’entendez-vous par là ?
– Ceci : ne se sachant pas « filé », Naldony opère comme si de rien n’était. Depuis hier, il a rendu visite à six personnes, dont les noms et les adresses ont été soigneusement notés, et qui, depuis, sont placées sous la surveillance de nos hommes. De plus, il a expédié un télégramme et deux lettres qui ont été immédiatement saisis, et dont nos cryptographes effectuent actuellement la traduction, car cette correspondance était « chiffrée ».
– Tout ceci me paraît fort bien conduit, fit le général ; mais, surtout, recommandez bien à vos hommes de ne pas le laisser filer.
– Vous pouvez être rassuré à cet égard, mon général, répondis-je en riant ; il est entre les mains de Bob Lane et de Fred Bromley.
– Voilà qui me rassure, en effet, répondit le général ; car ces deux-là n’ont jamais encore raté leur homme !
Ils devaient le « rater », cependant...
Non pas qu’ils aient manqué de vigilance ou que leur perspicacité ait été mise en défaut, mais bien parce que les complices de Naldony, le sachant « brûlé » et craignant d’être compromis par ses imprudences, décidèrent de s’en débarrasser.
C’est par une lettre anonyme que je trouvai le soir même en rentrant chez moi, que j’appris la nouvelle. Cette lettre était ainsi conçue :
« Puisque James Nobody persiste à diriger l’enquête ouverte « contre Hans Fuchs et tous autres », nous l’informons que nous mettrons tout en œuvre pour nous débarrasser de lui.
« D’autre part, s’il compte sur la filature organisée contre Naldony pour s’emparer de nos amis, il se trompe lourdement.
« À l’heure où James Nobody lira ces lignes, Naldony aura cessé d’exister, car il est des imprudences qui équivalent à des trahisons, et que seule la mort peut faire expier. »
– Fichtre ! pensai-je ; voilà des gens qui n’y vont pas de main morte !
En tout cas, la lettre étant dactylographiée, il n’y avait, pour le moment, aucune indication à en tirer.
Je pris l’enveloppe pour vérifier l’endroit où elle avait été mise à la poste ; je m’aperçus alors qu’elle avait dû être apportée par un commissionnaire, puisqu’aucun timbre n’y figurait.
Ayant appelé mon valet de chambre, je lui demandai :
– À quelle heure, John, vous a-t-on remis cette lettre ?
Il eut l’air de tomber des nues...
– Mais..., répondit-il, on ne m’a remis aucune lettre à l’adresse de monsieur.
– Vous en êtes sûr ? m’écriai-je.
– J’en suis d’autant plus sûr que je n’ai pas mis les pieds dehors et que...
– Personne n’est venu pendant mon absence ? interrompis-je.
– Je demande pardon à monsieur ; mais j’ai eu la visite des plombiers.
– Ah ! Ah ! Et que sont-ils venus faire, ces plombiers ?
John me regarda d’un air stupéfait... puis il me répondit :
– Monsieur aurait-il donc oublié que c’est par son ordre que ces plombiers sont venus pour réparer la tuyauterie de la salle de bains ?
– Par mon ordre ? Ah ! ça, vous rêvez !
– Comment, je rêve ! s’exclama John, dont la stupéfaction tournait à l’ahurissement ; je rêve si peu que voici la carte que m’ont remis les ouvriers en arrivant ici.
Tout en parlant, mon valet de chambre me tendait une carte que je lui arrachai des mains...
Ce fut à mon tour, alors, à ne plus comprendre...
Ce que je tenais entre les mains, c’était une de MES PROPRES CARTES DE VISITE, sur laquelle, DE MA PROPRE ÉCRITURE, était écrit ce que voici :
« John est autorisé à laisser entrer les plombiers dans la salle de bain, où ils ont à effectuer une réparation urgente. »
Ma signature, admirablement imitée, figurait au bas de ce texte...
– By Jove ! m’écriai-je ; l’homme qui a écrit cela est vraiment un « as » !
John eut un sourire discret puis, paisiblement, il ajouta :
– Monsieur a une bien belle écriture, en effet.
Je le regardai pour voir s’il ne se moquait pas de moi...
Mais non ; il était sincère.
– Vous ne voyez donc pas, lui dis-je, que cette carte est l’œuvre d’un faussaire, et qu’on s’en est servi pour pénétrer ici, à mon insu ?
– Mais, alors, s’écria-t-il, ces gens-là étaient des bandits !
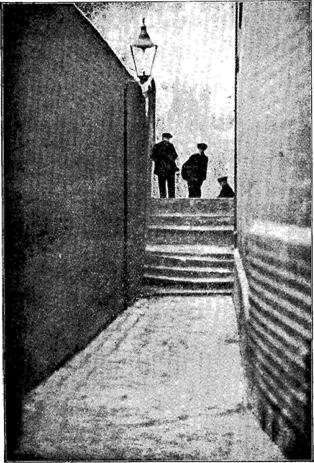
OLD BARGE HOUSE STEPS
où habitait le terroriste russe Naldony.
Et, naïvement, il ajouta :
– Je suis sûr, cependant, qu’ils n’ont rien emporté...
– C’est possible, fis-je, mais es-tu sûr également qu’ils n’ont rien apporté ?
Cette question parut troubler profondément mon fidèle John qui, cependant, me déclara :
– Je puis donner à monsieur l’assurance que, pendant tout le temps que les plombiers ont travaillé dans la salle de bain, je ne les ai pas perdus de vue.
– Tu es sûr de cela ?
Il allait répondre quand, soudain, je le vis pâlir...
– Malheureux que je suis ! s’écria-t-il, je me suis laissé « rouler » comme une vieille bête !
– Que veux-tu dire ?
– Pendant que travaillaient les plombiers, on a sonné. Naturellement, je suis allé ouvrir, et je me suis trouvé en présence de deux dames d’aspect vénérable, qui quêtaient pour les œuvres de la « Croix-Rouge ».
– Pas mal joué ! fis-je ; et alors ?
– Alors, je leur ai donné un shilling, et elles sont parties.
– Donc, pendant cinq minutes au moins, les plombiers ont été seuls.
– Hélas !
– Et, après leur départ, vous n’avez rien remarqué d’anormal ?
– Absolument rien.
– Parfait, fis-je ; nous allons aller voir à quoi ces messieurs ont employé leur temps. Mais, auparavant, faites-moi le plaisir d’ouvrir toutes les fenêtres de l’appartement.
– Mais, monsieur, le brouillard va tout abîmer.
– Ne vous en faites pas pour le brouillard, John, et obéissez.
Très digne, le vieux domestique m’objecta :
– Je me dois d’obéir à monsieur, mais... je ne comprends pas.
– Comment, vous ne comprenez pas que si, par hasard, les malfaiteurs qui se sont introduits ici avaient laissé derrière eux un explosif quelconque, la déflagration serait d’autant moins forte que les gaz trouveraient d’issues pour s’échapper ?
Tout en parlant, je me livrai à une inspection minutieuse de mon cabinet de travail.
Je me rendis vite compte que rien n’avait été dérangé.
Dans les autres pièces non plus, d’ailleurs...
J’arrivai enfin dans la salle de bain. D’un coup d’œil, je constatai que, en réalité, aucune réparation n’avait été faite à la tuyauterie. Tout au plus, avait-on resserré un ou deux écrous sur lesquels j’aperçus des traces laissées par la clef anglaise...
La baignoire était intacte ; le chauffe-bain également.
À terre, rien de suspect.
Je me tournai vers ma table de toilette et j’examinai minutieusement l’un après l’autre les instruments dont je me servais habituellement.
Toujours rien...
Je procédai à l’examen des flacons.
Tout d’abord, je ne remarquai rien de spécial. Mais dès que j’eus débouché celui qui contenait mon eau dentifrice, je fus pris à la gorge par une violente odeur d’amande amère.
Alors, je compris...
À mon eau dentifrice, on avait mélangé de L’ACIDE CYANHYDRIQUE ; c’est-à-dire un poison des plus violents, puisqu’il suffit de cinq centigrammes de ce poison pour tuer un homme.
Ainsi, je venais, une fois de plus, d’échapper à la mort !
Et quelle mort !
Ralentissement du cœur et accès tétaniques !
Je ne pus m’empêcher de frémir...
Mais en même temps je compris que, désormais, entre Hans Fuchs et moi, c’était la guerre à mort, LA GUERRE AU COUTEAU.
Où James Nobody
fait plus ample connaissance avec Naldony.
L’attentat qui venait d’être tenté contre moi, et auquel j’avais si heureusement échappé, me valut de la part de mon chef, le général sir Arthur Birdwell, une mise en demeure nette et catégorique d’avoir à me mettre à l’abri de toute nouvelle tentative criminelle.
– Me conseilleriez-vous donc de fuir devant l’ennemi ? lui demandai-je.
– Point ; mais j’estime que, s’il est bon d’être courageux, on ne gagne rien à faire preuve de témérité. En conséquence, je vous demande, sinon de quitter Londres, – où il vous reste, je le sais, quelques affaires à régler, – du moins, de changer momentanément de domicile.
– Nous sommes à ce point d’accord, mon général, lui répondis-je, que voici l’entrefilet que publieront demain les principaux journaux de Londres.
– Voyons ? fit-il, en prenant la note que je lui tendais.
Et il lut :
« Nous apprenons, avec le plus vif regret, que notre confrère James Nobody, le reporter bien connu, qui est actuellement mobilisé, vient de tomber subitement malade.
« Il a été transporté d’urgence à la clinique du professeur Selfridge.
« Son état est considéré comme désespéré. »
– Croyez-vous vraiment, fit le général, quand il eut pris connaissance du texte qui précède, que cette note vous mettra à l’abri d’un nouvel attentat ?
J’eus un sourire...
– Aussi cette note ne constitue-t-elle qu’une annonce, mon général, répondis-je.
Et lui tendant un second entrefilet :
– Voici, ajoutai-je, qui nous permettra d’atteindre, je crois, le résultat que vous escomptez :
Ce second entrefilet était ainsi conçu :
« Ainsi que nous l’avions donné à entendre, notre éminent confrère James Nobody a succombé la nuit dernière, au cours d’une crise cardiaque.
« Ses obsèques seront célébrées à Cravan-Lodge (Yorkshire), où le défunt possédait une propriété. »
– Pas mal, fit le général, qui ajouta :
– Il reste à savoir si le professeur Selfridge va marcher dans la combinaison.
– Le professeur Selfridge, répondis-je, est mon beau-frère et...
– Vous m’en direz tant !
– D’ailleurs, je me suis mis d’accord avec lui et voici ce dont nous avons convenu :
Ce soir, vers huit heures, je simulerai une indisposition et je prierai mon valet de chambre, John Burns, de téléphoner au professeur Selfridge de venir d’urgence.
Selfridge ordonnera mon transfert immédiat dans sa clinique et me mettra en observation dans le pavillon d’isolement... jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Le reste ira tout seul.
– Comment ! Vous trouvez que le reste ira tout seul ? Mais, malheureux, votre succession sera ouverte ipso facto.
– N’ayez aucune crainte à cet égard, répondis-je, en riant. Le notaire de la famille est un de mes cousins et ma seule héritière est ma sœur, la femme, précisément, du professeur Selfridge. Vous pensez bien que, dans ces conditions, je joue sur le velours.
– Je commence à le croire.
– Parbleu ! Et comme ce brave Hans Fuchs me croira mort et enterré, – car aucun détail ne sera omis pour qu’il en soit persuadé, – je pense qu’il me permettra de « travailler » en paix désormais.
– Évidemment, devant la mort, les haines s’apaisent, fit le général, songeur...
Soudain, il me demanda :
– Au fait ! Qu’est devenu Naldony ?
– Étant données les menaces dont il était l’objet, j’ai cru devoir le soustraire à la colère de ses amis et, dès hier soir, il a été mis en état d’arrestation.
– Où se trouve-t-il actuellement ?
– Il est en bas, répondis-je, dans mon bureau, où deux de nos hommes le gardent à vue.
– Qu’allez-vous en faire ?
– Cela va dépendre. Mon intention est de l’interroger à fond car, fréquentant les milieux terroristes russes de Londres, il est mieux à même que qui que ce soit de me donner des détails sur ce qui s’y trame contre le tsar, sa famille et son empire.
– Et... vous croyez qu’il parlera ?
– J’en fais mon affaire, mon général, répondis-je. D’ailleurs, il sait – encore que le rôle qu’il a joué aux côtés de Hans Fuchs soit mal connu – qu’il y va de sa tête.
– Heu ! Vous savez, ces gens-là, quand ils entrent dans une association secrète, font par avance le sacrifice de leur vie.
– Sans doute, mon général ; mais s’ils sont prêts à donner leur vie pour la « Cause », ils n’aiment pas, par contre, qu’on les sacrifie inutilement et, qui plus est, lâchement.
– Très juste, fit le général ; et je pense comme vous que si Naldony apprend que ses amis avaient décidé de l’assassiner, il pourrait leur en cuire...
Puis, se levant pour m’indiquer que l’audience qu’il venait de m’accorder était terminée, il ajouta :
– Faites donc pour le mieux, cher ami ; mais, surtout, tenez-moi au courant de cette affaire.
Ayant pris congé du général, je me rendis aux archives afin de compulser le dossier de Naldony.
Et alors, devant moi, lumineuse, surgit la vie de cet homme extraordinaire que, jusqu’ici, j’avais tenu pour un malhonnête homme, mais auquel, de l’aveu même de l’Okrana, on n’avait à reprocher que ses opinions politiques
Élève à l’École des mines de Moscou, Naldony y était considéré comme un étudiant travailleur, rangé, auquel le plus brillant avenir semblait promis. Ses professeurs ne tarissaient pas d’éloges à son égard, et les notes de police le concernant étaient des meilleures
Mais une femme survint, Véra Choulguine, dont la néfaste influence modifia du tout au tout ces heureuses dispositions.
Véra Choulguine, que la police russe, la considérant comme une nihiliste enragée, surveillait de très près, devint bientôt la maîtresse de Naldony, qu’elle introduisit à sa suite dans les milieux terroristes.
Il en résulta que cet homme, qui ne s’était jamais occupé de politique, devint peu à peu l’un des chefs du mouvement révolutionnaire russe.
Impliqués dans un complot contre la sûreté de l’État, Véra Choulguine et lui furent envoyés en Sibérie.
Mais alors que lui était interné à Ienisseï, sa complice, considérée comme étant infiniment plus coupable, fut emprisonnée à Irkoutsk.
Désormais, des centaines de kilomètres les séparaient l’un de l’autre.
Et de cela, Naldony faillit mourir...
Dès qu’il fut rétabli, une seule et unique pensée hanta son cerveau : l’évasion.
Tous ses efforts tendirent vers ce but : s’enfuir.
Finalement, il y parvint.
Les gens de l’Okrana, qui n’avaient pas su le garder, retrouvèrent enfin sa piste.

VÉRA CHOULGUINE.
On signala sa présence à Königsberg, à Berlin, à Hambourg, à Berne.
Traqué comme une bête fauve, il dut fuir devant la meute de policiers lancés à ses trousses.
Las de fuir, un beau jour il fit tête et, d’un coup de revolver, « descendit » un policier.
Comme il s’agissait d’une « affaire entre Russes », pitoyable, le jury de Berne l’acquitta.
Mais il fut expulsé...
C’est alors qu’il se réfugia en Angleterre.
On était alors en 1912.
Quelques jours après son arrivée, – le 5 juin exactement, – il entrait, en qualité de préparateur, au laboratoire d’analyse des mines du Southwalles.
C’est là qu’il rencontra Hans Fuchs, lequel surveillait, au sein du Comité de direction, au nom des porteurs allemands, la marche de l’entreprise.
Dès lors, le drame se noua.
Hans Fuchs ayant promis à Naldony de faire évader Véra Choulguine, Naldony devint son homme à tout faire.
Tout d’abord, il quitta sa place et, largement pourvu d’argent, se disant le représentant d’une firme allemande, il se mit à voyager.
On le repéra en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Hollande...
En quelque endroit qu’il arrivât, son premier geste était pour s’aboucher avec les dirigeants révolutionnaires.
Puis, Juif-errant du nihilisme, il repartait plus loin...
C’est alors qu’éclata la guerre du droit.
Mais ce n’est pas pour le droit que prit parti Naldony...
Pieds et poings liés, il se livra aux puissances du mal...
Et maintenant, renié par ces mêmes puissances, condamné à mort par elles, il était là à ma merci, attendant que je statue sur son sort...
Où James Nobody éprouve, coup sur coup,
deux fortes déceptions.
Longuement, je réfléchis...
Peut-être était-il encore temps de sauver cet homme et de l’inciter à rentrer dans la bonne voie.
Avait-il vraiment fait de l’espionnage ? Était-il, au sens propre du mot, un serviteur de l’ennemi ?
Rien ne l’indiquait dans son dossier.
Il y faisait figure de révolté, sans doute ; mais il est des révoltés qui n’en sont pas moins d’honnêtes gens, et qu’on salue avant de tirer sur eux...
J’en étais là de mes réflexions quand, soudain, du rez-de-chaussée, une rumeur me parvint, que ponctua un coup de feu.
Laissant là mon dossier, je me jetai dans l’ascenseur qui, en moins d’une minute, me déposa au seuil même de mon cabinet de travail.
Il y régnait un beau désordre.
Plusieurs inspecteurs s’affairaient autour d’un homme qui, impassible, se laissait ligoter en silence.
D’autres inspecteurs, penchés sur un individu allongé les bras en croix sur le tapis, lui prodiguaient leurs soins.
D’un coup d’œil, j’embrassai la scène et m’avançant vers un brigadier qui se trouvait là :
– Que se passe-t-il donc ? lui demandai-je...
– Il se passe, me répondit-il en me désignant l’homme que maintenaient ses inspecteurs, que ce brigand-là vient d’assassiner Naldony.
Le meurtrier eut un sourire de dédain...
– Pardon ! rectifia-t-il ; je ne l’ai pas assassiné ; je l’ai EXÉCUTÉ ; ce qui n’est pas la même chose.
– Le distinguo est évidemment subtil, intervins-je ; mais il n’en demeure pas moins que vous avez tué un homme. Pourquoi avez-vous fait cela ? Et, d’abord qui êtes-vous ?
L’homme me lança un coup d’œil acéré...
– Le mobile qui m’a fait agir, me répondit-il, ne vous regarde en rien. C’est affaire entre ma conscience et moi. Quant à mon incognito, je vous laisse le soin de le percer.
Je l’avais écouté attentivement. Il parlait correctement notre langue, mais avec un léger accent germanique.
M’approchant de lui, je l’examinai avec soin.
La face, entièrement rasée, était quelconque. Toutefois, le regard était fuyant. Les mains, longues et fines, étaient soignées. Les vêtements et les chaussures sortaient de chez le bon faiseur.
Donc, rien à tirer de l’ensemble, sinon que je me trouvais en présence d’un individu appartenant à la classe aisée de la société.
– Vous refusez de répondre ? insistai-je.
– Je refuse FORMELLEMENT de répondre ! fit-il.
– Bien !
Puis, me tournant vers mon secrétaire, qui venait d’arriver :
– Veuillez prendre les empreintes digitales de ce... monsieur, lui dis-je. Vous procéderez ensuite aux vérifications d’usage, au service anthropométrique.
L’homme tressaillit imperceptiblement ; puis, je le vis pâlir...
Quand on eut pris ses empreintes :
– En cellule, et au secret ! ordonnai-je.
Docilement, il se laissa emmener...
Tandis que je procédais à son interrogatoire, plusieurs de mes chefs, parmi lesquels le général sir Arthur Birdwell, étaient entrés dans mon cabinet de travail...
– Voilà une bien vilaine affaire ! fit le général ; a-t-on envoyé chercher le médecin ?
– Le voici, répondit l’un des inspecteurs.
En un clin d’œil, notre médecin, le Dr Bermington, un savant aussi consciencieux que modeste, vit de quoi il s’agissait.
Ayant fait placer Naldony sur un canapé, en un tournemain il le débarrassa de ses vêtements, et mit son torse à nu. Après quoi se penchant sur lui, il sonda longuement la blessure.
Enfin, il se redressa et, après s’être absorbé en lui-même pendant quelques secondes, se tournant vers nous, il déclara :
– Le mal est moins grave que je ne le craignais. La balle s’est logée dans l’articulation scapulo-humérale, d’où je pense l’extraire assez facilement. Il y a évidemment fracture du col de l’humérus et l’apophyse coracoïde me paraît fort mal en point.
Puis, s’adressant au général Birdwell :
– Puis-je disposer de ce blessé ? demanda-t-il.
– Oui, répondit le général ; mais à la condition formelle que deux de mes hommes ne le perdent pas de vue.
Quelques instants plus tard, une ambulance automobile emportait Naldony vers la clinique du docteur.
Je pus alors poursuivre mon enquête...
Interrogés, les inspecteurs qui se trouvaient là au moment de l’attentat me le racontèrent en ces termes :
– Après avoir passé la nuit en cellule, Naldony, conformément aux ordres donnés par moi, avait été amené à mon bureau par deux inspecteurs.
Ces derniers, après lui avoir enlevé les menottes, l’invitèrent à s’asseoir. Ils s’apprêtaient à en faire autant quand, soudain, la porte s’ouvrit, et entre les montants, un homme s’encadra.
Avant que les inspecteurs aient eu le temps d’intervenir, il sortit de sa poche un browning et, sans un mot, tira sur Naldony qui, atteint à l’épaule, s’écoula sur le sol.
Croyant l’avoir tué, le meurtrier se laissa arrêter sans résistance.
Alors, mais alors seulement, il s’écria :
– Puissent mourir ainsi tous les traîtres !
Il s’agissait donc, indiscutablement, d’un attentat politique.
Or, si je tenais en mon pouvoir celui qui avait exécuté cet attentat, j’ignorais tout de celui qui l’avait conçu et ordonné.
Devais-je l’attribuer à Hans Fuchs ou à l’une des organisations révolutionnaires auxquelles appartenait Naldony ?
Je n’allais pas tarder à être fixé.
En effet, quelques minutes après, le service anthropométrique me communiquait une fiche.
Cette fiche était celle du meurtrier.

HANS MULLER.
Et, je lus :
Nom : Muller ;
Prénoms : Hans Gottlieb Hermann ;
Lieu de naissance : Stettin ;
Date de naissance : 4 février 1869 ;
Profession : officier de marine ;
Situation de famille : célibataire ;
Résidence habituelle : Hambourg ;
Marques particulières : Croix gammée tatouée sur la poitrine, avec au-dessous, dans un écusson : « Deutschland über alles ».
Notice individuelle.
Le nommé Hans Muller, convaincu d’espionnage au profit de l’Allemagne, a été condamné le 5 avril 1897 à cinq ans de prison et à vingt ans d’interdiction de séjour par le conseil de guerre de Paris.
Libéré en 1902, et expulsé du territoire français, il se réfugia en Angleterre, où il fut arrêté le 2 janvier 1903, pour espionnage au profit d’une puissance étrangère, et condamné à cinq ans de réclusion.
Libéré en 1908, interdiction lui a été signifiée de résider sur le territoire britannique.
Rentré en Allemagne, a été promu au grade de capitaine de corvette pour « services exceptionnels », mais n’a été pourvu d’aucun emploi de son grade.
Serait détaché, au titre des missions spéciales, à la section personnelle secrète du Kaiser 10.
Est en relations personnelles et directes avec Mlle Doktor, qui dirige les services d’espionnage allemand à Bruxelles.
Considéré comme très dangereux.
À surveiller de près.
La notice se terminait là.
Les portraits, face et profil, qui y étaient annexés, les empreintes digitales, me permirent d’établir immédiatement qu’il ne pouvait y avoir erreur sur la personne.
– Qu’on m’amène le prisonnier ! fis-je.
L’un des inspecteurs sortit aussitôt pour exécuter cet ordre.
Deux minutes plus tard, il était de retour, mais seul...
– Eh ! bien ; demandai-je, où est cet homme ?
Se mettant au « garde-à-vous », l’inspecteur me répondit :
– On vient de le trouver mort dans sa cellule, chef ; il s’est suicidé !
– On ne l’avait donc pas fouillé ? m’écriai-je, violemment ému.
– Je vous demande pardon, chef ; me répondit l’inspecteur ; il avait été « fouillé à corps ».
Et c’était vrai...
L’enquête médico-légale nous révéla par la suite que Muller s’était suicidé en absorbant du cyanure de potassium...
Où James Nobody
opère une conversion.
Comme bien on pense, cette affaire retarda mon départ de quelques jours ; non pas qu’elle fût très grave en elle-même, mais bien parce qu’elle allait me permettre d’agir utilement auprès de Naldony.
Dès qu’il fut en état de me recevoir, je me rendis auprès de lui et, carrément, je jouai mon va-tout...
– Je viens à vous, lui dis-je, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Considérant que vous avez été suffisamment puni, la justice britannique a décidé d’abandonner toute poursuite en ce qui vous concerne personnellement.
– Est-ce possible ? s’exclama le malheureux.
– C’est tellement possible, répondis-je en souriant, que dès ce moment vous êtes libre. Je vais d’ailleurs vous en donner immédiatement la preuve.
Me tournant vers les deux inspecteurs qui étaient chargés de le surveiller, je leur dis :
– Vous pouvez disposer, messieurs ; votre mission est terminée.
Quand ils furent partis, m’asseyant près du lit de Naldony, je repris :
– Il me reste à vous donner quelques détails relatifs à l’attentat qui a été commis contre vous.
– Il s’agissait donc d’un attentat ? s’écria-t-il.
– Ah ! ça, répondis-je ; croyez-vous que nous avons pour habitude d’assassiner les gens ?
– Non, sans doute, mais...
– Mais, ne sachant, interrompis-je, à qui attribuer l’agression aussi lâche que stupide dont vous avez failli être victime, tout naturellement, vous nous en avez rendus responsables.
– Is fecit cui prodest !
– C’est entendu, répondis-je ; mais puisque nous vous tenions, notre intérêt évident était de vous traduire en justice, et non de vous assassiner. D’ailleurs, vous avez dû reconnaître votre meurtrier. Cela étant, vous savez bien qu’il n’était pas des nôtres !
– Mon meurtrier ? s’écria-t-il ; jamais je ne l’avais tant vu.
– Comment ! Vous ne connaissiez pas Hans Muller ?
Il devint livide...
– C’est Hans Muller qui a tiré sur moi, fit-il, à voix basse ; qu’ont-ILS donc à me reprocher ?
– Cela, je n’en sais rien, répondis-je ; mais ce que je sais, par contre, c’est qu’ILS vous ont condamné à mort.
– Vous pouvez m’en donner la preuve ? fit-il vivement.
– Je puis vous la donner immédiatement, fis-je.
Tirant alors de mon portefeuille la lettre de menaces qui m’avait été adressée, et dans laquelle il était fait mention de la condamnation à mort de Naldony par ses amis, je la lui communiquai...
Il la lut attentivement puis, de sa main valide, trempant son mouchoir dans le verre de tisane qui se trouvait sur la table de nuit, il humecta la lettre, à l’endroit même où, sous le texte, eût dû normalement figurer la signature.
Sur le papier apparut alors une aigle couronnée : L’AIGLE ROYALE DE PRUSSE.
– Oh ! oh ! m’exclamai-je ; voilà qui établit l’authenticité de cette lettre.
– Incontestablement ! me répondit-il, mais, déjà, j’étais fixé.
– Comment cela ? demandai-je.
– Par l’examen des caractères dactylographiés, j’ai pu me rendre compte que cette lettre a été « tapée » sur une machine à écrire dont le propriétaire... m’est personnellement connu.
– Quoi qu’il en soit, répondis-je ; je tiens une seconde preuve de la culpabilité de vos « amis » à votre disposition.
– Voyons ? fit-il.
– Le cas échéant, reconnaîtriez-vous votre agresseur, si on vous montrait sa photographie ?
– Indubitablement.
Lui tendant alors la fiche anthropométrique de Hans Muller, je lui demandai :
– Que pensez-vous de ceci ?
Il prit la fiche, examina attentivement la double photographie de son meurtrier, prit connaissance de son « curriculum vitae », puis me déclara :
– Tout cela est exact, car, bien que ne connaissant pas de vue Hans Muller, je savais qu’il avait été arrêté et emprisonné à différentes reprises. Toutefois, je ne le croyais pas capable –, MÊME POUR COMPLAIRE À HANS FUCHS, – de se transformer en meurtrier.
– Croyez-vous donc devoir attribuer à Hans Fuchs la responsabilité de l’attentat dont vous avez été l’objet ?
Me désignant du doigt l’aigle couronnée qui figurait en bas du document que je venais de lui communiquer, froidement, Naldony répondit :
– Cet homme est le seul qui, en Allemagne, ait le droit de signer ainsi les lettres qu’il écrit !
– Qu’offre donc de particulier cette signature ? demandai-je.
 |
COSAQUES SPÉCIALEMENT AFFECTÉS À
LA GARDE DES PRISONNIERS POLITIQUES, EN SIBÉRIE.
Naldony me jeta un coup d’œil surpris...
– Ignoreriez-vous vraiment, fit-il en se penchant vers moi, que cette signature – ou plus exactement, cette griffe – est réservée au chef de la section personnelle secrète de l’empereur Guillaume II ?
– Vous dites ? m’écriai-je, abasourdi.
– Je dis, trancha Naldony ; que Hans Fuchs n’est autre que L’ESPION DU KAISER !
– Vous êtes sûr de cela ?
– Je vous en donne ma parole d’honneur !
– Mais, alors...
– Alors, il ne vous reste plus qu’à le prendre.
– Voilà qui est plus facile à dire qu’à faire ! m’exclamai-je.
– Et, si, un jour venant, je vous le livrais pieds et poings liés, que diriez-vous ?
– Vous feriez cela ?
– Aussi vrai que Naldony est mon nom, je le ferai ! s’écria-t-il, farouche. Hans Fuchs m’a « raté » ; tant pis pour lui, car, moi, je ne le « raterai » pas !
Cela fut dit sur un tel ton que je compris que Naldony, – fût-ce au risque de sa vie – tiendrait parole.
– J’enregistre votre promesse, lui répondis-je ; mais comme toute bonne action mérite une récompense...
– Je ne veux pas d’argent ! interrompit-il.
– Aussi, n’est-ce pas de l’argent que je vous offre.
– De quoi s’agit-il donc alors ?
Je le regardai en souriant puis, lentement, je répondis :
– Le jour où vous aurez tenu votre promesse...
– Eh bien ? demanda-t-il, haletant.
– Eh bien ! Véra Choulguine vous sera rendue !
– Bojé moï ! s’écria-t-il...
Et je dus le prendre à bras le corps pour lui interdire de se lever.
Galvanisé par la promesse que je venais de lui faire, – et que j’étais sûr de tenir, – Naldony voulait immédiatement se mettre à la recherche de Hans Fuchs...
Où James Nobody,
bien qu’étant officiellement mort et enterré,
n’en fait pas moins œuvre utile.
En attendant qu’il pût tenir sa parole relativement à Hans Fuchs, Naldony nous remit la liste de tous les gens qui « travaillaient » pour le compte de ce dernier, en Angleterre.
Bientôt, traîtres et espions affluèrent à Londres, sous bonne escorte.
Traduits devant une Cour martiale, celle-ci les envoya tous – ou presque – au poteau d’exécution, ce qui est une façon comme une autre d’opérer le nettoyage par le vide.
Lord Edward Berrydale subit un sort identique.
Il mourut sans avoir révélé ce qu’était devenu le dossier dérobé par lui à Downing Street.
L’organisation, installée à grand frais par Hans Fuchs sur notre territoire, ayant ainsi été anéantie, certain d’autre part que Naldony tiendrait loyalement sa promesse, je mis à exécution le plan que j’avais précédemment soumis au général sir Arthur Birdwell.
J’envoyai aux journaux les notices annonçant ma maladie, d’abord, mon décès, ensuite ; et, trois jours plus tard, à l’heure même où se refermaient sur un cercueil, bourré de débris anatomiques, les portes de mon caveau de famille, un avion extra-rapide me déposait sain et sauf aux environs de Dunkerque.
Ayant laissé pousser ma barbe et mes cheveux, j’étais devenu méconnaissable...
Tel fut l’avis de mon vieil ami le comte de Nys, auquel j’avais écrit de venir me rejoindre à Dunkerque et qui, se doutant qu’il y avait du nouveau, se serait bien gardé de manquer au rendez-vous.
Dunkerque, à l’époque, n’était point une ville de tout repos. Soumises nuit et jour à un bombardement intensif, ses maisons offraient un abri des plus précaires ; aussi, pour être plus tranquille, m’étais-je installé dans une cave.
C’est là que vint me rejoindre, plus ardent et plus combatif que jamais, le comte de Nys.
Succinctement, mais clairement, je lui fis part des évènements qui venaient de se produire en Angleterre ; après quoi, je lui révélai l’objet de ma mission, qui se pouvait résumer ainsi : s’emparer, mort ou vif, de Hans Fuchs, L’ESPION DU KAISER.
– J’en suis ! me répondit sans la moindre hésitation le grand patriote belge qui, avec un sourire, ajouta :
– À vrai dire, la vie du Havre ne me vaut rien. Choyés par les autorités françaises, dont on ne dira jamais assez la correction à notre égard, nous vivons là comme des coqs en pâte et, personnellement, je commençais à me rouiller. C’est donc un véritable service d’ami que vous me rendez, en me mettant de moitié dans votre jeu.
– Jeu qui n’est pas sans comporter quelques risques, répondis-je.
– Bah ! Nous en avons vu d’autres ; et, somme toute, quand on a « eu » Irma Staub, bafoué Schwarzteuffel, ridiculisé von Bissing et annihilé quelques-uns de leurs plus importants sous-verges, un Hans Fuchs n’est pas pour nous faire peur. L’essentiel est de savoir ou gîte ce... monsieur. Le reste ira tout seul...
– J’admire votre optimisme, répondis-je, en souriant, mais je ne le partage pas. Hans Fuchs, ne l’oublions pas, est un personnage considérable à la cour du Kaiser. De plus, c’est un espion d’autant plus redoutable qu’il ne s’embarrasse pas de scrupules et que, pour lui, la vie d’un homme ne compte pas.
– Et puis après ?
– Mais... il me semble que c’est déjà suffisant, fis-je ; et, pour ma part, je ne saurais oublier qu’il a essayé de me faire assassiner à deux reprises différentes.
– Raison de plus pour l’abattre le plus tôt possible !
– Oui, mais comment ?
– Savez-vous où se trouve actuellement le Kaiser ? me répondit le comte de Nys.
– Au siège du G. Q. G. allemand, sans doute.
– C’est-à-dire ?
– C’est-à-dire à Charleville.
– Donc, fit paisiblement le comte de Nys, c’est à Charleville que doit également se trouver Hans Fuchs.
– C’est tout à fait mon avis, répondis-je ; mais, même en admettant que Hans Fuchs soit ailleurs, il n’en demeure pas moins que c’est de Charleville que doit partir notre enquête, car c’est à Charleville seulement que nous pourrons apprendre ce à quoi il occupe ses loisirs actuellement.
– D’accord, fit le comte de Nys ; ce point étant acquis, il reste à savoir comment nous allons bien pouvoir faire pour nous rendre là-bas. M’est avis qu’on ne doit pas pénétrer dans Charleville aussi aisément que dans un moulin.
– Vous pensez bien que la police de campagne allemande et la section personnelle du Kaiser doivent fonctionner à plein rendement ; aussi, ne vois-je que trois moyens d’aboutir...
– Lesquels ?
– Le premier est classique : c’est celui qui consiste à nous faire déposer par un avion en arrière des lignes allemandes à proximité de Charleville, ce qui nous permettrait de nous rabattre ensuite sur la ville.
– Y connaissez-vous quelqu’un ?
– Ma foi, non, répondis-je, et vous ?
– Moi non plus ; donc, ce moyen est risqué, fit-il, voyons le second ?
– Le second, beaucoup plus simple, consisterait à pénétrer en Allemagne par la Suisse, soit en nous mêlant à un convoi de grands blessés rapatriés, soit par tout autre moyen ; j’en sais et des meilleurs.
– Ceci est mieux, répondit-il ; voyons votre troisième proposition ?
– Quoique d’une exécution difficile, elle est de beaucoup la plus sûre. Partant d’ici-même en sous-marin, nous nous ferions mettre à terre, soit en Belgique, soit en Hollande, ce qui, avec des passeports adéquats, nous permettrait de pénétrer ensuite en Allemagne.

UN POSTE ALLEMAND DISSIMULÉ DANS LES DUNES
AUX ENVIRONS DE ZEEBRUGGE
– Verriez-vous un inconvénient quelconque, me demanda le comte de Nys, à ce que nous débarquions plutôt en Belgique qu’en Hollande et, de préférence, aux environs de Zeebrugge ?
– Pas le moins du monde, répondis-je ; auriez-vous donc quelque « affaire » en train de ce côté ?
– Une « affaire », non ! On m’a simplement demandé, fit-il, si, le cas échéant, je ne pourrais pas me procurer quelques renseignements relatifs à la nouvelle base sous-marine que les « Boches » viennent d’installer à Zeebrugge.
– Eh bien ! rien ne nous empêche de recueillir ces renseignements en passant.
– D’autant plus qu’ils sont destinés à l’Amirauté anglaise, que cette nouvelle base inquiète quelque peu...
Cet accord de principe étant intervenu entre le comte de Nys et moi, nous étudiâmes en détail les moyens de le réaliser.
Huit jours plus tard, tout ayant été mis au point, un sous-marin français nous déposait sur la côte belge, à six kilomètres environ de Zeebrugge.
Le comte de Nys avait disparu pour faire place à l’ingénieur von Kressmann, ex-officier aux pionniers allemands, réformé pour blessure reçue en service commandé.
Quant à moi, j’avais adopté le nom beaucoup plus démocratique de Wilhelm Schnaps.
Il est vrai que mon rôle était sensiblement moins reluisant.
Aveugle de guerre, j’avais été adopté par von Kressmann, lequel me prodiguait les soins les plus touchants...
Où James Nobody fait la connaissance
d’un « as » de première grandeur.
Étant attendus par l’un des agents du service de contre-espionnage belge, lequel était depuis fort longtemps en correspondance avec le comte de Nys, notre arrivée à Zeebrugge passa complètement inaperçue.
Non pas que les « Huns » ne fissent bonne garde, mais bien parce que nous empruntâmes une voie sur laquelle ils n’auraient jamais osé se risquer.
Certains qui s’y engagèrent... ne reparurent jamais.
Qu’on m’excuse de ne pas préciser, mais il est des secrets qu’il importe, – surtout à l’heure actuelle – de ne point révéler.
Tout ce que je puis dire est que cette voie était souterraine, qu’elle s’amorçait dans une ferme isolée de la campagne, et qu’elle aboutissait dans les sous-sols d’un immeuble, où se réunissaient d’habitude, pour s’y livrer à de crapuleuses orgies, les fonctionnaires et les officiers allemands en résidence à Zeebrugge.
Pour être complet, j’ajouterai que, grâce à l’installation de microphones perfectionnés, rien de ce qui se passait aux étages supérieurs de l’immeuble ne demeurait ignoré de nos amis belges.
On verra par la suite comment étaient transmis, à qui de droit, les renseignements ainsi recueillis.
J’avoue que cette organisation me stupéfia...
– Il me semble extraordinaire, dis-je à notre cicérone, que les Allemands ne se soient doutés de rien jusqu’ici.
– C’est-à-dire qu’ils ont perquisitionné un peu partout, me répondit-il, en souriant ; le sous-sol dans lequel nous nous trouvons actuellement a même été fouillé de fond en comble.
– Et ils n’ont rien trouvé ?
– Que vouliez-vous qu’ils trouvent ? répondit-il paisiblement. Là où il n’y a rien, le roi – fût-il roi de Prusse et empereur d’Allemagne – perd ses droits.
Je jetai un coup d’œil autour de moi et je constatai, en effet, que le sous-sol ne contenait que quelques futailles défoncées, une demi-douzaine de chaises brisées, une table bancale et, appuyée contre un mur, une armoire vermoulue.
– Évidemment, déclarai-je, il faudrait être doué d’un bien mauvais caractère pour trouver quoi que ce soit de suspect dans ce sous-sol.
– En êtes-vous bien sûr ? me demanda en souriant M. van Iseghem, notre aimable cicérone.
– Dame ! J’avoue que, à première vue...
– Voulez-vous me dire alors comment et par où nous sommes entrés ici ?
– Mais..., par la porte, répondis-je, interloqué...
– Voulez-vous avoir l’obligeance de me montrer cette porte ?
Prêt à déférer à ce désir, je me retournai.
La porte avait disparu...
À la place où, normalement, elle eût dû se trouver, je vis un escalier conduisant à l’étage au-dessus...
Je demeurai bouche bée.
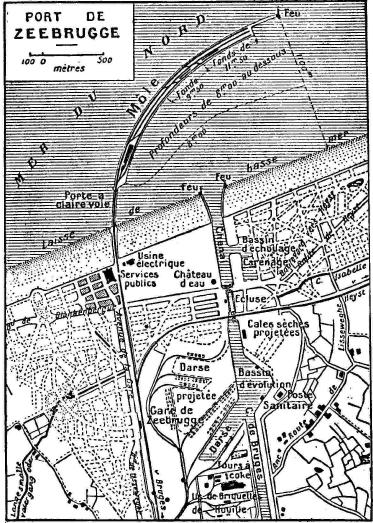 |
PLAN DU PORT ET DE LA VILLE DE ZEEBRUGGE.
Jouissant de ma surprise, M. van Iseghem, s’approchant de moi, me dit :
– L’escalier que vous voyez là est admirablement et ingénieusement « truqué ». Non seulement il dissimule l’entrée du souterrain, mais, en cas de besoin, il constituerait le plus terrible des pièges. Voyez plutôt...
Saisissant à pleines mains la boule de l’escalier, il la dévissa et la plaça à ses pieds. Après quoi, m’ayant fait signe d’approcher, il me désigna un bouton qui, maintenant, apparaissait à découvert, et il me dit :
– Voulez-vous avoir l’obligeance d’appuyer sur cc bouton ?
Je n’eus pas plutôt obéi, que toute une partie de l’escalier culbuta...
Là, où tout à l’heure se trouvaient des marches, j’apercevais maintenant un trou béant...
Il est bien certain que quiconque se serait trouvé à cet endroit de l’escalier, au moment où il basculait, aurait fait dans le vide une chute mortelle...
– Ainsi que vous le voyez, me dit M. van Iseghem, nous avons là un excellent moyen de nous isoler et, en cas de besoin, d’échapper à toute poursuite. Mais il y a mieux.
– Vraiment ? fis-je, vivement intéressé.
– Après ce que vous venez de constater, reprit-il, vous devez bien vous douter que nous n’aurions pas pris toutes ces précautions, si nous n’y avions été forcés. En réalité, dans cet immeuble, est installée une centrale de contre-espionnage.
– Comment cela ?
– Indépendamment des renseignements que nous nous procurons sur place, c’est vers nous que convergent les renseignements provenant des postes de l’intérieur situés dans le triangle stratégique Bruges–Gand–Courtrai.
– Comment ! m’exclamai-je ; votre zone d’action s’étend jusque là ?
– Elle s’étend même beaucoup plus loin, intervint le comte de Nys ; car ils travaillent par « relais », non seulement avec la Belgique tout entière ; mais aussi avec le nord de la France.
– Mais alors, fis-je, vous devez disposer d’un personnel considérable ?
– Point, fit en souriant M. van Iseghem ; nous sommes quatre en tout et pour tout : DEUX DACTYLOS, UN « OBSTRUCTEUR » ET MOI.
– Qu’appelez-vous un « obstructeur » ? demandai-je.
– Je vais vous le dire, me répondit-il ; mais, auparavant, il faut que vous sachiez que tous les renseignements recueillis par nous sont transmis à certaines heures convenues, par signaux optiques, aux navires alliés qui croisent au large ; ce qui leur permet de faire, de temps à autre, d’excellente besogne.
Il consulta sa montre, puis il ajouta :
– Voici l’heure où, précisément, je dois effectuer mes signaux. Sauf erreur, en ce moment, doivent croiser devant Zeebrugge deux destroyers britanniques.
– Où se trouve donc votre appareil ? fis-je, en regardant autour de moi.
M. van Iseghem eut un sourire...
– Mon appareil, le voici, répondit-il, en me montrant sa lampe électrique de poche.
– C’est avec cela, m’écriai-je, que vous comptez transmettre vos renseignements ? Vous n’y parviendrez jamais, surtout s’ils sont « chiffrés ».
– C’est ce que nous allons voir, répondit-il paisiblement.
S’approchant alors de la muraille, il déplaça la vieille armoire puis, se penchant vers le sol, une pelle-bêche à la main, il se mit à creuser la terre.
Bientôt une dalle apparut qui, sous la pression de son doigt, bascula...
– Voulez-vous avoir l’obligeance de venir, me dit-il.
– Volontiers, répondis-je.
– Méfiez-vous, il y a cinq marches à descendre.
Quand je l’eus rejoint, il reprit :
– Nous nous trouvons en ce moment dans un ancien égout désaffecté. Son orifice, que vous ne pouvez apercevoir actuellement parce qu’il est obstrué, est situé à cinquante mètres d’ici et donne sur la plage, parmi les rochers.
– Bien, fis-je ; je commence à comprendre.
– Un homme à moi, – l’« obstructeur », – se tient en permanence près de cet orifice qu’il dégage, dès que je lui en donne le signal et qu’il bouche dès que la communication est terminée... ou s’il s’aperçoit qu’un danger quelconque nous menace.
Tout en parlant, M. van Iseghem, que je suivais pas à pas, s’était approché de l’orifice qu’obstruait un solide panneau de chêne et avait donné le signal convenu.
J’entendis, de l’autre côté du panneau, un grattement se produire.
– Il enlève le sable qui recouvre le panneau à l’extérieur, ce qui le dissimule à tous les yeux.
Bientôt, le panneau céda et, à deux mètres de nous à peine, je vis la mer, dont les vagues venaient se briser sur les rochers.
– Rien de nouveau, Hardouin ? s’informa M. van Iseghem.
– Rien de nouveau, chef, répondit une voix à l’extérieur.
– Tu n’as pas aperçu le signal ?
– Non, mais je crois que le voici.
Nous regardâmes vers le large et au loin, nous aperçûmes trois feux disposés en triangle.
– Ce sont eux ! me dit M. van Iseghem ; et aussitôt, en « Morse », il transmit ses signaux.
Je remarquai que prudemment, il se tenait à l’intérieur de l’égout, à cinq mètres environ de l’orifice.
De cette façon, à moins d’être en mer, nui ne le pouvait apercevoir.
Les « brèves » et les « longues » se succédant avec une extrême rapidité, la transmission dura à peine cinq minutes.
– « COMPRIS et MERCI », signala-t-on du large.
Tandis que l’« obstructeur » fermait son panneau, se tournant vers moi, M. van Iseghem, déclara :
– Deux pirates ont quitté Zeebrugge aujourd’hui ; je serais extrêmement surpris si, demain, nous n’avions pas de leurs nouvelles.
Le lendemain, en effet, nous apprenions que, au cours de la nuit, deux sous-marins allemands avaient été coulés...
Où James Nobody se distingue.
S’il était relativement facile de circuler dans Zeebrugge – en regardant bien, toutefois, où on mettait ses pieds, – il était fort difficile, par contre, d’approcher de la base sous-marine, récemment aménagée par les Boches.
Au vrai, la base elle-même, c’est-à-dire le port et ses annexes, était surveillée de très près, les installations et le matériel qu’ils renfermaient étant considérés comme vitaux par l’amirauté allemande.
Le port, on le sait, est constitué par deux jetées qui servent d’estuaire au canal maritime, et se complète par une rade artificielle, fermée au nord et à l’ouest par une jetée en arc de cercle dont la longueur est de 2.487 mètres, et dont la largeur atteint, en certains endroits, 75 mètres.
C’est là, sur cette jetée, qu’étaient installés les services de la base, laquelle était défendue par une artillerie formidable, puisque, le comte de Nys et moi, nous ne comptâmes pas moins de 120 canons de 380 mm et de 300 canons de 80 mm.
Le tout était rigoureusement surveillé par des sentinelles nombreuses, que reliaient entre elles des patrouilles volantes.
D’autre part, nous pûmes nous rendre compte que, jour et nuit, ces sentinelles et les postes de police d’où elles étaient détachées, étaient perpétuellement tenus en alerte par des rondes d’officiers et de sous-officiers.
Comment « travailler » dans ces conditions ?
Et surtout, comment procurer au vice-amiral sir Roger Keyes les documents photographiques relatifs à la base sous-marine qu’il avait demandés au comte de Nys de lui procurer ?
Il fallait aboutir cependant.
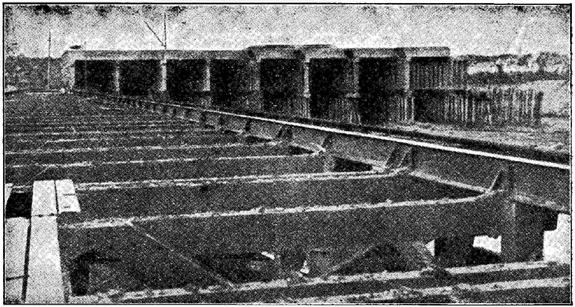 |
LA BASE SOUS-MARINE ALLEMANDE DE ZEEBRUGGE.
On aperçoit les huit alvéoles en ciment armé, dans lesquels, à l’abri des bombardements
terrestres ou aériens, se dissimulaient les sous-marins.
Ayant examiné la situation sous toutes ses faces, nous en arrivâmes à cette conclusion, qu’il était mathématiquement impossible d’arriver à la base sous-marine en utilisant la voie de terre.
Restait la voie de mer.
Bien qu’ayant quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent d’y rester, nous décidâmes de l’employer.
C’est pourquoi, le soir même, après m’être enduit soigneusement de graisse, je me mis à l’eau à proximité de la base sous-marine, emportant, solidement fixé sur ma tête, un appareil photographique « Warrior », qui offrait le double avantage de pouvoir fonctionner la nuit et d’être d’une étanchéité absolue.
Il pleuvait à plein temps ; mais les sentinelles allemandes, encapuchonnées dans leurs suroîts, n’en faisaient pas moins bonne garde.
Tout en nageant dans la zone d’ombre proche de la jetée, je les entendais lancer dans la nuit leur wer da ? sonore, quand s’approchait d’elles une ronde.
J’arrivai bientôt à la passe par laquelle embouquaient les sous-marins pour entrer dans leur repaire.
C’était là un endroit d’autant plus périlleux qu’il était mieux gardé. Non seulement les sentinelles y étaient nombreuses, mais deux puissants réflecteurs braqués sur la passe la fouillaient inlassablement dans ses moindres recoins.
– By Jove ! pensai-je ; si je réussis à sortir indemne de cette aventure, je pourrai me vanter d’avoir de la chance...
Ayant absorbé une gorgée d’air frais, résolument je plongeai et je me mis à nager entre deux eaux, me dissimulant de mon mieux derrière les « ducs d’Albe » en ciment armé qui jalonnaient ma route et qui conduisaient à la base sous-marine.
J’étais sur le point de l’atteindre quand, soudain, je fus plaqué contre un « duc d’Albe » par un violent remous.
Me cramponnant de mon mieux, j’émergeai prudemment et, à deux mètres de moi à peine, je vis passer un grand sous-marin allemand qui, toutes lumières éteintes, fonçait vers le large...
Au-dessus de ma tête sur le terre-plein que supportaient les « ducs d’Albe », j’entendais le va-et-vient monotone d’une sentinelle allemande...
– Wer da ? s’écria-t-elle soudain...
– Diable ! pensai-je ; serait-ce à moi que ce discours s’adresse... ?
Il n’en était rien, fort heureusement.
Une ronde passait...
En effet, dès que furent échangés mot d’ordre et mot de ralliement, j’entendis quelqu’un demander :
– Rien de nouveau ?
– Rien de nouveau, herr leutnant !
– So ! Continuez à faire bonne garde !
– À vos ordres, herr leutnant !
Après quoi, l’officier s’en fût, et tout retomba dans le silence.
Affirmer que j’étais transi serait peu dire. Au vrai, je grelottais.
Quoi qu’en pensent les prohibitionnistes, il est des moments où on se rend compte de l’importance que peut avoir un whisky « bien tassé » dans la vie d’un homme...
N’apercevant rien de suspect autour de moi, je grimpai le long du « duc d’Albe » et, m’installant à califourchon sur l’une des entretoises, je me mis au travail.
La pluie avait cessé de tomber et – secourable et complice – la lune, réussissant à percer les nuages, inondait de sa douce clarté les êtres et les choses...
Et, alors, à vingt mètres de moi à peine, j’aperçus le repaire des sous-marins...
Entièrement construit en béton, il se composait de huit alvéoles, qui, toutes, étaient vides pour l’instant.
Séparées les unes des autres par des murs en ciment armé, ces alvéoles, – étant donnée l’épaisseur du toit en terrasse qui les recouvrait, – étaient invulnérables.
Aucun projectile, – qu’il fût terrestre ou aérien, – n’aurait pu percer la formidable chape de béton qui recouvrait et protégeait cet ensemble vraiment impressionnant.
J’en fis plusieurs photographies et j’en notai les différentes caractéristiques ; après quoi, je me laissai glisser dans l’eau et je pris le chemin du retour.
De même qu’à l’aller, aucun incident ne se produisit.
En m’apercevant, le comte de Nys poussa un soupir de soulagement.
– Je commençais à être terriblement inquiet, me confia-t-il, tandis qu’il m’enveloppait dans son propre manteau de fourrure.
– Bah ! Et, pourquoi donc ? répondis-je.
– Mais..., parce qu’il y a plus de deux heures que vous êtes parti et que, tout de même, quel que soit votre « cran », les forces humaines ont des limites. Vous devez être gelé ?
– Dites plutôt que je suis frigorifié, et vous serez dans le vrai.
Tout en convenant de la sorte, nous avions regagné, au pas gymnastique, notre abri souterrain où m’attendait un grog bouillant.
Je l’absorbai d’un trait...
Me tournant alors vers le comte de Nys :
– J’ai réussi ! lui dis-je.
– J’en étais sûr ! me répondit-il, avec un bon sourire, mais nous parlerons de cela tout à l’heure, dès qu’un bain vous aura débarrassé de toute cette graisse et qu’un massage aura remis vos articulations en état...
Une demi-heure plus tard, enfoui jusqu’au cou dans une chaude couverture de laine, je lui rendis compte des résultats que j’avais obtenus.
– C’est parfait, me répondit-il, et je pense que sir Roger Keyes sera satisfait.
– Espérons-le, fis-je, en souriant.
Puis, passant à un autre ordre d’idées :
– Et ici, demandai-je, il n’y a rien eu de nouveau en mon absence ?
– Peuh ! fit-il, il y a eu un incident, mais il est sans importance aucune.
– De quelle nature, cet incident ?
Se tournant vers moi, le comte de Nys me répondit :
– Tout à l’heure, en sortant, j’ai rencontré Hans Fuchs...
Où James Nobody
démontre que, parfois, la boxe a du bon.
J’étais bien fatigué et, après la longue immersion que je venais de subir, la tiédeur de ma couche était bien engageante ; il n’en demeure pas moins que la nouvelle me galvanisa et que, d’un bond, je fus sur pieds.
– Hans Fuchs est ici ? m’écriai-je.
– Et après ? me répondit avec le plus grand calme le comte de Nys, voilà-t-il pas de quoi vous émouvoir !
– Vous en parlez à votre aise, fis-je amèrement, on voit bien que vous ne le connaissez pas.
– Raison de plus pour faire connaissance, reprit le comte de Nys, qui, tout en vérifiant le fonctionnement de son browning, ajouta sur le mode plaisant :
– Somme toute, que pouvions-nous désirer de mieux, et de quoi vous plaignez-vous ? Au lieu que de courir au diable vauvert pour retrouver cet homme, le hasard fait que, de lui-même, il vient s’offrir à nous. Remercions le hasard et... profitons de l’aubaine.
Cela fut dit d’un tel ton que je ne pus réprimer un sourire.
– Comptez-vous donc, fis-je, vous emparer de Hans Fuchs, ici même ?
Imperturbable, le comte de Nys me répondit :
– Si, au lieu de m’emparer de lui, je l’abattais comme une bête venimeuse, y trouveriez-vous à redire ?
– Certes, non ! m’écriai-je ; mais, tout de même, mieux vaudrait, je crois, le prendre vivant.
– Qu’il soit fait selon votre désir, répondit avec philosophie le comte de Nys qui, après avoir chargé son revolver, le mit dans sa poche.
Puis, il ajouta :
– Encore que la capture d’un tel homme apparaisse malaisée, je ne la crois pas au-dessus de nos modestes moyens.
– Parbleu ! N’avons-nous pas fait plus fort que cela, déjà ?
– C’est juste ! Toutefois, je crois qu’il va y avoir de la casse.
Je me mis à rire...
– Je crains, répondis-je, qu’il n’en soit de même tant qu’on n’aura pas découvert le moyen de faire des omelettes sans casser des œufs...
Tout en discourant de la sorte, j’avais fini de me vêtir, ce que voyant, le comte de Nys me demanda :
– Alors, on y va ?
– Allons-y ! répondis-je, résolument.
Le comte de Nys se dirigea vers l’escalier ; puis, soudain, se tournant vers moi, il me dit amicalement :
– Savez-vous que, vraiment, vous êtes un type peu banal ?
– Pourquoi cela ? demandai-je, interloqué.
– Mais, tout simplement, parce que vous ne vous inquiétez nullement de savoir en quel endroit je vous conduis, ni même si j’ai combiné quelque plan d’action...
– Qu’ai-je à faire de tous ces détails ? lui répondis-je ; l’essentiel est que vous sachiez où prendre Hans Fuchs ; le reste ira tout seul.
– J’admire votre optimisme, fit le comte de Nys, mais je ne le partage pas, car, là où il se trouve, Hans Fuchs est formidablement gardé.
– Qu’importe, répondis-je, toute cuirasse n’a-t-elle pas son défaut ?
– Sans doute, aussi me suis-je préoccupé de connaître le défaut de la sienne.
– Vous voyez bien ! fis-je, narquois.
– Tout d’abord, grâce à cet excellent van Iseghem, j’ai pu me procurer le mot d’ordre et le mot de ralliement de ce jour.
– Quels sont-ils ?
– Kaiser und Kœnig ! Ensuite, – toujours en compagnie de van Iseghem, – je suis allé examiner les abords de l’immeuble où se trouve actuellement notre homme.
– Parfait ! Et alors ?
– Au rez-de-chaussée, précisa le comte de Nys, se trouve un poste de police fourni par la landsturm, mais que commande un ober-leutnant de l’active. Ce poste détache trois sentinelles. L’une se tient à la porte de l’immeuble ; la seconde surveille l’entrée des communs ; la troisième est postée à proximité de l’endroit où stationnent les voitures de l’auto Korps, qu’elle a pour mission de garder.
– Donc, précisai-je, il est matériellement impossible de pénétrer dans l’immeuble à l’insu des sentinelles.
– D’autant plus qu’il est complètement isolé, ajouta le comte de Nys.
– Qu’entendez-vous par là ? demandai-je.
– Je veux dire que, séparé des immeubles voisins par de larges avenues, il constitue à lui seul un îlot.
– Diable ! Comment y accéder dès lors ? fis-je, soucieux...
– Rien n’est plus facile, répondit le comte de Nys qui, voyant mon ébahissement, s’empressa d’ajouter :
– Le « Kasino » des officiers étant installé dans cet immeuble, pour y pénétrer, il n’existe qu’un moyen.
– Lequel ? fis-je, vivement.
– Nous camoufler en officiers boches, répondit froidement le comte de Nys.
 |
L’AMIRAL VON SCHRÖDER
qui commandait les bases navales allemandes en Flandre.
– Très joli, fis-je ; mais où trouver des uniformes ?
– Nous les avons ! Au complet et en bon état.
– Ça, par exemple ! m’exclamai-je, ne pouvant en croire mes oreilles...
– Je puis même vous indiquer, ajouta paisiblement le comte de Nys, que votre uniforme provient en droite ligne de la garde-robe du lieutenant de vaisseau von Kasper, décédé en mer...
– N’est-ce point ce von Kasper qui commandait le sous-marin « U-97 », récemment coulé ? interrompis-je.
– C’est celui-là même, répondit le comte de Nys, qui poursuivit :
– Comme il paraît que je ressemble trait pour trait au commandant d’armes de Zeebrugge, S. E. le général von der Zahn, notre brave van Iseghem a réussi à me procurer un uniforme de petite tenue de ce foudre de guerre qui, paraît-il, étant toujours entre deux vins, n’a rien trouvé de mieux que d’installer son Quartier général au Kasino, ce qui « empoisonne » les autres officiers à un point que vous ne sauriez imaginer.
– Pourquoi cela ? demandai-je en riant.
– Mais parce que, installé là à demeure, il est toujours sur leur dos. D’autre part, sa présence au « Kasino » détermine un perpétuel va-et-vient d’estafettes, de plantons, de télégraphistes, ce qui, à tout prendre, n’a rien de particulièrement agréable...
– Mais ce qui, interrompis-je, pourra nous être fort utile.
– Bien entendu ! répondit-il, ET C’EST SUR CE DÉTAIL QU’EST ENTIÈREMENT BASÉ MON PLAN...
Quelques instants plus tard, nous arrivions à l’endroit où nous attendait M. van Iseghem ; et, tandis que nous revêtions les uniformes qu’il s’était procurés à notre intention, l’excellent homme nous fit part des derniers renseignements qui venaient de lui parvenir.
– Hans Fuchs, nous dit-il, s’est installé au troisième étage, dans l’appartement no 16, lequel se compose d’un salon, d’une chambre à coucher et d’une salle de bain. Dans le salon, QUI PRÉCÈDE LA CHAMBRE, est posté en permanence un inspecteur de la police aux armées.
– Et dans le corridor ? demandai-je.
– Dans le corridor, il n’y a personne, me répondit M. van Iseghem.
– Vous en êtes certain ? insistai-je.
– Parfaitement ! De même que je suis certain que, à l’heure actuelle, Hans Fuchs qui, entre parenthèses, a bu comme une outre toute la soirée, est encore attablé au bar du Kasino.
– By J’ove ! fis-je ; vous paraissez être admirablement renseigné.
– Je suis là pour ça ! me répondit-il simplement.
– Et c’est fort heureux pour nous ! m’écriai-je ; car si nous réussissons, ce sera grâce à vous.
– N’exagérons rien, fit-il ; puis, passant à un autre ordre d’idées, il ajouta :
– Camouflé moi-même en chauffeur de l’auto-Korps, je vous attendrai avec ma voiture à proximité du Kasino. En cas d’insuccès, repliez-vous sur moi. Je me porterai immédiatement à votre rencontre. Mes dispositions sont prises pour vous mettre rapidement hors d’atteinte.
Tout ayant été convenu avec minutie, entre nous, nous remerciâmes vivement M. van Iseghem et nous partîmes pour le Kasino.
Un quart d’heure plus tard, après avoir échangé le mot d’ordre avec la sentinelle, nous pénétrions dans l’immeuble et, directement, nous nous rendions à l’appartement occupé par Hans Fuchs.
M’avançant vers la porte, je frappai...
Elle s’ouvrit aussitôt et, la barrant dans toute sa largeur, devant nous se dressa un colosse roux, aux yeux bleus, mais dont le « punch » – il n’y avait qu’à regarder ses poings pour en être convaincu – s’avérait redoutable.
C’était le garde du corps de l’espion du Kaiser.
Dès qu’il nous aperçut, il retira lestement sa pipe de sa bouche et il s’effaça pour nous laisser passer.
Puis, figé dans la position du « garde-à-vous », il attendait...
– M. Hans Fuchs, est-il rentré ? demanda le comte de Nys.
– Pas encore, Excellence ; mais il ne saurait tarder répondit-il.
Il n’avait pas fini de parler que, d’un violent coup de poing sous le menton, je l’envoyai rouler à terre, inanimé...
– Mes compliments, fit le comte de Nys ; je ne vous connaissais pas ce talent...
– C’est là un vieux souvenir d’Oxford, répondis-je en souriant ; la boxe y est fort en honneur.
Et, tranquillement, je me mis à « ficeler » l’inspecteur que, déjà, avait bâillonné le comte de Nys.
– Et d’un ! fis-je ; en dissimulant ma « victime » dans le cabinet de toilette.
– Je crois que voici l’autre ! fit, à son tour, le comte de Nys, qui arma silencieusement son browning.
La porte s’ouvrit lentement et, Hans Fuchs, abominablement gris, entra...
Où James Nobody s’empare
de Hans Fuchs, et ce qui en résulte.
Il n’alla pas loin...
À peine eût-il refermé la porte que, d’un geste brusque, je le ceinturai et l’envoyai au tapis, sur lequel il se plaqua tel un pantin disloqué.
Il ne tenta pas la moindre réaction.
Étant donné l’homme, une telle passivité ne pouvait s’expliquer que par l’ivresse. Mais, comment réagirait-il quand, les vapeurs de l’alcool s’étant dissipées, il recouvrerait, en même temps que ses esprits, l’usage de ses facultés ?
Penché sur lui, je le fixai intensément...
De toute évidence, il cherchait à comprendre.
Son teint, naturellement terreux, devint soudain d’une lividité cadavérique, et ses yeux, qu’il riva aux miens, reflétèrent une terreur intense.
Enfin, il parla...
– Qui êtes-vous ? demanda-t-il, à voix basse ; et que signifie, de la part de deux officiers allemands, cette agression aussi lâche que stupide ? S’il s’agit d’une plaisanterie, sachez que je la trouve d’un goût détestable.
– Vraiment ? répondis-je ; voilà qui est regrettable.
– C’est d’autant plus regrettable, reprit-il, que vous ignorez sans doute qui je suis.
– Qui vous êtes ? Nous ne le savons que trop, Hans Fuchs.
– Et, sachant mon nom, vous avez osé...
– Nous oserons bien davantage, interrompis-je ; surtout si nous n’arrivons pas à nous entendre...
Cette phrase, volontairement ambiguë, sembla lui donner quelque espoir. Peut-être, y vit-il une offre de transaction...
– Somme toute, demanda-t-il ; de quoi s’agit-il, et que me voulez-vous exactement ?
Ce disant, il s’était mis sur son séant.
– Peut-être daignerons-nous vous l’apprendre un jour venant, répondis-je sur le mode ironique ; pour l’instant, nous vous demandons tout simplement de vous lever et de nous suivre.
– Vous suivre ? s’exclama-t-il ; où comptez-vous donc me conduire ?
– Finissons-en ! intervint le comte de Nys ; ce colloque n’a que trop duré.
Puis, fixant à son tour Hans Fuchs, il lui déclara :
– De deux choses l’une : ou vous allez consentir à nous suivre sans tenter la moindre résistance, et dans ce cas, il ne vous arrivera rien de fâcheux ; ou...
– Et si je refusais de vous suivre ? haleta Hans Fuchs.
– En ce cas, je me verrais forcé de vous abattre immédiatement, répondit froidement le comte de Nys qui, après avoir regardé sa montre, ajouta :
– Je vous accorde une minute de réflexion. Toutefois, si vous le jugez préférable, vous pouvez disposer de cette minute pour faire vos prières ; car il est bien entendu que vous n’obtiendrez aucun autre délai.
Et, tenant sa montre d’une main, son browning de l’autre, il attendait...
Pas longtemps car, à peine avait-il achevé de parler que, déjà, Hans Fuchs acquiesçait.
– Comme il m’est impossible d’agir autrement, déclara-t-il, et afin de vous éviter de commettre un meurtre, je me remets entre vos mains.
– Et, bien vous faites ! répondit le comte de Nys, qui n’en continua pas moins à tenir Hans Fuchs sous la menace de son revolver.
Puis, s’adressant à moi
– Voulez-vous, cher ami, fit-il, débarrasser ce... monsieur, de ce qui se trouve dans ses poches ? Un malheur est si vite arrivé.
Complaisamment, Hans Fuchs se prêta à la fouille qui fut terminée en un clin d’œil.
Sur lui je trouvai un revolver, un couteau-poignard, une trousse contenant des ampoules médicales de diverses couleurs et un portefeuille bourré de papiers et de billets de banque.
Je fis disparaître le tout dans mes poches, après quoi, je lui déclarai :
– Vous allez vous placer entre nous deux, et vous nous accompagnerez bien sagement. Je vous préviens une fois pour toutes qu’au moindre geste suspect, à la plus petite incartade, je vous « descendrai » sans hésitation. Est-ce compris ?
Il me jeta un coup d’œil haineux...
– C’est compris ! répondit-il ; vous avez ma parole.
– J’aime mieux ceci, fis-je ; en lui montrant mon browning, que je plaçai tout armé dans ma poche.
Sans ajouter un mot, il se plaça de lui-même entre nous, et nous partîmes.
Nous ne fîmes aucune fâcheuse rencontre et, quelques minutes plus tard, nous rejoignîmes devant le Kasino M. van Iseghem qui nous attendait avec son auto.
– Je vois avec plaisir, fit-il, en dévisageant Hans Fuchs, que vous n’avez pas fait buisson creux. Mais, nom d’une pipe ; que ce... monsieur a donc une vilaine tête.
Hans Fuchs, en effet, était horrible à voir.
La haine, la rage, la honte, l’orgueil déçu, étaient peints sur son visage, en stigmates ineffaçables...
D’un geste, je l’invitai à prendre place dans l’auto où, le comte de Nys et moi, nous l’eûmes bientôt rejoint.
Dès qu’il fut assis, je lui bandai les yeux, et je baissai les stores de la voiture, Hans Fuchs n’ayant pas à savoir en quel endroit nous le conduisions.
Quand j’eus terminé, M. van Iseghem qui, à travers la glace, suivait avec attention tous mes mouvements, démarra en quatrième vitesse.
Afin d’éviter les postes installés aux différentes issues de la ville, M. van Iseghem prit la route du bord de mer qui, à l’ouest, n’était nullement gardée ; les batteries de la défense se chargeant de ce soin.
Quelques minutes plus tard, nous passions en trombe devant la dernière maison de la ville et, fonçant droit devant nous, nous filâmes en direction de Bruges, croisant et recroisant notre piste.
Nous contournâmes la ville et, à une allure sensiblement plus modérée, nous nous dirigeâmes par des chemins de terre, vers la maison où se trouvait l’entrée du souterrain, et qui appartenait à un affilié de la « Libre Belgique ».
– Qu’allez-vous faire de cet individu ? me demanda M. van Iseghem, dès que les portes de la cour se furent refermées sur nous.
 |
M. VAN ISEGHEM
l’un des agents du service de contre-espionnage belge.
– Mon intention, répondis-je, est de l’emmener en Angleterre, où mes chefs prendront toutes décisions utiles en ce qui le concerne. Mais d’ici là, je voudrais qu’il soit enfermé en lieu sûr.
– J’ai précisément ce qu’il vous faut, me déclara le Belge, propriétaire de la maison où nous nous trouvions et qui, je le sus par la suite, s’appelait Skaerbeck.
Nous faisant signe de le suivre, il nous fit descendre dans les caves de sa maison et, nous désignant l’une d’entre elles, il nous dit :
– Je pense que vous ne pourriez trouver mieux. Non seulement cette cave n’a pas de fenêtre ; mais la porte est en chêne et les ferrures qui la garnissent viennent d’être renouvelées.
– Comment se fait l’aération ? demandai-je.
– Par les caves voisines qui, elles, ont des soupiraux donnant sur l’extérieur.
Étant donné l’état des lieux, il était impossible de trouver mieux, en effet.
Dans cette cellule improvisée, nous plaçâmes quelques bottes de paille, une cruche d’eau et une miche de pain ; après quoi nous y enfermâmes Hans Fuchs.
Or, écoutez bien ceci :
Quand nous revînmes le soir même pour prendre notre prisonnier afin de l’emmener à bord d’un sous-marin qui l’attendait, caché dans une anfractuosité de la côte, la première chose que nous aperçûmes en entrant dans la salle à manger, fut le cadavre de M. Skaerbeck.
Le malheureux gisait à terre, un couteau entre les épaules.
Quant à Hans Fuchs, il avait disparu...
Où James Nobody
prend les décisions qui s’imposent.
Le comte de Nys et moi, nous nous regardâmes consternés.
Quel drame mystérieux s’était donc déroulé là, en notre absence, et comment Hans Fuchs, ENFERMÉ COMME IL L’ÉTAIT, avait-il pu faire pour s’enfuir ?
Nous remîmes à plus tard l’enquête qui s’imposait ; l’essentiel pour nous, maintenant, étant d’échapper aux sbires que le maître-espion allait lâcher à nos trousses.
Après nous être inclinés respectueusement devant la dépouille funèbre de M. Skaerbeck, nous nous réfugiâmes dans le souterrain, dont nous dissimulâmes l’entrée avec le plus grand soin.
Le comte de Nys était furieux, et ne parlait rien moins que d’aller brûler la cervelle à Hans Fuchs, et cela, en plein Kasino, à la face de tous...
Je parvins, non sans peine, à le calmer.
– Soit ! fit-il enfin ; mais je vous préviens loyalement que rien ni personne ne m’empêchera d’abattre ce bandit, la première fois qu’il se trouvera en ma présence...
À ce moment survint M. van Iseghem qui, tout effaré, nous dit :
– On a dû s’apercevoir de la disparition de Hans Fuchs, car toute la police de Zeebrugge est alertée et commence à perquisitionner un peu partout. Je crois qu’il serait prudent de le conduire immédiatement à bord.
Puis, ayant jeté un coup d’œil autour de lui, il nous demanda :
– Mais, au fait, où avez-vous mis Hans Fuchs ? L’auriez-vous déjà descendu dans l’égout ?
– Dieu seul peut savoir où se trouve désormais ce bandit ! lui répondit avec une indicible tristesse le comte de Nys, qui ajouta :
– Non content de recouvrer sa liberté, il a, par surcroît, assassiné votre malheureux ami, M. Skaerbeck.
M. van Iseghem fléchit sous le coup...
– Que m’apprenez-vous là ? s’écria-t-il, atterré.
– L’exacte vérité, fis-je ; et, pour tout dire, s’il est vrai que la police effectue en ce moment des perquisitions en ville, je suis persuadé que c’est Hans Fuchs qui les dirige en personne.
– Mais alors, s’exclama M. van Iseghem, vous n’êtes plus en sûreté à Zeebrugge ; il faut fuir.
– Fuir ! Toujours fuir ! Est-ce une existence ? s’écria le comte de Nys.
– Dame ! répondit naïvement M. van Iseghem, quand on ne peut faire autrement.
– Hélas !
– Et puis, insista M. van Iseghem, vous n’avez tout de même pas la prétention de lutter, à vous seul, contre les centaines de policiers et de soldats lancés à votre poursuite.
– Parbleu ! fis-je, à l’impossible nul n’est tenu, et je pense que nous avons mieux à faire que de nous laisser arrêter stupidement.
– D’où vous concluez ? me demanda le comte de Nys.
– D’où je conclus, répondis-je, que si nous voulons réparer notre échec et venger l’assassinat de M. Skaerbeck, il faut que, momentanément, nous disparaissions de la circulation. Mais, soyez tranquille ; je vous donne ma parole que Hans Fuchs ne perdra rien pour attendre.
Le comte de Nys, les yeux fixés sur moi, m’avait écouté attentivement.
De toute évidence, ma déclaration le satisfit, car je vis ses traits se rasséréner.
Sans doute, avait-il supposé que, découragé par l’échec que nous venions de subir, j’avais, en mon for intérieur, décidé de renoncer à la lutte...
C’était bien mal me connaître...
En effet, je suis de ceux que stimule l’insuccès, leur raison d’être étant de lutter et de vaincre.
– S’il en est ainsi, fit-il en venant vers moi, la main tendue, plus que jamais je suis votre homme, car, fuir dans ces conditions, C’EST ENCORE COMBATTRE !
– À la bonne heure ! s’écria M. van Iseghem, voilà qui s’appelle parler !
– Je n’en attendais pas moins du comte de Nys, répondis-je, en rendant à ce dernier son étreinte ; il va voir, d’ailleurs, comment je comprends la fuite. Voici le plan d’action que je propose :
« Comme, de toute façon, Hans Fuchs, devra, tôt ou tard, retourner à Mézières, où se trouve, en même temps que le Kaiser, le Grand Quartier Général, notre intérêt évident est, NON PAS DE L’Y SUIVRE, MAIS DE L’Y PRÉCÉDER.
« Tandis qu’il perdra un temps précieux à nous chercher dans Zeebrugge ou dans les environs, NOUS EMPLOIERONS LE NÔTRE À TENDRE LE PIÈGE DANS LEQUEL IL VIENDRA SE PRENDRE.
– Très bien ! interrompit le comte de Nys, mais par quelle voie comptez-vous vous rendre à Mézières ?
– Par la voie que jalonnent les agents de l’« Intelligence Service », lui répondis-je.
– C’est-à-dire ?
– C’est-à-dire que, tout d’abord, nous allons nous faire déposer dans les environs de Heyst, par le sous-marin anglais qui, – soit dit en passant, – doit nous attendre non sans impatience.
« Après quoi, nous nous dirigerons sur Mézières par Gand, Audenarde, Soignies, Charleroi, Philippeville, Rocroi et Charleville.
« L’un de nos agents, qui réside entre Charleville et Mézières, dans le faubourg d’Arches, nous procurera, en même temps qu’un asile, les moyens qui nous permettront de rayonner dans toute la région, c’est-à-dire de suivre, pas à pas, Hans Fuchs, dans tous ses déplacements.
« Ce plan, vous agrée-t-il ? demandai-je, en terminant ; dans le cas contraire, avez-vous mieux à me proposer ?
– Il serait impossible de trouver mieux, répondit le comte de Nys ; mais comme, somme toute, il s’agit d’une course de vitesse, quels moyens de transport comptez-vous utiliser ?
– À partir de Gand, nous pourrons, je pense, utiliser l’auto. Le tout est d’arriver à Gand. Or, entre Heyst et Gand, c’est-à-dire entre la côte et cette ville, je ne dispose d’aucun moyen de transport. Il nous faudra donc faire la route à pied...
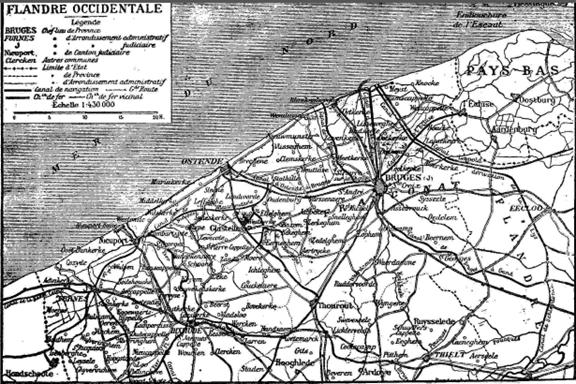 |
CARTE DE LA FLANDRE OCCIDENTALE MONTRANT LE PARCOURS
SUIVI PAR JAMES NOBODY ET LE COMTE DE NYS.
– À moins, intervint M. van Iseghem, que vous ne trouviez là-bas, vous y attendant, une auto.
– Une auto ? fit le comte de Nys, et laquelle ?
– Mais la mienne, répondit avec un bon sourire M. van Iseghem ; je la mets à votre entière disposition, car elle ne pourrait servir à meilleur usage.
– Vous feriez cela ? m’écriai-je, profondément touché par cette nouvelle preuve de dévouement.
– N’est-il pas de mon devoir de vous aider de toutes mes forces ? répondit M. van Iseghem, avec simplicité.
Nous ne pouvions qu’accepter l’offre de cet excellent homme ; et, après lui avoir donné rendez-vous à Heyst, en un endroit facile à repérer, nous le quittâmes, non sans l’avoir chaudement remercié.
À l’aube, le sous-marin nous déposa à proximité de Heyst.
Mais M. van Iseghem ne se trouvait pas au rendez-vous qu’il avait fixé...
Nous l’attendîmes en vain jusqu’au soir...
Et, quand vint la nuit, assaillis de sombres pressentiments, le cœur serré, tristement nous partîmes...
Où James Nobody se rend compte
une fois de plus
qu’un bienfait n’est jamais perdu.
Ce n’est qu’en arrivant à Oostkamp, après avoir dépassé Bruges, que nous aperçûmes, battant l’estrade, les premières patrouilles allemandes lancées à notre poursuite, en direction de Gand.
Nous nous jetâmes immédiatement à travers champs, utilisant avec soin les accidents du terrain afin de nous mieux défiler aux vues de l’ennemi.
Ce dernier avait pensé à tout...
Juché sur un camion-automobile, un projecteur de campagne projetait ses rayons en tous sens, fouillant minutieusement le terrain.
Fort heureusement pour nous, cc dernier étant très accidenté, il nous fut relativement facile de nous soustraire aux recherches dont nous étions l’objet.
Après avoir marché toute la nuit, tout en laissant sur notre droite Eeklo, Waarschoot et Evergem, nous arrivâmes, au moment même où sonnait la diane, en vue de Gand.
Au loin se profilaient les clochers de la cathédrale Saint-Bayon et de l’église Saint-Nicolas ; et, de l’endroit où nous nous trouvions, nous distinguions très aisément le beffroi et le château des comtes de Flandre.
La route, maintenant, s’animait...
Des maraîchers, venus des villages environnants, apportaient au marché les produits du sol. Leurs voitures surchargées de légumes, après avoir défilé à quelques mètres de nous, s’éloignaient cahin-caha et bientôt disparaissaient, absorbées par la brume.
L’une d’entre elles, plus pesamment chargée sans doute, s’embourba au sortir d’un chemin creux.
De toute évidence, les bêtes étiques qui la traînaient n’étaient pas de force à la sortir des ornières où elle s’enlisait jusqu’aux moyeux.
Désespéré, le maraîcher se vouait à tous les saints du paradis...
D’un coup d’œil nous nous consultâmes ; et, franchissant le fossé, nous vînmes joindre nos efforts aux siens.
Après quelques minutes d’un travail acharné, nous réussîmes à le tirer d’affaire ; et, déjà, sans attendre ses remerciements, nous nous apprêtions à le quitter, quand, nous ayant toisé avec un singulier sourire, il nous demanda :
– Ne seriez-vous pas, par hasard, les deux fugitifs que recherchent les Boches avec tant d’acharnement ?
– Et quand cela serait ? répondit d’un ton bref le comte de Nys.
– Dame ! fit le paysan en se grattant la tête – ce qui chez lui devait être un signe de grave réflexion – s’il en était ainsi, vous feriez bien de vous méfier. Sûrement que, s’ils vous attrapent, ils ne vous « rateront » pas !
Et, accentuant son sourire, il ajouta :
– Paraît que vous en avez fait de belles à Zeebrugge ?
– Qui donc vous a renseigné ainsi ? demanda le comte de Nys.
– Qui donc ? Les Boches, pardi ! répondit le paysan ; je les ai eus toute la nuit sur le dos à la ferme. Il y en avait un, entre autres – il était en civil, celui-là – qui paraissait plus enragé que les autres.
Le comte de Nys et moi échangeâmes un coup d’œil inquiet...
Tirant alors de mon portefeuille la photographie de Hans Fuchs, je la montrai au paysan.
– Ne serait-ce pas là, lui demandai-je, le « civil » dont vous parlez ?
– Dame, si ! répondit-il, vivement, c’est bien lui, certainement.
– Et, qu’est-il devenu ? intervint le comte de Nys.
– Il est parti sur le coup de quatre heures avec ses hommes, – ils étaient bien une vingtaine, – pestant et jurant comme un paysan, disant comme ça qu’il allait « tendre une souricière » à Gand.
– Merci du renseignement, camarade, répondit le comte de Nys ; nous en ferons notre profit.
– Il n’y a vraiment pas de quoi me remercier, fit le paysan ; vous pensez bien que, en ma qualité de Belge, et de Belge dont les quatre fils sont au front, j’ai les Boches en horreur.
– Voilà une affaire qui se présente bien mal, fit le comte de Nys en se tournant vers moi, et je ne vois vraiment pas comment nous pourrions bien faire pour pénétrer à Gand.
Le paysan se mit à rire...
Puis, regardant le comte de Nys :
– Et mon chariot, fit-il, pourquoi qu’il est faire ?
Désignant d’un large geste la montagne de choux, de carottes et de navets, qui surchargeait sa voiture :
– Croyez-vous vraiment, fit-il, que les Boches viendraient vous chercher là-dessous, si vous y étiez cachés ?
Malgré la gravité de la situation, nous ne pûmes nous empêcher de sourire et, aussi spontanément qu’elle nous avait été faite, nous acceptâmes sa proposition.
Ainsi qu’on va le voir, c’est à ce stratagème que nous dûmes notre salut.
En effet, quand nous arrivâmes aux portes de Gand, la voiture dans laquelle nous nous trouvions fut environnée d’un essaim de policiers et de soldats boches qui enjoignirent au maraîcher de s’arrêter.
Dès qu’il eût obéi, s’avançant vers lui, le chef des policiers lui dit :
– Videz immédiatement sur le sol tout ce que contient votre voiture ! Et que ce soit vite fait, n’est-ce pas ?
Au son de cette voix, nous tressaillîmes..., car c’était Hans Fuchs, lui-même, qui venait de parler...
– Nous allons certainement y rester, me dit à l’oreille le comte de Nys ; mais, du moins, ne le « ratons » pas !
Et, prenant son browning, il se tint prêt à faire feu.
Mais le paysan paraissait décidé à ne pas se laisser faire.
– Si c’est pour me remercier de l’hospitalité que je vous ai offerte cette nuit que vous me « mécanisez » de la sorte, répondit-il avec le plus grand calme, vous n’êtes vraiment pas gentil.
Hans Fuchs vint le regarder sous le nez...
– Ha ! Ha ! fit-il, en riant, c’est donc toi qui nous as si bien reçus ? En effet, je te reconnais.
Il hésita imperceptiblement ; puis, se tournant vers ses hommes :
– Laissez passer ! ordonna-t-il.
– Vous êtes bien aimable, répondit le maraîcher, mais vous le seriez encore plus si...
– Qu’est-ce que tu veux encore ? lui demanda Hans Fuchs, qui paraissait d’excellente humeur.
– Dame ! Vous voudrez bien reconnaître, répondit le paysan, que j’ai eu de la chance de tomber sur vous.
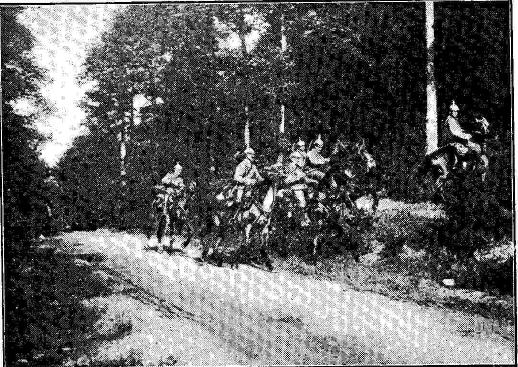 |
DES PATROUILLES ALLEMANDES DE CAVALERIE LANCÉES
À LA POURSUITE DE JAMES NOBODY.
– Ça, tu peux le dire. Et après ?
– Après ? Comme il n’en serait peut-être pas de même si je tombais sur un autre que vous tout à l’heure, je voudrais bien que vous me donniez un petit bout de papier signé de vous, pour qu’on me laisse aller tranquillement à mes affaires.
– C’est juste ! répondit Hans Fuchs ; comme tu t’es montré correct à notre égard, je vais te donner satisfaction.
Tirant un carnet de sa poche, il en arracha une feuille sur laquelle il écrivit quelques mots.
La tendant ensuite au paysan, il lui enjoignit :
– Et, maintenant, file ; je t’ai assez vu.
Comme bien on pense, ce dernier ne se fit pas répéter cette invitation.
Faisant claquer joyeusement son fouet, il reprit sa route, sous les yeux jaloux des autres maraîchers qui, moins heureux que lui, avaient dû installer à terre toutes leurs marchandises.
Quelques instants plus tard, après avoir suivi l’Allée verte qui longe le canal de Gand à Bruges, il nous déposait quai de la Lys, c’est-à-dire à deux pas de l’endroit où habitait la personne à laquelle nous avions affaire.
– Et voilà ! fit-il, avec un gros rire ; vous voyez que ce n’est guère malin de « rouler » les Boches !
– Non seulement vous les avez « roulés », répondit le comte de Nys, mais, par surcroît, vous nous avez sauvé la vie. Et, de cela, nous vous serons éternellement reconnaissants...
– Bah ! fit le brave homme, un service en vaut un autre, et puis, notre devoir n’est-il pas de nous entr’aider ?
Tout en parlant, il s’était décoiffé ; et, prenant à l’intérieur de son chapeau le « petit bout de papier » que lui avait remis Hans Fuchs, il nous le tendit en nous disant :
– M’est avis que voilà une « passe » qui vaut son pesant d’or...
– Son pesant d’or ? Je pense bien, s’écria le comte de Nys, après avoir lu.
Et, se tournant vers moi :
– Prenez donc connaissance de ce papier, fit-il en souriant.
Je pris le papier et je lus :
« Laissez passer le porteur de ce mot. Je réponds de lui. »
HANS FUCHS.
Et, au-dessous de la signature, rutilait le cachet de la Section secrète du Kaiser...
Où James Nobody arrive à Charleville
et ce qu’il y découvre.
Il est à peine besoin d’indiquer que, grâce à ce « laissez-passer » providentiel, nous arrivâmes à Charleville sans le moindre incident.
Toutes les fois qu’une patrouille, un policier ou un gendarme nous arrêtait pour nous demander nos papiers, le comte de Nys, qui s’était confectionné la plus réjouissante tête de Boche qu’il m’ait été donné de voir, sortait de sa poche le « laissez-passer » de Hans Fuchs et, après l’avoir montré à son interlocuteur, déclarait d’une voix autoritaire :
– Service spécial et secret de Sa Majesté l’Empereur et Roi !
Ce qu’ayant entendu, l’interlocuteur, après avoir effectué une courbette, s’empressait de filer par la tangente.
À partir d’Hirson, et cela jusqu’à Charleville, nous pûmes constater, à la fréquence des arrêts qui nous furent imposés, que le service de surveillance était admirablement organisé.
Non seulement la police allemande de campagne fonctionnait à plein rendement, mais la gendarmerie et la troupe la secondaient avec ensemble.
C’est alors, MAIS ALORS SEULEMENT, que nous nous rendîmes compte que, sans le « laissez-passer » de Hans Fuchs, jamais nous n’aurions réussi à franchir un réseau policier d’une telle ampleur.
Comme il eût été d’une imprudence folle de pénétrer en automobile dans Charleville, nous abandonnâmes notre voiture dans un garage de Warcq et, pédestrement, en bons bourgeois n’ayant rien à se reprocher, nous gagnâmes le faubourg d’Arches, en longeant la voie ferrée.
Dix minutes plus tard, m’étant fait reconnaître de l’agent qu’entretenait auprès du Grand Quartier Général allemand l’« Intelligence Service » de Londres, nous recevions de lui l’accueil le plus empressé.
D’origine danoise, mais habitant Charleville depuis son enfance, M. Harald Haraldsen – ainsi se nommait ce brave homme – était entré, après de fortes études, en qualité d’ingénieur dans l’une des principales usines de la région.
La police allemande l’avait surveillé pendant fort longtemps ; puis, rassurée par sa qualité de ressortissant neutre et par sa germanophilie, – au vrai, il ne laissait passer aucune occasion de la manifester avec fougue, – elle avait fini par le considérer avec sympathie...
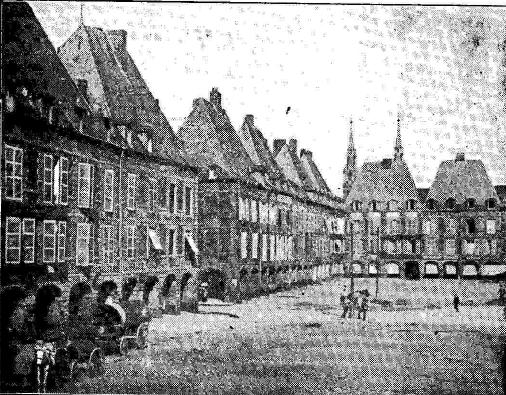 |
CHARLEVILLE. – PLACE DUCALE.
D’ailleurs, célibataire endurci, ne fréquentait-il pas avec assiduité la Grande Taverne, cet établissement dont le côté droit était réservé aux Français, et le côté gauche aux Allemands ? Et n’était-ce pas du côté allemand que, au vu et au su de tout le monde, il se tenait de préférence ?
Et puis, le Danemark – de même que les autres États scandinaves, d’ailleurs – n’était-il pas destiné, aussitôt la guerre finie, dès que le Kaiser aurait remanié à son gré la carte de l’Europe, à faire partie intégrante de la Confédération germanique ?
De là à considérer Harald Haraldsen comme un Boche authentique, il n’y avait qu’un pas à franchir.
La police allemande le franchit d’autant plus aisément que, sondé par elle, Harald Haraldsen se montra tout disposé à lui rendre « quelques petits services ».
C’est ainsi qu’elle lui demanda de surveiller pour son compte cet extraordinaire café du Barrage, – celui-là même que les initiés avaient surnommé : la friture, – qui, tapi au pied des hauteurs de Bel-Air, sur un coude de la Meuse, recevait toute sorte de monde, depuis les généraux de la Garde – torsade à l’épaule et « litze » à la manche – jusqu’aux nobles embusqués de l’Auto-Korps, ce fastueux régiment que commandait en personne Waldemar de Prusse, le propre neveu du Kaiser...
Du moment qu’il s’agissait « d’empoisonner » toute une catégorie de Boches, Harald Haraldsen prit son rôle au sérieux.
Ses rapports que, sous le manteau, il remettait chaque jour à von Glauber, l’alter-ego de Hans Fuchs, se firent de plus en plus précis.
Tour à tour il signala comme ayant tenu des propos séditieux – pour ne pas dire défaitistes –- le général de hussards prince de Schaum Zourg-Zippe ; le major von Caprizi, de la maison militaire du Kaiser ; son Altesse Royale Wilhelm de Hohenzollern-Sigmaringen, frère du roi de Roumanie et beau-père de S. M. le roi Manoël de Portugal ; le Dr Webel, médecin du kaiser ; le général von Breytag-Zoringhoven, premier commandant de la Kommandantur du Grand Quartier Général...
J’en passe, et des meilleurs...
Tant et si bien que, émerveillé par la précision des rapports que lui remettait Harald Haraldsen, von Glauber avait convoqué ce dernier la veille même de notre arrivée et, tout de go, lui avait demandé si, le cas échéant, il ne consentirait pas à effectuer, pour le compte du service allemand d’espionnage, un ou plusieurs voyages en France et en Angleterre.
Ne pouvant accepter une telle offre, sans en avoir référé auparavant à l’« Intelligence Service », Harald Haraldsen avait réservé sa réponse.
Or, le matin même, von Glauber, – qu’il avait rencontré tout à fait par hasard sur la place ducale, – l’avait pressenti de nouveau, et avec une telle insistance, qu’il avait dû se résoudre à accepter sa proposition.
Les choses en étaient là...
Après avoir longuement réfléchi, je ne pus qu’approuver la décision prise par Harald Haraldsen.
Il est hors de doute, en effet, que s’il avait répondu par un refus, son expulsion immédiate eût été ordonnée, ce qui, pour nous, eût équivalu à une catastrophe.
En acceptant, par contre, il allait être à même de nous rendre des services d’autant plus précieux que, confiant en lui, von Glauber le mettrait sûrement en relations avec ses « correspondants » installés à Paris et à Londres.
D’autre part, du fait de mon arrivée à Charleville, Harald Haraldsen serait automatiquement remplacé ; ce qui, étant donnée l’importance de la mission dont il était chargé, était essentiel.
Enfin, par le fait même qu’il était destiné à faire constamment la navette entre Paris, Londres et Charleville, il constituerait entre mes chefs et moi le plus parfait des agents de liaison.
Donc, tout bien pesé, l’affaire s’avérait excellente.
Dès le lendemain, von Glauber nous démontra qu’elle était meilleure que nous n’aurions osé l’espérer.
Jugez-en plutôt...
Où James Nobody
sauve la vie à Harald Haraldsen.
À peine faisait-il jour, en effet, qu’un sous-officier de la « Stadtwache 11 », arborant au bras gauche le brassard noir-blanc-rouge, se présentait porteur d’un pli officiel à l’adresse de M. Harald Haraldsen.
Ce pli contenait une convocation signée de M. Bauer, le directeur de la police secrète du Grand Quartier Général 12.
En termes courtois, mais pressants, ce haut fonctionnaire invitait notre ami à se présenter à son bureau à dix heures très précises.
– Voilà une invitation qui ressemble terriblement à un ordre, fit en souriant le comte de Nys, après avoir pris connaissance de la convocation. Je me demande ce que peut bien vous vouloir cet individu qui, si je ne m’abuse, dirige une branche de la police dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle concurrence directement la branche aux destinées de laquelle préside votre « ami » von Glauber.
– En effet, répondit Harald Haraldsen ; ces messieurs n’ont d’autre souci que de se tirer dans les jambes. Aussi cette « invitation » n’est-elle pas sans m’inquiéter quelque peu.
Puis, avec un sourire, il ajouta :
– Bah ! Qui vivra verra !
– Ne pensez-vous pas, lui demandai-je alors, qu’il y aurait intérêt à mettre von Glauber au courant de ce qui vous arrive ? Il est possible que, en manœuvrant ces deux hommes l’un par l’autre, en les mettant – si j’ose dire – en compétition, nous obtenions des résultats bien supérieurs à ceux que nous escomptons.
Il en fut ainsi décidé et, quelques instants plus tard, Harald Haraldsen nous quitta pour se rendre chez von Glauber.
L’entrevue, paraît-il, fut épique...
– Herr Gott sakrament ! s’écria von Glauber ; que veut dire cela ? Et de quoi se mêle – je vous le demande – ce propre à rien de Bauer ? S’imagine-t-il, par hasard, que je mets les plats au chaud pour qu’il n’ait plus qu’à les servir... ou à les manger ?
Et, comme Harald Haraldsen, n’en pouvant mais, s’efforçait de le calmer...
– Point ! s’écria-t-il ; point ! C’est une affaire à régler entre Bauer et moi. Et, puisqu’il a osé vous donner rendez-vous, que le tonnerre de Dieu m’extermine si je ne vous accompagne pas chez lui !
Il fut impossible de l’en faire démordre et, bon gré mal gré, Harald Haraldsen dut consentir à ce que von Glauber intervienne en tiers dans la conversation.
En tiers ?
Au vrai, quand Harald Haraldsen se présenta en compagnie de von Glauber dans le cabinet de M. Bauer, plusieurs personnages se trouvaient là, qu’il ne s’attendait certes pas à rencontrer... parmi lesquels figuraient en bonne place le comte von Boltke, de la maison de Sa Majesté l’Empereur et Roi ; le général von Slessen, chef du Cabinet militaire du Kaiser ; le colonel von Barschall, délégué du ministère de la Guerre, et plusieurs officiers supérieurs du G. Q. G., reconnaissables à la bande amarante qui ornait (?) leur pantalon...
Von Glauber tomba comme un bolide au sein de cette assemblée et, faisant tête, aussitôt, le mufle en avant :
– Somme toute, que nous voulez-vous ? demanda-t-il, et à quoi rime ce conseil de guerre ?
Et, promenant autour de lui son regard menaçant :
– Prenez garde ! ajouta-t-il ; je n’admets pas – ET JE N’ADMETTRAI JAMAIS – qu’on intervienne dans une affaire dont j’ai assumé la charge, et dont j’ai reçu mission de m’occuper personnellement et exclusivement !
Bauer se fit tout miel...
– Puis-je vous demander, mon cher collègue, fit il, de qui vous tenez cette mission ?
– D’abord, répondit brutalement von Glauber, je ne suis pas votre collègue ; ensuite, ce que je fais ne vous regarde pas !
– Vous admettrez, cependant...
 |
VON GLAUBER
sous-chef de la section secrète du Kaiser.
– Je n’admets rien ! trancha von Glauber, en ponctuant d’un violent coup de poing sur la table cette affirmation ; et, tous, tant que vous êtes ici, souvenez-vous que, moi présent, vous avez le devoir strict de vous taire.
Des murmures s’élevèrent...
– Cette consigne me concerne-t-elle également ? fit, soudain, un officier, en écartant un rideau derrière lequel, jusqu’ici, il s’était dissimulé.
À sa vue, tous les officiers présents et M. Bauer lui-même se levèrent et se figèrent dans la position du « garde-à-vous »...
Seul, von Glauber ne parut pas intimidé...
Fixant le nouveau venu droit dans les yeux, froidement, il répondit :
– Pourquoi ne vous concernerait-elle pas ? Parce que vous êtes Son Altesse Impériale et Royale le Kronprinz, vous croyez-vous, sinon au-dessus des lois, tout au moins de taille à méconnaître la volonté du seul maître que je reconnaisse, votre auguste père ?
Le Kronprinz était devenu livide...
Il esquissa même un geste de menace...
Mais, sans se laisser intimider le moins du monde, von Glauber ajouta :
– Vous voudrez donc bien, Altesse, vous occuper strictement de ce qui vous regarde, et...
– Vous osez me donner des ordres ! À moi ! s’écria le Kronprinz, furieux.
– J’oserai bien plus encore, si vous ne vous taisez immédiatement, répondit avec le plus grand calme von Glauber, qui ajouta :
– Comment se fait-il d’ailleurs que Votre Altesse soit à Charleville au lieu d’être à Stenay ; où se trouve son Quartier Général ? Je vous préviens d’ores et déjà que ce nouvel acte d’indiscipline sera porté à la connaissance de Sa Majesté le Kaiser, auquel je demanderai de prendre les sanctions qui s’imposent.
Sans un mot, le Kronprinz, pâle et tremblant, mais étouffant de rage, s’effondra dans un fauteuil, sous les yeux consternés de ses amis...
Sans plus s’occuper de lui que s’il n’avait jamais existé, von Glauber, s’adressant à M. Bauer cette fois, lui dit :
– J’espère que cette leçon vous servira et que, désormais, vous éviterez avec soin de marcher sur mes brisées. Dans le cas contraire, je me verrais obligé d’en référer à mon chef direct, Son Excellence Monsieur Hans Fuchs, premier Conseiller privé de Sa Majesté.
À l’énoncé de ce nom, un frémissement secoua l’assistance... Toutes les têtes se courbèrent...
– Vous ne ferez pas cela ! s’écria M. Bauer, terrifié...
– Soit, concéda von Glauber ; mais n’y revenez pas !
– Vous pouvez y compter, murmura l’autre.
Après l’avoir tenu quelques secondes sous son regard, von Glauber reprit :
– Me ferez-vous, maintenant, l’honneur de m’apprendre dans quel but vous aviez convoqué M. Harald Haraldsen, ici présent, lequel – je tiens à vous en prévenir – est l’un des plus fidèles serviteurs de Sa Majesté ?
– Veuillez croire que j’ignorais cc détail, répondit M. Bauer ; sans quoi...
– Pas de phrase ! interrompit von Glauber ; venez-en au fait, tout de suite !
Alors, ce fut l’aveu...
Il ne s’agissait nullement de ce que croyait von Glauber...
– Ayant appris que M. Harald Haraldsen, répondit M. Bauer, avait dénoncé et fait punir de nombreuses personnalités, coupables seulement de s’être diverties...
– ALORS QUE D’AUTRES SE FAISAIENT TUER, N’EST-IL PAS VRAI ? tonna von Glauber.
– ... nous avions décidé, poursuivit, en courbant la tête M. Bauer, de lui infliger une punition exemplaire et de...
– Assez ! s’écria von Glauber ; assez !
Et, scandant ses mots, il ajouta :
– Je vous tenais pour un coquin, Monsieur Bauer ; je vous savais vil et pleutre à souhait, – PARTANT, CAPABLE DE TOUTES LES VILENIES, – mais je ne vous aurais jamais cru lâche à ce point.
– Un lâche, moi ! s’exclama M. Bauer...
Von Glauber eut un rire effrayant.
– Oui ! Un lâche ! Car, quand on est un homme on agit en homme et non pas en jean-foutre !
Puis, promenant sur l’assistance son regard courroucé, il précisa :
– Quand on est des hommes dignes de ce nom, on ne se met pas à dix pour assassiner un autre homme !
« Car c’est de cela qu’il s’agissait, n’est-ce pas, messieurs ?
« Si je n’avais accompagné M. Harald Haraldsen, si je l’avais laissé venir seul dans cet... antre, il n’en serait très probablement pas sorti vivant !
« Est-ce vrai ? »
Nul n’osa le contredire...
Les bras croisés, un sourire méprisant aux lèvres, fixant tour à tour les personnalités présentes, von Glauber attendait...
Soudain, il éclata :
– Je vous préviens, s’écria-t-il, que je tiens votre silence pour un aveu ! Tous, autant que vous êtes, vous aurez à répondre de ce complot tramé contre un agent de Sa Majesté.
Puis, se tournant vers M. Bauer :
– J’ai des excuses à vous adresser, lui dit-il ; je vous ai dit tout à l’heure que vous étiez le dernier des lâches ! Je me suis trompé !
Et, fixant le Kronprinz, il ajouta :
– Car il y a plus lâche que vous encore...
Où James Nobody commence à voir clair
dans le jeu de Hans Fuchs.
C’est à son retour du Grand Quartier Général que Harald Haraldsen nous relata dans ses moindres détails cette peu banale entrevue.
Je savais, évidemment qu’il existait un certain antagonisme entre la police du Grand Quartier Général et la police personnelle du Kaiser ; mais j’étais loin de penser que cet antagonisme revêtait un tel caractère de gravité...
Pour que des personnages aussi considérables que Bauer et von Glauber – qui, ne l’oublions pas, étaient « les cerveaux de l’armée allemande », – en vinssent à s’insulter publiquement ; pour que von Glauber se permît d’outrager le Kronprinz en présence des plus hautes personnalités de la Cour ; il fallait qu’une haine violente, tenace, irréductible, divisât ces deux chefs du grand parti militaire qu’étaient le Kaiser et son fils, le prince héritier.
S’il n’avait été sûr de l’impunité, jamais von Glauber ne se serait permis une pareille incartade.
Les échecs répétés et sanglants que le Kronprinz venait de subir devant Verdun l’avaient rendu impopulaire, certes...
Mais l’était-il devenu à ce point qu’on pût l’insulter impunément ?
La question étant ainsi posée, il importait de la résoudre au plus vite, le facteur psychologique étant de ceux dont, en pareille matière, il eût été impardonnable de se désintéresser.
Si vraiment les chefs de l’armée allemande en étaient arrivés au point de ne pouvoir s’aborder que l’insulte à la bouche ; si, au lieu de marcher la main dans la main, ils pratiquaient, au contraire, la politique du « Faustrecht 13 » ; notre devoir strict était d’analyser – afin de les mieux exploiter à notre profit – les causes déterminantes de cette invraisemblable attitude.
Il était hors de doute, en effet, que dans le conflit qui divisait ainsi les grands chefs allemands, Bauer et von Glauber n’intervenaient qu’à titre de comparses.
Derrière eux, se profilant en silhouettes massives, apparaissaient les vrais protagonistes du drame : LUDENDORFF, le représentant attitré du Kaiser à la tête du G. Q. G., et SCHMIDT VON KNOBELSDORFF, l’homme lige du Kronprinz qui, de son Kommando de Damvillers, prétendait régenter l’État-major général.
Ce n’étaient plus deux hommes qui se trouvaient en présence, mais deux tactiques.
L’une, plus souple, celle de Ludendorff – s’inspirant des nécessités de la guerre moderne, partant, plus dangereuse ; l’autre, brutale à l’excès, – celle de Schmidt von Knobelsdorff, – procédant par coups de boutoir, à l’aide d’attaques massives, extrêmement coûteuses, et sans résultats stratégiques appréciables...
Mon enquête m’apprit bientôt que, dans la coulisse, manœuvrait un troisième larron.
Ce dernier n’était autre que le maréchal von Haeseler, l’un des derniers vestiges de l’ancienne armée, et l’une de ses gloires.
Bien que privé de tout commandement actif, von Haeseler, n’en jouissait pas moins d’une certaine influence auprès des généraux qui, plus jeunes que lui, avaient, pour la plupart, servi sous ses ordres.
Mais parmi ceux qui échappaient à cette influence se trouvaient précisément Ludendorff et Schmidt von Knobelsdorff, lesquels s’accordaient à trouver « impossible » le vieux maréchal, et déclaraient à qui voulait les entendre qu’ils le tenaient pour une « vieille bête ».
Quoi qu’il en soit, von Haeseler ne pouvait tout de même pas imposer ses directives à des hommes ainsi prévenus contre lui et qui, à tout prendre, jouissaient tous deux à un égal degré de la confiance de leurs chefs respectifs.
Aussi, tapi dans l’ombre, assouvissait-il sa rage, en semant la discorde et en attisant les rancunes...
Les choses en étaient là quand le comte de Nys et moi arrivâmes à Charleville.
Nous attendîmes, pour combiner notre plan d’attaque, que von Glauber ait démasqué ses batteries et fait connaître à Harald Haraldsen ce qu’il attendait de lui.
Nous ne tardâmes pas à être fixés...
En effet, deux jours après la scène relatée ci-dessus, Harald Haraldsen reçut une nouvelle convocation.
Mais, cette fois, elle n’était pas signée par von Glauber.
Hans Fuchs en était le signataire.
Hans Fuchs, c’est-à-dire le chef direct de von Glauber.
Son intervention – encore qu’elle ne nous gênât guère – aurait-elle pour résultat de rompre ou de modifier les propositions faites par von Glauber à Harald Haraldsen ?
Autrement dit, Hans Fuchs maintiendrait-il – tout en le chargeant d’une « mission spéciale » – Harald Haraldsen dans les cadres de la section personnelle secrète du Kaiser ?
La question, ainsi qu’on le voit, était d’importance.
À notre grande satisfaction, Hans Fuchs la trancha par l’affirmative.
Ayant fait comparaître Harald Haraldsen devant lui il lui déclara, en effet, tout de go :
– Les références qui m’ont été fournies sur votre compte sont des meilleures et, bien que vous ne soyez pas Allemand d’origine, j’ai décidé de vous considérer comme tel, et de vous prendre à mon service. J’espère que vous ne m’en ferez pas repentir.
Harald Haraldsen s’étant empressé de lui donner tous apaisements à cet égard, l’espion du Kaiser reprit :
– J’ai appris, au cours d’un voyage que je viens de faire en Angleterre, que l’Amirauté britannique prépare actuellement une attaque de grand style contre deux de nos bases sous-marines de Belgique : Ostende et Zeebrugge.
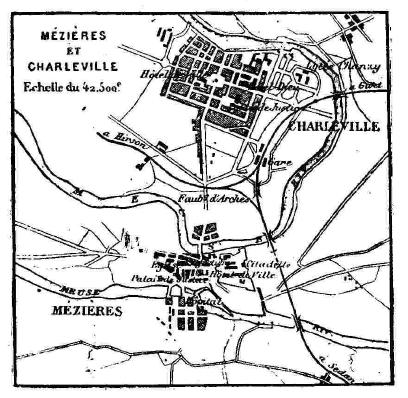 |
« Les évènements ayant mal tourné, je n’ai pu me procurer les renseignements désirables.
« J’ignore notamment le nombre et les forces des bâtiments que l’Amirauté compte employer ; j’ignore également si des forces aériennes participeront à cette attaque.
« Voulez-vous essayer de « m’avoir » ces renseignements ? »
– Pourquoi pas ? répondit froidement Harald Haraldsen ; le tout est de savoir combien vous me paierez.
Hans Fuchs, croyant se trouver en présence d’un homme vénal, tomba dans le piège...
Il eut un sourire et répondit :
– Si vous réussissez cette affaire, vous « toucherez » cent mille marks.
– Bien, fit Harald Haraldsen, je m’efforcerai de la réussir ; le prix en vaut la peine.
Puis, tout en allumant une cigarette, il ajouta :
– C’est tout ce que vous désirez de moi ?
Hans Fuchs le regarda, ébahi.
– Ah ! ça, s’écria-t-il ; croyez-vous donc que vous allez obtenir ces renseignements en vous adressant au premier venu ? C’est une affaire montée et conduite dans le plus grand secret et...
– Peuh ! interrompit Harald Haraldsen, c’est une affaire comme une autre. Et puisque vous avez pris des références sur mon compte, vous devez savoir que j’ai fait, autrefois, afin d’achever mes études techniques, un stage dans les chantiers de la Mersey, à Liverpool et aussi, chez Armstrong.
– Teuffel ! s’écria Hans Fuchs, j’ignorais cela ! Et alors ?
– Alors, répondit Harald Haraldsen, vous pensez bien que je ne suis pas sans avoir conservé quelques relations en Angleterre. Je suis même demeuré dans les meilleurs termes avec de nombreux ingénieurs et officiers de marine.
– Herr Gott sakrament ! s’exclama Hans Fuchs ; mais alors, vous êtes un homme précieux un homme providentiel et je vais avoir beaucoup mieux que cela à vous proposer...
Et, le fixant dans les yeux...
– Êtes-vous homme, lui demanda-t-il, à tenter un grand coup, un coup énorme, un coup qui pourrait vous rapporter... UN MILLION DE MARKS ?
Prenant une chaise, Harald Haraldsen s’assit puis, fixant à son tour l’espion du Kaiser, posément il répondit :
– Causons...
Où James Nobody joue un tour pendable
à Hans Fuchs.
Après avoir pris dans un coffre-fort placé derrière lui un dossier de couleur chamois, sur la couverture duquel se lisait la mention que voici :
Ordres et Prescriptions
de S. E. M. le Premier Quartier-Maître Général 14 ;
Hans Fuchs, se tournant vers Harald Haraldsen lui demanda :
– Connaissez-vous l’Égypte ?
– Fort peu, répondit Harald Haraldsen ; au vrai, je ne connais de l’Égypte que ce qu’on peut apercevoir du bord d’un navire, entre Port-Saïd et Suez.
– Donc vous avez traversé le canal ?
– Oui, en me rendant à Saigon.
– C’est amplement suffisant, répondit Hans Fuchs d’un air satisfait...
Puis, ayant tiré du dossier une carte, il l’étala sur la table et reprit :
– Comme vous le savez, l’isthme de Suez est constitué par une énorme dépression de terrain, qui est bordée, d’une part, par les monts asiatiques et, d’autre part, par les plaines de l’Égypte.
– C’est exact.
– Son sol, loin d’être régulier, se creuse du nord au sud et forme quatre immenses réservoirs auxquels les géographes ont donné les noms de lac Menzaleh, lac Ballah, lac Timsah et lacs Amers. Un plateau, qui ne dépasse pas vingt mètres de hauteur, sépare les deux premiers lacs des deux autres. Ce plateau, qui porte le nom d’El Ghisrh (ce qui, en français veut dire le seuil) est le point culminant de l’isthme. Veuillez, je vous prie, noter ce nom.
Harald Haraldsen obtempéra immédiatement et, sur son calepin écrivit :
– Une autre éminence, poursuivit l’espion du Kaiser, sépare le lac Timsah des lacs Amers ; c’est le lieudit : SERAPEUM. Notez également ce nom.
Quand ce fut fait, il reprit :
– Comme moi vous savez que l’offensive entreprise contre le canal par les Turcs et les Bédouins a complètement échoué. Les alliés font bonne garde, et leurs troupes ont anéanti les quelques formations ottomanes qui se dirigeaient à marches forcées vers le canal.
 |
LA CARTE DU CANAL DE SUEZ.
« Mais, là où a échoué la force, la ruse peut et doit réussir.
« Tel est l’avis du général Ludendorff, lequel vient de me donner l’ordre formel d’« embouteiller » par tous les moyens en mon pouvoir le canal de Suez, qu’il considère avec juste raison comme l’une des artères vitales de l’ennemi. »
– Parbleu ! répondit paisiblement Harald Haraldsen ; il y a longtemps que cela aurait dû être fait.
– Voilà qui est énorme ! s’écria Hans Fuchs, démonté par cette réponse.
– Pourquoi énorme ?
– Mais, parce que pour réussir un coup pareil, il faut disposer d’un personnel et d’un matériel de tout premier ordre et que...
– Voulez-vous que nous parlions sérieusement ? interrompit Harald Haraldsen ; je n’ai pas pour habitude de perdre mon temps, et les billevesées ne sont pas mon fait.
Démonté une fois de plus, Hans Fuchs lui jeta un coup d’œil de coin, semblant se demander d’où sortait ce phénomène...
– Mais, je vous assure, répondit-il, que je parle tout à fait sérieusement, et que...
– Alors que viennent faire, dans une affaire aussi simple, le personnel et le matériel auxquels vous faites allusion ?
– Mais...
– De deux choses l’une, trancha Harald Haraldsen : ou vous voulez monter une attaque de grand style et, alors, toute votre flotte n’y suffira pas ; ou voulez employer la ruse, et...
– Mais, c’est que je vous ai dit tout à l’heure, s’écria l’espion du Kaiser ; seule, la ruse peut nous permettre d’aboutir.
– D’accord ! fit Harald Haraldsen ; cela étant, quel est votre plan ?
– Il est fort simple et, de l’avis même de nos techniciens, il est d’une exécution facile.
– Voyons ?
– Il tient en deux mots : FAIRE SAUTER LE CANAL AUX DEUX POINTS SENSIBLES ; C’EST-A-DIRE À EL-GHISRH ET À SERAPEUM.
– Pas plus ? gouailla Harald Haraldsen.
– Mais...
– Permettez-moi de vous dire que vos techniciens sont complètement idiots.
– Pourquoi cela ?
– Mais parce que vous ne trouverez jamais un homme – j’entends : un homme sain d’esprit – pour se lancer dans une aventure pareille.
Puis, prenant la carte, il ajouta :
– Comment voulez-vous, en effet, qu’un homme puisse se charger à lui seul, de faire exploser, À LA MÊME HEURE, deux mines en deux endroits aussi éloignés que le sont l’un de l’autre, El-Ghisrh et Serapeum ?
– Je n’ai pas dit qu’il serait obligé de faire exploser ces mines à la même heure, répondit, profondément vexé, Hans Fuchs.
– Alors, s’écria Harald Haraldsen, vos techniciens sont encore plus idiots que je ne le pensais. Comment ne comprennent-ils pas, en effet, que si, à l’extrême rigueur, l’un de ces attentats peut réussir, le second, par contre, est voué à un échec certain ?
– Vous croyez ?
– Parbleu ! répondit Harald Haraldsen qui ajouta aussitôt :
– Il ne faut tout de même pas sous-estimer les Anglais et les croire plus bêtes que nature. Il est possible, je vous le répète, qu’on réussisse à faire exploser la première mine ; mais cinq minutes plus tard, toute la police du canal, toutes les troupes britanniques seront alertées, et la circulation sera rigoureusement contrôlée. Comment voulez-vous faire sauter la seconde mine dans ces conditions ? Par l’électricité ? Cela suppose une installation adéquate, et des concours que vous ne possédez pas. Alors ?
– C’est évident, répondit Hans Fuchs, consterné ; je n’avais pas songé à cela. Il va falloir trouver autre chose.
– Peuh ! fit négligemment Harald Haraldsen, point n’est besoin de se creuser les méninges pour trouver mieux !
– Vous auriez une idée ? s’écria Hans Fuchs, vivement intéressé.
– J’en ai même plusieurs, répondit avec calme Harald Haraldsen ; mais, comme je ne suis pas un technicien, moi, et que je tiens essentiellement à vous proposer une affaire viable, souffrez que, avant de vous la soumettre, je l’étudie à fond.
– Quand me donnerez-vous réponse ? demanda Hans Fuchs.
– Demain à la même heure, répondit Harald Haraldsen.
– J’y compte absolument ! insista l’espion du Kaiser, en reconduisant notre ami...
Dès qu’il fut de retour, Harald Haraldsen nous fit part de la conversation qu’il venait d’avoir avec Hans Fuchs.
– Étant donnée la gravité de la situation, ajouta-t-il en terminant, j’ai pensé que mieux valait gagner du temps.
– Que comptez-vous donc faire ? lui demandai-je.
Il se mit à rire, puis il répondit :
– Je compte proposer à Hans Fuchs d’acheter deux bateaux, que je chargerai de ciment, et que j’irai couler au beau milieu du canal de Suez, à El-Ghirsh et à Serapeum.
– Diable ! fit le comte de Nys, et si les Boches adoptaient cette idée ?
– L’Amirauté britannique étant prévenue, comment la pourraient-ils réaliser ? répondit Harald Haraldsen.
– En effet, fis-je à mon tour, après avoir longuement réfléchi, je ne vois que des avantages à la leur présenter. Comme elle n’est pas immédiatement réalisable, nous aurons le temps voulu pour manœuvrer.
Nous étant mis entièrement d’accord, je décidai de rentrer immédiatement à Londres, afin de mettre le général sir Arthur Birdwell au courant de ce nouvel et grave incident.
Et, quinze jours plus tard, le 23 avril 1918 exactement, plusieurs navires chargés de ciment étaient coulés dans une passe...
Mais cette passe était celle de Zeebrugge.
Les navires coulés étaient tous britanniques.
Et l’auteur de ce magnifique exploit QUI EUT POUR PREMIER RÉSULTAT D’ « EMBOUTEILLER » LES SOUS-MARINS BOCHES STATIONNÉS À ZEEBRUGGE, était le vice-amiral sir Roger Keyes...
Où James Nobody
est mis sur la trace d’un nouveau complot.
Quand je revins à Charleville, je pus constater que, chez nos adversaires, le moral était au plus bas.
Au Grand Quartier Général, tout n’était que confusion et que rage...
Dans les corps et services de la garnison, les échecs sanglants et répétés que l’armée venait de subir un peu partout avaient causé une profonde consternation.
Non seulement les troupes ne croyaient plus à la victoire ; mais elles n’osaient même plus escompter cette « paix blanche » qu’on leur promettait depuis si longtemps ; la rude poigne de Clémenceau ayant mis à la raison ceux qui en France avaient osé se faire les tenants de l’Allemagne et les « apôtres » du défaitisme.
Bientôt, les causes de mécontentement : raréfaction des vivres et des denrées de première nécessité ; crise politique intérieure, – dont on ne put dissimuler la gravité aux troupes, – intervention de l’Amérique ; échec de la guerre sous-marine, etc., se multiplièrent.
Le « cafard » fit son œuvre, et il advint que, fatalement, les liens qui unissaient les soldats à leurs chefs se distendirent, et que la discipline qui, jusqu’ici avait été maintenue à grand-peine, s’abolit...
On assista à cet invraisemblable spectacle de simples soldats qui, croisant leurs supérieurs dans la rue, poursuivaient leur route sans les saluer.
Chose plus invraisemblable encore, aucune sanction n’intervenait.
Les officiers que je rencontrais, soit au Salon des Familles, rue de Tivoli, où se trouvait leur mess ; soit à l’Hôtel du Lion d’Argent, rue Thiers ; soit encore au Café Dubois, de joyeuse mémoire, paraissaient complètement abattus.
Ils n’avaient plus rien de commun certes, avec ces brillants Junckers qui, en août 1914, étaient partis le sourire aux lèvres pour la guerre fraîche et joyeuse...
Le Kaiser lui-même, – qu’il m’arrivait parfois de rencontrer aux environs de la magnifique villa, où, au mépris de tout droit, il s’était installé, et qui appartenait à M. Georges Corneau, Directeur du « Petit Ardennais », – semblait triste et désemparé.
Il avait renoncé à ses habitudes de cabotinage et, toute morgue abolie, c’est à peine si, d’un geste négligent, il répondait au salut des hommes préposés à sa garde.
On sait que ces derniers étaient tenus, dès qu’ils l’apercevaient, de hurler en chœur : Dem Kaiser...! Hoch ! Hoch ! Hoch !
Le comte de Nys qui, comme moi, observait avec la plus extrême attention cette désagrégation lente, mais continue, de l’édifice militaire allemand, ne se tenait pas de joie.
Sans cesse par monts et par vaux, il rentrait chaque soir avec des renseignements du plus haut intérêt que, par « la voie ordinaire », nous transmettions d’urgence au G. Q. G. britannique.
De son côté, Harald Haraldsen ne demeurait pas inactif.
Tous les matins vers neuf heures, il se rendait aux ordres, chez Hans Fuchs, auprès duquel il était maintenant « persona grata ».
Très habilement, il en profitait pour étendre le cercle de ses relations.
C’est ainsi qu’il fit connaissance, – pour le plus grand bien de notre cause, – des lieutenants-colonels Heutsch et von Rauch, qui dirigeaient de concert le service des renseignements de l’armée, et aussi du chef de la IIIe section de l’État-major général, le fameux colonel Nicolaï.
Ayant su, en peu de temps, se rendre indispensable, Harald Haraldsen manœuvrait ces gens-là avec la plus déconcertante facilité.
Non seulement il obtenait d’eux des renseignements qui « valaient leur pesant d’or », mais aussi, il leur suggérait des « idées » qui, dès leur mise en application, avortaient – et pour cause – lamentablement.
Vraiment, nous jouions sur le velours...
Or, un jour, tandis qu’il « travaillait » avec Hans Fuchs, on introduisit auprès de ce dernier le général von Hoeppner, commandant général des forces aériennes allemandes, et son chef d’état-major, le lieutenant-colonel Thomson.
Ces deux hommes paraissaient en proie à la plus vive agitation...
Ainsi qu’il le faisait toujours en pareille occurrence, Harald Haraldsen, – on sait qu’il était la discrétion même, – se leva et passa dans une pièce voisine... d’où, grâce à un dispositif de son invention, il entendait
 |
LE GÉNÉRAL DE DIVISION HOEPPNER
général commandant des Forces aériennes.
distinctement tout ce qui se disait dans le cabinet de travail de Hans Fuchs...
Après les salutations d’usage, ce dernier s’enquit auprès du général du but de sa visite.
– Avant de vous apprendre ce qui m’amène auprès de vous, répondit von Hoeppner, je tiens à bien spécifier que ce que je vais vous dire restera strictement entre nous.
– C’est une affaire entendue, Excellence, répondit Hans Fuchs ; mais que se passe-t-il donc ?
Le général eut une seconde d’hésitation, puis déclara :
– Il se passe, cher ami, que, à moins d’un miracle, nous sommes à la veille d’une nouvelle catastrophe.
– Je ne crois pas beaucoup aux miracles, fit Hans Fuchs froidement ; quant aux catastrophes, on commence à s’y habituer. De quel genre est celle que vous prévoyez ?
– C’est bien simple, répondit von Hoeppner ; si d’ici un mois nous n’avons pas trouvé le moyen d’obtenir d’une manière ou d’une autre le lubrifiant qui nous est nécessaire, il nous sera matériellement impossible de « tenir le coup ».
– Diable ! s’exclama Hans Fuchs ; en serions-nous vraiment là ?
– Hélas ! reprit le général qui, angoissé, ajouta :
– Non seulement nos transports automobiles ne pourraient plus fonctionner ; mais notre aviation elle-même serait immobilisée, ce qui, vous le concevez, équivaudrait, en l’état actuel des choses, à un véritable désastre !
– Ce serait, en effet, un désastre, fit Hans Fuchs ; mais..., je ne vois pas bien en quoi ceci me concerne. Somme toute, je ne « tiens pas cet article ».
– Oui, mais moi, répondit le général, je connais quelqu’un qui le tient, cet article. Malheureusement, ce quelqu’un refuse formellement – PARCE QUE GERMANOPHOBE – de traiter avec nous, et cela, à quelque prix que ce soit.
– Quel est cet olibrius ?
– C’est un nommé Johan Hansen, un Danois. Il habite à Rotterdam, où se trouvent également les lubrifiants dont il dispose.
– De qui tenez-vous ce renseignement ?
– Je le tiens d’un de mes officiers, répondit le général.
– Savez-vous également de quelle quantité de lubrifiant dispose Johan Hansen ? demanda Hans Fuchs.
– Douze mille tonnes environ.
– Herr Gott ! Cela nous sauverait. Et il refuse de nous les vendre ?
– Formellement, vous dis-je.
– Sous quel prétexte ?
– Il prétend avoir déjà traité avec l’Amirauté britannique pour l’ensemble du stock.
– Oh ! Oh ! s’exclama Hans Fuchs, qui reprit aussitôt :
– Ce qui fait que non seulement ce lubrifiant nous échapperait, mais que, par surcroît, il passerait en Angleterre ! Teuffel ! Il faut empêcher cela !
– Je suis venu précisément vous demander de m’en fournir le moyen, répondit le général.
Hans Fuchs s’isola en lui-même...
– Je crois que j’ai trouvé, fit-il, après avoir longuement réfléchi...
Et, s’adressant au général, il ajouta :
– Voici ce que nous allons faire. J’ai sous la main un agent d’une intelligence et d’une souplesse remarquables. C’est un Danois précisément. Nous allons lui demander d’intervenir auprès de son compatriote...
– De quelle manière ? interrompit von Hoeppner, anxieux.
– Mais, en qualité d’agent de l’Amirauté britannique, répondit avec un gros rire, Hans Fuchs.
– Vous croyez qu’il réussira ?
– Pourquoi ne réussirait-il pas ? Au fond, il ne s’agit que d’une question d’argent. Or, de l’argent nous en avons.
– Évidemment ! Mais, c’est un habile homme que ce Johan Hansen, et je ne sais...
– Je vous dis, moi, que l’affaire est dans le sac ! interrompit brutalement Hans Fuchs. Et je veux que le diable m’emporte si, dans quinze jours au maximum, le stock de Johan Hansen n’est pas en notre possession...
L’affaire était dans le sac, en effet.
Mais, malheureusement pour Hans Fuchs et ses commettants, au fond du sac, il y avait un trou...
Et un trou dans lequel, ainsi qu’on va le voir, s’enlisa bel et bien l’armée allemande...
Où James Nobody contribue modestement
à la victoire de nos armes.
Dès que le général von Hoeppner et son adjoint le lieutenant-colonel Thomson eurent tourné les talons, Hans Fuchs ayant invité Harald Haraldsen à reprendre sa place habituelle, lui déclara tout de go :
– J’ai une mission très importante à vous confier. J’ajoute que, si vous la menez à bien, vous rendrez à l’Allemagne – qui, croyez-le bien, s’aura s’en souvenir – un service capital.
– De quoi s’agit-il ? répondit avec calme Harald Haraldsen, qui savait déjà à quoi s’en tenir...
– Vous allez immédiatement partir pour Londres, reprit Hans Fuchs, et vous essaierez de savoir s’il est exact qu’un sieur Johan Hansen, de nationalité danoise, résidant à Rotterdam, est en relation d’affaires avec l’Amirauté britannique, à laquelle il fournirait des huiles de graissage, importées par lui.
– Bien, et après ?
– Si la nouvelle est exacte, poursuivit Hans Fuchs, vous vous procurerez tous les renseignements relatifs à cette affaire, notamment ceux ayant trait au mode de livraison de ces lubrifiants.
– Voulez-vous avoir l’obligeance de préciser, fit Harald Haraldsen.
– Le stock se trouvant en Hollande et la livraison devant s’effectuer en Angleterre, cette livraison ne peut s’effectuer que par mer. Ce que je désire savoir, c’est si le lubrifiant est transporté par des cargos ordinaires ou par bateaux-citernes ; si ces bateaux partent isolément ou en convois, et s’ils sont escortés.
– Bien, j’ai compris.
– Si ces navires sont escortés, reprit Hans Fuchs, et qu’il faille livrer bataille pour s’en emparer, il est clair que nos chances de succès diminuent d’autant. Par contre, s’ils naviguent isolément, rien ne sera plus facile à un sous-marin que de les arrêter et de les « dérouter » sur Kiel ou sur Wilhelmshaffen.
– Vous semblez omettre une troisième hypothèse, fit Harald Haraldsen.
– Laquelle ?
– Johan Hansen est un importateur et non un fabricant, m’avez-vous dit. Pourquoi, cela étant, aurait-il constitué un stock à Rotterdam, alors qu’il lui serait si facile de faire diriger sur Londres, par les pays d’origine, ses stocks de lubrifiants ?
– Mais ces stocks existent. Ils sont à Rotterdam, s’écria Hans Fuchs.
– Alors pourquoi ne pas entrer directement en relations avec Johan Hansen ?
– Parce qu’il ne veut à aucun prix les céder à l’Allemagne.
– On lui a donc déjà fait des offres ?
– Parbleu ! répondit Hans Fuchs ; c’est même le refus qu’il nous a opposé, qui nous oblige à nous emparer de ces stocks.
Harald Haraldsen fit semblant de se plonger dans de profondes réflexions, puis, soudain, il tendit l’amorce.
– Et si, au lieu de s’emparer de ces lubrifiants par la force, on les obtenait pas la ruse ? fit-il.
– En voyez-vous le moyen ? répondit Hans Fuchs, vivement intéressé.
– Le moyen est tout trouvé, fit Harald Haraldsen, encore qu’il nécessite une certaine mise au point, je le crois préférable à celui que vous préconisez.
– Quel est-il ?
– Ne pourrait-on trouver quelqu’un, par exemple, qui, muni des papiers et des moyens d’action adéquats, se
 |
LE LIEUTENANT-COLONEL THOMSON
chef d’état-major du commandement général
des Forces aériennes allemandes.
présenterait à Johan Hansen, pour prendre livraison, au nom de l’Amirauté, des stocks qui lui sont destinés ?
– Herr Gott ! sakrament ! s’écria Hans Fuchs, tout hilare ; voilà une idée splendide, une idée « kolossale » !
– Et de plus, facile à réaliser, reprit Harald Haraldsen ; somme toute, que faut-il ? Des papiers, des bateaux et de l’argent.
– Vous oubliez quelque chose ; ou plutôt, vous oubliez quelqu’un, répondit en souriant l’espion du Kaiser.
– J’oublie quelqu’un ?
– Mais oui ; vous oubliez de me dire le nom de l’homme qui réalisera ce tour de force.
– Pardon ! Ceci est affaire à vous.
Hans Fuchs pouffa...
– Mais non, cher ami, s’écria-t-il, quand il eut fini de rire ; mais non ; ceci est affaire à vous et non à moi ; car c’est vous qui, en vertu de l’axiome : ON N’EXÉCUTE BIEN QUE CE QU’ON CONÇOIT BIEN – allez réaliser votre idée.
– Moi ! C’est moi que vous voulez charger de cette affaire ? s’exclama Harald Haraldsen, jouant la surprise.
– N’êtes-vous pas tout qualifié pour la mener à bien ? répondit Hans Fuchs.
– Certes, mais...
– De même que Johan Hansen, vous êtes Danois. Vous avez vécu en Angleterre, et dans les milieux maritimes encore. Vous parlez admirablement anglais. Vous avez donc tous les atouts en main.
Harald Haraldsen l’avait écouté avec attention. Voyant que Hans Fuchs en était arrivé au point où il avait voulu l’amener, il répondit, après avoir feint de réfléchir quelques secondes :
– Soit, j’accepte, mais à une condition.
– Laquelle ? répondit Hans Fuchs, en fronçant les sourcils...
– Je veux qu’on me laisse agir à ma guise. Dans ce cas – MAIS DANS CE CAS SEULEMENT – je réponds du succès.
– Affaire conclue, s’écria Hans Fuchs, en lui tendant la main ; quand comptez-vous partir ?
– Je vous le dirai ce soir, répondit Harald Haraldsen ; d’ici là, veuillez faire préparer les papiers qui me seront nécessaires.
– Soyez tranquille à cet égard, affirma Hans Fuchs, tout sera prêt en temps voulu..., les papiers, l’argent et les navires...
Dix minutes plus tard, Harald Haraldsen nous faisait part de cet extraordinaire incident.
Quand il eut terminé son exposé :
– Que comptez-vous faire ? lui demandai-je.
– Mais, fit-il, je ne crois pas qu’il y ait deux manières d’envisager la chose. Si, vraiment, les Boches ne possèdent plus de lubrifiant, ils seront forcés de mettre bas les armes. Donc, il ne faut pas qu’ils puissent s’emparer de celui qu’ils convoitent.
– Et s’ils s’en procuraient ailleurs ? insistai-je ; vous pensez bien que Johan Hansen ne doit pas être le seul et unique détenteur de ce précieux produit.
– Diable ! En effet, je n’avais pas pensé à cela !
Un silence, lourd d’angoisse, s’établit...
– Je ne vois qu’un moyen d’empêcher les Allemands de chercher ailleurs ce qui leur manque, fis-je, après avoir examiné le problème sous toutes ses faces.
– Et, quel est ce moyen ? demanda le comte de Nys, en se tournant vers moi.
– C’est de livrer aux Boches les stocks que détient Johan Hansen, répondis-je.
– Vous plaisantez, sans doute ? s’écria le vieux gentilhomme.
– Je vous assure que jamais je n’ai été aussi sérieux, lui dis-je.
– Alors, je ne comprends pas, car, agir de la sorte, c’est donner à nos ennemis des armes pour nous vaincre.
J’eus un sourire ; après quoi, au comte de Nys et à Harald Haraldsen stupéfaits, j’exposai le plan que je venais de concevoir...
Quinze jours plus tard, abondamment ravitaillée en lubrifiants, l’armée allemande passait à l’offensive.
Jetant ses troupes à l’assaut du Chemin des Dames, Ludendorff, franchissait l’Aisne, prenait Soissons et atteignait la Marne.
Décidé à percer coûte que coûte, il engageait le 15 juillet la bataille de Champagne, au cours de laquelle Gouraud arrêta net et massacra les troupes allemandes.
Bousculé par Foch, Mangin et Degoutte, l’ennemi repasse la Marne, abandonne Château-Thierry, puis, reculant sous la poussée convergente des armées françaises, il évacue Soissons et franchit, à rebours, la Vesle.
Le 28 août, Noyon, Ham, Chauny, Péronne et Bapaume sont repris.
La mort dans l’âme, Ludendorff retraite sur la ligne Hindenburg, abandonnant entre nos mains 130.000 prisonniers, 2.000 pièces de canon, 14.000 mitrailleuses, 12.000 camions-autos et la plupart de ses parcs d’aviation.
Que s’était-il donc passé ?
Et à quoi devait-on attribuer cette série ininterrompue de victoires foudroyantes ?
À la science de nos états-majors et à l’héroïsme des troupes alliées, certes.
Mais aussi à l’excellent lubrifiant que nous avions livré à l’ennemi ; lubrifiant auquel nous avions mélangé, au préalable, une certaine quantité de mélasse... CE QUI EUT POUR PREMIER RÉSULTAT D’IMMOBILISER SES TRANSPORTS AUTOMOBILES ET SON AVIATION.
Guillaume II faillit en faire une maladie.
Il n’était pas au bout de ses peines...
Où James Nobody fait une rencontre
inattendue et ce qui s’ensuit.
Comme bien on pense, l’affaire des lubrifiants fit un bruit énorme au Grand Quartier Général.
Ludendorff exigea une enquête et des sanctions.
Harald Haraldsen s’étant bien gardé de reparaître à Charleville, on en conclut à sa culpabilité ; mais comme il était en sûreté à Londres, aucune sanction ne put lui être appliquée.
Supposant avec juste raison que la police allemande ne manquerait pas de perquisitionner chez Harald Haraldsen, le comte de Nys et moi détruisîmes tout ce qu’avait de compromettant la correspondance oubliée par notre ami ; puis après avoir démonté l’appareil de T. S. F., nous nous mîmes en lieu sûr.
Nous n’allâmes pas loin d’ailleurs...
Le comte de Nys, qui avait des intelligences dans la place, réussit à entrer en qualité de rédacteur auxiliaire à la préfecture des Ardennes, où s’était installé « l’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES EN CAMPAGNE » et, de son bureau – qui se trouvait situé sur la face sud de l’immense édifice, – il avait une vue superbe sur la place d’armes... et sur ce qui s’y faisait.
De goûts plus modestes, je m’étais placé en qualité de garçon au café Henrion, près de l’Hôtel de ville ; ce café dont la grande salle avait été transformée en café-concert, était le rendez-vous préféré des officiers attachés aux différents états-majors stationnés à « Charleville ».
Tous les soirs, notre service terminé, le comte de Nys et moi, nous nous rencontrions en un endroit isolé, sur la route de Revin, laquelle, comme on le sait, longe la Meuse et, après nous être fait part mutuellement des renseignements que nous avions pu nous procurer dans le courant de la journée, nous les transmettions... à qui de droit.
Toutefois, Hans Fuchs n’avait pas été sans s’apercevoir que, à Charleville même, des « fuites » se produisaient.
Par des « recoupements » extrêmement habiles, il tenta de savoir d’où elles provenaient.
Ses agents – il est à peine besoin d’indiquer qu’ils pullulaient – étaient déchaînés, et nous eûmes les plus grandes peines du monde à nous soustraire à leurs investigations.
Il fallait « tenir » cependant.
ET CELA, PLUS QUE JAMAIS.
En effet, pour les Boches, l’heure était venue des résolutions désespérées.
Les nouvelles qui leur parvenaient du front de combat étaient des plus alarmantes, l’armée battant en retraite sur toute la ligne.
Dans la zone des étapes, des actes d’insubordination, – brutalement réprimés, il est vrai, – s’étaient produits et, de toutes parts, on signalait le fâcheux état d’esprit des permissionnaires rentrant d’Allemagne.
De toute évidence, le blocus produisait ses effets...
Les choses en étaient là quand, un beau jour, alors que je traversais la place ducale pour aller prendre mon service au Café Henrion, je me trouvai nez à nez avec Naldony.
Je ne pus dissimuler ma surprise.
– Vous ici ? m’écriai-je, c’est de la folie. Vous allez vous faire prendre !
Il eut un sourire narquois.
– N’ayez aucune crainte à cet égard, répondit-il, en me serrant la main ; je suis plus en faveur que jamais.
– Pas possible ! m’exclamai-je, stupéfait.
– C’est tellement possible, fit-il en riant, que je suis accrédité auprès du G. Q. G. allemand, en qualité d’attaché militaire de l’Union des Républiques Socialistes de Russie.
– Voilà qui va faire plaisir à Hans Fuchs, fis-je, en riant à mon tour.
– Hans Fuchs ! Je le quitte à l’instant, me répondit Naldony ; il a été parfait à mon égard.
– Diable ! Méfiez-vous alors ; car cet être-là n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il vous fait bonne mine.
– Il n’oserait pas, fit Naldony ; il sait, d’ailleurs, que, désormais, IL NE PEUT PLUS SE PASSER DE MOI.
Après avoir jeté un coup d’œil circonspect autour de lui, il ajouta :
– Ainsi que vous le voyez, j’ai des choses fort importantes à vous apprendre. Je pense, toutefois, que nous serions mieux ailleurs que sur cette place, pour « causer ». Où habitez-vous ?
– À deux pas d’ici, rue Waroquier.
– Parfait. Quand pourrais-je vous voir ? Vous pensez bien, en effet, que si je suis venu à Charleville, c’est uniquement pour m’entretenir avec vous.
– Vous saviez donc que j’étais ici ?
– Mais oui ; et en voici la preuve...
Ce disant, il me tendit une lettre :
– Voici un pli, précisa-t-il, que m’a chargé de vous remettre sir Arthur Birdwell.
Je regardai la suscription ; elle était bien de l’écriture de mon chef...
Comme il m’était impossible de prendre connaissance de cette lettre en public, la place et les arcades qui l’entourent commençant à se peupler, je la fourrai dans ma poche et, me tournant vers Naldony, je lui demandai :
– Connaissez-vous le café du Barrage ?
– Non, mais je m’informerai.
– Mieux vaut que je vous indique où il se trouve, fis-je ; ce sera plus prudent.
Après lui avoir donné les indications utiles, je repris :
– Je vous attendrai au « Barrage », ce soir, vers onze heures. C’est le seul endroit où, à cette heure, nous puissions nous rencontrer sans être importunés par la police.
 |
LE KAISER ET L’IMPÉRATRICE, TRÈS ABATTUS,
S’ENTRETENANT AVEC HINDENBURG AU G. Q. G. ALLEMAND.
– Pourquoi ne pas nous y rendre immédiatement, objecta Naldony ; ce que j’ai à vous communiquer est d’importance capitale, ne souffre aucun retard, et nécessite des décisions immédiates.
Voyant que j’hésitais, il insista...
– Je regrette beaucoup, fit-il, que vous n’ayez pas pris connaissance immédiatement de la lettre que je viens de vous remettre ; vous comprendriez mieux combien il importe que nous prenions de concert les mesures qui s’imposent.
Je le regardai...
– Est-ce donc si grave que cela ? lui demandai-je.
Il hésita l’espace d’une seconde puis, posant sa main sur mon épaule, martelant ses mots, l’air grave, il me déclara :
– De la décision que nous allons prendre, dépend non pas l’issue de la guerre – L’AFFAIRE EST DÉSORMAIS RÉGLÉE – mais sa durée.
– Vous dites ? m’écriai-je, n’en pouvant croire mes oreilles.
Rivant ses yeux sur les miens, Naldony me fit la stupéfiante déclaration que voici :
– Vous connaissez mon passé, passé de misère, de luttes et de souffrances. Vous savez donc que je suis un homme dans toute l’acception du terme ; UN HOMME QUI SAIT CE QUE PARLER VEUT DIRE. Eh ! bien ; je vous donne ma parole d’honneur, ma parole de militant, que j’ai la possibilité, NON SEULEMENT DE METTRE UN TERME AUX HOSTILITÉS, MAIS AUSSI, ET SURTOUT DE JETER BAS L’ABOMINABLE DYNASTIE DES HOHENZOLLERN.
– Vous feriez cela, vous ? m’exclamai-je.
Jamais, – vivrai-je cent ans, – je n’oublierai le coup d’œil que me lança alors Naldony...
– Voulez-vous me rendre un service, fit-il.
Et comme je l’interrogeai du regard...
– Lisez, insista-t-il, la lettre que je viens de vous remettre.
Il n’y avait plus à hésiter...
Je pris dans ma poche la lettre, je la décachetai et je lus :
« En réponse à l’offensive déclenchée par l’Allemagne contre le moral des troupes alliées, prenez toutes dispositions utiles pour fomenter la révolution en Allemagne. »
Où James Nobody devient
le tovaritch Boris Tchourisky.
Le mandat était impératif...
Il n’y avait donc qu’à s’incliner et à obéir, sir Arthur Birdwell, qui possédait des moyens d’information autrement puissants que ceux que je possédais moi-même, n’étant pas homme à donner un ordre de cette importance sans s’être assuré au préalable qu’il était réalisable.
Me tournant vers Naldony, je lui demandai :
– Vous avez certainement d’autres instructions, – verbales celles-là – à me transmettre. Quelles sont-elles ?
– Elles se peuvent résumer ainsi : Agir vite et bien.
– J’entends, mais encore ?
– Étant donnée la crise qui sévit actuellement en Allemagne, et qui dresse toutes les classes de la population contre le gouvernement, sir Arthur Birdwell pense que l’affaire peut et doit être liquidée rapidement. À son avis, elle comporte deux stades : préparation, exécution.
– Naturellement, répondis-je ; mais vous a-t-il indiqué les concours sur lesquels il croyait pouvoir compter le cas échéant ou, à défaut de ces concours, a-t-il prévu des moyens d’exécution et établi un plan d’action ?
– Il m’a simplement déclaré qu’il comptait entièrement sur vous pour mener cette affaire à bien, et il m’a demandé de me mettre à votre disposition.
Tout en discourant de la sorte, nous étions arrivés au pied de la statue du duc Charles de Gonzague, situé au centre de la place ducale.
Je consultai ma montre et je constatai que l’heure à laquelle je prenais habituellement mon service était passée depuis longtemps.
J’appelai un gamin et, après lui avoir donné un billet de vingt sous, je l’envoyai prévenir le gérant du café Henrion que, pris d’une indisposition subite, je me voyais, à mon grand regret, obligé de rendre mon tablier...
Après quoi, m’adressant à Naldony, je lui dis :
– Ainsi que vous le voyez, je viens de me rendre libre. Nous allons donc pouvoir nous mettre au travail immédiatement. Mais, comme il serait souverainement imprudent de poursuivre cette conversation ici même, nous allons nous séparer.
– Bien, où nous retrouverons-nous ?
– Dans une heure, au café du « Barrage », si vous le voulez bien.
– Qu’allez-vous faire d’ici là ?
– Je vais rentrer chez moi, répondis-je, pour changer de costume, et pour réfléchir à l’ordre que vous venez de me transmettre.
Prenant alors dans sa poche un portefeuille qu’il me tendit, Naldony me dit en souriant :
– La fonction créant l’homme, j’ai pensé que, à fonction nouvelle devait correspondre un homme nouveau. Le portefeuille que voici appartenait à Tchourisky, l’un des attachés de Joffe, qui représente, en qualité d’ambassadeur et de ministre plénipotentiaire, les Soviets à Berlin. Malheureusement pour lui, Tchourisky est mort en cours de route et j’ai pensé que vous le remplaceriez admirablement. C’est pourquoi, à toutes fins utiles, j’ai apporté ce portefeuille.
En un clin d’œil, je vis tout le parti que je pouvais tirer de l’incident.
Ayant longtemps vécu en Russie avant la guerre 15, je parlais correctement et sans le moindre accent la langue russe. De plus, ayant étudié à fond les mœurs et les coutumes de ce peuple si complexe, je pouvais me faire passer, sans la moindre difficulté, pour un Russe d’origine...
Pour peu que le signalement de Tchourisky correspondît au mien, et que je pusse « me faire sa tête », tout irait pour le mieux.
Je jetai un coup d’œil sur son passeport diplomatique et je me rendis compte aussitôt que rien ne me serait plus facile que de me substituer à lui.
Nous avions, à un pouce près, la même taille et la même corpulence. Seul, le système pileux différait car, de même que la plupart des révolutionnaires russes de l’époque, Tchourisky était velu comme un ours.
C’était là une difficulté facile à résoudre...
Naldony fut le premier à pouvoir s’en assurer car, moins d’une heure plus tard, quand il arriva au « Barrage », il passa devant la table sur laquelle je m’étais accoudé sans me reconnaître.
Me levant, j’allai vers lui la main tendue et, en russe, je lui dis :
– Salut et fraternité, camarade !
C’est à la voix qu’il me reconnut...
– Mes compliments, fit-il, stupéfait ; vous êtes absolument méconnaissable et j’avoue que je m’y suis laissé prendre. Hans Fuchs lui-même y perdrait le peu de latin qu’il possède.
Il n’avait pas achevé sa phrase que, d’une luxueuse automobile timbrée aux armes de la Cour, nous vîmes descendre l’espion du Kaiser.
Le calme dont il faisait preuve habituellement semblait l’avoir abandonné...
Me regardant en souriant, Naldony me dit à mi-voix :
– Le cher homme a dû tomber sur quelque nouveau « bec de gaz ». Il a l’air plutôt « empoisonné » !
– En effet, répondis-je, vaguement inquiet ; qu’a-t-il bien pu se passer ?
Nous ne devions pas tarder à l’apprendre.
 |
Sur cette curieuse photographie, se trouvent groupés les premiers – en date – diplomates
qu’utilisa l’U. R. S. S. On aperçoit, en effet, Rakowsky (1), Delgoff (2), Ioffe (3), Trottenberg (4),
Kakowsky (5), Roudzoutack (6) et Bergzanda (7), qui, tous, firent partie de la délégation soviétique
à la Conférence de Gênes.
Ayant ouvert d’un geste brusque la porte de la salle dans laquelle nous nous trouvions, Hans Fuchs, dès qu’il nous aperçut, se dirigea vers nous, puis, s’adressant à Naldony, il lui dit, après m’avoir longuement toisé :
– C’est vous que je cherchais, cher ami ; j’ai à vous causer très sérieusement.
Puis, me désignant du doigt :
– Quel est ce monsieur ? demanda-t-il, d’un air moitié figue moitié raisin...
Cérémonieusement, Naldony déclina mes noms et qualités...
– Permettez-moi de vous présenter, fit-il, mon collègue et ami, le citoyen Boris Tchourisky, attaché d’ambassade de première classe, et faisant partie, à ce titre, de la délégation soviétique à Berlin.
Rassuré, Hans Fuchs me tendit la main.
– Enchanté de faire votre connaissance, déclara-t-il très courtoisement.
– Veuillez croire, lui répondis-je, que tout le plaisir est pour moi.
– Vous savez donc qui je suis ? fit-il, vivement.
– Moi ? Pas le moins du monde ! Mais comme vous êtes un ami de Naldony, je ne puis qu’être enchanté de vous connaître.
– C’est juste, fit-il.
Et alors, il se présenta...
Cette cérémonie accomplie, il en revint à Naldony :
– Vous ne direz pas que ma police est mal faite, lui dit-il en souriant. Voyez plutôt : en moins de cinq minutes, j’ai su où vous prendre.
– J’espère bien, sourit à son tour Naldony, que vous n’êtes pas venu ici pour me « prendre » ; mais bien pour prendre quelque chose en notre compagnie.
Le jeu de mot plut à Hans Fuchs qui, mis en confiance, reprit :
– Si je ne m’abuse, vous êtes au mieux avec Liebknecht ?
– Je le connais, en effet, de longue date, répondit prudemment Naldony.
– Vous connaissez également cette vieille folle de Rosa Luxembourg ?
– Je la connais également, mais moins bien.
– Et Clara Zetkin ?
– J’ai beaucoup entendu parler d’elle, fit évasivement Naldony ; mais je ne l’ai jamais rencontrée.
– N’importe ; vous chargeriez-vous d’une commission pour eux ?
Naldony se tourna vers Hans Fuchs et, le regardant droit dans les yeux, demanda :
– De quelle nature, cette commission ?
L’espion du Kaiser parut embarrassé...
– Nous voudrions, fit-il enfin, leur faire savoir que leur activité révolutionnaire devient quelque peu gênante et que, dans leur propre intérêt, il vaudrait mieux qu’ils y missent un terme.
Le ton s’était haussé, et même était devenu agressif...
Du tac au tac, Naldony riposta :
– Je ne puis me charger d’une commission pareille ; à quel titre, d’ailleurs, interviendrai-je ?
– Mais en votre qualité de délégué du gouvernement des Soviets, déclara Hans Fuchs.
– Voulez-vous m’expliquer, répondit Naldony, ce que peut bien avoir de commun le gouvernement des soviets – dont je suis l’un des fonctionnaires, mais que je ne représente pas, cette mission étant dévolue à Joffe – avec les personnes dont vous venez de citer les noms ?
Les yeux de Hans Fuchs fulgurèrent, et son attitude devint franchement menaçante...
Puis, se penchant par-dessus la table vers Naldony :
– Ils ont ceci de commun, gronda-t-il, que Liebknecht, Rosa Luxembourg et Clara Zetkin ont reçu mission du Gouvernement des Soviets de déclencher la révolution en Allemagne.
Naldony – dont je ne pus m’empêcher d’admirer le « cran » – partit d’un éclat de rire...
Puis, quand il eut repris son sérieux :
– Je doute qu’il en soit ainsi, déclara-t-il, mais en admettant même que cela soit vrai, je refuse formellement de me mêler de cette affaire.
– Pourquoi cela ? demanda Hans Fuchs furieux.
– Mais, tout simplement, parce que vous êtes parfaitement capable de la mener à bien, répondit Naldony.
– Que voulez-vous dire ?
Lors, le toisant, Naldony de déclarer :
– Lénine n’est-il pas votre homme ? Ne tient-il pas de vous le pouvoir qu’il exerce en Russie ? La révolution russe n’a-t-elle pas été financée par vous ?
– Et quand cela serait ? haleta Hans Fuchs.
– Eh ! bien, répondit paisiblement Naldony, puisque cela est, pourquoi ne demandez-vous pas à Lénine lui-même de se tenir tranquille. Quand on paye les gens, on doit pouvoir se faire obéir d’eux, que diable !
– C’est votre dernier mot ? gronda Hans Fuchs.
– Mais oui, répondit Naldony.
– Prenez garde !
– À quoi voulez-vous que je prenne garde, cher ami, fit Naldony en le narguant ; ne suis-je pas couvert par l’immunité diplomatique ?
Puis, haussant les épaules :
– Au surplus, ajouta-t-il, il y a belle lurette que Polichinelle ne me fait plus peur !
– Polichinelle ! hurla Hans Fuchs ; vous osez me traiter de polichinelle !
Et Naldony de répondre :
– Mais oui, cher ami. Et, entre nous, c’est grand honneur vous faire...
Où James Nobody se rend compte
de la justesse de cet axiome :
Tel est pris qui croyait prendre.
Je savais certes que Naldony avait de solides raisons d’en vouloir à Hans Fuchs, ce dernier ayant tenté de le faire assassiner ; mais j’étais loin de me douter que la haine qu’il ressentait pour l’espion du Kaiser se manifesterait sous cette forme.
Tout en me gardant bien de critiquer l’attitude qu’il avait cru devoir adopter au cours de cette entrevue qui ressembla plutôt à une passe d’armes qu’à une discussion courtoise, je ne pus m’empêcher de demander à Naldony à quel mobile il avait obéi en agissant ainsi.
– Pure affaire de psychologie, me répondit-il en souriant ; connaissant mon homme, j’ai manœuvré en conséquence. Que risquons-nous, au surplus ?
– Mais, s’il nous faisait expulser...
– Il s’en gardera bien, répondit Naldony ; d’abord, – et sa démarche le prouve, – parce qu’il a besoin de nous ; ensuite parce que se basant sur mon attitude, il me croit bien plus fort – politiquement parlant – que je ne le suis en réalité. Or, les Allemands, vous le savez, ne s’inclinent que devant la force.
– Et comment va-t-il réagir, selon vous ? demandai-je ; la situation me paraît...
– La situation ? interrompit Naldony, elle sera ce que vous voudrons qu’elle soit. Vous l’allez bien voir, d’ailleurs.
Il s’absorba quelques secondes en lui-même, puis il reprit :
– Quel est notre but ? Fomenter à notre profit la révolution en Allemagne, n’est-il pas vrai ?
– Certes.
– Comment procéder dès lors ? Je ne vois qu’un moyen : entrer en contact avec les chefs de la Social-démocratie ; non pas – ainsi que m’invitait, tout à l’heure, à le faire Hans Fuchs – pour leur conseiller de mettre de l’eau dans leur vin ; mais bien, au contraire, pour répandre de l’huile sur le feu. N’est-ce point là votre avis ?
– Tout à fait, répondis-je, vivement intéressé par l’argumentation de Naldony.
– Or, que se serait-il produit, reprit-il, si j’avais cédé ? Ceci : AUX YEUX DES RÉVOLUTIONNAIRES ALLEMANDS, J’AURAIS ÉTÉ DISQUALIFIÉ, ET AUX YEUX DES DIRIGEANTS SOVIÉTIQUES, J’AURAIS FAIT FIGURE DE TRAÎTRE.
– C’est l’évidence même, m’exclamai-je ; mais alors, comment comptez-vous tourner la difficulté, car vous pensez bien que jamais Hans Fuchs ne restera sur un échec pareil.
– Aussi allons-nous lui fournir le moyen de le réparer, me répondit Naldony.
– Comment cela ? demandai-je surpris.
Naldony eut un nouveau sourire...
– Mais, fit-il, en employant tout simplement le système des compensations. Ce que, moi, j’ai refusé de faire, POURQUOI NE LE FERIEZ-VOUS PAS ?
Je le regardai, ébahi...
– C’est énorme ce que vous me proposez là, m’écriai-je.
– Évidemment, concéda-t-il ; mais c’est précisément parce que c’est énorme que cela doit réussir. Hans Fuchs, vous le savez, est atteint de déformation professionnelle. Chez lui, « l’espionnite », – passez-moi ce terme, – existe à l’état endémique. Cela étant, soyez assuré que si vous faites mine de me trahir, il vous accueillera à bras ouverts.
La logique de ce raisonnement me frappa...
À bien l’examiner, – les risques mis à part, – l’affaire ne comportait que des avantages.
Tout d’abord, elle me permettrait d’entrer en relations directes et continues avec Hans Fuchs, c’est-à-dire avec celui-là même que j’avais pour mission de CAPTURER MORT OU VIF.
Je pourrais, d’autre part, grâce à l’immunité dont me ferait bénéficier l’espion du Kaiser, circuler à mon aise sur le territoire allemand et y travailler en toute sécurité à l’œuvre de désagrégation qu’on venait de me charger d’entreprendre.
On ne pourrait même pas m’imputer à charge mes relations avec les révolutionnaires, puisque c’est par ordre de Hans Fuchs, que j’agirais ainsi.
Donc, tout bien pesé, l’affaire valait d’être tentée, et cela, quels que fussent les risques à courir.
Quand il eut reçu mon acceptation, Naldony ne put dissimuler sa joie.
– Je crois que cette fois, s’écria-t-il, nous le tenons.
Nous convînmes aussitôt de nos faits et gestes, puis nous nous quittâmes, après avoir pris rendez-vous pour le soir.
Ne sachant pas exactement comment tournerait l’entrevue que j’allais avoir avec Hans Fuchs, je me rendis chez le comte de Nys, pour le mettre au courant des incidents qui s’étaient succédé depuis le matin et l’informer de la décision que je venais de prendre.
Tout d’abord, il ne me reconnut pas et, me prenant pour un espion boche, il faillit me faire un mauvais parti.
Dès qu’il fut rassuré à cet égard, il me toisa des pieds à la tête, puis il se mit à rire à gorge déployée.
– Bone Deus ! s’écria-t-il quand il se fut calmé ; que vous arrive-t-il donc, et à quoi rime cette dégaine ?
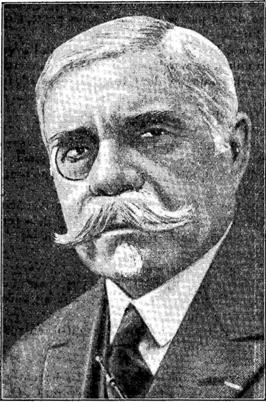
LE COMTE DE NYS.
– Tel que vous me voyez, lui répondis-je, en riant également ; je représente le gouvernement des Soviets, en qualité d’attaché militaire.
– Non ? C’est une plaisanterie...
– Je ne plaisante nullement, fis-je ; la preuve en est que de ce pas je me rends chez notre vieil ami Hans Fuchs.
Du coup, le vieux gentilhomme, – je l’avais surpris au milieu de son déjeuner – lâcha l’assiette qu’il tenait à la main, et dont le contenu se répandit à terre.
– Vous dites ? s’exclama-t-il, ahuri...
– Je dis l’exacte vérité.
Et, en quelques mots je lui fis part des évènements relatés ci-dessus ; évènements dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils modifiaient du tout au tout notre situation.
Le comte de Nys m’écouta attentivement, me fit préciser certains détails, puis quand j’eus terminé, il prit son chapeau et simplement me dit :
– Je vous accompagne !
Je le regardai, abasourdi...
– Vous n’allez tout de même pas venir avec moi chez Hans Fuchs, m’exclamai-je ; ce serait vous jeter dans la gueule du loup...
– Tranquillisez-vous, me répondit-il, en souriant ; telle n’est pas mon intention.
– Alors ?
– Alors, je vous attendrai paisiblement en faisant les cent pas, en face de la porte du G. Q. G. et, si dans une heure, montre en main, vous ne reparaissiez pas...
– Eh ! bien ; que feriez-vous ?
– Ce que je ferais ? s’écria-t-il, j’irais vous réclamer, parbleu !
Il n’y eut pas moyen de l’en faire démordre.
J’eus beau lui représenter que l’affaire était engagée de telle sorte qu’elle ne comportait aucun risque grave et que, en tout état de cause, j’avais bec et ongles pour me défendre ; je ne pus modifier sa décision.
Je partis donc pour le Grand Quartier Général, suivi à cent pas de distance par le comte de Nys.
Hardiment, je me présentai au chef de poste, –un capitaine de la gendarmerie de campagne – et je lui demandai de me faire conduire au bureau de Hans Fuchs.
– Avez-vous une lettre d’audience ? me répondit-il.
– Ma foi, non, fis-je.
– Dans ce cas, je ne puis vous introduire auprès de Son Excellence.
– Mais...
– Inutile d’insister ; la consigne est formelle, vous ne passerez pas !
Je réfléchis une seconde...
– Accepteriez-vous, du moins, de faire remettre une lettre à M. Hans Fuchs, demandai-je, vivement contrarié par ce contretemps...
– Cela, bien volontiers, me répondit l’officier qui, après m’avoir fait signe de le suivre, m’installa devant une table sur laquelle se trouvait tout ce qu’il fallait pour écrire.
Je rédigeai alors la note que voici :
« Le camarade Tchourisky, secrétaire à l’ambassade soviétique, a l’honneur de demander à M. Hans Fuchs la faveur d’un entretien.
« M. Hans Fuchs est prié de transmettre sa réponse au corps de garde, où se trouve actuellement le camarade Tchourisky. »
Cinq minutes plus tard, je me trouvai en présence de Hans Fuchs.
Quand l’huissier qui m’avait introduit près de lui fut sorti, dardant sur les miens ses yeux d’un gris d’acier, l’espion du Kaiser, avec un intraduisible sourire, me dit :
– Je savais bien, CHER MONSIEUR NOBODY, que, tôt ou tard, nous finirions par nous rencontrer.
Puis, me désignant d’un geste, un fauteuil :
– Prenez donc la peine de vous asseoir, ajouta-t-il ; nous avons, en effet, pas mal de choses à nous dire ; n’est-il pas vrai ?
D’un coup d’œil je vérifiai l’heure à ma montre puis j’allumai une cigarette, après quoi, me tournant vers Hans Fuchs, je lui répondis, tout en m’installant dans le fauteuil qu’il venait de me désigner :
– Puisque vous croyez avoir des confidences à me faire, allez-y, cher Monsieur, je vous écoute ; mais pour l’amour de Dieu, soyez bref, j’ai à peine une heure à vous accorder...
Où James Nobody met knock-out
son vieil ami Hans Fuchs.
L’attitude adoptée par moi décontenança visiblement l’espion du Kaiser.
En moins d’une minute, je venais, en effet, de lui infliger deux échecs cuisants...
Tout d’abord, en annihilant par mon flegme, l’effet de surprise sur lequel il comptait pour m’abattre du premier coup ; en lui annonçant ensuite que le temps dont je disposais étant limité, il ait à faire vite.
Comme il me regardait bouche bée, ne pouvant en croire ses oreilles, je repris :
– Ma déclaration a l’air de vous surprendre. Vous devez bien vous douter pourtant que je ne suis pas homme à venir me mettre bénévolement entre vos mains sans avoir pris, au préalable, les dispositions qui s’imposent.
Du coup, il éclata...
– Savez-vous, éructa-t-il, en assenant un violent coup de poing sur la table, que vous avez un fier toupet.
– Peuh ! fis-je, en souriant ; vous en verrez bien d’autres si, toutefois, Dieu vous prête vie...
– Vous dites ? hurla-t-il...
Je consultai de nouveau ma montre et, tranquillement, je répondis :
– Je dis que nous perdons actuellement un temps précieux. J’ajoute que c’est grand dommage car, si dans trois quarts d’heure exactement je n’ai pas rejoint les amis qui m’attendent, il pourrait vous en cuire.
– Ah ! ça ; gouailla-t-il ; vos amis se proposeraient-ils de donner l’assaut au Grand Quartier Général ?
– Je n’ai pas à vous révéler leurs projets, répondis-je ; mais vous devez savoir, – pour les avoir vus à l’œuvre, – qu’ils sont parfaitement capables de vous mettre hors d’état de nuire.
– Ce qui veut dire ?
– Ce qui veut dire que vous serez traité exactement comme je le serai moi-même. J’espère que vous comprenez ce que parler veut dire.
– Herr Gott sakrament ! s’écria-t-il, furieux ; je ne sais ce qui me retient de vous faire fusiller séance tenante !
– Je vous en défie bien ! répondis-je, sans me troubler le moins du monde. D’abord, à quel titre me feriez-vous fusiller ?
– Comment, à quel titre ? Mais comme espion, parbleu !
– Cela, il faudra le prouver.
– Mais votre nom constitue, à lui seul, la meilleure des preuves.
– Quel nom ? J’en ai plusieurs, vous savez !
Il grinça des dents...
– Je n’en connais et n’en veux connaître qu’un : JAMES NOBODY.
– J’entends bien ; mais comment prouvez-vous que je m’appelle ainsi ? Vous ne possédez, que je sache, aucune fiche anthropométrique à mon nom. Par conséquent, il vous manque mon signalement, ma photographie et mes empreintes digitales.
– Bandit !
– Ceci est une appréciation qui vous est personnelle ; donc, si vous le voulez bien, nous n’en ferons pas état. Par contre, ce dont je vous mets au défi de ne pas faire état, c’est mon passeport diplomatique.
– Je démontrerai qu’il est faux ! hurla-t-il ; je ferai venir des témoins, je...
– Donc, il y aura procès, interrompis-je ; ce qui revient à dire que vous ne pourrez pas me faire fusiller avant que les juges ne se soient prononcés sur mon cas. Or, s’il y a procès, c’est qu’il y a doute et, comme il est de règle constante en matière d’espionnage que le doute profite toujours à l’accusé, je crains fort que vous n’alliez à un échec.
– C’est ce que nous verrons ! gronda-t-il, en me jetant un coup d’œil torve...
– C’est tout vu, cher monsieur, insistai-je, et voici pourquoi :
« Votre armée, à l’heure qu’il est, est en pleine déliquescence et recule sur toute la ligne. Il est même de notoriété publique que le Kaiser, se jugeant en danger à « Charleville », songe à s’enfuir à Spa où, de toutes façons, nous saurons bien le retrouver en temps utile.
« Mieux que moi – parce que dans le secret des dieux – vous savez que, d’ici huit jours, vous serez obligés de solliciter un armistice.
« Vos plénipotentiaires sont même déjà désignés.
– Vraiment ? ricana-t-il.
– Mais oui ! Et, pour peu que vous le désiriez, je puis même vous donner leurs noms.
– Voyons ? fit-il, en pâlissant.
Je pris un temps, puis, froidement, je déclarai :
– Si je ne m’abuse, ce sont : le général von Winterfeldt, le comte Oberndorff et M. Erzberger.
De pâle qu’il était, Hans Fuchs devint livide...
– Teuffel ! s’écria-t-il ; comment savez-vous cela ?
– Peu importe, répondis-je ; l’essentiel est que je le sache.
– Cela importe beaucoup, au contraire, s’écria-t-il ; car ici, au Grand Quartier Général, nous ne sommes que deux – LE KAISER ET MOI – à connaître ce secret !
– Et comme, de toute évidence, repris-je, imperturbable, il est impossible que la « FUITE » provienne du Kaiser, il faut donc qu’elle provienne de vous.
Je crus qu’il allait étouffer...
Il dégrafa le col de son dolman, puis, se tournant vers moi, la voix rêche :
– Voilà ce qu’il faudra prouver ! s’écria-t-il ; et si vous prouvez cela, foi d’officier allemand, JE VOUS TIENS QUITTE DU RESTE.
– J’ai votre parole ? demandai-je.
– Vous l’avez pleine et entière !
Sans plus insister, je sortis de mon portefeuille la COPIE du télégramme officiel que voici :
Grosse Hauptquartier
S. M. des Königs von Preussen
D’ordre de Sa Majesté, prière de faciliter le passage des lignes à S. E. le général von Winterfeldt ; à S. E. l’ambassadeur von Oberndorff et à M. Erzberger, député au Reichstag, qui sont chargés d’une mission spéciale auprès du Grand Quartier Général interallié.
HANS FUCHS,
Premier conseiller privé
de Sa Majesté l’Empereur et Roi.
À la lecture de ce télégramme, Hans Fuchs s’effondra...
Mais, me hâtant de poursuivre l’avantage que je venais de remporter, je repris :
– Ainsi que vous le voyez, je suis renseigné de première main. JE ME DEMANDE MÊME CE QUE PENSERAIT LE KAISER, SI JE LUI COMMUNIQUAIS L’ORIGINAL DE CE TÉLÉGRAMME ?

LE KAISER ET LES GRANDS CHEFS DE SON ARMÉE DEVANT LE G. Q. G. ALLEMAND.
– Vous possédez donc cet original ? haleta Hans Fuchs.
– C’est-à-dire, qu’il est entre les mains des amis dont je vous parlais tout à l’heure, répondis-je.
– Il n’y a pas à dire, s’exclama Hans Fuchs, vous me tenez...
– Ce qui revient à dire, spécifiai-je, en souriant, que vous, vous ne me tenez plus.
– Hélas !
– Tranquillisez-vous, lui dis-je, je n’ai pas pour habitude de frapper un ennemi à terre. Il me suffit de l’avoir vaincu. Dès ce soir, vous recevrez l’original de votre télégramme.
– Vous feriez cela, s’écria-t-il.
– Certes, mais à une condition.
– Laquelle ?
– C’est que, désormais, vous vous désintéressiez totalement des faits et gestes du citoyen Tchourisky.
Il s’absorba quelques minutes en lui-même puis, se tournant vers moi :
– Soit, concéda-t-il, mais il demeure entendu que ce soir même, vous me ferez tenir l’original de mon télégramme.
– Dont vous me permettrez bien, ripostai-je du tac au tac, de conserver par devers moi, – ON NE SAIT JAMAIS CE QUI PEUT ARRIVER, – quelques reproductions photographiques.
Définitivement vaincu, il ne discuta pas plus avant.
Se levant, il s’inclina sèchement puis, d’un ton qu’il s’efforça de rendre aimable, il me déclara :
– Citoyen Tchourisky, je ne vous retiens pas.
Ce à quoi, non moins aimablement, je répondis :
– Et bien vous faites...
Il n’en demeure pas moins que si ses yeux avaient été des pistolets, il m’aurait été impossible d’écrire la suite de cette très véridique histoire...
Et pour cause...
Où James Nobody s’aperçoit
que les évènements se précipitent.
Il est à peine besoin d’indiquer que si, en apparence, j’avais admirablement « tenu le coup », au cours de cette entrevue mouvementée, en réalité, je n’avais plus un poil de sec quand je sortis du cabinet de l’espion du Kaiser.
S’il était abattu moralement, je l’étais physiquement.
Ce n’est pas impunément, en effet, qu’on brave pendant une heure entière la colère – poussée au paroxysme – d’un homme aussi violent que Hans Fuchs.
Bien que le sachant impulsif au plus haut degré, partant, capable des plus terribles réactions, c’est d’un pas calme et mesuré que je quittai le Grand Quartier Général allemand.
Sentinelle vigilante, le comte de Nys m’attendait en faisant les cent pas le long du square de la gare.
Je traversai la chaussée et, toujours du même pas, je me dirigeai vers lui, de manière à le croiser.
Quand je fus arrivé à sa hauteur, je pris une cigarette dans mon étui et, m’approchant de lui, je lui demandai du feu, après l’avoir correctement salué.
Tout en approchant ma cigarette de la sienne, le lui dis tout bas :
– Attention ! Hans Fuchs sait que je suis James Nobody. J’ai eu les plus grandes difficultés à me sortir de ses griffes. Il est probable que je vais être « filé » par lui, ou par l’un de ses hommes. Tâchez de vous mettre en travers, et de rompre la filature pendant deux ou trois minutes, afin que je puisse disparaître. Je pars immédiatement pour Berlin ; venez m’y rejoindre à l’endroit convenu.
– Compris, me répondit le comte de Nys qui, au moment où je le quittai pour remonter l’avenue de la gare, ajouta précipitamment :
– Partez vite ! Voici Hans Fuchs camouflé en femme ! Il vient vers nous ! Je me porte à sa rencontre afin de l’arrêter ! Bonne chance !
Le comte de Nys et moi échangeâmes un nouveau coup de chapeau puis, paisiblement, je poursuivis ma route comme si de rien n’était.
Hans Fuchs qui, de l’autre côté de la chaussée, nous avait regardé d’un air soupçonneux, se dirigea vers le comte de Nys qu’il interpella.
Le colloque ne tarda pas à dégénérer en discussion...
Machinalement, je m’arrêtai...
Ce qui se passa ensuite eut la rapidité de l’éclair...
Je vis le comte de Nys sortir de sa poche son browning ; après quoi, le braquant sur Hans Fuchs, il tira...
Atteint en pleine figure, l’espion du Kaiser s’écroula comme une masse.
Sautant alors dans une superbe limousine timbrée aux armes de la Cour, que son propriétaire avait abandonnée au bord du trottoir, le comte de Nys la mit en marche et se dirigea vers moi.
Quand il arriva à ma hauteur, d’un bond je sautai dans l’auto et, aussitôt, nous démarrâmes en quatrième vitesse.
Là-bas, derrière nous, c’était l’affolement le plus complet.
Je vis courir des gens, des soldats surtout, vers l’endroit où gisait Hans Fuchs ; mais, chose curieuse ; nul ne semblait songer à nous poursuivre...
– Que fait-on ? me demanda brièvement le comte de Nys.
– Point de direction : la Grande Taverne, lui répondis-je ; il y a deux issues...
– Compris, fit-il, et la voiture ?

LE PRINCE HENRI DE PRUSSE, GRAND AMIRAL,
PRÊCHANT LE CALME AUX ÉQUIPAGES DE KIEL.
– Nous l’abandonnerons devant la porte principale.
– Parfait
Cinq minutes plus tard, nous arrivâmes à la Grande Taverne. Nous entrâmes et, après avoir traversé la salle dans toute sa longueur, nous sortîmes par la porte de derrière.
Puis, posément, l’un suivant l’autre, nous nous rendîmes au no 1 de la place Carnot, où nous étions assurés de trouver un refuge d’autant plus inaccessible que l’immeuble tout entier était occupé par les divers services du ministère de la Marine allemand.
Nous nous terrâmes là pendant quatre jours, assistant de loin aux recherches entreprises pour nous retrouver.
Elles devaient demeurer vaines...
Von Glauber qui, automatiquement, avait succédé à Hans Fuchs, n’épargna pourtant ni son temps, ni sa peine. Mais ne sachant pas exactement à qui attribuer l’attentat commis contre l’espion du Kaiser, ignorant les incidents qui avaient immédiatement précédé cet attentat, il lui était impossible de donner à son enquête l’orientation voulue.
Il en résulta que, si de nombreux suspects furent arrêtés, on dut les relâcher les uns après les autres, les alibis fournis par eux ayant été reconnus exacts.
Puis, tout ce bruit se calma...
La situation, en effet, s’était aggravée à un tel point sur le front que les Allemands avaient mieux à faire qu’à s’occuper de nous.
En Flandre, le roi Albert, après avoir attaqué le 14 octobre, était entré à Thourout et à Courtrai le 16. Ostende était prise le 17 et Bruges le 19. Le 17 également Degoutte, après avoir enlevé le plateau de Tielt, s’emparait de Lille et de Douai.
Cependant, Douglas Haig et Debeney, attaquant à fond, plus au sud, bousculaient l’ennemi sur la Selle, la Rhouelle, l’Écaillon, le contraignant à évacuer la forêt d’Andigny. Le 2 novembre, Valenciennes tombait entre leurs mains.
Le 4 novembre, nos troupes enlevaient le canal de la Sambre à l’Aisne et la forêt de Mormal.
À cette même date, les armées allemandes, vaincues usées, démoralisées, ayant perdu depuis le 15 juillet 370.000 prisonniers, 6.500 canons et 50.000 mitrailleuses, battaient en retraite sur tout l’ensemble du front.
Affolé, Ludendorff avait abandonné son commandement le 26 octobre.
Quant au Kaiser, il s’était réfugié à Spa...
Tout d’abord, nous avions songé à l’y suivre. Mais, réflexion faite, et après nous être mis d’accord avec Naldony, nous décidâmes de partir pour Berlin où, déjà, grondait l’émeute.
En effet, tandis que nous agissions à Charleville, Naldony, de son côté, n’était pas demeuré inactif.
Dès le lendemain de la mort de Hans Fuchs, il s’était rendu à Berlin et il était entré en rapports avec les chefs de la Social-démocratie allemande, notamment avec Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, dont les tendances étaient nettement bolchevistes.
Fort bien accueilli par eux et par leurs amis, ils avaient établi de concert un programme de revendications qui pouvait s’énoncer ainsi :
1o Abdication du Kaiser ;
2o Proclamation de la République ;
3o Armistice ;
4o Amnistie ;
5o Signature de la paix ;
6o Droit électoral pour tous.
Grâce à l’aide fournie par les révolutionnaires russes arrivés en grand nombre à Berlin et qui, tous, obéissaient au doigt et à l’œil à Naldony, nous pûmes nous convaincre, dès que nous eûmes pris contact avec ce dernier, que les ordres de Sir Arthur Birdwell étaient en voie d’exécution et que la révolution était à moitié faite.
L’aspect de la rue, d’ailleurs, était terrifiant...
Précédées d’automitrailleuses, des bandes de soldats et de matelots ivres, qu’escortaient des hommes et des femmes appartenant visiblement à la lie du peuple, défilaient derrière des drapeaux rouges, au chant de « l’Internationale ».
Maltraités et faits prisonniers par leurs hommes, les officiers, auxquels on avait arraché les insignes de leurs grades et leurs décorations, étaient contraints de suivre le mouvement.
Ceux qui avaient pu s’échapper se terraient...
Çà et là, dans la nuit, des immeubles flambaient, autour desquels les révoltés en liesse effectuaient des rondes échevelées.
Et, sans cesse, comme un leitmotiv, revenait ce cri : À BAS LE KAISER ! auquel immédiatement répondait cet autre : VIVE LA RÉVOLUTION.
Quand nous rentrâmes, quelque peu écœurés par ce spectacle, à l’hôtel où nous étions descendus, se penchant vers moi, le comte de Nys, résuma ainsi ses impressions :
– Je crois, cher ami, que l’affaire est dans le sac.
– Certes, répondis-je, mais à une condition...
– Laquelle ?
– C’est que Naldony et ses amis n’aillent pas trop loin car, en cela comme en tout, le mieux est l’ennemi du bien...
Où James Nobody se rend compte
qu’il est plus facile d’allumer un incendie
que de l’éteindre.
De toute évidence, en effet, dans l’esprit de mes chefs, la révolution allemande apparaissait comme un MOYEN et non comme un BUT.
Qu’on se servît de la révolution pour abattre le militarisme allemand, rien de plus normal, PUISQUE C’EST DE CETTE FAÇON QUE L’ALLEMAGNE AVAIT PROVOQUÉ L’EFFONDREMENT DU FRONT RUSSE ; mais que sur les ruines de ce militarisme on laissât s’édifier un État bolchevisé à l’extrême, voilà ce que nul, en Angleterre, n’eût voulu admettre.
Il eût fallu être fou à lier pour souhaiter voir s’installer au centre de l’Europe, et qui plus est, à proximité de nos frontières, un nouveau foyer d’anarchie.
C’est ce que je m’efforçai d’expliquer le lendemain à Naldony, que je trouvai en train d’expédier des ordres aux différents centres d’action révolutionnaire.
– Diable ! fit-il, soucieux, c’est qu’on n’arrête pas un mouvement de cette envergure en soufflant dessus.
– C’est pourquoi je vous recommande d’être excessivement prudent. Il y a une limite que nous ne saurions dépasser...
Tandis que nous discourions de la sorte, sur sa table s’accumulaient lettres, rapports et télégrammes.
– C’est alors que je pus admirer – ce qui est, évidemment, une façon de parler – les résultats de la technique révolutionnaire.
Pour si déséquilibrés qu’ils fussent, les gens qui composaient l’état-major de Naldony n’en connaissaient pas moins à fond la tactique à employer pour bouleverser, de fond en comble, les institutions d’un pays.
Et chacun d’eux avait sa spécialité...
Les uns s’occupaient de l’armée, – si tant est qu’on put encore donner ce nom aux bandes sans cohésion, composées de déserteurs ou de fuyards qui hier encore étaient des soldats, mais qui, aujourd’hui, n’étaient plus que des brutes avinées.
Les autres s’intéressaient plus spécialement à la marine.
Ces derniers me parurent les plus redoutables, parce que techniciens, et techniciens avertis.
Leur ayant été présenté par Naldony, ils m’accueillirent avec empressement ; ce qui me permit de les observer à mon aise.
Déjà, ils avaient envoyé sur le littoral de nombreux émissaires, – germano-baltes pour la plupart, – qu’ils avaient chargé de « travailler » les équipages de la flotte.
Et ce « travail », ils l’avaient accompli avec un tel zèle, avec une si magistrale aisance, que dans tous les ports sans exception, s’étaient produites des mutineries d’une réelle gravité.
Puis, aux mutineries avait succédé la révolte ; tant et si bien que depuis la veille, – nous étions au 4 novembre, – la plupart des unités de l’escadre avaient arboré le drapeau rouge, après avoir « balancé par-dessus bord », quelques-uns de leurs officiers.
Poussant plus loin mon enquête, je parvins à savoir comment ils avaient obtenu un si mirifique résultat.

MANIFESTATIONS D’OUVRIERS PENDANT LA RÉVOLUTION.
Tout d’abord, ils avaient annoncé aux marins allemands qu’une révolution bolchevique venait d’éclater en Angleterre, au cours de laquelle le roi George et ses ministres avaient été massacrés.
Après quoi, ils leur certifièrent que l’escadre anglaise s’était révoltée, avait arboré l’emblème des soviets et s’apprêtait à fraterniser avec l’escadre allemande.
Enthousiasmés, les marins allemands n’avaient pas voulu faire moins que leurs camarades britanniques et, sans même prendre la peine de contrôler ces nouvelles, avaient marché à fond.
Et, maintenant, les télégrammes se succédaient.
Kiel était en pleine révolte.
Lubeck, Flensburg, Cuxhaven, Schwerin, Hambourg et Brunsbüttel suivaient le mouvement.
Partout, qu’ils fussent à bord ou à terre, les officiers étaient traqués, brutalisés et privés de leurs insignes.
Affolé, le chancelier d’Empire, prince Max de Bade, conseillé en cela par des socialistes faisant partie de son cabinet, avait tenté d’endiguer la révolte. Sentant qu’il convenait de jeter du lest, il avait envoyé à Kiel, avec pleins pouvoirs, le socialiste Noske, auquel il avait adjoint le secrétaire d’État Haussmann.
Dès son arrivée, Noske « débarqua » l’amiral Souchon et prit le commandement de la base navale de Kiel, ce qui eut pour premier résultat de calmer les esprits.
Mais, poussés par les émissaires soviétiques qui manœuvraient dans la coulisse, les Comités de matelots ne lui donnèrent pas le temps d’agir et formulèrent des revendications que seul un phénomène dans le genre de Lénine eût pu accepter.
Il convient toutefois de noter que, parmi ces revendications, figurait en bonne place L’ABDICATION DU KAISER.
Or, tandis que le gouvernement délibérait pour examiner la suite à donner à ces revendications, nous apprîmes coup sur coup que, à Cuxhaven, les sous-marins avaient refusé de sortir et que, à Wilhelmshaven, on ne savait pas ce qu’était devenue la troisième escadre.
Ainsi qu’on le voit, la situation s’aggravait d’heure en heure et son « processus » s’avérait identique à celui qu’avait suivi la révolution russe.
Et cette situation avait ceci de tragique pour les Allemands, que l’Entente qui déjà avait refusé les offres de paix du Kaiser avec lequel, – LE JUGEANT DISQUALIFIÉ, – elle n’avait pas voulu discuter, refuserait bien plus encore de discuter avec les représentants de la Révolution.
Or, l’encerclement des armées allemandes s’avérant proche, c’était donc un nouvel Iéna qui se préparait pour l’Allemagne.
Foch, en effet, sans se laisser détourner de sa tâche par les bruits plus ou moins précis qui lui parvenaient d’outre-Rhin, s’obstinait à taper comme un sourd sur ce qui restait de l’armée « fraîche et joyeuse ».
Aux dernières nouvelles, ses troupes venaient de s’emparer de Sedan, Rethel, Maubeuge et Tournai, et déjà, en Lorraine, se préparait la dernière bataille, celle où – SI ELLE AVAIT EU LIEU – eut été définitivement écrasé le militarisme prussien...
Les choses en étaient là quand le comte de Nys, qui m’avait quitté « pour aller voir, avait-il précisé, ce qui se passait à Spa », me téléphona d’aller le rejoindre, toute affaire cessante.
Connaissant l’homme et le sachant parfaitement incapable de me déranger inutilement, je partis aussitôt... non sans m’être muni de deux sauf-conduits, l’un émanant du gouvernement régulier, l’autre contresigné par Radke, l’un des chefs les plus en vue du mouvement révolutionnaire.
Il en résulta que mon voyage s’effectua sans le moindre incident car, aux troupes restées fidèles, je montrais le sauf-conduit gouvernemental ; tandis qu’aux autres, j’exhibais mon second sauf-conduit.
C’est là une façon de voyager que je ne saurais trop recommander aux gens se trouvant dans mon cas.
Elle est de tout repos...
Pour avoir négligé d’employer ce subterfuge, le général Groener 16, quartier-maître général et successeur de Ludendorff qui, comme moi, se rendait à Spa, et dont la voiture précédait la mienne, eut tous les ennuis possibles...
Le comte de Nys m’accueillit avec un large sourire.
– Vous arrivez à temps, me dit-il, pour assister au dernier acte du drame.
– Que se passe-t-il donc ? lui demandai-je.
– Le Kaiser va abdiquer, me répondit-il, ce n’est plus qu’une question d’heures...
– Vous en êtes sûr ? m’exclamai-je.
– Oh ! l’opération ne se fera pas sans douleur, fit-il en riant ; mais soyez assuré de ceci : D’UNE FAÇON OU D’UNE AUTRE, IL DISPARAÎTRA.
– Que voulez-vous dire ? demandai-je.
Après avoir jeté autour de lui un coup d’œil, afin de voir si personne n’était à portée de l’entendre, il se pencha vers moi et, tout bas, il me dit :
– C’est bien simple ; S’IL N’ABDIQUE PAS, JE L’ENLÈVE.
Où James Nobody fait commerce d’amitié
avec les loups, et apprend la fin d’un rapace.
Venant d’un autre, cette déclaration m’eût fait sourire, l’idée d’enlever Guillaume II au milieu de son état-major et de sa garde n’ayant pu germer que dans la tête d’un fou.
Mais le comte de Nys avait accompli tant d’actes audacieux, il avait toujours fait preuve d’un tel « cran » que force me fut bien de le prendre au sérieux.
Je ne pus, toutefois, dissimuler ma surprise...
– Jugeriez-vous donc mon projet irréalisable et cet enlèvement impossible ? me demanda-t-il, vaguement inquiet...
– Impossible, non ; lui répondis-je car, en principe, rien n’est impossible à qui sait vouloir ; mais je le crois difficilement réalisable ; le Kaiser, – étant donnée la période de tension actuelle, – devant se tenir strictement sur ses gardes.
– Qu’il se tienne ou non sur ses gardes, gronda le comte de Nys, je puis vous assurer que s’il n’abdique pas, il ne fera pas de vieux os !
Et, mezza voce, il précisa :
– Si, contrairement à ce que nous espérons, il manifestait l’intention de se cramponner à son trône ; s’il hésitait à comprendre que son peuple lui-même le vomit ; je ne donnerais pas un rouge liard de sa peau ; certains de mes hommes ayant fait le serment de le saigner comme un porc, si jamais il venait à tomber entre leurs mains...
Ses hommes ?
À qui faisait-il allusion ?
Et quel était donc ce nouveau mystère ?
Je n’allais pas tarder à être fixé...
S’étant placé au volant de mon automobile, –une superbe limousine « empruntée » à mon intention par Naldony au parc de l’État-major de la place de Berlin, – le comte de Nys m’invita à prendre place à son côté, après quoi il me dit :
– Comme je présume que vous ne connaissez ni Spa, ni ses environs, je vais, si vous le voulez bien, et afin d’éviter toute perte de temps, vous piloter jusque chez moi...
– Résideriez-vous donc dans la région, lui demandai-je, surpris...
– Mais oui, répondit-il, en appuyant sur l’accélérateur ; ma maison familiale se trouve à quelques kilomètres d’ici, entre Spa et la frontière rhénane. Nous y serons en quelques minutes.
Ce que le comte de Nys appelait modestement sa « maison familiale » était, en réalité, un château de fort belle apparence, construit dans le goût du XIIIe siècle français et qu’entourait un vaste domaine.
Une large avenue, qu’ombrageaient des arbres séculaires, donnait accès dans la cour d’honneur du château, lequel, – extérieurement tout au moins, – ne semblait nullement avoir souffert de l’occupation allemande...
Après avoir effectué un savant virage autour des pelouses, le comte de Nys arrêta la voiture au pied d’un superbe escalier à double révolution, sur les marches duquel étaient accourus pour nous recevoir plusieurs domestiques âgés, – les autres étant au front...
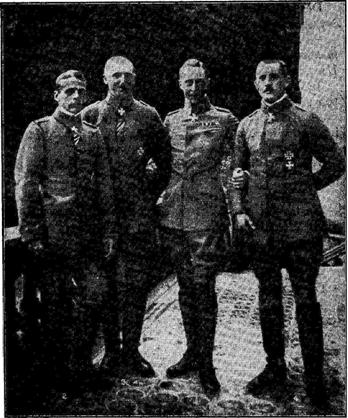
LE VAINCU DE VERDUN
Le prince héritier et des officiers de son état-major.
Dès que nous eûmes mis pied à terre, le comte de Nys, un bon sourire au coin des lèvres, me déclara :
– Mon cher Nobody, vous êtes ici chez vous. Je mets ma demeure et mes biens à votre entière disposition. Usez-en à votre convenance.
Je voulus le remercier, mais il ne m’en laissa pas le temps...
– Après ce que vous avez fait pour mon pays, interrompit-il, c’est bien le moins que je puisse faire. Tenez-nous, les miens et moi, pour vos obligés.
Tandis qu’il parlait de la sorte, la cour s’était peuplée...
De robustes gaillards, au masque viril, à l’air résolu, on les eût cru jaillis du sol, tellement leur arrivée avait été silencieuse, – étaient venus se ranger en demi-cercle autour de nous.
D’un geste large, il me les présenta :
– La « BRIGADE DES LOUPS » ! fit-il...
Du coup, je tressaillis...
Je n’étais pas, en effet, sans avoir entendu exalter les hauts faits de ces hardis partisans, lesquels, grands blessés de guerre pour la plupart, ET RÉFORMÉS COMME TELS, n’en avaient pas moins constitué un corps franc, – pour servir toujours et quand même, – et qui faisaient aux Boches une guerre au couteau 17.
La « Brigade des loups » !
D’un coup d’œil circulaire, je passai en revue les cinquante hommes dont elle se composait.
Alors, JE ME DÉCOUVRIS...
Je me découvris, parce qu’il n’était pas un seul de ces hommes qui ne portât le stigmate de quelque glorieuse blessure.
CE N’ÉTAIENT QUE « GUEULES CASSÉES », CRANES PERFORÉS ET TRÉPANÉS, MEMBRES MUTILÉS.
Mais dans leur attitude, quelle énergie ; et quelle flamme dans leurs yeux !
Soudain, un détail me revint l’esprit, puis se précisa...
Non seulement on attribuait aux « LOUPS » une commune origine ethnique, mais on allait jusqu’à prétendre qu’ils appartenaient tous, peu ou prou, à la même famille.
Sur eux, alors, j’appuyai mon regard, et je me rendis compte qu’entre eux il existait, en effet, une ressemblance que ne suffisait pas à expliquer leur évidente communauté d’origine, mais qui s’accusait d’autant plus que tous portaient un uniforme identique...
On les eût dits coulés dans le même moule...
Déconcerté, je me tournai vers le comte de lys, pour lui demander l’explication de ce nouveau mystère ; mais, me désignant du doigt, et s’adressant à eux cette fois, il reprit :
– Tous autant que vous êtes, camarades, vous avez contribué pour une large part au succès de nos armes, soit en traquant dans les fourrés du Hertogenwald les émissaires de l’ennemi ; soit en luttant dans les marécages de la Fagne contre nos irréductibles adversaires ; mais, – écoutez bien ceci, – eussiez-vous manifesté cent fois plus d’héroïsme et abattu cent fois plus d’ennemis, que vous n’auriez pas encore réalisé la millième partie des exploits dont, avec une légitime fierté, peut s’enorgueillir l’homme que voici !
Et, plaçant sa main sur mon épaule :
– Camarades ! ajouta-t-il, je vous présente James Nobody, que je considère comme mon maître, et dont je m’honore d’être l’ami.
Les loups, les yeux fixés sur le comte de Nys, l’avaient écouté avec attention.
Alors, mais alors seulement, ils me rendirent mon salut.
Je compris que c’était là un geste dont ils ne devaient se montrer prodigues qu’à bon escient...
Quoi qu’il en soit, je m’apprêtais à protester contre cet éloge qui, pour avoir été décoché à brûle-pourpoint, n’en était pas moins trop dithyrambique à mon gré, quand, au loin, le ronflement d’un moteur nous annonça qu’une visite nous arrivait.
Quelques instants plus tard, en effet, nous aperçûmes un motocycliste qui, après s’être engagé dans l’avenue, venait vers nous à toute allure...
Déjà, le comte de Nys, dont la vue était perçante, l’avait reconnu.
– Diable ! fit-il, pour que le baron de Marchiennes se soit dérangé en personne, il faut que la nouvelle qu’il nous apporte soit d’importance.
– Puisse-t-elle être conforme à nos désirs, répondis-je.
Mon vœu devait être exaucé...
En effet, à peine eut-il mis pied à terre, que d’une voix retentissante, le baron de Marchiennes s’écria :
– Vive la Belgique ! mes amis ; LE KAISER VIENT D’ABDIQUER !
Conclusion.
C’est avec une joie profonde que j’appris cette nouvelle.
Ainsi s’écroulait dans la boue et dans le sang, l’être malfaisant qui, afin de réaliser son rêve d’hégémonie mondiale, n’avait pas hésité à déchaîner cet horrible fléau : la guerre.
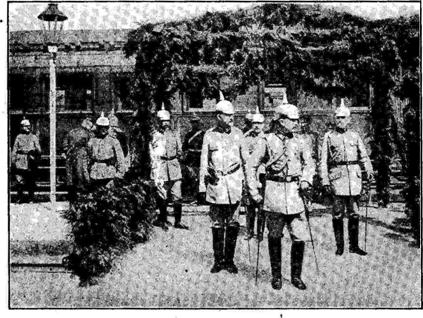
LA FUITE DU KAISER
DE PAR SA VOLONTÉ, pendant cinq années consécutives, l’Europe fut mise à feu et à sang ;
DE PAR SA VOLONTÉ, dix millions d’hommes sont tombés, qui dorment leur dernier sommeil dans les cimetières du front ;
DE PAR SA VOLONTÉ, d’inestimables trésors d’art ont été anéantis ;
DE PAR SA VOLONTÉ, des milliers de navires ont été coulés, dont les équipages ont disparu « sans laisser de traces » ;
DE PAR SA VOLONTÉ, des villes ont été détruites de fond en comble ;
DE PAR SA VOLONTÉ, les victimes de la guerre : mutilés, veuves, orphelins, se comptent par millions ;
DE PAR SA VOLONTÉ, le bolchevisme est né ;
DE PAR SA VOLONTÉ, enfin, la plus effroyable des crises économiques sévit depuis dix ans...
ET CET HOMME N’A PAS ÉTÉ PUNI !
Soit !
Mais, se repent-il, du moins, du mal qu’il a fait ?
Cherche-t-il, dans une mesure quelconque, à réparer ses fautes ?
Pour tout dire : CONNAÎT-IL LE REMORDS ?
Point !
Car voici ce qu’a osé cet homme qui, après avoir abdiqué, a déserté son poste et, – SUPRÊME IGNOMINIE ! – s’est enfui à l’étranger.
Aux anciens combattants allemands, – c’est-à-dire, à ceux-là même qu’il a abandonnés à l’heure de la défaite, les laissant aux prises avec les pires difficultés, – il a imposé cette devise, qu’ils ont inscrite en lettres d’or sur leurs drapeaux :
« IM FELD UND ZUR SEE, UNBESIEGT ! »
Ce qui, en bon français, se peut traduire ainsi :
« JAMAIS VAINCUS, NI SUR TERRE NI SUR MER ! »
Donc, à l’en croire, l’Allemagne n’a pas été vaincue !
Pourquoi, dès lors, ne recommencerait-elle pas, afin de « PARACHEVER SA VICTOIRE » ?
Connaissez-vous dilemme plus angoissant que celui-là ?
Et de quel état d’esprit procède-t-il ?
Je vais vous le dire ; car, comme bien on pense, la question étant ainsi posée, j’ai voulu la résoudre.
Mon enquête m’a conduit à Doorn.
Après avoir franchi les grilles de la somptueuse résidence où vit, pense et agit le Kaiser, je me suis efforcé de savoir à quoi il occupait ses loisirs.
Pendant de longs mois, je l’ai suivi pas à pas, ne le quittant pas plus que son ombre.
J’ai scruté ses pensées ; J’AI ANALYSÉ SES TRAVAUX ; J’AI OBSERVÉ SES MOINDRES GESTES.
Et j’en suis arrivé à cette conviction que le « SEIGNEUR DE LA GUERRE » n’avait pas encore dit son dernier mot...
Or ce mot, – LE MOT DE L’ÉNIGME VIVANTE QU’EST LE KAISER, – je l’ai deviné.
Peut-être, un jour venant, vous le révélerai-je...
Note de l’Auteur
Au moment même où j’achevais la correction des épreuves de ce livre, j’ai reçu d’Allemagne des nouvelles tellement troublantes que j’ai décidé d’aller faire personnellement une enquête outre-Rhin.
Si ce que l’on m’a révélé est exact, je ne manquerai pas de vous en faire part, mes chers Lecteurs, en un livre qui vous renseignera aussi exactement que possible sur ce qui se passe là-bas.
Ch. LUCIETO.